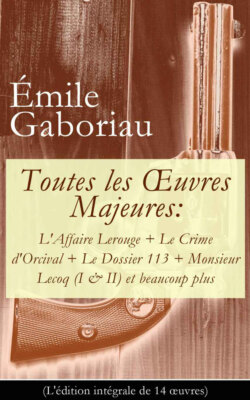Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III LES AMOURS DE FRANÇOIS IerLE ROI CHEVALIER
ОглавлениеTable des matières
Dans la nuit du 1er janvier 1515, à l'heure même où commençait l'année, le bon roi Louis XII rendait le dernier soupir, à l'hôtel des Tournelles, non loin de la porte Saint-Antoine.
Louis XII, toute sa vie, s'était montré digne de ce glorieux surnom de père du peuple qui lui avait été décerné. Bien supérieur à tous les souverains de son temps, il fut bon sans faiblesse, et juste sans rigueur. La prospérité publique fut son unique mobile et avant tout il s'inquiéta du bonheur de ses peuples.
—Un bon berger ne saurait trop engraisser son troupeau, disait-il souvent.
Il disait encore:
—J'aime mieux voir rire mes courtisans de mes épargnes que de voir pleurer mon peuple de mes dépenses.
Le plus cruel souci des dernières années du vieux monarque avait été de laisser aux mains de François d'Angoulême, prince ami du faste et de l'éclat, ce peuple qui lui était si cher et au milieu duquel il aimait à se promener familièrement, monté sur une petite mule.
La France tout entière, que ne désolaient plus les guerres, que ne ruinaient plus les impôts excessifs, bénissait alors le nom du roi. La capitale était enfin calme et paisible, et l'on avait pu, pour le blason de la «bonne ville,» faire l'acrostiche suivant:
P aisible domaine, A moureux vergier, R epos sans dangier, I ustice certaine, S cience haultaine. C'est Paris entier.
—Las! répétait souvent Louis XII à ses conseillers, en hochant tristement la tête et en montrant le duc d'Angoulême, vainement nous besognons pour le bien du pays, voilà un gros gas qui gâtera tout cela.
Les tristes prévisions du père du peuple ne tardèrent pas à se réaliser.
Donc, avec la nouvelle année 1515, commença un nouveau règne. Au matin du premier janvier, les courtisans, en guise de souhaits de bonne année, vinrent saluer François d'Angoulême du nom de roi de France.
François Ier succédait à Louis XII.
L'histoire a toujours traité François Ier en véritable enfant gâté. Mort, on a continué à le louer comme on l'avait loué vivant, et il a conservé, malgré tout, les titres de roi-chevalier et de restaurateur des lettres et des arts.
La vérité est que François ne fut remarquable que par son goût déréglé pour le faste, pour les fêtes, pour les cérémonies. Il se croyait magnifique et n'était que follement dissipateur. Il fit tout pour son orgueil et ses plaisirs, et rien pour la France, jetant au vent de toutes ses fantaisies des sommes considérables, au moment même où ses généraux se faisaient battre, faute d'argent pour payer les soldats.
Il n'eut même pas l'habileté vulgaire de faire tourner tout son faste au profit de ses projets. A-t-il, par exemple, une entrevue avec Henri VIII, roi d'Angleterre, il lui faudra épuiser le trésor royal pour subvenir aux magnificences du champ du drap d'or, et il se retirera sans avoir fait autre chose qu'essayer sa force musculaire avec le robuste monarque Anglais.
A suivre l'exemple du roi, la noblesse se ruinait: «Plusieurs portaient alors sur leur dos leurs moulins, leurs forêts et leurs prés.» Mais on comptait sur la générosité du maître.
Les impôts, on doit le comprendre, avaient été considérablement augmentés, et si, comme le dit l'auteur des Mémoires du chevalier Bayard, «oncques n'avait esté veu roi de France de qui la noblesse s'esjouit tant,» les provinces accablées murmuraient hautement. La raillerie et la chanson, alors comme toujours depuis, étaient les seules armes des opprimés; ils s'en servaient.
Pour combler le déficit creusé par les dépenses du mariage de Jeanne d'Albret, nièce du roi, avec le duc de Clèves, il fallut établir la gabelle sur le sel dans plusieurs provinces du midi; le peuple appelait ces noces somptueuses des noces trop salées.
Faible, indécis, changeant, trop présomptueux pour se l'avouer à lui-même, François Ier ne fut qu'un jouet aux mains de ceux qui l'entouraient. Pantin magnifique, dont tour à tour tenaient les fils: ses ministres, dont deux au moins furent des misérables; sa mère, ambitieuse passionnée; enfin toutes ses maîtresses, dirigées elles-mêmes par leur famille ou leurs amants, car il fut trahi, en amour comme en politique, sans jamais s'en apercevoir.
Amoureux de combats, de belles troupes, de gens de guerre, de grands coups de lance ou d'épée, il n'eut jamais que le courage brillant, mais alors si commun, d'un chevalier mourant les armes à la main; il pouvait passer à deux cents pas de l'ennemi, «vingt heures, armet en tête et le cul sur la selle,» comme il l'écrivait à sa mère, mais il était incapable de diriger une bataille. Il réussit presque toujours à se faire battre et finit par tomber aux mains de l'ennemi.
Il eut recours, pour quitter la prison où le retenait Charles-Quint, à des promesses bien jésuitiques pour un roi-chevalier. Il faisait grande parade de sa foi de gentilhomme, et ne garda pas toujours scrupuleusement sa parole, sauf peut-être dans les circonstances où il eût été «politique» de la violer.
Le plus beau titre de François Ier à l'admiration et à la reconnaissance est donc celui de Restaurateur des lettres et des arts. Malheureusement il se trouve qu'il a plutôt entravé qu'aidé le mouvement des lumières. Il protégea, il est vrai, quelques artistes étrangers et quelques poëtes, ses adulateurs; mais, tandis que, tour à tour, et au gré de la maîtresse régnante, Sébastien Serlio, Le Rosso, Benvenuto Cellini et bien d'autres, trouvaient à la cour une magnifique hospitalité qu'ils payaient en chefs-d'oeuvre, on essayait de supprimer l'imprimerie, sans doute dans le but de restaurer les lettres manuscrites, et on établissait la censure.
Le successeur de Louis XII prétendit être tout à la fois religieux et tolérant; il ne fut ni l'un ni l'autre. Ses convictions cependant ne devaient pas le gêner. Il avait accepté les principes de la religion réformée, et pourtant il obéissait à tous les ordres de la Cour de Rome.
Il donna l'exemple de l'horrible persécution contre les luthériens, qui, pendant trente-sept années consécutives, fit périr tant de braves gens, de sujets dévoués; il alluma les premiers bûchers qui devaient dévorer tant de victimes. Enfin il persécuta ou laissa persécuter par le Parlement ou la Sorbonne des savants que lui-même avait attirés à Paris, et laissa condamner et exécuter plusieurs professeurs, Étienne Dolet entre autres, que l'on disait, fort à tort probablement, être son propre fils.
En un mot, le restaurateur des lettres et des arts passa sa vie à éteindre d'une main, les lumières qu'il allumait de l'autre.
L'avénement de François Ier fut le signal d'un changement complet dans les moeurs de la Cour de France. Le sombre caractère de Louis XI, la simplicité bourgeoise de Louis XII ne se prêtaient guère à la représentation: «Lors on ne voyait, aux résidences royales que ceux qui y avaient affaire, commandants de troupes, magistrats ou hommes d'État. Il n'était point aisé alors, d'approcher la personne royale,» le souverain passait sa vie dans une retraite pleine de majesté, «et la noblesse même était arrière.»
Le successeur de Louis XII, brillant, léger, fastueux, dissolu, entreprit de façonner son entourage à son caractère. Il réussit facilement.
Il avait le coeur héroïque, dans l'acception niaise du mot, et l'esprit fort rempli de toutes les ridicules fadaises des romans de chevalerie; tous ceux qui l'approchaient n'aspirèrent plus qu'à atteindre les rares et sublimes perfections d'Amadis. On ne rêvait alors que fêtes et tournois, joutes et passes d'armes.
Le roi voulait avant tout une cour nombreuse: à sa voix accoururent de toutes les provinces les représentants des grandes familles: les demeures féodales ne furent plus habitées que par les hiboux et quelques vieux mécontents, représentants grondeurs d'un passé oublié.
A côté de la noblesse, se pressait la troupe des aventuriers. Point n'était besoin, alors, de faire ses preuves pour être admis à l'honneur des fêtes royales. Une belle prestance, un riche ajustement, une longue rapière, suffisaient. On avait deux cents écus par an et le titre de gentilhomme du roi.
Mais une cour sans femmes, c'est une année sans printemps, un printemps sans roses. Il fallait une dame et souveraine de la pensée à chacun de ces émules d'Amadis, une maîtresse dont il pût porter les couleurs. Que serait un tournoi pour les chevaliers qui se préparent à «bien faire dans la lice,» sans beaux yeux pour les encourager, sans petites mains pour les applaudir?
François Ier voulut avoir autour de lui les filles des plus nobles maisons de France: les pères durent amener leurs filles, les maris leurs femmes, les frères leurs soeurs. De sorte que jamais on n'avait vu troupe si brillante et si bien ajustée de dames de familles nobles et de damoiselles de réputation.
Il y a loin de ces «assemblées honnêtes», aux sujettes du roi des Ribauds, qu'avant cette époque traînaient à leur suite les rois de France.
Brantôme, pour sa part, félicite fort François Ier d'avoir «institué sa belle cour, fréquentée de si belles et honnêtes princesses, grandes dames et damoiselles;» «désormais on pouvait s'approprier d'un amour point sallaud, mais gentil, net et pur.»
Faire l'amour, en effet, était la grande occupation de toute cette noblesse qui alors entourait le roi et suivait son exemple. Les dames favorisaient, il est vrai, leur amants et serviteurs, mais les pères et les maris n'étaient pas si mal avisés que de s'en fâcher, ils cherchaient à se venger ailleurs, voilà tout.
Le langage était alors à la hauteur des moeurs, tandis que toute débauche était excusée sous le nom de galanterie, on parlait comme ont écrit les vieux chroniqueurs, comme Rabelais dans Pantagruel et dans Gargantua, comme Brantôme dans les Dames galantes, comme Marguerite de Navarre dans ses Contes. On appelait alors chaque chose par son nom. Comme le latin, le vieux français bravait la pudeur en ce bon vieux temps de libres moeurs et de libre parler.
La cour de François Ier était alors la plus brillante de l'Europe, la noblesse se ruinait pour suivre l'exemple du roi qui ruinait la France. Un luxe inconnu jusqu'alors éclatait de toutes parts. Hommes et femmes semblaient lutter pour la richesse ridicule de leurs accoutrements, le velours, les fourrures, les draps d'or, étaient alors à la mode, et Brantôme nous apprend que les dames savaient fort bien se procurer les toilettes que leurs maris ou leurs familles ne pouvaient leur donner.
C'était chaque jour une fête nouvelle, les prétextes ne manquaient pas. Tournois, bals masqués, feux d'artifices, comédies, chasses, promenades aux flambeaux, «les jours, dit un vieil auteur luthérien, ne suffisaient pas aux folies et aux divertissements, il fallait prendre sur les nuits.» Écoutons Ronsard, qui décrit, de souvenir, les splendeurs et les plaisirs des résidences royales:
Quand verrons-nous quelque tournoi nouveau;
Quand verrons-nous, par tout Fontainebleau
De chambre en chambre aller les mascarades?
Quand ouïrons-nous, au matin, les aubades
De divers luths mariés à la voix?
Et les cornets, les fifres, les hautbois,
Les tambourins, violons, épinettes
Sonner ensemble avecque les trompettes?
Quand verrons-nous, comme balles, voler
Par artifice, un grand feu dedans l'air?
Quand verrons-nous, sur le haut d'une scène
Quelque farceur, ayant la joue pleine
Ou de farine, ou d'encre, qui dira
Quelque bon mot qui nous réjouira?...
Souverain magnifique de cette cour brillante et licencieuse, François Ier allait adressant de l'une à l'autre ses hommages passagers. On en était arrivé à ne plus compter ses caprices; n'importe, il ne rencontrait guère plus de cruelles que de maris jaloux. N'était-il pas le roi!
Nous ne savons au juste quelle était la physionomie de François Ier avant l'accident qui l'obligea, pour cacher une cicatrice, à couper ses cheveux et à laisser croître sa barbe; mais le Titien nous a laissé un portrait du roi-chevalier que l'on admire encore dans une des galeries du Louvre.
Le peintre a su donner à cette figure un noble et grand caractère, malgré sa frappante ressemblance avec certain personnage burlesque de la Comédie Italienne, ressemblance qui tient à la ligne du nez, trop avancée sur une lèvre mince, et à la proéminence du menton un peu bombé et terminé par une barbe pointue. On retrouve bien là d'ailleurs le rival de Charles-Quint, le front un peu ramassé, mais noble cependant, l'oeil ouvert et spirituel, la bouche fine, sensuelle, pleine d'appétits et de désirs.
François Ier était d'une stature au-dessus de la moyenne, sa jambe nerveuse était mince et un peu maigre, sa taille bien prise; peut-être péchait-il par les épaules, un peu bombées, mais il avait adopté un costume qui dissimulait ce léger défaut.
Tel était François Ier à l'époque la plus florissante de son règne. Le château d'Amboise, le palais des Tournelles étaient devenus trop petits pour toute cette noblesse amoureuse de mascarades et des champs clos qui vivait à l'ombre du trône. Le roi songea alors à construire de nouvelles résidences, dignes des nouvelles splendeurs de la cour.
Dans tous ces bâtiments, dont le roi avait pris le goût en Italie, on retrouve comme un reflet de cette époque qui sacrifia tout au dehors. Mais Chenonceaux, Chambord, disent toute la vie du roi-chevalier: sa prodigalité, ses faiblesses, son goût pour les arts, ses fêtes, ses soucis, ses peines d'amour.
A Chambord furent englouties bien des années du revenu de la France, mais aussi quelle merveille!
Avez-vous quelquefois gravi ses vingt-quatre escaliers? Vous êtes-vous promené dans ses quatre cent quarante pièces? Avez-vous compté ses fenêtres aussi nombreuses que les jours de l'année?
Le Primatice en a donné les dessins, dix-huit cents ouvriers ont mis douze ans à élever les pavillons, les terrasses, les galeries, à creuser les bassins, à détourner le lit des ruisseaux.
Jean Goujon et Germain Pilon avaient été chargés des sculptures; Léonard de Vinci et Jean Cousin avaient peint les belles fresques, aujourd'hui dégradées.
Lorsque parfois quelque audacieux faisait remarquer au roi les énormes dépenses de ce merveilleux château:
—Ce ne sera jamais trop pour mes amours! répondait le roi.
C'est à Chambord, surtout, que revivent les amours de l'amant de madame d'Étampes et de la comtesse de Chateaubriant. Le temps n'a point effacé les amoureuses devises et les galants emblèmes.
Au milieu des délicates sculptures qui courent le long des corniches, ou qui pendent comme de fines dentelles du haut des piliers, on aperçoit encore bien des initiales enlacées, non loin de cette salamandre entourée de flammes, symbole choisi par le roi, avec cette devise si explicite: nutrisco et extinguo.
Que d'amoureux soupirs sous les charmilles des jardins, sous les ombrages frais du parc, que de tendres causeries près des fenêtres charmantes des grandes salles habillées de riches tapisseries de Flandre, que de chansons joyeuses sous ces lambris étincelants d'or!
Soupirs dans le nuage, hélas! chanteurs au tombeau!
Chambord est resté debout, muet témoin, et la légende n'est plus qu'un vague murmure. Que de pieds légers cependant ont gravi l'escalier secret de la chambre du roi! qui donc a compté les ombres qui passaient rapides le long des corridors?
Il a trahi, le roi-chevalier, tant de serments d'amour!
Et c'est lui cependant, en un jour de mélancolie, alors qu'il pensait au beau Brissac, peut-être, qui traçait son distique fameux:
Souvent femme varie;
Bien fol est qui s'y fie.