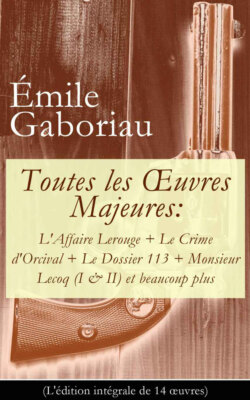Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 14
X LA BELLE GABRIELLE.
ОглавлениеEntre tous les noms amoureux et chéris que la tradition s'est plu à entourer d'une poétique auréole, celui de Gabrielle d'Estrées est assurément un des plus populaires.
Cette belle maîtresse du roi de France, cependant, était loin en son temps d'être l'idole de la foule: ses titres, son luxe, son ambition offusquaient les bourgeois. Elle fut marquise d'abord, puis duchesse; ils craignaient de la voir un jour assise sur le trône. Ils lui faisaient un crime de son esprit, de sa beauté même, beauté damnable!
Un Genevois, à Paris depuis la veille, est arrêté un matin aux portes du Louvre par la litière de la belle favorite.
—Quelle est, demande-t-il, cette grande dame si richement parée qu'entoure une si magnifique escorte de seigneurs et de damoiselles?
—Ne faites nulle attention à cela, répond le bourgeois de Paris, et remettez votre chapeau; ce n'est rien qui vaille, c'est la maîtresse du roi.
Il faut dire que les parures de Gabrielle, ses belles robes, ses diamants tiraient les yeux aux femmes des échevins: à chaque cérémonie elles trouvaient amplement matière à la critique.—«Encore un ajustement nouveau!» et aussitôt d'en évaluer le prix.
Le peuple s'obstinait à voir en elle la cause de tous ses maux; «volontiers il l'eût accusée de la dureté des temps ou du manque de récoltes.» On disait qu'elle ruinait son amant et l'empêchait de remplir ses bonnes intentions.—«Sans elle, depuis longtemps, nous tiendrions la poule au pot!»
Le temps a plus fait pour la duchesse de Beaufort que les panégyriques de ses historiens et de ses poëtes, admirateurs de commande. Chaque année a ajouté quelques traits charmants à la légende de ses amours, légende romanesque qui a fini par se substituer à l'histoire, et qui n'est cependant véridique ou menteuse qu'à demi. La popularité de cette femme séduisante a grandi à l'ombre de la popularité du Béarnais, et désormais le nom de la Belle Gabrielle est inséparable de celui de Henri IV.
On doit glisser légèrement sur les premières années de mademoiselle d'Estrées et se défier de toutes les exagérations en bien ou en mal des chroniques et des mémoires du temps. Sa position fut telle à la cour de France, qu'elle avait des amitiés dévouées et des haines ardentes, et nul de tous ceux qui ont parlé d'elle n'était complétement désintéressé, c'est-à-dire impartial.
Issue d'une famille qui avait déjà plusieurs quartiers de noblesse dans les fastes de la galanterie, Gabrielle suivit forcément les traditions de sa maison, et c'est sous les auspices d'une mère plus que complaisante qu'elle fit ses débuts à la cour de Henri III.
Dans le fond d'un château, tranquille et solitaire,
Loin du bruit des combats elle attendait son père.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son coeur, né pour aimer, mais fier et généreux,
D'aucun amant encor n'avait reçu les voeux.
Ainsi parle Voltaire, lorsque, pour la première fois, il met en scène la belle amie de Henri IV. Ici nous prenons la Henriade en flagrant délit d'adulation, mais l'épopée a ses exigences.
Bassompierre, sur le même sujet, s'explique tout autrement; malheureusement, ce brillant séducteur est légèrement suspect de calomnie. Trop bien traité par les femmes, il paya leurs faveurs au moins en médisances.
Le premier amant de Gabrielle paraît avoir été Henri III, auquel sa mère la livra moyennant une somme de six mille écus; mais l'ami de Quélus, de Schomberg et de Maugiron, qui avait en amour sa manière de voir, se dégoûta bien vite de sa jeune maîtresse; il la trouvait trop blanche et trop délicate.—«Pour du blanc et du maigre, disait-il, j'en ai tant que j'en veux chez la reine ma femme.»
Cet échec découragea fort madame d'Estrées, que les beaux écus d'or avaient mise en appétit; et sans doute pour remplacer la qualité des galants par la quantité, elle continua à produire sa fille dans le monde.
Le riche Zamet et d'autres partisans avaient succédé à Henri III, lorsque le cardinal de Guise vint à s'éprendre de Gabrielle. Cette passion durait depuis un an, quand le cardinal, étant devenu jaloux de M. de Longueville, rompit brusquement. M. de Longueville et Stanay, qui recueillirent sa succession, firent bientôt place au duc de Bellegarde, qui lui-même, à son grand regret, dut se retirer devant Henri IV.
Amant heureux de Gabrielle, enivré de cette rare fortune d'être aimé d'une femme si charmante, le duc de Bellegarde ne savait à qui conter son bonheur et vanter les charmes infinis d'une maîtresse adorée, lorsqu'il eut la malheureuse idée de choisir Henri pour confident. Il devait cependant savoir à quoi s'en tenir sur le coeur inflammable de son maître.
Du matin au soir, il ne cessait de lui décrire les infinies perfections de Gabrielle; il ne tarissait pas en éloges; il dépeignait avec passion ses grâces, sa beauté, son esprit, tant et tant qu'à sans cesse entendre exalter les charmes d'une femme qu'il ne connaissait pas, Henri IV en devint amoureux et pria Bellegarde de le mettre à même de l'admirer. Le duc y consentit, d'autant plus volontiers que son amour-propre y trouvait son compte et qu'il ne pensait pas avoir rien à redouter du roi, fort occupé alors de Marie de Beauvilliers.
La première entrevue du roi et de Gabrielle eut lieu au château de Coeuvres en Picardie. Bellegarde ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait fait une école, car il reçut l'ordre de ne plus penser à sa maîtresse. Il promit tout ce que voulut le roi; mais en secret, il prévint Gabrielle des exigences de Henri. Soit qu'elle aimât réellement le duc, qui était, du reste, un des plus beaux cavaliers de la cour, soit qu'elle cherchât par une résistance calculée à irriter la passion du roi, elle le reçut fort mal au début et lui déclara net qu'elle lui préférait Bellegarde qui devait l'épouser.
Le héros de son temps éprouva un vif chagrin de ce refus, et quoique Mantes, dont il s'était fait comme une petite capitale pendant qu'il tenait la campagne aux alentours de Paris, fût distant de sept lieues du château de Coeuvres, et que la forêt à travers laquelle il fallait passer fût entourée de partis ennemis, il résolut d'aller en personne apaiser la belle courroucée. Il partit accompagné de cinq gentilshommes de sa suite seulement. A trois lieues de Coeuvres, il descendit de cheval, endossa des habits de paysan, mit un sac plein de paille sur sa tête, et se rendit à pied au château où, la veille, il avait fait annoncer son arrivée. Gabrielle lui fit le plus froid accueil, lui disant qu'il était si laid sous cet accoutrement qu'elle ne pouvait se résoudre à le regarder.
L'insuccès de cette ridicule démarche ne découragea point le roi; il s'était piqué au jeu, et bientôt Gabrielle cessa de l'accabler de ses rigueurs. Il appela alors près de lui, à Mantes, le marquis d'Estrées sous prétexte de le faire entrer dans son conseil. Naturellement le marquis avait été invité à amener sa fille. Comme chaperon, le roi avait donné à Gabrielle une de ses tantes, madame de Sourdis, «ce qui, dit gravement Dreux du Radier, sauvait toutes les apparences.»
Cependant la présence d'un «bonhomme» de père ne laissait pas que d'être fort gênante pour des relations si publiques; il y avait aussi un frère, le marquis de Coeuvres, esprit fin et délié, un des plus habiles intrigants de la cour, qui semblait vouloir surveiller la conduite de sa soeur. Le roi ne trouva d'autre expédient que de marier sa maîtresse. On trouva tout exprès pour l'émanciper un bon gentilhomme de Picardie, Nicolas d'Armeval, seigneur de Liancourt. Ce gentilhomme tergiversa bien tout d'abord, «le mariage lui semblait dur à avaler;» mais on le convainquit à force d'arguments, des arguments de poids, dirait Basile.
Il avait été convenu que le jour de la noce, à l'heure où les époux ont l'habitude de réclamer leurs droits, le roi paraîtrait, «adsum qui feci,» et arracherait Gabrielle à M. de Liancourt.
Le roi manqua de parole; «il était si Gascon qu'il ne pouvait même se la tenir à lui-même.» Mais, en époux bien appris, M. de Liancourt ne demanda rien, et, dès le lendemain, accompagné de sa femme, il rejoignit le roi. Disons, pour en finir avec ce comparse, que quelques mois plus tard il mit non moins de bonne volonté à rompre le mariage, en se laissant déclarer dans le seul cas qui pût alors faire prononcer un divorce.
En 1593, Gabrielle devint enceinte. La joie du roi eût été immense sans quelques doutes qu'il avait au sujet de l'authenticité de sa paternité. En effet, lorsque Alibour, son médecin, lui avait appris cette heureuse nouvelle, Henri n'en avait rien voulu croire, ayant de bonnes raisons pour cela, dit une chronique ridiculement mensongère.
—Vous rêvez, bonhomme, aurait dit le roi.
Cette jolie petite calomnie semble avoir été arrangée tout exprès pour accuser Gabrielle de la mort d'Alibour, arrivée à quelque temps de là.
Elle n'avait point cependant renoncé entièrement à Bellegarde, et peu s'en fallut qu'un beau jour, ou plutôt une belle nuit, le roi ne les surprît. Une entreprise qu'il avait formée l'ayant obligé de s'éloigner de trois ou quatre lieues de Gabrielle, il partit; mais, n'ayant pas trouvé ce qu'il cherchait, il revint aussitôt et pensa trouver ce qu'il ne cherchait point. Bellegarde, qui avait feint de partir de son côté, était resté auprès de madame Gabrielle.
«Au retour imprévu du roi, ils étaient ensemble. Tout ce que put faire une confidente, ce fut de faire passer Bellegarde dans un cabinet où elle couchait près du lit de sa maîtresse. Cela s'était fait sans que le roi s'en aperçût, et tout était tranquille lorsqu'il s'avisa de demander des confitures qu'on mettait dans ce cabinet. Madame Gabrielle appela la Rousse (c'était le nom de cette confidente); on avait pris des mesures pour qu'elle ne s'y trouvât point. Soit que cette absence donnât du soupçon au roi, ou qu'il ne pensât qu'à se satisfaire sur les confitures, il dit qu'il n'y avait qu'à forcer la serrure. Sa maîtresse s'y opposa et prétexta un grand mal de tête. Le roi, auquel cette résistance ne parut pas naturelle, n'en devint que plus obstiné à faire ouvrir le cabinet, et donna même quelques coups de pied dans la porte pour l'enfoncer.
«Bellegarde était perdu s'il n'eût pris le parti de sauter par une fenêtre qui s'ouvrait sur le jardin: heureusement il ne se blessa point, quoiqu'elle fût assez haute. La Rousse, qui était aux aguets, parut aussitôt, s'excusa sur son absence, ouvrit la porte, et donna au roi les confitures qu'il demandait.»
Cette même Rousse fut plus tard embastillée avec son mari. Chassée par Gabrielle, elle était devenue une de ses plus cruelles ennemies; elle se répandit en diatribes et en calomnies, si bien que cette histoire de Bellegarde pourrait fort bien avoir été mise en circulation par elle.
Si toutefois cette aventure est véritable, elle ne fit aucun tort à Gabrielle dans l'esprit du roi, et bientôt son influence fut immense.
Il ne faut point s'étonner de la toute-puissance de la belle Gabrielle: dans les diverses phases de ses amours avec Henri IV, elle avait pu se faire apprécier par ce prince, «qui avant tout, dans ses maîtresses, nous dit Sully, cherchait une amie dévouée et une confidente sûre.» L'esprit de Gabrielle acheva ce qu'avait commencé sa beauté.
Cette beauté était si remarquable que ce nom de belle lui avait été donné comme un titre naturel, et ses plus grands ennemis la constatent avec une amertume qui certes n'est pas suspecte.
C'était une blonde aux yeux bleus et limpides; ses cheveux légèrement ondés semblaient d'or fin; son nez était droit et délicat; sa bouche, petite, pourprine et souriante, faisait songer à une grenade pleine de perles; son teint était d'une blancheur et d'une transparence admirables, une carnation anglaise avec plus d'accent et de chaleur.
Quant à son esprit, il était des plus fins et des plus déliés. Souvent Henri IV eut recours à elle, lorsqu'elle jouait à la cour le rôle de souveraine. «Il en tirait service, dit l'historien Mathieu, aux démêlements de plusieurs brouilleries; il lui fiait les avis et rapports qu'on lui faisait de ses serviteurs, et lui découvrait les blessures de son coeur, dont elle apaisait incontinent la douleur, en sorte que cette grande faveur, dangereuse d'ordinaire à un sexe impérieux, soutenait chacun et n'opprimait personne.»
Voilà le grand et véritable titre de Gabrielle à notre intérêt, j'allais presque dire à notre estime. L'ambition qu'on lui a reprochée plus tard fut presque une nécessité politique. Lorsqu'il fut question de la placer sur le trône, c'est qu'elle était l'âme d'un parti, du parti huguenot, qui voyait en ses enfants des protecteurs naturels, et se trouvait débarrassé de la crainte de quelque alliance qui lui eût été opposée.
L'entrée de Henri IV à Paris est le commencement des triomphes de la belle Gabrielle. Aux côtés du roi, elle tenait la tête du cortége, à demi-couchée dans une litière «où l'or superbement se relevait en bosse.» C'est sur elle que, brillant d'ivresse et d'orgueil, s'arrêtaient les yeux de Henri IV.
Les rues de l'ancien Paris étaient trop étroites pour la foule qui se pressait bruyante et joyeuse autour du roi. Le tableau de Gérard donne une idée assez juste de cette grande scène historique.
Toute cette population parisienne, amoureuse de bruit et d'émeutes, mal remise des souffrances et des perplexités d'un siége désastreux, acclamait dans Henri IV l'homme qui allait lui rendre la paix et lui donner du pain. Aussi jamais souverain ne fit plus triomphale entrée dans une capitale reconquise. Gabrielle était femme, ce jour-là elle dut aimer Henri IV.
Mais n'était-ce pas pour elle que triomphait son amant? A chaque instant arrêtant son cheval, il venait caracoler près de la riche litière découverte où elle trônait en souveraine.
«Le roi, dit l'Estoile, avait un visage fort riant et content de voir tout ce monde crier si allégrement Vive le roi! Il avait presque toujours son chapeau au poing, surtout pour saluer les dames et damoiselles qui étaient aux fenêtres.»
Nous avons les plus grands détails sur cette triomphale entrée; c'est toujours l'Estoile qui nous les donne; le brave bourgeois de Paris avait dû jouer des coudes pour fendre la foule, pour tout voir, pour tout entendre. Il a compté les clous de la selle royale et mesuré la longueur des housses de drap d'or; il n'oublie point la toilette de Gabrielle, il nous la décrit avec complaisance.
«Elle avait une robe de satin noir, toute houppée de blanc,» plus constellée de pierreries et de perles «que d'étoiles le manteau de la nuit.» Les chroniques reviennent souvent sur les toilettes de la belle favorite. Ses diamants, ses dentelles, ses robes, ses fourrures, inquiètent singulièrement les gens du tiers. Ils mettent en contraste les misères présentes et le luxe de la cour où Gabrielle donne le ton.
«Aujourd'hui quinze février, le roi est venu à Paris avec sa Gabrielle; elle avait un capot et une devantière pour porter à cheval, de satin couleur de zizolin, en broderies d'argent avec du passement d'argent mis en bâtons rompus; dessus des passepoils de satin vert. Le capot-doublé de satin vert gaufré, et ladite devantière doublée de taffetas couleur de zizolin avec le chapeau de taffetas aussi couleur de zizolin garni d'argent. Le tout valant au moins deux cents écus.»
Gabrielle affectionnait cette couleur verte qui seyait admirablement à sa beauté; on la voit toujours ainsi vêtue aux côtés de Henri IV, habillé toujours, lui, tout en gris. Nous ne ferons pas avec l'Estoile l'inventaire des coffres de Gabrielle. «Le cinq mars elle assistait au bal magnifiquement parée; elle avait douze brillants dans les cheveux. Le huit octobre, elle avait un manteau doublé de satin d'une richesse incroyable. Enfin le samedi douze novembre un brodeur de Paris acheva pour elle un mouchoir du prix de dix-neuf cents écus.»
Dix-neuf cents écus! Payés comptant! Voilà l'impopularité.
Moins de trois mois après son entrée à Paris, Gabrielle mit au monde un fils qu'elle appela César, comme pour exalter cet amour de la gloire qui, par bouffées, montait au cerveau du roi.
L'arrivée du poupon combla de joie le Béarnais; la naissance de cet enfant lui semblait un événement aussi heureux que la prise de possession de sa capitale; et comme il fallait un titre à la mère de Monsieur, duc de Vendôme, il la nomma marquise de Monceaux. La fortune de mademoiselle d'Estrées grandissait; «le roi commanda qu'on lui rendît désormais plus de respects.» Ici commence le rôle politique de Gabrielle, beaucoup plus grand qu'on ne pense. C'est un sujet que nous ne ferons qu'effleurer.
Tout d'abord elle protége Sully et le fait entrer aux finances. C'est donc à Gabrielle que cet homme d'Etat, dont la réputation eut des fortunes si diverses, et qui est une des créations de Mézeray, dut de pouvoir servir si utilement son maître.
Sully, dans ses Œconomies, s'occupe beaucoup de la maîtresse du roi; il ne la traite pas toujours avec le respect d'un homme qui lui doit tout. De là le reproche qu'on lui a fait d'ingratitude, reproche injuste. Sully pouvait-il changer de politique, parce que madame de Monceaux lui avait rendu quelques services? Elle lui causa souvent de terribles embarras dont il ne savait comment sortir. Une petite aventure de voyage, que l'on trouve dans les Œconomies, nous en donne la preuve. Sully accompagnait alors madame Gabrielle, qui allait rejoindre le roi. Sully était à cheval près de la litière. Celle-ci vint à verser tout à coup. On entendit un grand cri, auquel succéda le plus profond silence. Sully croit à un malheur, et tout aussitôt il pense à la douleur du roi.
—Cette mort serait, cependant, un grand embarras de moins, ne peut-il s'empêcher de se dire.
Il était alors plus que jamais question du mariage du roi et de sa maîtresse.
La belle Gabrielle fut un des auteurs de l'abjuration du roi, et elle contribua puissamment à vaincre des scrupules qu'il n'avait point, mais qu'il joua toute sa vie.
Car il y avait en lui bien plus d'Auguste que de César.—«Mes amis, ai-je bien joué cette comédie?»
A tort on a accusé Henri IV de tenir si prodigieusement à la religion réformée. Si quelquefois il en fredonnait les psaumes, c'est qu'il les avait appris dans son enfance, et que ces pieux airs chantaient dans son coeur comme un écho affaibli de ses jeunes années. La belle Gabrielle alors lui mettait la main sur la bouche et, malgré ses Ventre-saint-gris, le faisait taire.
—Souvenez-vous, Sire, que vous êtes le fils aîné de l'Église.
Plus tard nous voyons Gabrielle pousser à la conquête de la Franche-Comté, prendre les intérêts de Balaguy-Montluc, s'entremettre entre Henri IV et le duc de Mercoeur, enfin, à l'apogée de sa puissance, faire négocier à Rome la rupture du mariage du roi et de Marguerite de Navarre.
Épouse délaissée. Marguerite expiait alors les folies de sa jeunesse. Reléguée en Auvergne dans sa résidence d'Usson, elle se plaignait en beaux vers d'être une épouse sans mari, et elle écrivait ses Mémoires qui ne réussissent point à donner à nos yeux tort à Henri IV. Déjà elle pouvait prévoir qu'elle allait avoir à lutter contre l'influence de la favorite.
Aucun nuage n'obscurcissait alors le radieux avenir de la marquise de Monceaux. Sa position à la cour était devenue officielle, et chacun lui rendait les hommages dus à une souveraine.
Partout nous la retrouvons aux côtés de Henri IV, aux bals, aux fêtes, et jusque dans les conseils. Le roi reçoit-il des ambassadeurs, il la fait cacher derrière une tapisserie, afin qu'elle puisse ouïr tout ce qu'on dira et lui donner son avis.
Le premier président du parlement de Normandie, Groulard, nous donne dans ses curieux Mémoires la mesure de la toute-puissance de Gabrielle.
Le roi était venu à Rouen pour tenir l'assemblée des notables; c'est même à cette occasion qu'il fit cette mémorable harangue, dans laquelle il disait aux notables que, bien que ce ne fût l'usage des rois, des barbes grises et des victorieux, «il venait se mettre en tutelle entre leurs mains.»
Comme, à l'issue du conseil, le roi demandait l'avis de Gabrielle sur le discours qu'il avait prononcé devant ces bourgeois:
—Je suis fort étonnée, Sire, répondit la marquise de Monceaux, que Votre Majesté ait parlé de se mettre en tutelle.
—Ventre-saint-gris! répondit le roi, il est vrai; mais je l'entends avec mon épée au côté.
Gabrielle en cette circonstance fut officiellement présentée au parlement. Le bonhomme Groulard ne laisse pas que d'en être surpris; mais il en prend son parti et nous raconte que dès le lendemain matin il se transporta en l'hôtel de madame Gabrielle pour lui faire sa visite.
Lorsqu'elle suivait le roi à la chasse, Gabrielle avait adopté un galant costume d'homme, sous lequel sa beauté semblait plus piquante. Ils s'en allaient tous les deux le long des chemins de la forêt, faisant la cour buissonnière, leurs chevaux tellement rapprochés qu'ils pouvaient se donner la main.
Mais cette douce et charmante existence ne pouvait durer toujours. Le royaume n'était point si pacifié encore que Henri pût se permettre les tranquilles amours des rois fainéants. La nécessité, bottée et éperonnée, vint plus d'une fois soulever les rideaux de son alcôve au milieu de la nuit. Alors il fallait partir. Toute frissonnante et demi-nue, Gabrielle accompagnait son amant jusqu'à la cour d'honneur.
—Dieu vous garde, Sire, et au revoir!
Et le roi s'élançait à cheval, non sans avoir pris auparavant le baiser de l'étrier.
C'est en telles circonstances qu'il envoyait à Gabrielle cette charmante romance, digne d'un ménestrel du gai sçavoir, et qui est la gloire et le renom même de Gabrielle:
Charmante Gabrielle,
Percé de mille dards
Quand la gloire m'appelle
A la suite de Mars,
Cruelle départie!
Malheureux jour!
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour!
L'amour sans nulle peine
M'a, par vos doux regards,
Comme un grand capitaine,
Mis sous ses étendards.
Cruelle départie!
Malheureux jour!
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour!
La réponse de Gabrielle, bien que moins populaire, mérite d'être rappelée, car c'est à tort qu'on en a contesté l'authenticité.
Héros dont la présence
Fait mes plus doux plaisirs,
Que ta cruelle absence
Me coûte de soupirs!
Que ne puis-je te suivre;
Dans les hasards
Ou bien cesser de vivre,
Lorsque tu pars.
Quoi! toujours aux alarmes
Tu veux livrer mon coeur,
Le moindre bruit des armes
Le glace de frayeur.
Il n'est point de remède
A mon tourment;
Si le guerrier ne cède
Au tendre amant.
On a attribué bien d'autres vers à Henri IV, comme on lui a attribué bien des mots qu'il n'a jamais dits. Quel que soit le poëte qui ait adressé à Gabrielle les vers charmants que nous allons citer, le Béarnais n'a pas à se plaindre d'en avoir vu grossir son bagage d'écrivain.
Viens, Aurore,
Je t'implore,
Je suis gai quand je te voi.
La bergère
Qui m'est chère
Est vermeille comme toi.
Pour entendre
Sa voix tendre
On déserte le hameau,
Et Tityre
Qui soupire
Faire taireson chalumeau.
Elle est blonde,
Sans seconde;
Elle a la taille à la main;
Sa prunelle
Etincelle
Comme l'astre du matin.
De rosée
Arrosée
La rose a moins de fraîcheur,
Une hermine
Est moins fine;
Le lys a moins de blancheur.
D'ambroisie
Bien choisie
Hébé la nourrit à part;
Et sa bouche,
Quand j'y touche,
Me parfume de nectar.
Les séparations momentanées des deux amants nous ont valu une série de lettres charmantes qui forment, avec les billets froissés soigneusement recueillis par la belle Corisandre, un galant recueil que Saint-Preux de sa plume ampoulée n'eût certes point écrit.
Les expressions les plus heureuses y peignent la passion la plus ardente, et rien n'égale la grâce des laconiques billets que chaque soir, avant de s'endormir sous la tente, Henri IV envoyait à sa maîtresse.
«Mes belles amours, deux heures après l'arrivée de ce porteur, vous verrez un cavalier qui vous aime fort, qu'on appelle roi de France et de Navarre, titre bien-honneureux, mais bien pénible; celui de votre sujet est bien plus délicieux.»
Voici quelques traits pris au hasard dans cette correspondance; plus nombreux et recueillis avec soin, ils ajouteraient un chapitre à l'histoire du Béarnais, chapitre que l'on pourrait intituler Esprit de Henri IV:
«Cette lettre est courte, afin que vous vous endormiez après l'avoir lue.»
«Passer le mois d'avril absent de sa maîtresse, c'est ne vivre pas.»
«Pour femme, il n'en est pas de pareille à vous; pour homme nul ne m'égale à savoir bien aimer.»
«Que ne puis-je partir en croupe derrière le messager que je vous envoie! je pourrais au moins baiser un million de fois vos belles mains.»
Il faut citer encore cette lettre si célèbre qui dit en quatre lignes toute l'histoire des amours de Henri IV et de Gabrielle.
«Je vous écris, mes chères amours, des pieds de votre peinture que j'adore seulement pour ce qu'elle est faite pour vous, non qu'elle vous ressemble. J'en puis être juge compétent, vous ayant peinte en toute perfection dans mon âme,—dans mon âme, dans mon coeur, dans mes yeux.
«Henri.»
Pourquoi faut-il, hélas! que ces tendres expressions se retrouvent dans toutes les lettres de Henri IV! le roi galant ne change que les noms: c'est cette pauvre Fosseuse ou Corisandre, Gabrielle ou la fière Henriette d'Entragues, ritournelle d'amour qui sert d'ouverture à toutes les mélodies de la passion.
Au moment où nous sommes arrivés, l'étoile de la belle Gabrielle est au zénith. La séduisante maîtresse de Henri IV a déjà le pied sur la première marche du trône; quelques jours encore,
Et le roi va poser la couronne à son front.
Après quatre ans d'une union qui avait surmonté toutes les traverses, Gabrielle avait reçu du roi le titre de duchesse de Beaufort. Elle lui avait donné deux nouveaux enfants, Catherine-Henriette, et Alexandre de Vendôme, dont on célébra le baptême avec autant de pompe et d'éclat que s'il eût été fils de France.
Ce baptême fut la première cause des discordes de Sully et de la belle Gabrielle, qui bientôt devaient s'envenimer de tous les rapports des courtisans.
Un instant, pressée par ses amis, Gabrielle eut l'idée de renverser le ministre qu'elle avait protégé; elle y eût perdu son temps et ses peines.
Les historiens de Henri IV lui prêtent un mot superbe.
—Je ne sais comment, Sire, vous préférez un valet à une amie, avait dit Gabrielle.
—Je retrouverais plus facilement vingt maîtresses comme vous qu'un ministre comme lui, aurait répondu le roi.
Ajoutons cette anecdote à vingt autres tout aussi vraisemblables, et qu'elles aillent rejoindre la poule au pot dans les nuageux lointains de la fantaisie historique.
Cette question du mariage de Gabrielle avec le roi apparaissait déjà à l'horizon, grosse d'orages.
On en parlait tout bas à la cour; les créatures de la favorite avaient de grandes espérances, mais le roi ne s'était point encore prononcé.
C'est à Sully qu'il s'en ouvrit tout d'abord. Il faut lire dans les Œconomies la curieuse conversation du roi et de son ministre.
—Je voudrais bien, disait Henri IV, trouver femme à mon gré, non point épouser par politique quelque princesse qui ferait lit à part; je la veux jolie, bonne et indulgente, je veux surtout qu'elle me fasse de gros enfants, un tous les ans. Ne connaîtrais tu point, Rosny, celle qu'il me faut?
Et Sully de faire semblant de chercher.
—Voyons, cependant, continue Henri IV, les princesses qui sont à marier en Europe.
Sully savait bien où le roi voulait en venir;
—Cherchons, Sire.
Et il égrena la liste des filles nubiles de souches royales, sans en omettre une seule, avec une sûreté de mémoire et de renseignements qu'on trouverait à peine aujourd'hui chez le rédacteur aux gages de Justus Perthes, l'heureux éditeur de l'Almanach de Gotha.
A chaque nom nouveau, Henri IV secouait la tête.
—Ce n'est point encore mon affaire.
—Cherchons, Sire. Mais je ne vois plus qu'un moyen. Donnez rendez-vous dans la cour de votre Louvre à toutes les jolies filles de France de dix-sept à vingt-cinq ans, vous choisirez.
—Eh bien! non, dit le roi impatienté de la mauvaise volonté de son ministre, nous n'avons que faire de chercher. N'ai-je pas la duchesse de Beaufort?
Le grand mot était lâché. Sully poussa les hauts cris. Mais le roi tenait ferme à son idée. Il y eut des démarches faites à Rome d'abord, puis près de madame Marguerite, afin d'obtenir la liberté du roi.
Le Vatican la marchanda longtemps. Marguerite de Valois déclara qu'elle ne s'y prêterait jamais et que ce n'était pas pour «l'ancienne maîtresse du duc de Bellegarde, l'épouse déshonorée de Liancourt, qu'elle consentirait à briser son union avec Henri IV.»
Les négociations se poursuivirent néanmoins, et une nouvelle complication, le projet de mariage du roi et de Marie de Médicis, vint ajouter aux embarras déjà très-grands et très-réels de la cour de France.
Les choses en étaient à ce point, lorsque, comme un coup de foudre, parvint au roi la nouvelle de la mort de Gabrielle.
Quelques détails sur cette fin si prématurée.
On était alors dans la semaine sainte. Madame de Beaufort, enceinte de quatre mois, se rendit à Paris pour faire ses pâques dans cette ville, «afin de se faire voir bonne catholique au peuple qui ne la croyait pas telle.» Gabrielle descendit chez Zamet, ce fameux seigneur de dix-sept cent mille écus qui prêtait à Henri IV pour ses petites parties le magnifique hôtel qu'il avait fait construire.
Le jeudi de la semaine sainte, après un dîner où Zamet avait dépassé le nec plus ultrà de la somptuosité, madame de Beaufort eut envie d'entendre les Ténèbres en musique au petit Saint-Antoine. Elle s'y rendit accompagnée de mademoiselle de Guise et de la duchesse de Retz. Elle était fort joyeuse ce jour-là; les négociations pour son mariage allaient à son gré, et elle avait reçu du roi une lettre très-passionnée dans laquelle il lui annonçait que, pour en finir, il venait de dépêcher à Rome le sieur du Fresne.
Pendant l'office, elle fut prise de douleurs d'entrailles et d'éblouissements. On la reconduisit chez Zamet. A son arrivée à l'hôtel, elle se trouvait un peu mieux. Elle fit un tour de jardin et goûta d'un fruit.
C'est alors que Zamet lui annonça que le mariage de Henri IV et de Marie de Médicis était décidé.
Ses convulsions la reprirent presque aussitôt, accompagnées des symptômes les plus alarmants. «Fortement frappée de l'idée qu'elle était empoisonnée, dit Sully, elle commanda qu'on la tirât de chez Zamet et qu'on la transportât chez sa tante madame de Sourdis.»
Le trajet ne fit qu'augmenter ses douleurs, et, après un jour et demi d'atroces souffrances, elle expira le samedi 10 avril à sept heures du matin.
«Les médecins et chirurgiens, dit le journal de Henri IV, n'osèrent pas, à cause de sa grossesse, lui faire des remèdes violents. Tels avaient été ses efforts et ses syncopes, que sa bouche fut tournée vers la nuque de son col. Elle était devenue si hideuse qu'on ne pouvait la regarder sans effroi. Son corps ayant été ouvert, son enfant fut trouvé mort.»
Henri IV, prévenu trop tard, fit éclater le plus vif désespoir. Il sanglotait tout haut, refusait toute consolation, se plaignant d'être désormais «seul sur la terre.»
Il prit le deuil et il voulut que toute la cour suivit son exemple. Des funérailles presque royales furent faites pour cette belle maîtresse de Henri IV. Son corps fut conduit en pompe solennelle à l'abbaye de Maubuisson, dont une de ses soeurs était alors abbesse.
Des bruits sinistres se répandirent autour du cercueil de la duchesse de Beaufort. Ce mot terrible de poison, si souvent murmuré dans les sombres appartements du Louvre lorsque régnait une première Médicis, revenait fatalement avec une autre princesse de ce nom.
Zamet fut accusé, et bien d'autres.
Mais il faut se garder de prêter l'oreille aux vagues murmures du soupçon.
«Dieu seul, dit Shakespeare, a jamais su ce qu'il y avait au fond de la coupe.»
Le peuple, qui avait haï Gabrielle, ne s'agenouilla point au passage du cortège funèbre, et les cendres de la belle favorite n'étaient pas froides encore, que déjà couraient sur elle les pamphlets les plus injurieux.
Voici le commencement d'un dialogue de quatre pages, en vers, composé le lendemain de sa mort. C'est son ombre qui revient tout exprès de l'enfer pour confesser ses crimes:
De mes parents l'amour voluptueuse
Et de mes soeurs l'ardeur incestueuse
Rendent assez mon lignage connu.
De l'exécrable et malheureux Atrée
Est emprunté notre surnom d'Estrée,
Nom d'adultère et d'inceste venu.
Les haines ardentes contenues pendant sa vie éclataient, et les six soeurs de la belle Gabrielle ayant assisté à ses obsèques, il se trouva un poëte pour faire ce sixain.
J'ai vu passer sous ma fenêtre
Les six péchés mortels vivants
Conduits par le bâtard d'un prêtre,
Qui tous les six allaient chantants:
Un requiescat in pace
Pour le septième trépassé.
La Restauration eut l'idée de faire élever une statue à la belle Gabrielle, en 1820, époque où l'on ne parlait d'Henri IV dans les salons bien pensants que les larmes aux yeux.
Louis XVIII donna son approbation. Cet homme d'esprit dut bien rire ce jour-là.
Etait-ce sa faute à lui si ceux qui l'entouraient n'avaient lu l'histoire de France que dans les Père Loriquet de la maison de Bourbon?