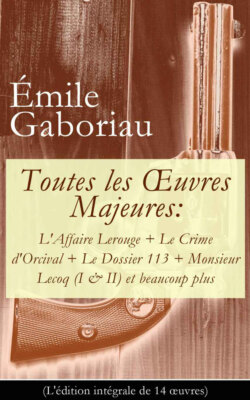Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XI CATHERINE-HENRIETTE D'ENTRAGUES.
MARQUISE DE VERNEUIL.
ОглавлениеTable des matières
Les cloches qui avaient sonné le glas funèbre de la duchesse de Beaufort vibraient encore, que déjà Henri IV songeait a pourvoir son coeur d'une nouvelle maîtresse. Son désespoir fut aussi court qu'il avait été violent.
Les distractions qu'il trouvait à l'hôtel de Zamet ne suffisaient pas pour combler le vide creusé par la mort de Gabrielle. Il s'en allait, comme a dit un écrivain du temps, «escarmouchant du coeur» avec l'une et avec l'autre, fort indécis de son choix, lorsque le hasard, aidé d'une mère peu scrupuleuse, jeta sur son passage la belle et fière Henriette d'Entragues. Cette mère complaisante n'était autre que la charmante Marie Touchet, qui, en épousant le seigneur de Balzac d'Entragues, ne songeait probablement pas à faire souche de maîtresses royales. Mais nous rencontrerons plus d'une fois dans l'histoire de ces familles prédestinées.
Une partie de chasse, fut le théâtre de la première entrevue. Le roi, tout aussitôt, mordit à cet appât irrésistible de deux yeux ardents d'une vivacité plus que provoquante. Les traits d'Henriette, sans avoir la régularité de ceux de Gabrielle, étaient peut-être encore plus séduisants. Et puis, n'était-elle pas encore embellie, aux yeux d'Henri IV, du piquant attrait de la nouveauté?
Mais le Vert-Galant dut modérer son impatience. La fille de Marie Touchet savait trop l'art de se faire désirer pour ne pas reculer à propos après être allée au-devant de l'amour. Les commencements de cette liaison ont toute la majesté d'une négociation diplomatique.
Il y eut des pourparlers, des allées, des venues; un ambassadeur, de Lude, avait été nommé.—Triste ambassade! La pierre d'achoppement, c'était M. de Balzac d'Entragues. Ce gentilhomme tenait à conserver ce qui restait d'honneur à sa maison; peut-être parce que la vertu de sa femme avait fait naufrage, il tenait à garder celle de sa fille. Il mit de Lude à la porte. Par bonheur, l'ambassadeur d'Henri IV connaissait le chemin des fenêtres.
Le roi maugréait fort de tous ces contre-temps. Oubliant que déjà sa barbe grisonnait, le Vert-Galant sur le retour se croyait aimé d'Henriette et n'accusait que la tyrannie des parents.
Bientôt cependant on entra dans la voie des transactions. Les bases des premiers protocoles furent posées par la jeune fille, ou plutôt par sa mère. M. d'Entragues continuait à jouer à l'écart son rôle de père rigide, sans doute pour se ménager une entrée lorsque le moment lui paraîtrait convenable. La modeste, séduisante et spirituelle Henriette d'Entragues mettait sa capitulation au prix de cent mille écus.
Ce chiffre formidable fit pousser les hauts cris à Henri IV. Il marchanda même, le ladre! oui, il marchanda; mais la place tint bon, et, un beau matin, Sully reçut l'ordre de compter la somme.
Le ministre, fort embarrassé à ce moment de réunir les quatre millions nécessaires au renouvellement de l'alliance des Suisses, commença par refuser net. Il disait que pour une somme si énorme son maître aurait dix femmes plus belles et plus vertueuses que mademoiselle d'Entragues. Il avait dix mille fois raison, mais on ne raisonnait pas avec l'impatience amoureuse du Vert-Galant, et il fallut bien s'exécuter.
C'est alors que Sully s'avisa d'un stratagème qui, mieux que de longues considérations, nous donne une exacte idée de son caractère et de celui de son maître.
Il fit porter les cent mille écus dans le cabinet du roi, et en sa présence les fit compter et recompter avec une grande ostentation par ses secrétaires. Cet or et cet argent, qui couvraient presqu'entièrement le plancher du cabinet, éblouirent le Béarnais.
—Nous sommes, dit-il d'un ton joyeux, bien plus riches que je ne croyais.
—Il est vrai, répondit Sully, mais tout ce que vous voyez là, Sire, doit être, par vos ordres, porté à mademoiselle d'Entragues.
Henri resta un instant pensif; puis, comme honteux de lui-même, il sortit en murmurant:
—Ventre-saint-gris, voilà une nuit bien payée.
Cette nuit, tant désirée et si chèrement achetée, il ne la tenait point encore.
Avec les cent mille écus, de nouveaux scrupules étaient venus à la famille d'Entragues. Il y eut de nouvelles difficultés, de nouvelles négociations. Le roi, de jour en jour plus pressant, sommait Henriette de tenir sa promesse; mais elle, avec un art infini, maudissait comme son amant la surveillance fâcheuse d'une famille trop attachée à un vain point d'honneur, lui jurait qu'elle attendait avec impatience une occasion favorable, et finissait par le remettre au lendemain.
Henri IV, de guerre lasse, allait peut-être abandonner la partie et ses cent mille écus, qui à cette heure lui tenaient au coeur au moins autant que son amour, lorsqu'il reçut d'Henriette une lettre où elle lui expliquait qu'une promesse de mariage en bonne et valable forme, adressée à M. d'Entragues, mettrait en repos la conscience chatouilleuse de ce bon père et assurerait enfin leur liberté et leur bonheur.
Les chroniques nous ont conservé la curieuse épître de l'adroite demoiselle: avec une heureuse habileté d'expressions, elle prouve au roi qu'elle n'est pour rien dans cette dernière exigence: elle a engagé ses parents à se contenter d'une promesse verbale, mais ils s'opiniâtrent à exiger un écrit, «Enfin, Sire, ajoute-t-elle en terminant, puisqu'ils s'entêtent de cette vaine formalité, quel risque y a-t-il à se prêter à leur manie? Vous ne ferez point difficulté de les satisfaire, si vous m'aimez comme je vous aime. A mon égard, tout ce qui m'assurera mon amant me satisfera.»
Il ne fallait pas tant d'éloquence pour convaincre le roi; une promesse, de mariage surtout, ne lui avait jamais semblé un obstacle sérieux. Après un don de cent mille écus, cette vaine formalité, comme disait mademoiselle d'Entragues, lui paraissait une plaisanterie. Il eût défendu son coffre-fort, il signa sans hésiter et de la meilleure grâce du monde la promesse de mariage qui devait lui ouvrir l'alcôve de la belle Henriette.
Nous avons ce document, écrit en entier de la main de Henri IV, et scellé du sceau royal; il était de nature à satisfaire le père le plus exigeant:
«Nous, Henri, roi de France et de Navarre, en foi et parole de roi, promettons et jurons à M. de Balzac d'Entragues, que nous donnant pour compagne demoiselle Catherine-Henriette d'Entragues, sa fille, au cas que dans six mois elle devienne grosse, et qu'elle accouche d'un fils, alors et à l'instant, nous la prendrons pour femme et légitime épouse, dont nous solenniserons le mariage publiquement et en face de notre mère sainte Eglise, selon les solennités requises et accoutumées.
«Henri.»
L'histoire de cette promesse de mariage, que Sully appelle «un honteux papier,» n'est pas la page la moins curieuse des Œconomies.
Henri IV, au moment de partir pour le château de M. d'Entragues, s'avise de montrer le fameux acte à son ministre. Sully le prend, le lit avec une attention triste qui fait monter le rouge au front du Vert-Galant, et enfin le lui rend froidement et sans prononcer une parole.
—«Là! là! dit le roi, parlez librement et ne faites pas tant le discret; n'ayez crainte que je me fâche.»
Sully alors reprend la promesse et la met en pièces.
—«Comment, morbleu! s'écrie Henri, que prétendez-vous faire? Je crois que vous êtes fou!»
—«Il est vrai, Sire, que je suis fou, répond le hardi confident; plût à Dieu que je le fusse tout seul en France!»
Le roi s'éloigna en maugréant, comme c'était son habitude lorsqu'il ne voulait pas avouer que Sully avait raison; mais avant de partir pour Malesherbes, résidence de la famille d'Entragues, il eut soin de préparer une nouvelle cédule.
De ce jour, Henriette fut toute à lui, et un mois ne s'était pas écoulé qu'elle jouissait de toutes les prérogatives et de toute l'influence que dix ans de dévouement et d'affection avaient méritées à la belle Gabrielle. Mais quelle différence! L'humeur égale et douce de la duchesse de Beaufort la faisait aimer de tous ceux qui approchaient le roi, son esprit conciliant suffisait à apaiser les mille querelles que des intérêts divers font naître entre les courtisans; avec l'altière Henriette, au contraire, la discorde entra à la cour, et Henri IV ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait choisi la tempête pour compagne.
Les graves embarras que, dès le premier jour, suscita la nouvelle favorite ne diminuèrent en rien la passion du Béarnais: le pouvoir des femmes sur son esprit grandissait avec les années.
Gabrielle avait été duchesse de Beaufort, Henriette fut marquise de Verneuil; et telle était après peu de semaines son influence, que le duc de Savoie se crut obligé d'acheter par des présents d'une énorme valeur sa toute-puissante protection.
Souveraine maîtresse au palais de Fontainebleau, ces «déserts» chers à Henri IV, la marquise ordonnait à son gré les fêtes et les chasses, ce qui ne l'empêchait pas d'assister aux conseils du roi, d'avoir sa politique et d'émettre son avis, au grand déplaisir de Sully, des généraux et des ministres.
Pour mademoiselle d'Entragues, le Béarnais était devenu prodigue, et chaque jour quelque don nouveau venait témoigner de la vivacité de sa passion. S'éloignait-il, était-il forcé de quitter les genoux d'Henriette, même pour une seule journée, il retrouvait pour lui écrire de ces expressions si tendres, si naïvement amoureuses, qui jadis mouillaient de douces larmes les yeux de la Belle Gabrielle:
«Mon cher coeur, un lièvre m'a mené jusque devant Malesherbes, j'y ai éprouvé la douce souvenance des plaisirs passés; je vous ai souhaitée entre mes bras comme autrefois je vous y ai vue.... Bonjour, chères amours. Si je dors, mes songes seront de vous, si je veille, mes pensées seront de même. Recevez un million de baisers de moi.
«Henri.»
O roi prometteur et oublieux! ô marchand de belles paroles! Tandis qu'il signait ainsi une promesse de mariage, qu'il écrivait à sa maîtresse des billets passionnés, ses ambassadeurs négociaient à Rome la rupture de son mariage avec Marguerite de Valois et une nouvelle alliance avec Marie de Médicis.
Les négociations étaient sur le point de réussir: la reine de Navarre avait accordé son consentement au divorce, et le pape devait saisir avec empressement cette occasion de donner en France une nouvelle force au parti catholique, cet ancien parti de la Ligue qui n'avait cessé de lutter de tout son pouvoir contre l'influence de la Belle Gabrielle.
Le moment approchait cependant où Henri IV allait être sommé de tenir sa parole royale fort aventurée. La marquise de Verneuil était enceinte et comptait avec une fébrile impatience les jours qui la séparaient du moment où la naissance d'un fils,—elle était sûre, disait-elle, que ce serait un fils,—lui assurerait la couronne.
Le roi était fort inquiet; il sentait que si la marquise mettait au monde un garçon les fauteurs de rébellions auraient en main une arme terrible. Le hasard, ce complice de toute sa vie, vint à son aide.
La favorite, en l'absence de son amant, alors dans les environs de Moulins, attendait au château de Monceaux le moment de ses couches, auxquelles Henri avait promis d'assister. Une nuit, le tonnerre tomba dans sa chambre et lui causa une telle frayeur, que quelques heures plus tard elle mit au monde, avant terme, un enfant mort.
Ainsi Henri IV fut délié de son engagement imprudent, mais non d'un amour disproportionné dont les conséquences devaient être si fâcheuses.
Cependant, à la première nouvelle du terrible accident survenu à sa maîtresse, le roi était accouru. Tant que la vie de la malade fut en danger, il veilla fidèlement à son chevet, et sa présence, plus que l'habileté des médecins, contribua au salut de la marquise.
Une triste nouvelle attendait Henriette à sa convalescence; elle ne recouvra la santé que pour apprendre le mariage de Henri IV avec Marie de Médicis.
La colère et le désespoir de mademoiselle d'Entragues sont faciles à comprendre, pour qui connaît le caractère fougueux de cette jeune ambitieuse; elle voulait aller trouver son amant, lui reprocher sa félonie et son manque de parole, l'accabler des plus cruelles injures. Mais déjà le Béarnais, redoutant une orageuse explication, avait quitté Monceaux et galopait vers la Savoie.
Quelques jours suffirent pour changer les dispositions d'Henriette. Ne pouvant être reine, elle pensa qu'elle devait au moins conserver comme maîtresse la toute-puissance, et nous la voyons accabler le roi de lettres tendrement plaintives:
«Souvenez-vous, Sire, écrit-elle, d'une demoiselle que vous avez possédée et qui s'est livrée à vous sur votre foi et parole royale.»
Ailleurs nous trouvons ce curieux passage:
«Je ne vous parle que par soupirs, car pour mes autres plaintes secrètes, Votre Majesté les peut sourdement entendre de ma pensée, puisque vous connaissez aussi bien mon âme que mon corps. En mon âme misérable, Sire, il ne me reste que cette seule gloire d'avoir été aimée du plus grand monarque de la terre.»
Ces larmes et ces tristesses troublaient comme un remords l'âme de Henri IV; et il n'y put rester insensible; plus d'une fois il quitta l'armée pour aller implorer son pardon, et c'est à Henriette qu'il fit porter les drapeaux pris sur l'ennemi, galanterie déplacée qui fit hautement murmurer les vieux compagnons d'armes du roi de Navarre.
Il est à croire que toutes «ces belles prévenances» du roi avaient leur but: Il désirait vraiment se faire rendre sa promesse de mariage, qui ne laissait pas que de l'inquiéter. Mais cet engagement était en bonnes mains; et tandis que la marquise trompait Henri par une feinte résignation, ses parents envoyaient à Rome la fameuse promesse. Elle arriva trop tard, lorsque déjà Marie de Médicis, mariée par procuration, mettait le pied sur la terre de France.
La première entrevue des nouveaux époux eut lieu à Lyon, le 9 décembre de l'an 1600. Le genre de beauté de Marie de Médicis ne plut point au Vert-Galant; pour une fois en sa vie, il se trouva une femme qui n'était pas à son gré, c'était la sienne. La nouvelle reine avait alors vingt-sept ans; «elle était grosse, commune, n'avait rien de l'élégance ni de l'esprit des Médicis, ses ancêtres paternels, et ne tenait que du sang autrichien de sa mère.»
Elle justifiait assez bien, on le voit, cette épithète de grosse banquière qu'en un jour de querelle devait lui donner la marquise de Verneuil.
Le caractère de Marie ne rachetait pas tous ces défauts, «elle était jalouse, emportée et bigote.»
Malgré tout, Henri IV, le soir même de la première entrevue, passa par-dessus toutes les lenteurs de l'étiquette et pénétra dans l'appartement de la nouvelle reine; il avait hâte de rendre indissoluble un mariage que trop de prétextes pouvaient faire annuler.
Le voyage de Marie de Médicis continua à petites journées, le roi parti en avant faisait l'office de fourrier. Ce voyage fut un long triomphe. Le parti catholique devait bien cette ovation à la nièce du Saint-Père, et c'est au milieu des acclamations les plus enthousiastes qu'elle fit son entrée à Paris, où l'attendaient de cruelles déceptions.
Il était dans la destinée de Marie de Médicis de voir sa vie troublée par des favorites royales. Jeune fille, elle avait dû fuir le palais paternel où régnait despotiquement Bianca Capello, la belle courtisane vénitienne; épouse et reine, elle dut subir une humiliante rivalité avec la marquise de Verneuil; mère enfin, elle eut la douleur de voir des bâtards partager avec son fils les caresses paternelles.
Il ne faudrait pas cependant se trop apitoyer sur les malheurs de Marie; sa vertu est restée trop équivoque pour qu'on lui accorde tout l'intérêt que mérite une épouse trahie. Son cousin Virginio Orsini, dont l'affection n'était rien moins que fraternelle, le duc de Bellegarde, et enfin le trop fameux Concini, l'aidèrent, dit-on, à se venger des infidélités trop nombreuses de son époux. Pour les deux premiers, la chronique s'aventure peut-être, mais le doute n'est pas possible à l'égard de celui qui devint plus tard le maréchal d'Ancre.
Tranquille du côté de ses ennemis, Henri IV, après son mariage, avait espéré vivre enfin en repos. Il se trompait: il retrouva dans sa maison la guerre qui avait cessé au dehors.
Un mois ne s'était pas écoulé depuis l'arrivée de Marie de Médicis, que déjà le Louvre était devenu un enfer. La faute en était au Vert-Galant, qui avait caressé cet espoir insensé «d'accorder deux femmes terriblement jalouses, une femme légitime et une maîtresse,» et qui «avait la prétention de les faire vivre en bonne intelligence sous le même toit.»
Henri n'accorda même pas à sa femme les trois mois du poëte, mois bénis du premier amour; il avait été repris d'une belle passion pour Henriette, «dont le bon bec» l'amusait infiniment, et il ne se passait pas de semaine «qu'il ne fit quelque nouvelle entreprise» pour aller coucher au château de Verneuil.
Aussi chaque jour de terribles querelles éclataient dans le ménage royal; «cette illustre paire d'amants, dit une chronique, vivait dans une brouillerie perpétuelle.» Sully avait assez à faire à mettre le holà, et deux ou trois fois il n'eut que le temps d'arrêter le bras de la reine qui se levait menaçant sur son époux. Le ministre n'était pas là sans doute le jour où elle égratigna si fort la figure de Henri qu'il en porta les marques plus d'une semaine.
Comme de juste, la marquise de Verneuil avait été présentée à la reine. Marie de Médicis l'avait reçue plus que froidement, et tout l'esprit de la favorite n'avait pu arracher une parole à l'épouse outragée.
Le rêve de Henri était de donner à sa maîtresse un logement au Louvre; mais toute son habileté diplomatique avait échoué contre la juste jalousie de la reine. Les courtisans qui s'étaient entremis ne réussirent pas mieux que leur maître, et deux ou trois d'entre eux payèrent d'une disgrâce un échec auquel ils eussent dû s'attendre. Rosny lui-même n'eut pas une chance meilleure. Le roi désespérait presque, lorsqu'une des femmes de la reine offrit de le servir. Cette femme était Léonora Galigaï.
Cette intrigante, toute-puissante sur l'esprit de sa maîtresse, la décida à subir la marquise de Verneuil, et bientôt les deux ennemies, l'épouse et la maîtresse, semblèrent vivre dans la meilleure intelligence.
Ce fut un scandaleux et triste spectacle: la reine et la favorite eurent chacune leur appartement au Louvre, appartements si voisins qu'une simple porte de communication dont le roi avait la clef les séparait.—«Je suis enfin heureux,» disait le Vert-Galant. Il y avait de quoi!
A quelque temps de là Marie de Médicis et la marquise eurent chacune un fils à peu de semaines de distance. Le roi fit aussi bon accueil à l'un qu'à l'autre. Les enfants avaient toujours eu le don de le réjouir, «de quelque part qu'ils vinssent.» Ils étaient pour lui comme un signe de prospérité, et à ce compte Henri put s'estimer un monarque prospère. Il n'était alors question que de la bonne intelligence des deux mères. Aux fêtes qui célébrèrent la naissance d'un dauphin, Marie de Médicis inscrivit le nom d'Henriette sur la liste des dames qui devaient danser un ballet qu'elle avait composé. Chaque dame représentait une vertu.
Ce fut le dernier triomphe d'Henriette. Nous allons voir pâlir son étoile jusqu'à ce qu'elle s'éteigne dans les brumes épaisses de l'oubli. Le premier coup qui devait ébranler sa fortune, lui fut porté par la reine; cette Italienne qui pouvait se composer un visage souriant, mais non étancher le fiel de son coeur. Marie de Médicis, par l'entremise d'une des soeurs de Gabrielle, fit tenir au roi des lettres de la marquise adressées au duc de Joinville, pour lequel elle avait eu une vive passion. Dans ces lettres, que Joinville avait sacrifiées à une nouvelle maîtresse, le roi et la reine étaient indignement outragés. L'amour d'Henri surtout y était tourné en ridicule au bénéfice d'un préféré.
Le Vert-Galant, si naïf au fond avec les femmes, fut altéré par la lecture de cette correspondance. Il se croyait aimé! Joinville dut quitter la cour, et on conseilla à la marquise d'aller prendre l'air dans une de ses terres. Elle obéit furieuse et jurant de se venger.
Nous n'entrerons point ici dans les détails des intrigues sourdes et des conspirations qui troublèrent le règne de Henri IV. A presque toutes nous trouvons mêlées mademoiselle d'Entragues et sa famille.
Déjà, lors de la conspiration de Biron, le père et le frère de la favorite n'avaient dû la vie qu'à ses prières. Une nouvelle entreprise ne fut pas plus heureuse; mais Henriette elle-même se trouva compromise, et le roi ordonna sa mise en jugement.
Rendue à la liberté, dévorée de rage et d'ambition déçue, elle passa sa vie à susciter des ennemis à ce roi qui l'avait tant aimée. Telles avaient été ses menaces, elle avait parlé si haut de ses projets de vengeance, qu'on l'accusa d'avoir, de concert avec d'Épernon, mis le couteau aux mains de l'infâme Ravaillac.
De ce moment elle cessa de paraître à la cour, et nul ne se souvenait plus de cette belle et fière Henriette d'Entragues, lorsqu'elle mourut à son château de Verneuil le 9 février 1633. Elle avait cinquante-quatre ans.