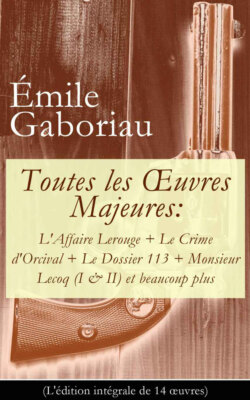Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II AGNES SOREL.
LA COUR DE CHARLES VII.
ОглавлениеTable des matières
Souverain dépossédé, roi sans couronne, Charles VII s'en allait perdant une à une les plus riches provinces de ce beau pays de France, devenu la proie des Anglais. La Normandie était conquise; Paris obéissait à des maîtres venus d'outremer; Orléans et toutes les villes environnantes ne voyaient plus briller la fleur-de-lis d'or de la royauté française.
A l'insensé Charles VI il eût fallu un successeur actif et énergique, Charles VII était indolent et faible: loin de profiter de l'ardeur guerrière de ses chevaliers fidèles, il ne songeait qu'à la contenir, et, sans souci de son devoir de roi, il ne s'occupait que de plaisirs et de fêtes, à l'heure où pièce à pièce s'écroulait l'édifice si péniblement construit de la nationalité.
L'Anglais, déjà, se croyait vainqueur, et le roi d'Angleterre prenait le titre de roi d'Angleterre et de France.
Quelques jours encore, et c'en était fait du royaume de Charles VII, la France était à deux doigts de sa perte, un miracle seul pouvait la sauver....
Le miracle eut lieu!
Une jeune paysanne, bien ignorante, bien inconnue, apparaît tout à coup à la cour du roi fugitif. C'est Jeanne Darc, l'humble bergère de Domrémy.
A travers mille périls, elle est venue trouver Charles VII, parce qu'elle en a reçu l'ordre d'en haut; des voix ont parlé à son oreille; elle a obéi.
A cette heure où le découragement s'est emparé de tous, elle annonce qu'elle a mission de Dieu pour chasser l'Anglais, pour faire sacrer le «gentil Dauphin,» pour sauver la France.
L'incrédulité et la raillerie l'accueillent. En ce temps de superstitions et de ridicules croyances nul ne veut ajouter foi à ses paroles.
—Que peut cette vilaine pour votre cause? disent au roi les courtisans.
Mais Charles VII répond:
—Quelle que soit la main qui me rendra ma couronne, je bénirai cette main.
Et il accueille Jeanne Darc, et il déclare que, le premier, il veut combattre sous sa miraculeuse bannière.
A dater de ce moment la vierge de Vaucouleurs devient le premier capitaine de Charles VII, tous les seigneurs se disputent l'honneur de la suivre au combat. On forme sa maison, D'Aulon est son premier écuyer, Raymond et Louis de Contes sont ses pages; elle choisit pour hérauts d'armes d'Ambleville et Guienne; le frère Jean Pasquerel, lecteur du couvent des Augustins de Tours, est son aumônier.
La France, comme l'agonisant qui recueille avidement la moindre parole de salut, a entendu la voix de la vierge inspirée, la France tressaille et renaît à l'espérance.
Jeanne Darc dit:
—Levez vous, et marchons!
Chacun se lève et la suit.
—Allons sauver Orléans!
Et Orléans est sauvé.
De ce jour, les choses changent de face; l'ennemi tremble à son tour. Jeanne Darc lui renvoie la terreur que, la veille encore, il inspirait à tous. L'Anglais n'attaque plus, il se défend. Il se renferme dans ses places fortes dont les murailles ne lui semblent même plus un abri suffisant. L'heure de la délivrance a sonné et, chaque jour, depuis l'arrivée de l'héroïque jeune fille, est marqué par de nouvelles conquêtes.
Jeanne Darc tient cependant toutes ses promesses, et bientôt, à la tête de douze mille hommes, elle traverse un pays presqu'entièrement occupé par l'ennemi, et arrive jusqu'à Reims où Charles VII doit être sacré.
A l'église, elle se tient près du roi, son étendard à la main.
—Il était à la peine, dit-il, il est juste qu'il soit à l'honneur.
Mais là s'arrête la mission de la vierge inspirée, les cérémonies du sacre terminées, Jeanne Darc conjure le roi de lui permettre de se retirer. Se mettant à genoux devant lui, «l'accolant par les genoux,» elle se met à fondre en larmes et toute l'assemblée avec elle:
—Gentil roi, dit-elle, ores est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre, pour montrer que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir, voilà mon devoir accompli, souffrez donc que je retourne vers mes parents qui sont en grand mal de moi.
Mais elle exerçait un trop grand prestige sur le peuple et sur l'armée pour qu'on la laissât partir. Obligée de rester, elle en éprouve un «grand regret;» sa confiance en elle même l'abandonne.
—Je n'entends plus mes voix, disait-elle, et c'est l'indice de ma fin prochaine.
Ce triste pressentiment allait, hélas! se réaliser bientôt.
Le duc de Bourgogne assiégeait alors Compiègne, qui venait de se rendre aux armes de Charles VII.
Toujours la première au danger, Jeanne Darc accourt à la défense de la ville menacée. Dès le jour de son arrivée, elle tente contre les Bourguignons une vigoureuse sortie. Les Français, inférieurs en nombre, sont repoussés. Jeanne, toujours la dernière à la retraite, reste seule exposée à tous les coups; elle tient tête aux masses afin de laisser aux siens le temps de se retirer. Enfin, elle songe à rentrer dans la ville; il est trop tard. Imprudence, fatalité ou trahison, la poterne qui doit assurer son salut est fermée, et, après d'héroïques efforts, elle est obligée de se rendre.
Un chevalier bourguignon, le bâtard de Vendôme, reçoit son épée.
A la nouvelle fatale, une morne tristesse enveloppe la France comme un crêpe de deuil. Les Anglais, au contraire, font éclater les transports de la joie la plus vive; dans toutes leurs églises ils font chanter des Te Deum; c'est que la Pucelle leur semble plus redoutable qu'une armée!
Mais tenir Jeanne Darc prisonnière n'est point assez pour l'Anglais. Il faut tenter de détruire le prestige de l'héroïne de la France, et, par un procès infâme, on essaie de la flétrir.
L'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, accepte le déshonneur et l'ignominie de cette tâche.
Jeanne Darc est conduite à Rouen. Douze mois on la retient prisonnière, la harcelant nuit et jour d'odieuses obsessions. Enfin, après une procédure dans laquelle le ridicule le dispute à l'ignoble, au mépris de toutes les lois divines et humaines, Jeanne Darc, dite Pucelle, est déclarée hérétique, dissolue, invocatrice de démons, blasphèmeresse de Dieu, pernicieuse, abuseresse du peuple, cruelle, devineresse, idolâtre.
Le 24 mai 1431, l'inique sentence reçoit son exécution, et Jeanne, conduite au bûcher, expire au milieu des plus cruels tourments.
—Jésus! Jésus! Jésus!
Telle est sa dernière parole, l'expression suprême de ses mortelles angoisses, cri de douleur et d'espérance qui, dominant les gémissements et les sanglots de la foule agenouillée autour du bûcher, monte vers le ciel comme pour demander grâce pour cette France oublieuse qu'elle vient de sauver, pour ce roi ingrat qui lui doit sa couronne, et qui n'ont rien tenté pour l'arracher des mains de ses ennemis.
Le supplice de Jeanne Darc fit horreur aux Anglais eux-mêmes, et l'un de leurs généraux ne put s'empêcher, lorsqu'on lui en apprit les détails, de s'écrier d'une voix indignée:
—Ah! nous venons de commettre là un exécrable forfait! il nous portera malheur.
La France apprit avec épouvante l'horrible martyre de Jeanne Darc. Seul, peut-être, de tout son royaume, Charles VII ne sembla point ému. En douze mois il avait eu le temps d'oublier celle qui avait, à Reims, replacé la couronne sur sa tête. Pendant un an qu'avait duré son illégale captivité, il n'avait rien entrepris pour l'arracher à l'horreur de la prison; il ne tenta rien pour venger sa mort.
Le roi de France était retombé dans son ancienne apathie, comme autrefois il ne songeait qu'aux amusements frivoles. Tandis que les Anglais s'acharnaient à détruire l'oeuvre de la Pucelle, Charles VII dissipait ses journées en parties de chasse et passait les nuits à exécuter des ballets de sa composition.
Ses capitaines, braves compagnons de Jeanne, murmuraient hautement; mais le roi ne voulait pas les entendre; il n'avait d'oreilles que pour les courtisans assez vils pour flatter tous ses goûts. Que de fois cependant il eut à rougir de son inaction!
Un matin, Xaintrailles et La Hire étaient venus trouver le roi afin de tenir conseil; les événements se pressaient avec une inquiétante rapidité; on le trouva, entouré de quelques familiers, fort occupé d'un ballet qu'on devait donner le soir même. Charles VII, bien que fort contrarié de la visite matinale des deux vaillants hommes d'armes, voulut faire bonne contenance.
—Eh bien! mes amis, leur dit-il, que pensez-vous de cette danse? Ne trouvé-je pas, malgré l'Anglais, moyen de me divertir?
—Il est vrai, Sire, répondit froidement La Hire, et «oncques on n'a vu ny oüy qu'aucun prince perdist si gaiement son estat.»
Charles VII tourna brusquement le dos au censeur incommode; il était de ceux que la vérité blesse; sensible à la gloire, ambitieux, il désirait le «renom de grand capitaine et souhaitait de tout son coeur rentrer dans le domaine de ses pères,» mais l'énergie lui manquait et nul n'avait sur lui assez d'ascendant pour l'arracher aux obscurs plaisirs de sa petite cour.
—Vous êtes heureux, Sire, de savoir vous contenter de si peu, lui disait dans une autre occasion un de ses meilleurs amis.
Le roi de France, en effet, avait grandement besoin d'être philosophe; tous les jours n'étaient pas jours de fête à sa cour; l'argent manquait souvent le lendemain des «festoyements,» il fallait alors recourir aux expédients. Toutes les chroniques de l'époque parlent de cet incroyable dénûment; le roi manquait des choses les plus nécessaires, ses écuyers n'avaient rien à servir sur sa table, ses fournisseurs refusaient de lui faire crédit.
Voici ce que raconte Martial d'Auvergne.
Un jour que La Hire et Pothon
Le vinrent voir pour festoyment,
N'avoit qu'une queue de mouton
Et deux poulets tant seulement.
Las! cela est bien au rebours
De ces viandes délicieuses,
Et de ces mets qu'on a tous jours
En dépenses trop somptueuses.
Une autre fois, Charles VII, qui se trouvait alors à Bourges, vint à manquer de chaussures; il fit mander un maître cordonnier de la ville.
—Maître, lui dit-il, prends moi la mesure d'une paire de souliers.
L'homme obéit.
—Maintenant, reprit le roi, tu peux te retirer, j'entends que ces souliers soient faits sans délai.
Et comme l'homme ne bougeait pas.
—Ne m'as-tu donc pas entendu? ajouta Charles VII.
—Pardonnez-moi, Sire, dit alors le maître cordonnier, seulement il faut être juste en affaires.
—Certainement, mais que veux-tu dire?
—Rien, sinon qu'il m'est impossible de faire les souliers dont je viens de prendre la mesure.
—Et pourquoi?
—Je n'ai point l'habitude, Sire, de faire crédit aux gens insolvables, et depuis longtemps ceux qui fournissent au roi ne sont pas payés....
Charles VII entra dans une furieuse colère, mais le maître cordonnier n'avait rien dit qui ne fût l'exacte vérité; comment se révolter contre un fait?
Le soir même, le roi se plaignait amèrement de l'insolence de cet homme.
—Hélas, Sire, répondit un de ses familiers, il faut bien vous résoudre à n'avoir plus crédit à Bourges, «puisque vous laissez les Anglais vous prendre tout.»
A ces moments d'humiliants déboires «la rougeur d'une noble vergogne» colorait le front du prince; il maudissait son apathie et jurait de reconquérir son royaume, il demandait ses armes et voulait, à l'instant même, courir sus à l'Anglais, puis il allait s'enfermer seul dans une des pièces les plus sombres de son château et répandait des larmes amères. Mais sa colère se dissipait aussi vite qu'elle était venue, le lendemain il avait tout oublié et de rechef ne pensait qu'à trouver «expédients de divertissements et de fêtes.»
Tel était le caractère de ce prince, faible, nonchalant, mobile. Impressionnable à l'excès, il avait des éclairs d'indignation et de courage, mais fréquentes étaient ses heures d'abattement et de désespoir. Un instant la voix inspirée de Jeanne Darc avait réveillé en lui le sentiment du devoir, mais cette voix éteinte, son caractère avait repris le dessus, et il semblait épuisé par les efforts d'énergie qu'il avait dû faire. Si bien que l'oeuvre de la Pucelle menaçait de devenir inutile, lorsque parut Agnès Sorel.
Le trône, sous Charles VII, a été sauvé par deux femmes, tel est le cri de l'histoire.
L'une est la vierge inspirée, qui, son miraculeux étendard à la main, conduisait elle-même les soldats à la bataille; l'autre est la maîtresse du roi, la dame de beauté
Qui toujours songeant à la gloire
Avant de songer à l'amour,
devint la bonne fée de son amant et contribua à lui faire mériter ce surnom de «Victorieux» que lui décernèrent ses contemporains.
La France doit tant aux femmes, disait le tendre et discret Fontenelle, que pour les Français la galanterie est un véritable devoir de reconnaissance.
C'était vers la fin du mois d'octobre 1431; cinq mois s'étaient écoulés depuis la mort de Jeanne Darc. La cour errante du roi de France avait pris ses quartiers d'hiver au château de Chinon. Charles VII affectionnait tout particulièrement cette résidence bâtie au sommet d'un côteau au milieu de l'un des plus ravissants paysages de ce beau pays de Touraine.
Charles VII n'était, pas encore «le victorieux,» il n'était que le «roi de Bourges,» surnom que lui avaient donné ses ennemis.
Les Anglais, avec leurs croix rouges,
Voyant lors sa confusion,
L'appelaient le roi de Bourges, Par forme de dérision.
Les affaires, à cette époque, allaient plus mal que jamais, les finances étaient complètement épuisées; et, de tous côtés, on annonçait ou l'on prévoyait des désastres; on comprend dès lors la mortelle tristesse de cette petite cour.
C'est donc avec un plaisir infini que Charles VII apprit l'arrivée à Chinon d'Isabelle de Lorraine, femme de René d'Anjou; il espérait que cette visite ferait quelque diversion à la monotonie de ses journées.
Isabelle de Lorraine, l'une des princesses les plus distinguées de son temps, venait à la cour de France, pour y solliciter la liberté de son mari fait prisonnier à la bataille de Bulgneville. Elle avait à plaider une cause difficile, puis elle comptait pour réussir, sur son adresse et sur les beaux yeux d'une de ses filles d'honneur, Agnès Sorel, que l'on appelait alors la demoiselle de Fromenteau.
Les espérances d'Isabelle ne furent pas trompées, toute la cour de Chinon n'eut plus bientôt d'yeux que pour la belle Tourangelle, et, plus que tous les autres, le roi la comblait de soins et d'attentions.
Agnès Sorel était, il faut le dire, dans tout l'éclat de son admirable beauté, et voici le portrait que trace d'elle un de ses contemporains, c'est-à-dire de ses admirateurs:
«C'était un teint de lis et de roses, des yeux où la vivacité était tempérée par tout ce que l'air de douceur a de plus séduisant, une bouche que les grâces avaient formée; tout cela était accompagné d'une taille libre et dégagée, et relevé d'un esprit aisé, amusant, et d'un entretien dont la gaîté et le tour agréable n'excluaient ni la justesse, ni la solidité.»
La femme de René d'Anjou, certaine désormais de l'influence d'Agnès sur le coeur du roi, comprit que sa cause était gagnée; cependant Charles hésitait à se prononcer. C'est qu'il savait qu'une fois la liberté de son mari assurée, Isabelle partirait pour la Sicile, où l'accompagnerait sa belle fille d'honneur, et il ne se sentait plus la force de se séparer d'Agnès.
Isabelle avait, depuis longtemps déjà, pénétré le motif des hésitations du roi de France, mais il ne lui appartenait pas de les faire cesser. Elle attendit, décidée à profiter de la première occasion qui se présenterait. Elle n'eut pas longtemps à attendre.
Heureusement pour la liberté de René d'Anjou, les princes et les rois vont fort vite en amour, et Agnès avait été touchée de la grande passion de Charles; elle se sentit prise de tendresse pour ce monarque que tout abandonnait, et dès ce moment elle prit la résolution de céder. Peut-être fut-elle tentée par la grandeur de la tâche imposée à l'amie de ce roi si faible, et conçut-elle dès ce moment la pensée d'user de toute son influence pour en faire un héros.
Agnès consentit donc à se rendre aux voeux du roi, à seconder les secrets désirs d'Isabelle. Elle tomba malade, subitement, et, dès les premiers jours, sa maladie présenta un caractère si grave que les médecins, appelés par le roi, déclarèrent que la jeune fille ne pouvait entreprendre un long voyage, sans danger pour ses jours.
Cette déclaration ne trompait certainement personne; mais elle sauvait les apparences. Charles VII, peu habitué à dissimuler ses impressions, laissa éclater sa joie. Isabelle de Lorraine, au contraire, témoigna un violent dépit; elle hésitait, disait-elle, entre deux partis: attendre le rétablissement de sa fille d'honneur ou partir sans elle. Il fallait cependant prendre une décision. Isabelle demanda une audience au roi, et lui fit observer que si elle tardait davantage à se mettre en route, elle serait probablement arrêtée par les neiges; d'un autre côté, elle hésitait beaucoup à abandonner une jeune fille si belle, si aimable, et qui lui avait été confiée.
Un mot de Charles VII arrangea tout. Il fut convenu qu'Agnès Sorel resterait à la cour, sous la surveillance de la reine Marie d'Anjou, et Isabelle de Lorraine, ayant obtenu la grâce qu'elle sollicitait, fit ses préparatifs de départ et ne tarda pas à quitter Chinon.
Voilà donc Agnès Sorel seule à la cour de France. Elle était tombée malade subitement, son rétablissement fut tout aussi rapide, le roi ne laissa même pas l'indisposition durer ce qu'il fallait pour la justifier. A peine rétablie, Agnès Sorel fut attachée à la reine en qualité de fille d'honneur. Marie d'Anjou se souvenait-elle des recommandations d'Isabelle de Lorraine ou obéissait-elle à une inspiration du roi, c'est ce qu'il est impossible de décider, bien que la suite des événements donne à penser qu'elle agit véritablement de son propre mouvement....
Agnès Sorel avait environ vingt-deux ans à cette époque (1431). Elle était fille d'un gentilhomme longtemps attaché à la Maison de Clermont, du nom de Sorelle, Soreau ou Surel[3], seigneur de Saint-Géran, et de Catherine de Maignelais.
Née vers 1409, au village de Fromenteau, dont elle portait le nom, elle perdit jeune encore son père et sa mère, et fut confiée aux soins d'une tante maternelle, la dame de Maignelais.
«Agnès, dès l'âge le plus tendre, était, au dire de tous, un véritable miracle de beauté, les paysans se mettaient sur le seuil de leurs portes pour la voir passer lorsqu'elle traversait quelque village, tantôt à pied, tantôt montée sur un beau cheval alezan. Elle n'avait d'autre prestige alors que celui de sa taille charmante et de son admirable figure, et cependant on lui donnait déjà un surnom que devaient confirmer, plus tard, les Seigneurs de la cour de France; les naïfs habitants de la Lorraine ne l'appelaient jamais que la reine de beauté.»
Bientôt, aux dons de la nature, elle joignit les avantages d'une éducation soignée, chose si rare à cette époque, et tous ceux qui l'entendaient causer se retiraient «esbahis de son esprit et de son merveilleux enjouement.»
—Nous ne sommes point en peine de la fortune d'Agnès, disait alors la dame de Maignelais, sa tante; elle a d'esprit et de beauté de quoi faire la fortune de trois familles.
Mais tous ces avantages qui émerveillaient chacun, tournèrent contre la jeune orpheline. La dame de Maignelais avait une fille, nommée Antoinette qui, bien inférieure à Agnès, sous tous les rapports, ne tarda pas à en devenir jalouse; dès lors le séjour de cette maison, jusque là si paisible, devint insupportable.
Impuissante à défendre sa nièce contre sa propre fille, madame de Maignelais ne songea plus qu'à éloigner la reine de beauté. Une occasion ne tarda pas à se présenter et l'orpheline, à peine âgée de quinze ans, repoussée par ses protecteurs naturels, dut se résigner à accepter la position de demoiselle d'honneur près d'Isabelle de Lorraine, celle-là même que nous venons de voir l'abandonner à la cour de France, à la merci de l'amour du roi.
Jeune, belle, spirituelle, protégée par la reine, aimée du roi, Agnès Sorel ne tarda pas à devenir l'âme de la petite cour de France. Charles VII n'avait eu jusqu'alors que des amours vulgaires; sa passion pour une femme supérieure ressemblait fort à un culte; il eût volontiers proclamé à la face du monde la dame de ses pensées et rompu des lances en son honneur, mais, douée et modeste autant que belle, Agnès ne souhaitait que le mystère.
—A quoi bon, disait-elle, donner de l'éclat à une faute?
Elle disait encore au roi:
—Je vous aimerai, Sire et de toute mon âme, et jamais je ne cesserai de vous aimer; si cependant on venait à connaître ce qui se passe, pleine de confusion, je m'irais cacher au fond de la campagne la plus déserte.
Si bien que, durant longtemps encore, la liaison d'Agnès et du roi demeura enveloppée d'un mystère, assez transparent pourtant pour ne tromper personne. Malheureusement pour le secret de ses amours, Agnès ne sut point assez repousser les présents incessants de son amant.
Prodigue, comme tous les princes ruinés, Charles VII avait la main toujours ouverte, surtout pour sa belle et douce amie; chaque jour quelque nouvelle marque de munificence décelait son grand amour; les joyaux succédaient aux parures, les maisons aux terres, les seigneuries aux châteaux. Si bien que les courtisans accusaient Agnès Sorel d'avidité et d'avarice.
—Cette douce colombe ne serait-elle point une pie effrontée? disait un jour le bâtard de Dunois qui avait gardé son franc parler.
Ce propos, véritablement injuste, ne tarda pas à être rapporté à la tendre Agnès. Ses beaux yeux se mouillèrent de larmes et, tout éplorée, elle courut se jeter aux pieds du roi....
—Reprenez, mon cher Sire, lui dit-elle, tous les présents dont vous m'avez enrichie, et permettez-moi de quitter cette cour méchante.
Charles VII eut toutes les peines imaginables à calmer son amie, et cependant il était bien plus irrité qu'elle. Mais comment la venger? Châtier Dunois, il n'y fallait pas penser; un châtiment n'eût fait qu'accroître la jalousie et la haine. Est-il d'ailleurs un roi si absolu que jamais il ait pu faire taire les méchants propos de sa cour?
Ne pouvant imposer silence aux contemporains, Charles VII espéra tromper l'histoire. Il manda Jean Chartier, son historiographe, et lui ordonna d'employer tout son talent à démentir les propos injurieux qui «entachaient l'honneur» de la belle Agnès.
Jean Chartier promit d'obéir, et c'est pour tenir sa parole, sans doute, qu'il écrivit les lignes suivantes qui n'ont pu abuser la postérité:
«Or, j'ai trouvé, tant par le récit des chevaliers, écuyers, conseillers, physiciens ou médecins et chirurgiens, comme par le rapport d'autres de divers états et amenés par serment, comme à mon office appartient, afin d'ôter et lever l'abus du peuple,... que, pendant les cinq ans que la dite demoiselle a demeuré avec la reine, oncques le roi ne délaissa de coucher avec sa femme, dont il a eu quantité de beaux enfants,... que, quand le roi allait voir les dames et damoiselles, même en l'absence de la reine, ou qu'icelle belle Agnès le venait voir, il y avait toujours grande quantité de gens présents, qui oncques ne la virent toucher par le roi, au-dessous du menton... et que, si aucune chose... elle a commise avec le roi dont on ne se soit pu apercevoir, cela aurait été fait très-cauteleusement et en cachette, elle étant encore au service de la reine (Marie d'Anjou).»
«Jean Chartier nous la baille belle,» dit un historien qui écrivait quelques années plus tard, «que prouvent les enfants que le roi avait eus avec la reine? Quant à ces mots de très-cauteleusement et en cachette, c'est là tout au plus la stricte décence.»
La postérité a partagé l'opinion du railleur de Jean Chartier; il est de fait que le bon et naïf historiographe eût pu trouver, pour défendre la belle Agnès, quelques raisons plus ingénieuses et plus concluantes, surtout lorsqu'il s'agissait de démentir tout un siècle. Mille témoignages, en effet, sculptures, poèmes, mémoires, légendes, retracent les amours de Charles VII et d'Agnès Sorel. Mais si le nom de la «dame de beauté» ne nous est point parvenu pur de toute tache, au moins doit-on absoudre, en raison de son oeuvre, cette douce amie du «roi de Bourges.»
En pleine Restauration, Béranger, qui cherchait à se faire arme de tout contre l'Anglomanie, donna à Agnès Sorel une dernière consécration, le jour où il fit paraître cette charmante chanson:
Je vais combattre, Agnès l'ordonne!
Malheureusement, en 1432, nul ne se doutait encore qu'Agnès Sorel faisait tous ses efforts pour réveiller une noble ambition dans le coeur de son royal amant. Tout entier à son amour, Charles semblait avoir oublié qu'il était le roi de France; que lui importaient désormais Anglais et Bourguignons! Ils pouvaient sans obstacle dévaster les provinces, démanteler les villes, faire manger le blé en herbe à leurs chevaux. Il régnait, lui, sur le coeur de «la dame de beauté» et cela suffisait à son bonheur.
Vainement Agnès le conjurait de se remettre à la tête de tous ses braves compagnons d'armes, qui jadis aux côtés de Jeanne Darc versaient leur sang sur les champs de bataille.
—Eh! ma mie, répondit-il, avez-vous donc si peu de souci de mon amour que vous veuilliez m'éloigner de vos beaux yeux.
Que répondre à ces douces paroles? «Gloire, devoir,» disait Agnès. «Plaisir, amour,» disait Charles VII.
Mais les courtisans et les peuples ignoraient toutes ces tentatives inutiles, et hautement ils murmuraient. On accusait Agnès de l'indigne inaction du prince; on maudissait le jour où, à la suite d'Isabelle de Lorraine, elle était venue à la cour. On la comparait à Dalila, énervant entre ses bras un nouveau Samson; les plus malveillants allaient jusqu'à dire que sans nul doute elle avait été envoyée par les ennemis de la France pour ensorceler et séduire le roi.
Le bruit de cette indignation arriva enfin aux oreilles d'Agnès; elle comprit que c'en était fait de sa réputation et de celle de son amant si cette situation se prolongeait; à tout prix elle résolut de le décider à se mettre à la tête de ses troupes afin d'en finir avec l'Anglais.
Justement Charles VII avait manifesté l'intention de se retirer en Dauphiné pour y chercher quelque peu de solitude et de paix. Une semblable résolution exécutée ruinait à tout jamais la monarchie.
—Eh quoi! lui dit Agnès Sorel indignée, vous ne serez même plus le roi de Bourges!
—Las! ma dame aussi doute de mon courage, murmura tristement Charles VII.
Puis comme Agnès ne répondait pas:
—Qu'il soit donc fait, reprit-il, comme vous le désirez nous nous séparerons.
Le lendemain de ce jour, pour faire souvenir le roi de sa promesse, tant de fois donnée, tant de fois oubliée, Agnès paya des groupes de gens du peuple qui, sous les fenêtres mêmes du château vinrent chanter quelques-uns des couplets ironiques que les Anglais avaient fait composer sur le roi de Bourges:
Mes amis, que reste-t-il
A ce dauphin si gentil?
Orléans et Beaugency,
Notre Dame de Cléry,
Vendôme!
Ces chants injurieux irritaient le roi; il parlait de faire pendre les chanteurs, mais il ne se décidait point à partir.
Enfin, un matin, Agnès Sorel parut devant le roi, plus triste qu'à l'ordinaire; depuis longtemps en effet les soucis et le chagrin avaient chassé l'air d'enjouement qui rayonnait autrefois sur son beau visage.
—Avez-vous donc, ma mie, quelque nouveau sujet de tristesse? demanda le roi tout inquiet.
—Hélas! Sire! répondit «la dame de beauté,» peut-être suis-je à la veille de m'éloigner de vous pour toujours.
—Eh! que dites-vous là?
—La vérité, Sire; «elle est pénible et dure, elle vous fâchera peut-être à entendre.»
—Et qu'importe, ma mie; je veux savoir la cause de votre chagrin.
—Sachez donc, Sire, que j'ai fait, hier, tirer mon horoscope.
—Bon! je devine, on vous aura dit quelques menteries.
—On m'a dit, au contraire, des choses fort sérieuses, on m'a prédit l'honneur d'être aimée du plus grand roi du monde.
Charles VII, rassuré, se prit à sourire:
—Que voyez-vous là, ma mie, de si effrayant? Cette prédiction ne s'est-elle pas déjà accomplie, au moins en partie?
Agnès Sorel secoua tristement la tête, quelques larmes brillèrent dans ses beaux yeux.
—Que vous a-t-on donc dit encore, ma mie? demanda vivement le roi.
—On ne m'a dit que cela, Sire; mais si l'oracle ne me trompe pas, je vous supplie de me permettre de me retirer à la cour du roi d'Angleterre afin de remplir ma destinée.
—Et pourquoi, s'il vous plaît, à la cour du roi d'Angleterre? dit-il d'une voix étranglée par la colère.
—C'est certainement lui, continua Agnès, que regarde la prédiction; puisque vous êtes à la veille de perdre votre royaume et que Henri va bientôt le réunir au sien, il est assurément un plus grand monarque que vous.
«Ces paroles, dit Brantôme, piquèrent si fort le coeur du roi qu'il se mit à pleurer de rage,» et courut s'enfermer dans son appartement.
Effrayée, non de la colère, mais de la douleur de son amant, Agnès Sorel essaya de le revoir; elle voulait le consoler sans doute ou pleurer avec lui. Charles VII s'obstina à ne recevoir personne. Mais le lendemain le château était plein de mouvement et de bruit, le roi faisait ses préparatifs de départ. Agnès venait enfin de réussir.
Plus tard, se souvenant de cette anecdote charmante, François Ier écrivit les vers suivants au-dessus d'un portrait de la dame de beauté:
Ici dessous, des belles gist l'élite,
Car de louanges sa beauté plus mérite,
La cause étant de France recouvrer,
Que tout cela qu'en cloistre peut ouvrer
Close nonain, ni en désert ermite.
Peu de jours après la venue si opportune de l'astrologue, une foule immense de peuple se pressait tout le long de la rampe rapide qui, des bords de la Vienne, conduit au royal château de Chinon. Depuis le matin tous les habitants de la ville et des bourgs des environs étaient sur pied, impatients de voir défiler le cortège de Charles VII, qui se décidait enfin à aller chasser les Anglais. La cour du château était trop étroite pour les gens d'armes, les pages, les écuyers, les chevaux; la brise agitait les oriflammes, les armures étincelaient au soleil.
Enfin, sur le perron, entouré de ses familiers, apparut Charles VII; la reine, quelques nobles dames et les demoiselles d'honneur, l'accompagnaient. Aux mille cris de joie qui l'accueillirent, le roi répondit par son cri de guerre «sus à l'Anglais.» Il prit alors congé de la reine, puis, s'approchant d'Agnès, «toute rougissante de honte:»
—Belle amie, murmura-t-il, souvenez-vous que c'est à vos pieds que je viendrai déposer ma couronne reconquise.
«Dès ce moment, dit un témoin oculaire, il parut à tous évident que, véritablement, la demoiselle de Fromenteau était la mie du roi.»
Tandis qu'Agnès, interdite, courbait la tête sous les regards dirigés vers elle, Charles VII s'élança à cheval; d'un dernier geste il salua les dames et demoiselles réunies sur les marches du perron, et, prenant la tête du cortège, il disparut bientôt sous la voûte étroite de la porte du château de Chinon.
Les premiers jours de solitude furent bien tristes pour la dame de beauté; elle aimait le roi, et la séparation, après tant de douces journées «passées en amoureux discours» lui semblait cruelle. Mais plus que son amant elle aimait «l'honneur et son pays.»
Loin de Charles VII d'ailleurs, Agnès se trouvait seule avec sa faute, et l'amour chez elle n'étouffa jamais le remords. Pour cette femme dévouée, les satisfactions de la puissance et de l'amour-propre étaient bien peu de chose, une douce parole, un tendre regard du roi, étaient son unique ambition. Sous les grands respects des courtisans il lui semblait toujours voir percer un secret mépris, et ce nom de concubine royale que donnait le peuple à l'amie du roi lui faisait verser bien des larmes.
La situation d'Agnès éloignée du roi n'était pas sans périls; elle avait des ennemis, et des ennemis puissants. Elle avait contrarié la politique de plus d'un et ne l'ignorait pas; mais ses dangers personnels étaient la moindre de ses préoccupations. Pour la défendre elle avait la reine dont elle resta toujours l'amie; elle avait aussi un serviteur fidèle, dévoué jusqu'à la mort, protecteur qu'en partant lui avait donné le roi, Étienne Chevalier.
L'amitié qui toujours unit l'épouse et la favorite de Charles VII a donné lieu à bien des commentaires. Quelques chroniqueurs ont supposé que la reine ignorait l'intimité des relations d'Agnès et du roi, mais cette supposition est inadmissible. Marie d'Anjou savait parfaitement qu'Agnès régnait en souveraine sur le coeur du roi, et peut-être en secret en était-elle jalouse; mais reine, avant d'être femme, elle comprit qu'il était de son intérêt, sinon de son devoir, de protéger de toutes ses forces cette favorite qui n'usait de son empire que pour le bien de l'État.
Quant au bon Étienne Chevalier, contrôleur des finances, nul plus que lui n'aima et n'admira la dame de beauté; sur un signe d'elle, il se fût précipité sans hésiter dans le brasier de «messire Satanas.» Cette grande passion, cet absolu dévouement, ont pu faire croire qu'Étienne Chevalier partageait au moins avec le roi le coeur de la belle Agnès, mais rien ne prouve cependant qu'il ait été autre chose qu'un ami.
Quelques rébus galants, quelques légendes naïves, viendraient à peine à l'appui de cette assertion. Étienne Chevalier avait l'amitié fort expansive, voilà tout. Servant fidèle d'une dame, il portait ses couleurs. Fier de son dévouement désintéressé, il tenait à honneur de l'apprendre par ses devises à l'univers entier.
Armé chevalier par le roi, qui, en lui donnant l'accolade, lui avait dit: «Chevalier désormais seras de fait comme de nom,» l'ami d'Agnès Sorel fit peindre sur son écu cet amoureux hiéroglyphe:
Le mot tant, une aile d'oiseau, le mot vaut, une selle de cheval, les mots pour qui je, et enfin un mors de bride.
Ce qui voulait dire:
Tant elle vaut, celle pour qui je meurs.
Plus tard, sur la porte de sa maison, à Paris, rue de la Verrerie, Étienne Chevalier fit graver, en grandes lettres antiques, au milieu de feuilles d'or entrelacées, ce rébus dont tout le mérite consistait à rappeler le nom de Sorel ou Surelle:
Rien sur L n'a regard.
Cependant, les soucis de la guerre ne faisaient point oublier à Charles VII sa gentille amie; au moindre instant de répit, il accourait, tantôt à Loches, tantôt à Chinon, séjour favori d'Agnès Sorel. Chaque jour, le roi se plaisait à enrichir celle qu'il aimait. Déjà il lui avait donné le duché de Penthièvre; il lui faisait construire une maison à Loches. On voit encore, en cette ville, le logis qu'occupa la dame de beauté; il est relié maintenant au spacieux château que fit plus tard bâtir Louis XI. A l'occident est une tour carrée, dans laquelle, dit la chronique du pays, le roi enfermait sa mie, lorsqu'il allait à la chasse.
C'est vers cette époque qu'Agnès commit l'imprudence d'introduire à la cour son ancienne ennemie d'enfance, cette Antoinette de Maignelais, dont la jalousie l'avait réduite à chercher un refuge près d'Isabelle de Lorraine.
Depuis longtemps, Antoinette enviait le sort d'Agnès à la cour de France; maintes fois déjà elle lui avait écrit pour la prier de la prendre près d'elle. Instinctivement, la dame de beauté redoutait sa cousine; mais au souvenir des bontés premières de sa tante de Maignelais, elle crut de son devoir d'oublier ce qui s'était passé et d'accueillir sa fille, dont grâce à son influence, elle pourrait faciliter l'établissement.
Elle dépêcha donc au château de Maignelais, son fidèle chevalier, et, moins de huit jours après, Antoinette arrivait à Chinon.
La première entrevue des deux cousines fut tout au moins singulière. Sans même songer à remercier Agnès, sans se soucier des femmes de service qui pouvaient l'entendre, Antoinette éclata en reproches amers.
—Eh quoi! cousine, est-ce bien vrai, ce que l'on dit, que vous êtes la mie du roi?
Et comme Agnès confuse ne répondait point:
—Ce bruit était venu jusqu'à nous, continua Antoinette, ma mère refusait d'y croire. Moi-même, je doutais; mais, dans mon court voyage, et depuis hier soir que je suis ici, j'ai appris d'étranges choses.
Agnès, les larmes aux yeux, voulut protester de la parfaite innocence de ses relations avec le roi; mais Antoinette était impitoyable.
—Fi, cousine, que cela est vilain; qui jamais eût pu croire, vous voyant si douce, que par vous le déshonneur arriverait sur notre maison. Vous avez donc mis en oubli toute honnêteté et toute retenue; pour moi, je ne resterai point ici plus longtemps, je préfère retourner près de ma mère que j'instruirai de la vérité, afin qu'elle arrache de son coeur toute amitié pour vous.
Cette menace épouvanta tellement Agnès, que, se jetant aux pieds de sa cousine, elle la conjura de rester, lui jurant de changer de vie, de ne plus faillir à l'honneur, de ne jamais revoir le roi.
Antoinette voulut bien, pour le moment, se contenter de ces prières et de ces promesses, et consentit à se fixer pour quelques mois à Chinon.
Le plan de la jeune Tourangelle était des plus simples: éveiller les remords dans le coeur d'Agnès, les exploiter habilement, l'engager vivement à aller pleurer ses fautes au fond de quelque monastère, et... prendre sa place à la cour et près du roi.
Mais ce beau projet échoua. En désespoir de cause, Antoinette entreprit de disputer à Agnès le coeur de Charles VII. Le roi ne fut point insensible aux meurtrières oeillades de la cousine de sa mie; mais tant que vécut la dame de beauté, elle fut toujours «la dame souveraine et la plus aimée de son amant.»
Les entrevues du roi et de sa douce maîtresse devinrent rares jusque vers 1438. Charles VII reprenait alors, pièce à pièce, son royaume aux Anglais.
—Vous voyez, ma mie, que je tiens loyalement mes promesses, disait-il, lorsqu'après quelque succès, il faisait à Loches ou à Chinon, une courte apparition.
De riches présents attestaient d'ailleurs que l'amour de Charles VII n'avait point diminué. Aux logis et aux terres que possédait déjà son amie, il avait ajouté la seigneurie de la Roche-Servière, les seigneuries de Roqueserieu, d'Issoudun en Berry et de Vernon sur Seine, enfin le château de Beauté-sur-Marne.
—Ainsi de fait, ma mie, serez ce que de nom êtes depuis longtemps déjà, châtelaine et dame de beauté.
En 1438, Charles VII vint avec toute sa cour s'établir, pour quelques mois, à Bourges. Désireux d'avoir non loin de lui sa douce amie, qui ne voulait point habiter le château royal, il lui donna, à peu de distance de la ville, une résidence charmante, le château de Bois-Trousseau, qu'elle vint habiter immédiatement.
Ce fut un heureux temps pour Charles VII et sa belle maîtresse; plus jamais ils ne retrouvèrent ces heures délicieuses «qui s'envolaient si rapides et si légères qu'on eût pu vivre ainsi plus de mille ans sans vieillir.» Le château de Bois-Trousseau, avec ses jardins et ses grands bois, abritait merveilleusement le mystère de leurs amours. Là, point d'importuns, point d'indiscrets; quelques serviteurs dévoués, muets, aveugles. Ensemble les deux amants passaient de longues soirées, aussi épris encore qu'au jour où, pour la première fois, ils avaient senti battre leur coeur. Charles racontait à sa mie ses exploits contre les Anglais, ses succès, ses espérances. Agnès, à son tour, faisait la lecture dans quelque manuscrit ou récitait des vers; car «elle était savante et bien instruite, s'étant toujours complue à la société des beaux esprits.»
Leurs amours au château de Bois-Trousseau avaient d'ailleurs commencé comme un roman de chevalerie.
C'était un soir, il pouvait être neuf heures; seule dans sa chambre, Agnès Sorel feuilletait un livre d'heures curieusement imagé, lorsqu'on vint lui annoncer qu'un chasseur égaré demandait l'hospitalité.
—Qu'on le conduise à ma plus belle chambre, répondit Agnès, et qu'on veille à ce qu'il ne manque de rien.
Quelques instants après, on revint dire à la belle châtelaine que le chasseur, comptant partir de grand matin, le lendemain, demandait à la remercier le soir même. Déjà elle se levait pour aller recevoir l'étranger, lorsqu'il parut lui-même, souriant et joyeux à la porte.
—Ah! mon cher Sire aimé s'écria Agnès, vous ici, seul à cette heure, quelle imprudence!
Cette imprudence devait se renouveler souvent.
Chaque soir, autant pour guider le roi que pour lui rappeler qu'elle l'attendait, la belle Agnès faisait allumer un falot sur la plus haute tour de son castel. A ce signal, impatiemment attendu, l'amoureux Charles VII accourait à toute bride, suivi d'un seul confident. Accoudée à son balcon, la dame de beauté inquiète, émue, interrogeait la route que suivait d'ordinaire son royal amant. L'apercevait-elle à l'extrémité de la longue avenue qui conduisait à Bois-Trousseau, légère et joyeuse, elle descendait le recevoir, et avec une grâce inimitable, lui faisait les honneurs du logis et du souper.
Parfois, bien rarement, il arrivait que le roi retenu par d'importantes affaires, qu'il maudissait du fond du coeur, ne pouvait quitter Bourges. Alors, pour répondre au signal de son amie, il faisait au sommet du château royal apparaître une vive lumière.
Seule et triste ces soirs-là, en son manoir, la douce Agnès se consolait en pensant qu'une noble ambition était sa seule rivale dans le coeur de Charles VII.
La charmante légende de ce télégraphe lumineux s'est conservée à travers les siècles, et, dans le pays, on montre encore au voyageur, au sommet d'une colline boisée, les restes d'une tour qui a gardé le nom de «la tour du signal.»
Tout entier à l'enivrement de cette existence de bonheur et d'amour, Charles VII, une fois encore, oubliait et son royaume et les Anglais. Mais Agnès se souvenait pour lui.
—Bientôt, hélas! mon cher Sire, il faudra nous séparer derechef.
—Je partirai, ma mie, répondait tristement le roi.
L'intérêt du royaume, telle fut la constante préoccupation d'Agnès Sorel, l'oeuvre de Charles VII fut la sienne, et c'est à cela qu'elle doit d'avoir trouvé grâce devant la sévère histoire qui flétrit d'ordinaire les maîtresses royales, c'est pour cela que son nom, comme un nom béni, a traversé les siècles.
Le roi de France n'était déjà plus ce monarque humilié que les Anglais railleurs appelaient «le roi de Bourges,» bientôt il allait mériter son surnom de Victorieux. L'ennemi n'était pas encore expulsé; mais on avait reconquis une bonne partie des provinces, d'heureuses nouvelles arrivaient de tous côtés, les soldats étaient nombreux, les finances commençaient à se rétablir.
Charles VII, il faut le dire, fut un prince heureux, nul autant que lui ne dut à ceux qui l'entouraient. «Le ciel et la terre, dit un vieil historien, semblent s'être réunis pour l'aider à reconquérir son royaume.»
Tout d'abord, et lorsque ses affaires paraissaient le plus désespérées, il eut Jeanne Darc, la vierge martyre, dont la miraculeuse intervention rendit le courage aux peuples désolés. Les noms de ses compagnons d'armes sont devenus les synonymes de fidélité et de courage, à ses côtés en effet, combattaient Boussac et Vignoles, Xaintrailles, La Hire, Guillaume de Barbassan, le bâtard de Dunois, et bien d'autres capitaines sans reproche et sans peur. Pour maîtresse il eut une femme belle, spirituelle, dévouée, toujours prête à s'oublier elle-même. Enfin, pour rétablir ses finances épuisées, il trouva un homme de génie, financier illustre, dans l'acception politique de ce mot, Jacques Coeur, qui, sans compter, lui ouvrit ses coffres et lui fournit de l'argent, ce nerf indispensable de la guerre.
Mais Charles VII était un prince ingrat: il avait laissé périr Jeanne Darc, nous le verrons, vers la fin de son règne, dépouiller Jacques Coeur, son argentier, son bienfaiteur.
C'est à Bourges, alors que la pénurie du roi était telle qu'il ne pouvait même pas payer une paire de souliers, que pour la première fois Jacques Coeur se présenta à la cour où chacun se racontait sa prodigieuse fortune.
Dans l'origine, l'argentier du roi n'était rien. Fils d'un pauvre et obscur pelletier du Bourbonnais, il devint bientôt l'homme le plus opulent de France. Possédant au plus haut degré le génie du commerce, il avait fait fructifier au centuple le très-mince pécule que lui avait laissé son père. A mesure que sa fortune augmentait, il étendait le cercle de ses relations. C'est ainsi qu'il était arrivé à établir des comptoirs nombreux dans le Levant et à devenir le premier négociant du monde entier.
—Sire, avait dit Agnès Sorel à son amant, faites bon accueil à Jacques Coeur, l'or n'est pas moins nécessaire que le fer, lorsqu'il s'agit de reconquérir un royaume.
Charles VII écouta son amie; très peu de temps après une première entrevue, Jacques Coeur fut nommé maître de la monnaie de Bourges, et dès lors il commença à faciliter au prince les moyens de faire la guerre à l'Anglais.
Dans la suite, Jacques Coeur eut l'administration des finances; avec la charge d'Argentier du roi. Un pareil titre équivalait à celui de fermier général. Les receveurs des provinces remettaient tous les ans une somme déterminée à l'argentier pour acquitter les dépenses de l'hôtel et des officiers. Jacques Coeur eut un pouvoir beaucoup plus étendu, puisqu'il réglait avec les provinces les contributions qu'elles devaient fournir à l'État. Il était en même temps ministre des finances et dépositaire du Trésor. Souvent il eut occasion de faire au roi des avances considérables, toujours sans intérêts, et, lorsqu'il s'agit de reconquérir la Normandie, il sacrifia, sans hésiter, deux cent mille écus d'or, somme véritablement fabuleuse pour le temps.
L'argentier était alors au comble de la faveur, Charles n'avait rien à refuser à cet ami qui largement fournissait l'or, qu'il fût question de guerre ou de plaisirs, qui payait les soldats et donnait à son maître les moyens de «danser des ballets ou de dessiner des parterres.»
—Vous êtes, messire, avec Jeanne Darc, les deux sauveurs de la France, lui disait Agnès Sorel.
De son côté Charles VII disait à son argentier:
—Vous me demanderiez ma plus belle province, que je vous la donnerais, je crois; ne vous dois-je pas ma puissance?
Vaines paroles, qu'oublia le roi lorsqu'il crut n'avoir plus besoin de son ami Jacques Coeur.
Durant les années qui suivirent les jours heureux du château de Bois-Trousseau, Agnès Sorel parut fort peu à la cour; elle habitait tantôt Loches, tantôt Chinon, le plus souvent le petit logis de Fromenteau; le roi venait passer près d'elle ses moments de liberté, ses jours s'écoulaient heureux et calmes. L'événement le plus important de cette époque de sa vie fut son entrevue avec Isabelle de Lorraine dont elle avait été demoiselle d'honneur, celle-là même qui l'avait abandonnée à la merci de l'amour du roi de France, et qui lui devait la liberté de son mari.
Agnès se faisait une fête de revoir son ancienne maîtresse. Mais la femme de René d'Anjou fut cruelle.
—«Êtes-vous donc si éhontée, lui dit-elle, que vous osiez vous présenter devant moi sans rougir, après avoir oublié la pudeur au point d'être publiquement la maîtresse du roi?»
Agnès pouvait répondre à cette Isabelle, alors si sévère, qu'elle-même l'avait poussée dans les bras du roi; mais douce et résignée, elle baissa la tête sans mot dire. Ces reproches amers lui étaient plus sensibles encore qu'autrefois ceux de sa cousine Antoinette de Maignelais.
Désolé d'être s'éparé de sa belle maîtresse, Charles VII, lors de ses fréquents voyages à Chinon ou à Bourges, se plaignait à sa mie de son obstination à demeurer loin de lui.
—Belle entre les plus belles, lui disait-il, que ne venez-vous à la cour du roi dont vous êtes l'unique souveraine?
Mais la dame de beauté préférait sa tranquille solitude. Si parfois le roi insistait pour l'emmener à Paris, si la reine joignait ses instances à celles de son époux, Agnès se jetait aux pieds de son amant et le conjurait de lui permettre de cacher au moins sa honte.
Agnès Sorel avait du reste ses raisons pour détester le séjour de Paris. Elle y était venue, en 1437, à la suite de la reine et le luxe qu'elle avait déployé en cette circonstance causa une espèce de scandale.
Agnès Sorel avait paru aux côtés de la reine vêtue de velours et de fourrures, étincelante de diamants qui faisaient éclater sa miraculeuse beauté. Les bourgeois, toujours les mêmes en tout temps et en tout pays, avaient murmuré hautement de cette grande magnificence. Des paroles malplaisantes étaient venues aux oreilles de la dame de beauté. Ces mépris, ces outrages, lui avaient fait verser bien des larmes, et elle avait dit au roi:
—«Ces Parisiens ne sont que des villains; et si j'avais cuidé qu'on ne m'eût point fait plus d'honneur en Paris, je n'y aurais jà entré ni mis le pied.»
Cependant les ennemis de la maîtresse du roi, jaloux de sa toute-puissance, s'agitaient dans l'ombre et cherchaient à la renverser.
A la tête de ces ennemis se trouvait le fils même de Charles VII, le Dauphin Louis. On est encore à s'expliquer les motifs de la haine de ce prince sombre et dissimulé. Avait-il aimé Agnès Sorel et en avait-il été repoussé comme quelques-uns le prétendent, redoutait-il simplement l'influence d'une femme spirituelle et dévouée, c'est ce qu'il est impossible de décider; toujours est-il qu'il fit tous ses efforts pour la perdre.
On était alors à la fin de l'année 1446, Charles VII et toute la cour habitaient le château de Chinon où Agnès était venue joindre le roi. «Le Dauphin, qui pensait que toute liaison entre le roi et sa mie serait rompue si celle-ci avait un autre amour et que cet amour vînt à être découvert, résolut de lui faire prendre cet amant qu'elle n'avait pas.»
Il fit donc appeler un de ses confidents, Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, l'homme le plus beau et le mieux fait de la cour, et lui donna l'ordre de se faire aimer d'Agnès.
Depuis longtemps déjà, Chabannes aimait la dame de beauté, et le rusé Louis le savait fort bien lorsqu'il choisit le comte pour être l'instrument de sa haine. Mais cet amour fut le salut d'Agnès, Chabannes ne put se résoudre à faire le malheur d'une femme aimée.
C'était une périlleuse mission que le Dauphin donnait là à son confident, et longtemps Chabannes ne sut quel parti prendre, il craignait presqu'également d'échouer et de réussir.
Bien accueilli, il avait à redouter la furieuse colère du roi, et le premier mouvement de Charles VII était terrible. Repoussé, il ne se dissimulait pas qu'il aurait en Louis un redoutable ennemi.
Il choisit un terme moyen et résolut de tromper tout à la fois le Dauphin et le roi. En conséquence, il commença à entourer Agnès de soins et d'hommages.
Toute la cour s'aperçut bientôt du grand amour du comte de Dammartin pour la dame de beauté, mais Agnès agréait-elle ou repoussait-elle ses hommages, c'est ce que les mieux informés ne savaient dire....
—Avances-ce tu nos affaires, Chabannes? demandait chaque jour le Dauphin.
Et invariablement le comte répondait.
—Je crois, monseigneur, que nos affaires sont en bonne voie.
Le Dauphin commençait à se défier de son confident, Charles VII, prévenu par quelques courtisans, commençait à prendre l'éveil, lorsqu'une scène inattendue vint mettre un terme aux assiduités de Chabannes.
Le roi revenait un soir de la chasse et regagnait seul ses appartements, lorsqu'au détour d'un corridor sombre il se trouva face à face avec Agnès Sorel.
Elle paraissait vivement émue; elle courait poursuivie par le comte.
Charles VII fronça les sourcils en les apercevant, et d'une voix sévère demanda une explication.
Agnès lui apprit alors que depuis longtemps elle était importunée par le comte. Ce soir-là, se trouvant seul avec elle il s'était jeté à ses pieds, lui parlant avec passion de son amour. Repoussé, il avait redoublé d'instances, et était bientôt devenu si pressant qu'elle avait cru devoir sortir et aller chercher un refuge dans les appartements du roi, remplis de monde à cette heure. Chabannes alors s'était élancé sur ses traces, et l'avait poursuivie jusque-là, non plus pour lui parler d'amour, mais pour la conjurer de garder le silence.
La contenance embarrassée du comte, immobile à quelques pas, prouvait au roi qu'Agnès n'avait rien dit qui ne fût l'exacte vérité.
Charles VII, à ce récit, entra dans une épouvantable colère et ordonna au comte de quitter à l'instant même le château pour ne jamais reparaître à la cour.
Chabannes, épouvanté du courroux du roi, tremblant presque pour sa vie, courut à l'appartement du Dauphin et lui raconta ce qui venait de se passer.
Louis, bien que marri de voir son projet manqué, consola son confident.
—C'est sur mes ordres que tu t'es exposé, lui dit-il; sois sûr que je ne t'abandonnerai pas; demain même je veux parler pour toi à mon père.
Le lendemain, en effet, en présence d'Agnès, Louis demanda au roi la grâce de Chabannes.
Charles VII fut inflexible; et comme le Dauphin insistait et rappelait au roi les bons et fidèles services du comte:
—Oncques, répondit le roi, cet homme ne reparaîtra en ma présence, et il se doit estimer heureux que la dame de beauté, ma mie, veuille bien se contenter de si petit châtiment pour si mortelle injure.
—Par la Pâques-Dieu! s'écria alors le Dauphin, c'est cependant cette effrontée ribaude qui cause toutes nos querelles!
Et s'avançant vers Agnès, il lui donna un soufflet.
A cet outrage, le roi bondit sur son fils et le saisit si brusquement par les épaules qu'il le fit tomber. Menaçant et terrible, il allait frapper lorsqu'Agnès, toujours généreuse, arrêta sa main.
—Revenez à vous, mon cher Sire, et songez que c'est là votre fils.
—Soit! mais qu'il quitte à l'instant Chinon, dit le roi.
Le Dauphin, dévorant sa colère, se releva lentement; pâle et sombre, il sortit sans proférer une parole, mais dans son dernier regard Agnès put lire une terrible promesse de vengeance.
Quelques chroniques, qui font allusion à cette terrible scène entre le père et le fils, disent tout simplement que «le jeune Dauphin, mal conseillé, se laissa aller envers Agnès à quelques promptitudes.»
Le mot vaut la peine d'être conservé.
Et maintenant, Agnès Sorel avait-elle partagé l'amour de Chabannes, avait-elle pour lui trahi Charles VII? S'il en est ainsi, et rien n'est moins démontré, il faut féliciter le comte de sa discrétion et de son adresse. Il sut en ce cas échapper aux nombreux espions du Dauphin qui nuit et jour surveillaient ses moindres démarches, et, plutôt que de compromettre sa dame, il se laissa héroïquement exiler.
Peu de temps après l'événement que nous venons de rapporter, Agnès Sorel quitta la cour pour n'y plus revenir. Les larmes et les prières du roi, les instances de la reine et de ses amis les plus chers, ne purent vaincre sa résolution. Retirée en son logis de Loches, elle voulait, disait-elle, finir ses jours dans cette charmante retraite, qui domine un des plus beaux sites de France, et que Charles VII s'était plu à embellir de tout ce que le luxe de l'époque offrait de plus recherché. Aucun événement, en effet, ne troubla ses dernières années; les visites du roi rompaient seules la monotone uniformité de l'existence de la dame de beauté.
Vers la fin de l'année 1448, Agnès Sorel, ayant eu connaissance d'un complot tramé contre la personne du roi, alors occupé de la conquête de la Normandie, elle se décida à sortir de sa retraite.
Elle écrivait à son «cher Sire, d'avoir à se tenir sur ses gardes,» et lui annonça que bientôt elle se mettrait en route afin de lui communiquer des détails qu'elle n'osait confier même à ceux dont elle se croyait sûre.
Dès les premiers jours de l'année suivante (1449), la dame de beauté quitta son gentil manoir pour rejoindre le roi alors à l'abbaye de Jumièges.
Mais elle ne put arriver jusque là; prise d'une indisposition subite, elle fut forcée de s'arrêter au château de Mesnil-la-Belle, situé à quelques lieues seulement de l'abbaye qu'habitait le roi.
Cette indisposition, légère au début, offrit bientôt les symptômes les plus alarmants, et en peu d'heures la vie de la dame de beauté fut en danger.
Elle ne s'abusa pas un instant sur sa position.
—Je vois bien, disait-elle, que tout est fini; jamais plus ne reverrai ma Touraine.
Elle prit alors ses dispositions dernières, recommandant ses enfants à Charles VII, pour qu'il en prît souci comme si elle n'avait point cessé de vivre.
Elle fit alors venir toutes les demoiselles attachées à son service et longuement les exhorta à la sagesse, «essayant de les convaincre par le récit de ses souffrances, endurées en secret, du peu de bonheur que l'on trouve en cette vie, lorsqu'on a cessé d'avoir le droit de supporter tous les regards sans rougir.»
Peu d'heures après, le 9 février 1449, vers six heures du soir, elle poussa quelques grands soupirs, dit: Ah! Jésus! et trépassa.
Agnès Sorel avait alors quarante ans.
Et retiré (le roi), l'hiver à Gemiège séjourne,
Là où la belle Agnès, comme lors on disait,
Vint pour lui découvrir l'emprise qu'on faisait
Contre Sa Majesté. La trahison fut telle Et tels les conjurés qu'encore on nous les cèle.... Mais las! elle ne put rompre sa destinée, Qui pour trancher ses jours l'avait ici menée Où la mort la surprit....
Ainsi s'exprime Baïf, laissant à entendre que le chef de cette conjuration, qu'Agnès allait découvrir au roi, n'était autre que le Dauphin lui-même.
La dame de beauté avait choisi pour exécuteurs testamentaires Robert Poitevin, physicien (médecin), maître Étienne Chevalier, trésorier du roi, et Jacques Coeur. Elle laissait des biens considérables qui furent répartis entre les trois filles qu'elle avait du roi, savoir:
Charlotte, qui épousa Jacques de Brézé, comte de Maulevrier; Marguerite, mariée à Prégent de Coëtivi, et Jeanne, qui devint la femme de Antoine de Beuil, comte de Sancerre.
La mort de la dame de beauté plongea Charles VII dans un morne abattement:
—J'ai perdu ma meilleure amie, disait-il à tous ceux qui l'approchaient.
Puis, jour et nuit, il se répétait comme à lui-même, les larmes aux yeux:
—Las! Las! quel malheur! mourir si jeune!
Il n'y eut qu'un cri à la cour de France:
—Agnès Sorel est morte empoisonnée!
Mais quel était l'auteur de ce crime?
Tour à tour on accusa Antoinette de Maignelais, Jacques Coeur, et enfin le Dauphin de France.
Les deux premières suppositions sont parfaitement ridicules, quant à la troisième, qui paraît avoir plus de probabilité, elle ne s'appuie sur aucune preuve.
Le Dauphin, après la mort d'Agnès, fit tout son possible pour effacer toute trace de la haine passée, et plusieurs historiens, pour prouver le peu d'inimitié qui avait dû régner entre la dame de beauté et le Dauphin, racontent le fait suivant:
Bien des années après la mort d'Agnès, le Dauphin, devenu roi, était allé prier dans l'église de Loches où la dame de beauté avait été enterrée.
Les chanoines, croyant faire leur cour au monarque, lui demandèrent l'autorisation de faire enlever de leur église la tombe de cette femme dont la vie avait été si scandaleuse.
—Je croyais, leur répondit Louis XI, que cette femme avait été votre bienfaitrice: m'a-t-on trompé, ne vous a-t-elle donc rien donné?
—Pardonnez-nous, Sire, elle nous a fait quelques présents.
—Mais quoi encore?
—Des tapisseries assez belles, des joyaux, des ornements, une image d'argent de la Madeleine.
—Sa générosité s'est-elle donc bornée là?
—Elle a encore donné au chapitre deux mille écus d'or et quelques terres.
—Vous oubliez, je crois, les terres de Fromenteau et de Bigorre: ne vous les a-t-elle donc pas octroyées par testament?
—Pardonnez-nous, Sire.
—Et c'est ainsi, reprit le roi avec toutes les marques de la plus vive indignation, que vous gardez la mémoire de celle qui fut votre bienfaitrice! Non-seulement je vous défends de troubler ses cendres, mais je veux que son tombeau soit plus respecté qu'il ne l'est.
Puis, comme l'un des chanoines essayait de se disculper:
—Souvenez-vous, dit encore Louis XI, de ne jamais mériter que je vous fasse rendre tout ce que vous a donné dame Agnès Sorel.
Cette anecdote, il est vrai, ne prouve absolument rien. Car si les uns y voient une marque d'amitié et de bon souvenir pour une femme qui en était si digne, d'autres, au contraire, y découvrent un trait d'habile politique d'un prince qui donna tant d'exemples de sa profonde dissimulation.
Antoinette de Maignelais détestait sa cousine; elle en était jalouse, mais non pas au point de l'empoisonner; les moyens d'ailleurs lui eussent manqué. Ambitieuse et coquette, Antoinette avait tenté de supplanter Agnès Sorel dans le coeur de Charles VII; elle n'y put réussir, mais elle eut la joie de recueillir la succession de la dame de beauté; elle fut la maîtresse du roi, mais ne fut jamais son amie.
Quant à Jacques Coeur, il ne put lui venir à l'idée d'attenter aux jours d'Agnès; en elle, au contraire, il perdit sa plus fidèle protectrice.
Les mauvais jours, hélas! ne tardèrent pas à venir pour l'argentier de Charles VII. Le roi croyait pouvoir se passer de lui, ses ennemis levèrent la tête.
La fortune de Jacques Coeur était alors à son apogée, ses richesses étaient si grandes que les plus crédules assuraient que Raymond Lulle, mort cependant depuis plus de cent quarante ans, lui avait communiqué le secret de faire de l'or.
Les courtisans détestaient Jacques Coeur, dont le faste royal les écrasait; ils lui enviaient ses terres, ses châteaux, ses palais. Presque tous étaient ses débiteurs pour des sommes considérables: ils se dirent qu'avec le créancier disparaîtrait la dette. La perte du malheureux fut donc résolue; la dame de beauté n'était plus là pour le défendre, la reconnaissance pesait à Charles VII. L'argentier succomba.
On l'accusa d'abord d'avoir empoisonné Agnès, et Anne de Vendôme, femme de François de Montberon se chargea du rôle d'accusatrice.
Jacques Coeur fut donc arrêté; mais il se disculpa si complètement, il prouva si bien que cette femme, qui l'avait choisi pour exécuter ses volontés dernières, était son amie, qu'il fut remis en liberté et que la dame de Vendôme fut condamnée à lui faire amende honorable.
Ses ennemis ne se tinrent pas pour battus, ils l'accusèrent de concussion.
Une fois encore, l'argentier du roi fut arrêté et conduit à Poitiers. Son procès s'instruisit rapidement, on ne voulut même pas lui permettre de se défendre; à tout prix il fallait le trouver coupable.
Ses juges ne purent le convaincre d'aucun des crimes dont on l'accusait, et cependant, aux mépris de toutes les lois divines et humaines, il fut condamné. L'arrêt portait que Jacques Coeur «durement atteint des crimes à lui imputés avait encouru la peine de mort que le roi lui remettait en considération de certains services rendus et à la recommandation du Pape.
Il va sans dire que tous les biens de l'argentier de Charles VII furent confisqués et partagés entre ses ennemis.
Moins ingrats que le roi, les commis de cet homme véritablement malheureux, se cotisèrent pour lui venir en aide et lui offrirent 60,000 écus d'or.
Jacques Coeur, profondément touché de ce témoignage d'estime et de reconnaissance, ne crut pas devoir refuser. Avec la même intelligence et le même bonheur il recommença l'édifice de sa fortune, et, en peu d'années, le commerce lui rendit tout ce qu'il avait perdu.
—Je jure, disait-il à ses derniers moments, que je n'ai jamais trahi le roi! je jure que je suis innocent de la mort d'Agnès Sorel.
Jacques Coeur, aimé et estimé de tous ceux qui l'avaient approché, mourut à l'île de Chio, où l'on voit encore son tombeau.
Plus lard, ses enfants firent casser comme nul, manifestement et expressément injuste, le jugement qui l'avait condamné, mais déjà depuis longtemps l'opinion publique avait réhabilité cet homme de bien.
Après la mort d'Agnès Sorel, Charles VII resta toujours triste et sombre. Antoinette de Maignelais ne fut jamais pour lui qu'une maîtresse vulgaire. Les dernières années du règne de l'amant de la dame de beauté furent d'ailleurs troublées par les perpétuelles rébellions du dauphin Louis.
Le roi en était arrivé à redouter tellement son fils, que, craignant d'être empoisonné par lui, il se laissa mourir de faim (22 juillet 1461).
Au nom de la dame de beauté sont restées attachées bien des légendes poétiques, récits naïfs que l'on conte en Touraine, ce riant pays de ses amours.
Il ne reste plus rien, dans l'église de Loches, du tombeau d'Agnès Sorel; sur un socle de marbre noir était sa statue couchée, deux anges, deux amours plutôt, soutenaient l'oreiller sur lequel reposait sa tête.
Il n'y a plus aujourd'hui à Loches qu'un froid monument, dans l'une des tours du château; une barbare inscription y «relate le nom de tous ceux qui contribuèrent à la translation de ce mausolée, restauré avec les fonds votés par le conseil général.»
Il était cependant si facile d'y écrire la charmante strophe de François Ier, ou seulement les deux derniers vers du poème de Baïf:
Agnès de belle Agnès portera le surnom
Tant que de la beauté beauté sera le nom.