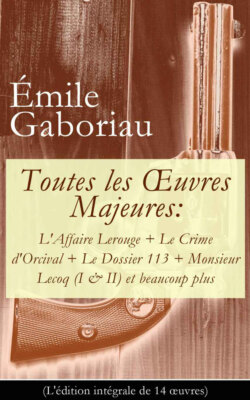Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI LES FEMMES DE LA RÉGENCE.
MADAME D'ARGENTON.—LA MARQUISE DE PARABÈRE.
ОглавлениеTable des matières
Un abîme sépare les deux règnes si différents de Louis XIV et de Louis XV, un abîme ou un cloaque, la Régence. Il fallait une transition; Philippe d'Orléans est le trait-d'union qui relie ces deux rois, contrastes vivants. Louis XIV avait conduit la monarchie à l'abîme, Louis XV la conduit à l'égout, il verse dans la boue le char de la royauté. Pour régner, il fallait au grand roi les enivrements de son Olympe de Versailles, les pompes d'une apothéose de tous les instants; plus modeste dans ses goûts, le Bien-Aimé ne se sent à l'aise que dans les petits appartements, et son sanctuaire d'élection sera le boudoir d'une courtisane.
À tort, cependant, on imputerait à Philippe d'avoir préparé le règne de Louis XV; le régent, nous ne parlons ici que de l'homme d'État, fut la première victime de la politique de Louis XIV; il dut payer les frais de l'apothéose. Pour tout héritage à recueillir sans bénéfice d'inventaire, le grand roi laissait la France saccagée, ruinée, ensanglantée, et deux milliards six cents millions de dettes. Une catastrophe était inévitable; le régent eut le mérite de la retarder. On lui jette à la face cette grande duperie du système, mais il n'avait pas à choisir; Saint-Simon lui conseillait une banqueroute pure et simple; il préféra le système de Law, qui du moins semblait sauver les apparences, et la banque de l'aventurier avait encore plus de chances que les projets des frères Pâris.
La débâcle des mœurs n'est pas plus le fait du régent que la débâcle des finances. Après avoir, trente ans durant, donné au monde l'étrange spectacle d'un roi de France vivant au milieu de sa cour comme un sultan au fond de son sérail, après avoir glorifié l'adultère et lâché la bride à toutes les passions, Louis XIV crut pouvoir, du jour au lendemain, réformer les mœurs dépravées par son exemple. Étrange erreur! Parce qu'il se convertissait dans les bras de madame de Maintenon, il crut que toute la cour allait le suivre sérieusement dans cette voie nouvelle et se convertir aussi. En effet, tous les courtisans prirent le masque de la vertu. Mais sous ce voile de triste austérité qui ravissait le vieux monarque, la corruption fit encore des progrès.
On s'en aperçoit, à la mort de Louis XIV; tous les masques tombent. La réaction arrive, d'autant plus furieuse que la contrainte a été plus grande; chacun semble vouloir se dédommager, «on avait été gêné, on ne se gêne plus.» La licence devient effroyable, les désordres insensés. Il semble que tous les liens qui retiennent la société sont près de se rompre; plus de morale, plus de retenue; on n'a plus qu'une hypocrisie, celle du vice. Rien ne surnage dans ce grand naufrage des mœurs, toute la noblesse se donne la main pour cette ronde infernale, la famille même ne subsiste plus, le mariage est ridiculisé, la fidélité conjugale bafouée, les grands seigneurs prennent leurs maîtresses au coin des rues, et les grandes dames, ouvrant leur lit à la populace, se font gloire d'y faire passer tout Paris.
Le régent, malheureusement, suivait l'exemple général, mais au moins ne songea-t-il jamais à se faire honneur de ses désordres. Il sut faire deux parts bien distinctes de sa vie: il donnait le jour aux affaires, la nuit à la débauche, et jamais la nuit n'empiéta sur le jour, c'est-à-dire que jamais aucune de ses maîtresses n'influença sa politique: roués et rouées, convives de ses soupers, favoris et maîtresses, n'obtinrent jamais le moindre rôle politique. Il détestait «les hommes qui se grisaient à demi et les femmes qui parlaient d'affaires.» Ni les uns ni les autres ne purent jamais lui tirer un secret d'État.—«Je ne donne point d'audience sur l'oreiller,» disait-il à une belle dame qui s'était avisée de lui parler des affaires d'Espagne. Une autre fois, il conduisait devant une glace une de ses maîtresses qui avait voulu essayer de causer politique.—«Comment une si jolie bouche, lui dit-il, peut-elle prononcer d'aussi vilains mots?»
Aussi aucune des femmes aimées du régent n'appartient à l'histoire; elles dominent l'homme privé, mais leur pouvoir s'arrête à l'homme d'État. Tout au plus sont-elles du ressort de la chronique; elles restent dans le huis-clos des petits appartements, et rien ne signale dans les affaires le passage de ces favorites d'un jour.
À part la vie privée, et il n'en est pas pour les gouvernants, le duc d'Orléans tient une place honorable dans l'histoire; «et quand Louis XV, devenu homme et roi, se rappela son enfance chétive et souffreteuse, grande dut être sa reconnaissance pour le tuteur, pour l'oncle qui, en dépit de la nature, l'avait rendu à la vie et au trône.»
Peu d'hommes cependant ont été plus indignement calomniés que Philippe d'Orléans; il n'est pas de crime dont on ne l'ait accusé, de dépravation qu'on ne lui reproche, de forfait qui ne semble naturel venant de lui. Ce devait être sa destinée; et il passa le moitié de sa vie à essayer de démontrer l'insigne fausseté des soupçons atroces qui pesaient sur lui. Dans les dernières années de Louis XIV, n'avait-on pas voulu voir en lui l'auteur de ces morts mystérieuses qui décimaient la famille royale!
À la mort de Louis XIV, lorsque le parlement eut cassé le testament qui léguait la régence au duc du Maine, le bâtard favori de madame de Maintenon, lorsque Philippe d'Orléans eut pris la direction des affaires, on essaya de faire revivre ces accusations insensées, et Lagrange-Chancel, le poëte des haines et des vengeances de la petite cour de Sceaux, adresse au jeune roi sa première Philippique:
Royal enfant, jeune monarque,
Ce coup a réglé ton destin;
Pour lui, l'inévitable Parque
Un jour te fera son butin.
Tant qu'on te verra sans défense
Dans une assez paisible enfance
On laissera couler tes jours;
Mais quand, par le secours de l'âge,
Tes yeux s'ouvriront davantage,
On les fermera pour toujours.
N'est-il pas temps de le dire? si jamais une main versa le poison aux héritiers légitimes du trône de Louis XIV, ce n'est assurément pas celle du duc d'Orléans.
Le régent, ainsi que le disait Louis XIV, ne fut qu'un fanfaron de vices. Homme ennuyé avant tout, peut-être avait-il toutes les dépravations, mais il était incapable d'un crime, et tant qu'il eut la toute-puissance, on ne peut lui reprocher une cruauté. Il versa des larmes le jour où l'on exécutait ceux qui avaient comploté sa mort, et il les eût graciés sans l'inflexible résistance de Dubois.
«M. le duc d'Orléans, dit Saint-Simon, était de taille médiocre au plus, fort, plein sans être gros, l'air et le port aisé et fort noble, le visage large, agréable, fort haut en couleur, le poil noir et la perruque de même. Quoiqu'il eût médiocrement réussi à l'académie, il avait dans le visage, dans le geste, dans toutes ses manières, une grâce infinie, et si naturelle qu'elle venait jusqu'à ses moindres actions. Il était doux, accueillant, ouvert, d'un accès facile et charmant, le son de la voix agréable, et un don de la parole qui lui était naturel en quelque genre que ce pût être.... Il excellait à parler sur-le-champ, et en justesse et en vivacité, soit de bons mots, soit de reparties.»
Tel était ce prince, qui avait toutes les grâces et tous les défauts de la faiblesse; on déplore ses déportements, on maudit ses désordres, et cependant on ne peut se défendre d'une certaine sympathie pour lui.
Élevé par un précepteur profondément corrompu, et dont l'occupation fut d'inoculer tous les vices à son élève, Philippe commença de bonne heure ses fredaines amoureuses:
Chez les âmes bien nées,
La valeur n'attend pas le nombre des années.
Il n'avait pas encore treize ans, lorsque «une dame de qualité» s'avisa de faire son éducation. La leçon profita, et dès l'année suivante il eut un enfant «de la petite Léonore, fille du concierge du garde-meuble du Palais-Royal.»
À dater de ce moment, on suit dans les mémoires de Madame, mère du régent, toutes les passions de son fils; elle semble déplorer ses égarements, mais elle les enregistre avec une scrupuleuse exactitude et même une certaine complaisance.
«Mon fils, dit-elle, n'a pas du tout les manières propres à se faire aimer; il est incapable de ressentir une passion et d'avoir longtemps de l'attachement pour la même personne. D'un autre côté, ses manières ne sont pas assez polies et assez séduisantes pour qu'il prétende à se faire aimer.... Tout le monde ne lui plaît pas. Le grand air lui convient moins que l'air déhanché et dégingandé comme celui des danseuses de l'Opéra. J'en ris souvent avec lui.... Mon fils n'est pas délicat; pourvu que les dames soient de bonne humeur, qu'elles boivent et mangent goulument, et qu'elles soient fraîches, elles n'ont même pas besoin d'avoir de la beauté.»
Madame, on le voit, semble prendre assez allègrement son parti des goûts de son fils; il n'est qu'une femme qu'elle ne lui pardonne pas, sa femme légitime. On sait que le jour où le duc d'Orléans, qui épousait malgré lui mademoiselle de Blois, fille légitimée du roi et de madame de Montespan, vint annoncer ce mariage à sa mère, elle répondit par un soufflet.
La duchesse d'Orléans tient une fort petite place dans la vie de son mari. «Peu m'importe qu'il m'aime, ou non, avait-elle dit, pourvu qu'il m'épouse.» Son désir fut exaucé. Le duc d'Orléans, lorsqu'il lui parlait, l'appelait madame Lucifer, et «elle convenait que ce nom ne lui déplaisait pas.»
Mais revenons au jeune duc d'Orléans. On comprend qu'avec ses théories en amour, il eut bientôt nombre de noms sur sa liste; d'ailleurs il s'adressait où il savait fort bien ne pas devoir être repoussé: aussi le mot de «conquêtes,» que Madame emploie, est-il une insigne flatterie.
C'est au théâtre que le duc d'Orléans alla chercher ses premières maîtresses. «La Grandval, comédienne, disent les Mémoires de Maurepas, succéda à Léonore, mais on s'opposa à cette intrigue, parce qu'on trouvait cette fille trop vieille et trop corrompue pour lui.»
Une actrice charmante, arrière-petite-fille de la Champmeslé, Ernestine-Antoinette-Charlotte Desmares, prit la place de la Grandval; elle ne la garda pas longtemps, et pourtant cet amour de comédie eut quatre ou cinq rechutes. Madame signale cette nouvelle conquête: «Mon fils a eu de la Desmares une petite fille. Elle aurait bien voulu lui mettre sur le corps un autre enfant, mais il a répondu:—Non, celui-ci est par trop arlequin.»
Mademoiselle Desmares, en effet, ne se piquait pas d'une bien exacte fidélité, et la porte de son boudoir s'ouvrait à tout venant.
On vit de la même façon
Chez Desmares que chez Fillon,
assure une annonce du temps. Mais Philippe ne s'en souciait guère, et la preuve, c'est que dès le lendemain de la rupture définitive, ou la veille, il alla porter son cœur chez une princesse de l'Opéra.
La danseuse Florence, admirablement belle, adorablement sotte, eut le pouvoir, avec l'aide de quelques-unes de ses amies, de retenir quelque temps le futur régent, elle en eut même un fils, cet abbé de Saint-Albin, favori de Madame, «le seul des enfants naturels du duc d'Orléans qui eût véritablement un air de famille.»
Mais il est impossible de suivre, même au vol de la plume, les aventures sans nombre de Philippe, en un temps où, jaloux avant tout de se faire une réputation solide de débauché, il courait de boudoir en boudoir, effeuillant sa vie et son cœur à tous les vents des passions; mieux vaut tourner brusquement quelques feuillets et arriver au premier, au seul amour probablement du duc d'Orléans.
Quoi, Philippe amoureux? Hélas! oui. Une fois en sa vie il subit la loi commune. Sérieusement épris, on crut un instant qu'il allait devenir fidèle. Les beaux yeux de mademoiselle de Séry, la plus gracieuse des filles d'honneur de Madame, opérèrent ce miracle. «C'était, dit Saint-Simon, une jeune personne de condition, sans aucun bien, jolie, piquante, d'un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu'il promettait.»
Discret «pour cette fois seulement,» le duc d'Orléans entoura d'abord son amour d'un tendre mystère, il écrivait des billets doux et rimait en secret pour sa belle:
Tircis me disait un jour:
Je ne connaîtrais pas l'amour,
Sans vous Philis, je vous le jure,
Sans vous, Philis.
Quand on a dépeint la beauté,
On n'a jamais représenté
Que vous, Philis.
Une grossesse malencontreuse vint par malheur révéler les faiblesses de mademoiselle de Séry. Philippe ne l'en aima que davantage; et comme elle ne pouvait, dans son état, continuer à porter ce titre de demoiselle, il lui fit présent de la terre d'Argenton, et à force d'instances obtint de Louis XIV, pour son amie, la faveur signalée de s'appeler désormais madame.
C'est le beau moment des amours de mademoiselle de Séry, devenue madame d'Argenton. Douce, modeste, bienveillante, toujours disposée à rendre service, elle sut se faire accepter de tous; autour d'elle, au Palais-Royal, elle s'était fait comme une petite cour de femmes aimables et spirituelles, et Philippe passait presque toutes ses soirées dans ces réunions intimes qu'il animait et égayait par son esprit charmant et sa verve facile.
Malheureusement pour elle, madame d'Argenton voulut user de son influence sur le duc d'Orléans pour le transformer, pour en faire un homme; elle réussit à demi, et une bonne partie de l'honneur qu'acquit son amant en Italie et en Espagne lui revient de droit.
Ce fut là sa perte. Madame de Maintenon qui, toute dévouée à la fortune du duc du Maine et des autres bâtards, voyait avec inquiétude grandir la popularité du duc d'Orléans, entreprit de faire renvoyer cette maîtresse dangereuse, assez hardie pour inspirer à son amant de nobles sentiments. Rien n'était impossible à l'élève du père Gobelin: elle porta au tribunal du roi les plus étranges accusations contre le duc d'Orléans, et les calomnies portèrent si bien leurs fruits que le prince se trouva dans cette alternative cruelle, de subir la colère royale ou de renvoyer sa maîtresse. Il hésitait; le duc de Saint-Simon le décida en lui prouvant que par ce sacrifice il désarmait la cour, toujours si hostile à sa famille. Le renvoi de madame d'Argenton fut résolu, et mademoiselle de Chausseraye fut chargée d'aller annoncer à l'infortunée cette rupture, qui la surprit comme un coup de foudre. Philippe, lui, retourna à la Desmares; il lui fallait une chaîne.
La cour battit des mains à la décision du duc d'Orléans, ou du moins fit semblant; mais le public fut indigné, et les chansonniers, les interprètes de l'opinion, commencèrent contre le jeune prince un feu roulant de couplets satiriques.
D'Orléans va bien s'amuser
Avec les maîtres à chanter,
Et le grand œuvre il pourra faire,
Lère, là, lanlère.
Quand la Séry le possédoit,
Mieux des trois-quarts il en valoit;
Maintenant il n'est bon qu'à faire
Lère, là, lanlère.
L'épigramme suivante est plus explicite encore:
Philippe ayant eu la faiblesse
De proscrire la d'Argenton,
Désormais n'aura pour maîtresse
Qu'une élève de la Fillon.
Il fait succéder à la gloire
La musique et la volupté:
On le nommera dans l'histoire
Le héros de l'oisiveté.
Le bon sens public ne se trompait pas. Après le départ de madame d'Argenton, le duc d'Orléans sembla se résigner à ce rôle de prince oisif que lui imposait la volonté du roi et de madame de Maintenon. Renonçant à toute légitime ambition, il reprit avec la Desmares ses habitudes décousues, «et ne sembla plus occupé qu'à soutenir sa réputation de premier débauché du royaume.»
Avec madame de Parabère, qui recueillit et partagea avec beaucoup d'autres l'héritage de madame d'Argenton, nous entrons en pleine régence; elle inaugure ces soupers qui de nuit en nuit croissent en licence, dégénèrent en orgies, et finissent par les saturnales des fêtes d'Adam. Digne maîtresse d'un homme comme le régent, madame de Parabère semble créée expressément pour lui; ils s'entendent, ils se comprennent, ils s'aiment même autant qu'ils peuvent aimer. Point de brouilles, point de jalousies mesquines, ils portent gaîment la chaîne de leur union illégitime, et n'hésitent point à se faire aider lorsqu'elle leur devient trop lourde.
Marie-Madeleine de La Vieuville appartenait à une famille où la légèreté semblait héréditaire chez les femmes. Sa mère, madame de La Vieuville, avait fait beaucoup parler d'elle, ainsi que le témoigne maint couplet du recueil Maurepas. Devenue vieille, elle tourna à la dévotion et entreprit de défendre la vertu de sa fille mieux qu'elle n'avait défendu la sienne. C'était une tâche difficile. La jeune Marie-Madeleine annonça de bonne heure tout ce qu'elle tint depuis. Vive, légère, audacieuse, elle essayait déjà la portée de ses œillades meurtrières, et toute la vigilance d'une maman expérimentée ne l'empêcha pas de se mettre en coquetterie réglée avec «plus d'un soupirant, et il y en avait bon nombre.» Mais ce n'étaient encore qu'escarmouches sans conséquence, sinon sans danger; des billets doux et quelques petits présents entretinrent seuls ces innocentes amitiés. Elle redoutait cependant assez sa mère pour se cacher d'elle autant que possible, et cette petite hypocrisie lui avait valu le surnom de Sainte n'y touche.
Quand sa mère approchait,
Faisait la souche,
Pas un mot ne disait,
Mais quand elle sortait....
Elle sortait rarement, il faut le dire, cette mère modèle, et la mort seule débarrassa Marie-Madeleine d'une surveillance qui lui pesait horriblement. Libre, elle se dédommagea de sa contrainte, car la colère de son mari ne l'effraya jamais assez pour l'empêcher de suivre ses goûts.
C'est en 1741 que mademoiselle de La Vieuville épousa le marquis de Parabère, bon gentilhomme du Poitou, qui sans doute ne s'attendait guère à l'illustration que sa femme donnerait au nom de ses aïeux. «C'était un fort pauvre homme en tout que ce mari,» dit Saint-Simon. «Borné d'esprit et de cœur, et sot avant de le devenir, ce qui ne tarda pas longtemps.»
Le marquis de Parabère ne commença à se soucier de sa femme que le jour où il s'aperçut que définitivement il était le seul à ne point avoir part à ses faveurs. Alors ne s'avisa-t-il pas de devenir jaloux?
La marquise lui prouva qu'il avait tort, et désormais il noya ses soupçons dans les pots.
C'est chez madame de Berry que le duc d'Orléans s'éprit de madame de Parabère. «Il aimait les victoires faciles, il tomba bien; à peine y eut-il un souper entre la première parole échangée et le premier rendez-vous.»
Les nombreux portraits qui nous sont restés de madame de Parabère expliquent l'attachement du régent pour elle. Il ne tarda pas à reconnaître en sa nouvelle maîtresse tous les défauts, tous les vices qu'il adorait, et qui étaient pour lui autant de charmes.
«Elle était vive, légère, capricieuse, hautaine, emportée; le séjour de la cour et la société du régent eurent bientôt développé cet heureux naturel. L'originalité de son esprit éclata sans retenue; ses traits malins atteignaient tout le monde, excepté le régent; et, dès lors, elle devint l'âme de tous ses plaisirs, quand ses plaisirs n'étaient pas des débauches. Il faut ajouter qu'aucun vil intérêt, qu'aucune idée d'ambition n'entrait dans la conduite de la comtesse. Elle aimait le régent pour lui; elle recherchait en lui le convive charmant, l'homme aimable, et se plaisait à méconnaître, à braver même le pouvoir et les transports jaloux du prince.»
Rien de plus vrai que cette esquisse, sauf pourtant la restriction à propos des débauches, dont au contraire elle devint la reine: quelques traits de Madame ne laissent à cet égard aucun doute:
«Mon fils dit qu'il s'était attaché à la Parabère parce qu'elle ne songe à rien, si ce n'est à se divertir, et qu'elle ne se mêle d'aucune affaire. Ce serait très-bien si elle n'était pas si ivrognesse.»
«Mon fils a une maudite maîtresse qui boit comme un trou et qui lui est infidèle; mais comme elle ne lui demande pas un cheveu, il n'en est pas jaloux.
«Elle est capable de manger et boire, et de débiter des étourderies; cela divertit mon fils et lui fait oublier tous ses travaux.»
Cette passion de l'orgie était ce que le duc d'Orléans aimait le plus en madame de Parabère. Grand buveur qui portait mal le vin, le régent admirait cette folle femme, «qui portait le champagne aussi légèrement que l'amour.»
«Ce n'est pas elle, en effet, dit M. de Lescure, le très-spirituel et très-érudit historien de la vie privée du duc d'Orléans[40], ce n'est pas madame de Parabère qui se fût exposée, comme madame d'Averne, à la honte de mourir d'indigestion. Elle avait l'héroïsme du plaisir. Tout nerfs, cette femme, frêle en apparence, apportait dans ces défis sensuels chaque soir jetés à la force humaine, une santé d'acier. Les convives s'abaissaient successivement sous la table, comme écrasés par une main invisible. Seule, madame de Parabère, toujours souriante, souriait au dernier buveur; seule, toujours la coupe à la main, elle défiait le dernier rieur. Et, quand elle s'était assez rassasiée de lumière, de parfums, de rires et de chansons, elle daignait laisser tomber sa paupière sur son œil toujours étincelant, et abdiquait un moment la royauté du festin. Une heure de repos lui suffisait pour se relever plus fraîche que les roses de son sein, plus disposée que jamais à rire d'un bon mot ou à goûter d'un bon cœur.»
Il faut passer légèrement sur les soupers qui firent de la vie du régent une perpétuelle saturnale, les détails sont de nature à faire monter le rouge au front d'un agent de la police secrète; mais il est nécessaire cependant de les indiquer, ils tiennent une trop large place dans la vie du duc d'Orléans, et d'ailleurs ils sont un des traits caractéristiques de cette époque étrange.
Arrivé au pouvoir par la mort de Louis XIV, libre enfin, mais chargé du poids écrasant d'un royaume presqu'en ruines, Philippe entreprit de faire marcher de front la politique et le
plaisir. Il fit deux parts de son existence, bien distinctes, bien séparées. Le jour, depuis sept heures du matin, appartenait aux affaires, son temps était réglé avec une précision digne de l'étiquette de Louis XIV; mais à six heures du soir l'homme d'Etat disparaissait pour faire place au débauché.
De six heures du soir au lendemain, plus de régent; pour l'affaire la plus urgente il ne se fût point levé de table, personne même n'eût osé lui proposer de se déranger. Dubois, le bizarre ministre de ce prince extraordinaire, l'essaya une ou deux fois en des cas extrêmes, il fut repoussé avec perte.
Toute la nuit, le régent courait dans des carrosses étrangers, soupant chez l'un, chez l'autre, dans les petites maisons de ses favoris, à Asnières, à Saint-Cloud, mais le plus souvent au Palais-Royal.
Messieurs les roués, ses amis, gens dignes de la roue, disent les étymologistes, étaient ses convives ordinaires, les compagnons de toutes ses débauches.
Ce sont messieurs les libertins,
Gens à bombances, à festins,
Gros garçons à vastes bedaines,
Aimant bien gentilles fredaines,
Traits malins et joyeux propos,
Bref, gens tout ronds et point cagots.
C'étaient Nocé, que Madame appelle un diable vert, noir et jaune foncé, La Fare, le duc de Noailles, Broglie, Canillac, Biron, Nancré, et bien d'autres encore.
En femmes, c'étaient toutes les femmes, grandes dames ou filles d'Opéra, mesdames de Parabère, d'Averne, de Phalaris, de Sabran, la princesse de Léon, Emilie Dupré, madame de Gesvres, la Le Roy, madame de Flavacourt, les deux sœurs Souris; la liste n'en finit pas. Toutes les femmes peuvent prétendre à l'honneur des soupers du Palais-Royal, il ne s'agit que d'être jolie ou spirituelle, de tenir haut son verre, d'être vive à la riposte, et de ne jamais rougir.
L'égalité la plus absolue existe autour de la table du «bon régent.»
Là, dit Saint-Simon, dans ces appartements secrets dont on avait fait sortir tous les domestiques, «quand on avoit assez bu, assez dit des ordures à gorge déployée, et des impiétés à qui mieux mieux,» et «que l'ivresse complète avoit mis les convives hors d'état de parler et de s'entendre, ceux qui pouvoient encore marcher se retiroient. On emportoit les autres. Et tous les jours se ressembloient. Le régent, pendant la première heure de son lever, étoit encore si appesanti, si offusqué des fumées du vin, qu'on lui auroit fait signer ce qu'on auroit voulu.»
Si secrètes que fussent ces orgies, il en transpirait toujours quelque chose, et, comme pour fouetter l'indignation publique, Lagrange-Chancel donnait libre cours à sa haine, et poursuivait ses philippiques, que la cour de Sceaux faisait distribuer par tous les moyens, et qui de main en main arrivaient toujours jusqu'à Philippe d'Orléans:
Suis-le dans cette autre Caprée,
Où non loin des yeux de Paris
Tu te vois bien mieux célébrée
Que dans l'île que tu chéris.
Vers cet impudique Tibère
Conduis Sabran et Parabère,
Rivales sans dissension,
Et pour achever l'allégresse
Mène Priape à la princesse
Sous la figure de Rion.
Vainqueur de l'Inde, Dieu d'Erice,
Soyez les âmes du festin;
Faites que tout y renchérisse
Sur Pétrone et sur l'Arétin;
Que plus d'une infâme posture,
Plus d'un outrage à la nature
Excitent d'impudiques ris,
Et que chaque digne convive
Y trace une peinture vive
De Capoue et de Sybaris.
Dans ces saturnales augustes,
Mettez au rang de vos égaux
Et vos gardes les plus robustes
Et vos esclaves les plus beaux;
Que la faveur ni la puissance,
La fortune ni la naissance
N'y puissent remporter le prix;
Mais que sur tout autre préside
Quiconque a la vigueur d'Alcide
Sous le visage de Pâris.
Malheureusement cet effroyable tableau de Lagrange ne s'éloigne point assez de la vérité pour qu'on puisse l'accuser de calomnie, et il explique la colère du peuple, qui plus d'une fois entoura en tumulte le Palais-Royal, ou poussa des cris menaçants sur le passage du régent.—À l'eau! à l'eau! à l'eau! hurlaient un jour des forcenés qui avaient entouré sa voiture. C'étaient pour lui comme des avertissements terribles; mais il n'en tenait compte, pas plus que des avis des médecins qui chaque jour lui disaient qu'à continuer son genre de vie il se tuerait infailliblement.
Usé par la débauche, excédé de la vie, il se précipitait dans l'orgie avec une fureur qui tenait de la folie. Depuis longtemps il ne se soutenait plus qu'à force d'excitants mortels, et chaque matin, pour retrouver sa raison et sa lucidité au milieu des vapeurs de l'ivresse, il lui fallait une incroyable énergie.
Madame de Parabère, le petit corbeau brun des jours de tendresse, était déjà bien loin. Tandis qu'elle trompait,—si tromperie il y a,—le régent pour Richelieu, Richelieu pour Nocé, Nocé pour bien d'autres, Philippe avait de son côté cherché des consolations, et les consolations ne lui avaient point fait défaut; tour à tour ou simultanément, il aima madame de Sabran, madame d'Averne et madame de Phalaris, sans compter le corps de ballet tout entier, les élèves de la Fillon, et bien d'autres qu'on vint lui offrir ou qui seules vinrent au-devant de lui.
Un souper vit commencer et finir le règne de madame de Sabran; elle avait le vin mauvais. C'est elle qui, à une de ces fêtes où «s'encanaillait, en compagnie du maître, toute la noblesse de France, se leva chancelante, et prononça ce mot terrible:—L'âme des princes est faite d'une boue à part, la même qui sert pour l'âme des laquais.»
Le régent prit la chose en riant, et les blasphèmes continuèrent; mais madame de Sabran ne pouvait plus être la maîtresse de Philippe, elle le comprit, et se retira, se réservant seulement le rôle d'amie, et le droit de présenter les postulantes aux faveurs du régent. Philippe la méprise, mais elle le lui rend bien, et se redressant sous l'injure: «Gare à la mouche, s'écrie-t-elle, qui n'est plus que la mouche du coche, mais qui pique.»
Les couplets du temps n'ont point failli à mettre en chanson le triste rôle de madame de Sabran:
Sabran, leste et piquante,
Conduisait Phalaris,
Comme la présidente,
Si célèbre à Paris.
Je cherche le régent. Voici bien son affaire,
Chez le petit poupon,—don, don;
Enfin il arriva,—là, là,
Mais avec Parabère.
Madame d'Averne, livrée par un époux complaisant, n'eut pas sur le régent plus d'empire que toutes les autres, non plus que madame de Phalaris, à qui était réservée cette épouvante de le voir mourir entre ses bras.
Le duc d'Orléans était plus malade que jamais, lorsque mourut Dubois; seul il voulut se charger des affaires, sans pour cela renoncer à ses orgies de chaque nuit; le faix était trop lourd, il l'écrasa.
Sa mort, en tout point, fut digne de sa vie, ce fut presqu'un suicide; il savait une apoplexie imminente et ne voulait pas se laisser même saigner; bien plus, il fit tout ce qui dépendait de lui pour hâter les progrès du mal. Cette mort, qu'il appelait de tous ses vœux, arriva enfin.
Le 2 décembre 1723, il venait de donner une audience et passait dans son cabinet, lorsqu'il aperçut madame de Phalaris.
—Entrez donc, duchesse, lui dit-il, je suis bien aise de vous voir; vous m'égaierez avec vos contes; j'ai grand mal à la tête.
À peine furent-ils seuls ensemble, que le régent, s'affaissant sur lui-même, glissa sur le tapis et resta sans mouvement. La Phalaris, effrayée, appela au secours; on accourut; un laquais essaya vainement de le saigner, il était trop tard.
«Monsieur le duc d'Orléans, dirent les gazettes étrangères, est mort entre les bras de son confesseur ordinaire.»
Une chanson ordurière fut son oraison funèbre, et ses épitaphes furent dignes de celles que sa conduite avait values à sa mère:
CI-GIT L'OISIVETÉ
MÈRE DE TOUS LES VICES.