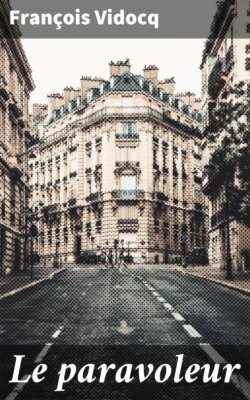Читать книгу Le paravoleur - François Vidocq - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II.
LA ROUTE.–ANECDOTE.
ОглавлениеTable des matières
JE n’ai rien à recommander au voyageur qui brûle la route en chaise de poste, seul et moelleusement assis sur des coussins, si ce n’est de se distraire le plus qu’il pourra, soit en observant les points de vue que sa course rapide lui met a chaque instant sous les yeux; soit en parcourant les livres dont il n’aura pas manqué de s’approvisionner au départ, s’il redoute les ennuis du chemin; soit enfin en dormant, s’il n’aime ni la lecture, ni le spectacle des beautés naturelles.
Quant à celui qui voyage par les voitures publiques, j’ai plusieurs recommandations importantes a lui faire.
La première, qui ne tient qu’aux usages et au savoir-vivre, est de se comporter décemment, de n’incommoder personne; de ne point laisser échapper de mots qui puissent faire rougir les dames, s’il fait route avec elles; au contraire, de leur témoigner beaucoup d’égards et de déférence.
Ce que je recommande particulièrement, et plus encore que la politesse, c’est la prudence. Comme en voiture publique on a besoin de distraction, on en cherche autour de soi, et l’on devient facilement expansif; le second jour du voyage, on regarde déjà ses compagnons comme des connaissances. Il faut se défier de cette démangeaison de trop parler, qui vient aisément chatouiller un voyageur: c’est une imprudence de se livrer étourdiment, de raconter ses affaires, ses relations sociales, ses chagrins et ses plaisirs domestiques, la nature de sa fortune et de ses biens, le but du voyage que l’on entrepend, etc. Tous ces détails sont inutiles, et le plus souvent dangereux à faire connaître. Il est des personnes pour qui ils ne sont que fatigans, et qui n’en recueillent pas un mot; mais il en est d’autres qui n’en perdent rien, et s’en servent plus tard, pour tendre au narrateur indiscret des pièges dans lesquels il sera pris.
Il est surtout très-dangereux d’agiter en voiture, et en présence de gens que l’on ne connaît pas, des questions qui se rattachent à la politique et au gouvernement, et de faire de l’opposition sans but ni utilité. Cette conduite est d’abord indécente dans un étranger, qui doit se taire sur les lois d’un pays qui le protège, sur des usages dont il ne connaît pas l’esprit, et auxquels il n’est tenu de se soumettre qu’aussi long-temps qu’il le voudra. Quant a un Français, il lui est permis de désirer une amélioration dans le régime social sous lequel il doit toujours vivre, mais ce n’est pas dans une voiture publique qu’il doit faire le frondeur. Il ne sait avec qui il se rencontre; l’imprudente manifestation d’une opinion hardie peut avoir pour lui des conséquences graves, et quelquefois même compromettre des gens qui ne sont pour rien dans ses étourderies. En voici un exemple:
Le fils d’un imprimeur de Paris, nommé P., avait, pour une chanson un peu frondeuse, été condamné à six mois d’emprisonnement et3,000francs d’amende. L’affaire en était restée là, et le jugement n’avait pas reçu d’exécution quatre ans et demi encore après son prononcé. On pouvait croire que le procureur du roi, trouvant la punition trop forte pour le délit, voulait tenir le jeune homme sous la main de la justice, et le forcer, par la crainte, à être sage pendant les cinq ans, après lesquels la prescription était acquise. P. était donc libre, et on ne lui disait rien. Un de ses cousins nommé P. comme lui, revenant un jour, avec plusieurs amis, de Claie, par la galiote, se permit, ainsi qu’eux, une conversation fort inconvenante sur les affaires du jour. Un magistrat qui se trouvait là sans être connu, les avertit de leur imprudence, en leur disant qu’ils ne savaient pas devant qui ils parlaient ainsi. Les jeunes gens, au heu de profiter de cet avis, qui leur eût suffi s’ils eussent conservé un reste de raison, le repoussèrent avec mépris, et traitèrent insolemment de mouchard, de dénonciateur, celui qui le leur donnait. Un magistrat ne pouvait pas laisser une pareille offense impunie; arrivé à Paris, il fit a qui de droit la déclaration de ce qui lui était arrivé. Comme dans la conversation le nom de P. avait été prononcé plusieurs fois, et qu’il l’avait retenu, il le répéta. On fouilla les dossiers de la police correctionnelle, on trouva le jugement rendu quatre ans et demi auparavant contre P., fils de l’imprimeur, on en munit un commissaire de police, qui vint un beau matin prendre le jeune homme dans son lit, et le conduire à Sainte-Pélagie. P. se récria, se plaignit de ce qu’on l’avait laissé si long-temps sans rien lui dire, pour lui faire subir sa condamnation au moment qu’il la croyait oubliée: on lui répondit que, s’il fût resté tranquille, il était à présumer qu’on l’eût laissé atteindre le terme fixé pour la prescription; mais qu’il s’était conduit avec tant d’imprudence tel jour dans la galiote de Claie, qu’il avait mis l’autorité dans l’impossibilité d’avoir plus long-temps pour lui de l’indulgence. P. se défendit de ce nouveau grief, prouva que ce jour-là il n’était pas sorti de Paris: cela fut reconnu; mais il était en prison, il dut y rester six mois pour la condamnation, et six mois pour l’amende qu’il ne pouvait ou ne voulait pas payer.
Lorsqu’on a voyagé de Lyon ou de Marseille à Paris, avec trois ou quatre personnes, et que la nécessité de se distraire, a établi une espèce de familiarité entre des hommes qui ne se connaissaient pas, deux jours auparavant, il ne faut pas croire qu’on a formé une liaison, et qu’à Paris on a le droit de relancer jusque chez elles les personnes avec qui on a fait la route. L’intimité que des voyageurs ont contractée ensemble finit dans la cour des messageries, a la descente de la voiture. Là, chacun se salue, se sépare, souvent pour ne plus se rencontrer, ni même se reconnaître. Les offres de service que l’on peut avoir reçues ne sont que des choses de forme que l’on doit bien se garder de prendre au mot, et ce serait se tromper étrangement, que de croire qu’un homme avec qui on a voyagé quelques jours, et de qui on a reçu des politesses, est devenu tout-à-coup un ami et un protecteur auquel on puisse recourir au besoin.
Il y a plus. Un provincial et un étranger doivent se tenir en garde contre celui qui les accable de prévenances et d’offres bienveillantes. Les hommes ne se passionnent pas subitement les uns pour les autres, et celui qui se jette à la tête d’un voyageur qu’il ne connaît pas, a deviné en lui une matière à travailler, et une victime à dépouiller d’une manière ou d’une autre.
Un provincial ne doit point manifester une admiration niaise pour les belles choses qui frappent ses yeux en entrant à Paris, s’il arrive par la barrière de l’Etoile, et un étranger son dégoût pour les masures dont il est offusqué, s’il entre par la barrière d’Italie et la sale rue Moufetard. Tous deux doivent attendre avant de juger la capitale du monde civilisé. Le premier y trouvera de quoi perdre un peu de son enthousiasme: le second, de quoi revenir sur le jugement trop précipité qu’il aura prononcé d’abord.
Il est inconvenant de se moquer de cette niaiserie native, dont on déclare en province les Parisiens atteints et convaincus. Les Parisiens ne sont point ce que des auteurs plus satiriques que bons observateurs les proclamaient jadis; et ces badauds donneront, s’il n’y prend garde, plus d’une leçon au provincial qui croit pouvoir impunément se moquer d’eux.