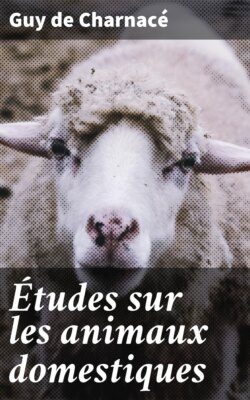Читать книгу Études sur les animaux domestiques - Guy de Charnacé - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Comme le dit le Livre de la Ferme, «le point de vue économique ou industriel doit dominer toutes les opérations. Le caractère propre, le caractère unique des améliorations est que leur effet soit la satisfaction plus directe ou plus complète d’un besoin économique. » Eh bien, c’est en nous appuyant sur ces deux vérités que nous combattons la doctrine de l’amélioration de nos races par le régime seulement, ce qui équivaut à peu près au statu quo, comme nous l’avons expliqué précédemment.
Les partisans du maintien de la pureté de nos races continentales invoquent les qualités qui les distinguent, et qui se résument en deux aptitudes, à savoir: l’aptitude au travail et l’aptitude à la sécrétion du lait. Ici, vient tout naturellement se placer la question de la spécialisation.
Il ne peut venir dans l’esprit de personne de nier qu’il y a des races chez lesquelles certaines aptitudes sont plus développées que chez d’autres; qu’il y a des races travailleuses, des races laitières et des races portées vers l’engraissement. C’est ce que Baudement le premier, croyons-nous, a nommé spécialisation des aptitudes, spécialisation des races. Le Livre de la Ferme prétend que toutes les améliorations du bétail doivent se garder de porter atteinte à ces différentes aptitudes, exclusives, dit-il, les unes des autres, au risque de rompre en visière avec la science, et, par conséquent aussi, au risque de stériliser toutes les opérations de perfectionnement. Tel est un des principaux arguments que nous opposent les adversaires du croisement des races. Examinons donc s’il n’est pas possible, en s’appuyant sur la doctrine elle-même de la spécialisation, de spécialiser nos races de boucherie en vue de la production de la viande, afin de l’obtenir à meilleur marché.
Tout d’abord, voyons s’il est économiquement avantageux de. développer l’aptitude au travail dans l’espèce bovine. Est-il vrai que le travail des champs soit plus économiquement opéré par les bœufs que par les chevaux? Voilà ce qui n’est point démontré, et ce qui ne peut l’être, à notre sens, d’une façon absolue. Toutefois, il résulte, des études publiées sur celte matière, que le travail du cheval, étant le plus expéditif, doit être, dans la plupart des cas, préféré à celui du bœuf. Et ceci s’applique à la grande comme à la moyenne culture. C’est même la nécessité d’accélérer les travaux, plus encore que le manque de bras, qui a fait adopter la vapeur comme force motrice appliquée à la charrue dans les exploitations considérables. Il résulte, des exigences d’une civilisation nouvelle, la nécessité économique d’augmenter les forces de production, et d’abandonner, lorsque les circonstances le permettent, les moyens d’action qui ne sont plus en rapport avec le but qu’on se propose. C’est une loi à laquelle toutes les industries ont obéi, et à laquelle l’agriculture ne peut se soustraire. Donc, la plupart de nos races bovines, spécialement dirigées jusqu’ici vers l’aptitude au travail, n’ont plus leur raison d’être; donc, il est nécessaire d’aviser au moyen de leur inculquer d’autres aptitudes. Cette opération est-elle possible? Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement, et personne ne nous contredira. Il s’agit maintenant de savoir de quelle façon on peut y parvenir, et c’est ce que nous voulons examiner.
En ce qui concerne l’aptitude à la production du lait chez quelques - unes de nos races, il n’est guère permis de soutenir qu’il est impossible de la leur conserver, tout en leur donnant la précocité. Ces deux qualités ne s’excluent nullement; la race durham en est une preuve éclatante, aussi bien que les croisements opérés en France avec cette race. Il est reconnu, par exemple, que les vaches durham-mancelles sont plus laitières que les mancelles purés. Personne, que nous sachions, n’a la prétention d’engraisser une vache lorsqu’elle est en lait; mais, du jour où elle tarit, elle demeure un agent important de production, lorsqu’elle appartient à une race possédant cette qualité essentielle de l’espèce bovine, l’aptitude à l’engraissement. Maintenant, si nous passons à l’espèce ovine, la question est bien simplifiée. En effet, il ne s’agit plus là de travail, mais seulement de savoir si nous devons donner la préférence à la production de la laine, ou bien, au contraire, si ce n’est pas plutôt à la production de la viande qu’il faut viser. Ici, le problème est encore plus facile à résoudre, comme nous croyons l’avoir montré dans nos Études d’économie rurale. Mais sans revenir sur une question déjà traitée à fond par nous, qu’il nous soit permis de reproduire un article publié l’année dernière par le Journal de Chartres, et dû à la plume de M. Lelong. Le président du comice agricole de cette ville conclut, comme nous, à la nécessité de la transformation des métis-mérinos. Non seulement cette race constitue une véritable plaie pour l’agriculture de certains pays, tels que la Beauce et l’Aisne par exemple, mais elle atteint encore le consommateur lui-même par la rareté et la cherté de la viande qu’elle produit. La meilleure preuve de ce que nous avançons est dans ce fait que la population ovine de la France atteint à peine celle de l’Angleterre, malgré la différence dans l’étendue du territoire des deux pays. Les trente-cinq millions de moutons anglais fournissent à peu près, selon M. de Lavergne, le double plus de viande que le même nombre n’en donne en France! Ce fait seul prononce la condamnation de la race, et toute croisade prêchée contre elle sera un bienfait signalé. En outre, comme nous l’avons prouvé victorieusement les chiffres en main, dans l’ouvrage cité plus haut, l’agriculture d’une grande partie de l’Europe ne peut soutenir la concurrence avec les vastes contrées transocéaniques pour la production des laines fines. C’est donc à ce double titre que nous citons ici l’opinion d’un agronome distingué et d’un homme important, puisqu’il a été appelé par ses concitoyens à présider le comice d’un pays où le métis-mérinos règne et gouverne malheureusement encore seul. Puisse l’opinion que voici, de M. Lelong, prévaloir bientôt autour de lui.
«Le Journal de Chartres du 16 novembre dernier a inséré un article intitulé : Moutons de Beauce et du croisement anglais. L’auteur, M. A. Sanson, écrivain vigoureux, très-versé dans les questions zootechniques, a appliqué cette fois son talent hardi et plein d’initiative à la défense d’une cause qui a rallié autrefois de nombreux partisans, mais que l’évidence des faits et le danger de persister dans une voie qui n’est plus en rapport avec les exigences agricoles et économiques de ce temps-ci a dispersés depuis et rendus fort rares. L’auteur néanmoins vient rompre une dernière lance en faveur du métis-mérinos et repousse toute amélioration de cette race par le croisement anglais. «Les personnes mieux intentionnées qu’éclai-
«rées, dit-il, qui se sont donné la louable mission
«d’indiquer la voie du progrès, engagent les culti-
«vateurs de la Beauce à renoncer à la production de
«la laine pour celle de la viande; il suffit de songer
«aux conditions agricoles de la contrée pour com-
«prendre à quel point aussi le préjudice serait grand
«pour la plupart des fermiers beaucerons s’ils com-
«mettaient la faute de les suivre.»
«Pour nous, noire conviction n’a pas varié, elle s’est fortifiée au contraire par les faits qui se sont déroulés devant nos yeux; nous devons donc passer en revue, pour les combattre, les objections et les arguments contre la transformation urgente et radicale qui doit, suivant nous, s’opérer dans la race ovine de la Beauce.
«Il y a eu jusqu’ici deux sortes d’objections en
faveur du métis-mérinos parmi ses fidèles partisans:
«Il faut le conserver parce qu’il est le meilleur pro-
«ducteur de laine et qu’il rapporte plus que les au-
«tres. Il faut le conserver parce que le mouton de
«provenance étrangère n’est pas fait à notre climat,
«à notre régime agricole.» C’est dans chacun de ces deux ordres d’idées que M. Sanson choisit ses arguments. Il trace d’abord du mérinos beauceron un portrait dans lequel les agriculteurs habitués à fréquenter les foires et les fermes de la contrée ne reconnaîtraient pas l’original. «Il a le corps trapu,
«court, ramassé, le garot un peu saillant, le ventre
«gros.» Qui dit trapu dit près de terre, carré par la base, plus développé en largeur qu’en hauteur. Cela suppose une poitrine large et profonde, qui présente à la partie antérieure comme à la partie postérieure, tout le long de la paroi costale, une conformation voûtée en forme de tonneau; cela dénote une cavité pectorale large et spacieuse, une structure ample et très-disposée à prendre graisse. Cette désignation d’animal trapu suppose encore qu’à partir des épaules jusqu’à l’arrière-train, le corps entier doit, par sa structure et sa conformation voûtée, ressembler à la poitrine; par là non-seulement les parties de la viande qui ont le plus de valeur peuvent prendre un grand développement, mais les organes de la digestion trouvent admirablement l’espace qui leur est nécessaire.
«Je demande si c’est bien là le portrait du mérinos beauceron, portrait dans lequel je ne reconnais que le garot saillant et le ventre gros. Pardon, j’y reconnais encore ceci, c’est que la peau présente de nombreux plis qu’on appelle fanon, autour du cou, en avant des cuisses et des fesses; on aurait dû ajouter avec du jarre dans les plis.
«Il est bon de s’entendre au début sur les termes de la question. En dissimulant la partie la plus saillante des défauts de cette race et en lui prêtant une conformation extérieure qu’elle n’a pas, il est évident qu’on fait disparaître aux yeux de l’homme prévenu l’urgence de sa transformation; mais nos lecteurs, familiers avec le type du mouton de Beauce, savent bien qu’à la place d’un animal trapu, court et ramassé, c’est-à-dire bien près de la perfection, nous ne possédons qu’une bête enlevée, lourde d’ossature, légère de parties charnues, à l’épine dorsale raboteuse et avivée, comme le profil que les géographes ont tracé de la Norwége: le cou est long, l’épaule mal adaptée antérieurement à l’encolure, postérieurement au dos et aux parties latérales de la poitrine; les jambes sont trop hautes, le nez et le facies d’un développement presque insensé, le flanc interminable; dans un grand nombre de sujets, l’indigence est grande dans la fesse et l’arrière-train.
Depygis, nasula, vago latere ac pede longo.
Voilà l’animal qu’il faut garder, d’après M. Sanson; en l’améliorant au point de vue de la boucherie, surtout au point de vue du tassé et de l’homogénéité de la laine, car pour lui la production de la laine fine a gardé sa vieille auréole; elle doit rester: ce sont ses propres termes, la base des opérations pour le cultivateur du pays.
«Les cultivateurs ne comprendront guère, après tant de déceptions, l’insistance avec laquelle il les engage à se livrer à l’amélioration de la laine, tant sous le rapport du poids que de la qualité, surtout en ajoutant, comme il le fait pour les encourager:
«Le prix baissera encore, sans nul doute, car c’est la
«loi du progrès pour les matières premières de l’in-
«dustrie.» Séduisante perspective, en vérité ! quand elle vaut 90 centimes à 1 franc le demi-kilo, ce qui est à peu près l’équivalent de deux bottes de foin d’une année de cherté moyenne.
«La laine, dans les conditions où le cultivateur s’obstine à la produire depuis trente ans, est une matière ingrate, qui coûte deux fois plus qu’elle ne rapporte. Dans cette carrière point de but pour les efforts de l’améliorateur; fine ou grossière, chargée d’impuretés ou préservée avec soin des souillures, soumise à l’étuve des bergeries hermétiquement closes pendant les jours caniculaires ou nourrie à l’air libre dans des conditions normales de fraîcheur et d’ombrage, c’est toujours 1 franc le demi-kilo pour tout le monde. L’acheteur se garderait bien d’offrir une prime à la propreté, à l’élasticité, à la qualité nerveuse, à l’homogénéité, à toutes les nuances qui établissent la supériorité d’une laine sur une autre, et qui devraient, ce nous semble, en faire varier la valeur vénale de 25 à 30 pour 100 en faveur des bons lots. Point du tout. Ce serait élever les prétentions des vendeurs de laine de qualité inférieure.
«La bergerie de Rambouillet, que vous présentez comme un type de qualité supérieure, et qui mérite cette distinction, n’a jamais réussi à vendre plus de 10 centimes au-dessus du cours. C’est entendu pour ce genre de commerce, c’est 1 franc le demi-kilo pour tout le monde! Ce n’est donc pas dans la laine, dans le développement du poids et de la qualité qu’il faut chercher l’avenir des troupeaux de la Beauce, quoique M. Sanson nous ait promis pour la laine un débouché toujours certain. Grand merci! Mais cela n’est pas toujours littéralement vrai. La laine se vend quand elle peut et quand on peut. Cet avenir, il faut le chercher dans l’aptitude et la disposition de la bête ovine à produire de la viande grasse et de la viande précoce; et le plus sûr moyen pour arriver au but, ce n’est pas l’amélioration du mérinos par lui-mème, car l’inanité des alliances par sélection entre deux sujets de la même souche qui ne possède pas à l’avance l’aptitude nouvelle qui lui est demandée, nous est démontrée par un trop grand nombre de faits, et ces faits nous apprennent que dans toutes les races, dans toutes les espèces, les reproducteurs ne peuvent transmettre à leurs descendants des qualités qu’ils ne possèdent pas eux-mêmes. Ce moyen, c’est le croisement dont la puissance est irrésistible, c’est le croisement avec les bêtes ovines de l’Angleterre, célèbres dans toute l’Europe par leur densité, par leur ampleur et leur puissance à reproduire des qualités précieuses développées par l’intelligence et le travail de plusieurs générations.
«Mais les sécheresses prolongées de votre climat de Beauce, l’absence d’eaux vives et d’ombrages, l’absence de fourrages verts, si nécessaires aux bêtes lymphatiques qui ont la production de la viande pour destination; mais votre assolement triennal, si peu élastique, et où les céréales tiennent tant de place, voilà des objections spécieuses, mais qui tombent devant l’examen des faits; l’auteur ignore-t-il que le mérinos de la Beauce a toujours été traité en enfant gâté, et qu’il ne ressemble en rien au mérinos des pays de pâturages calcaires qui vit comme il peut, ne rapporte guère, mais au demeurant n’a rien coûté. Pour le mérinos de la Beauce, au contraire, la nourriture d’hiver la plus succulente, les grains les plus riches en principes alibiles; au printemps, par ordre de précocité, les trèfles incarnats hâtifs, puis les trèfles incarnats tardifs, puis les premières coupes de sainfoin, de luzerne, de trèfle rouge, les vesces fauchées en vert et semées à diverses reprises jusqu’à la Saint-Jean; les deuxième et troisième coupes, enfin les feuilles de betteraves à la fin de la saison; pour compléter la similitude avec les troupeaux anglais, en hiver, de copieuses provendes de betteraves.
«Quant à l’eau vive et aux frais ombrages, la Beauce n’en est pas riche; mais il ne s’agit pas ici d’y faire vivre des troupeaux de pur sang, qui en effet ne peuvent se passer des conditions de brume, d’ombre et de fraîcheur qu’on ne rencontre que dans leur sol natal; il ne s’agit que des métis de sang anglais, et nous savons quelle brèche profonde un bélier qui ne possède qu’un quart et demi de sang peut faire dans un troupeau de brebis mérinos.
«Et le sang de rate, cette maladie qui sévit si cruellement sur les troupeaux des plaines calcaires; le sang de rate dont M. Sanson constate les effrayants sinistres dans la Beauce: n’est-il pas à croire qu’il perdrait de son intensité par le mélange de deux sangs si opposés? Cela n’est-il pas d’ailleurs dans les lois de la physiologie? Qui est-ce qui produit en effet l’apoplexie par le sang de rate? L’excès de sang apparemment; et le sang n’existe jamais en excès chez la bête croisée, puisque sa nature, son aptitude spéciale la déterminent à convertir, non pas en sang, mais en viande, en suif, en graisse tous les principes immédiats des aliments. Loin donc de conclure, comme le savant rédacteur en chef de la Culture, nous dirons aux intéressés: Ne retournez pas aux mérinos qui vivent de sacrifices perpétuels sans compensation; ne vous préoccupez pas de laines fines qu’il ne vous est pas donné de produire économiquement; la laine fine c’est la Russie qui vous la fournira; c’est Buenos-Ayres et l’Australie qui sont appelés à en inonder la France. Ce sont toutes les contrées où l’agriculteur n’a à payer ni le loyer de la terre, ni impôts, ni main-d’œuvre; la laine fine, malgré le prix du fret et trois mois de navigation, arrivera du port Philippe au Havre au prix effrayant (effrayant pour le producteur indigène) de 3 centimes le kilo, pour tous frais de transport!
«Pour vous qui êtes placés dans les plaines voisines de Paris, votre rôle est de pousser au marché des montagnes de viandes; vous le pouvez en choisissant bien vos types reproducteurs.
«Aujourd’hui, par le déplorable choix de votre race tout en os et en peau, vous n’avez que la triste clientèle des étaux où la viande se vend au rabais, et le monopole des restaurants de second ordre, où l’on ne consomme que des qualités infimes.»
Puissent ces sages avis porter bientôt leurs fruits!
En ce qui concerne l’espèce porcine, presque tous les agronomes s’accordent à dire que nous pouvons, sans danger aucun, croiser nos races avec les races étrangères, mieux dotées que les nôtres sous le rapport de la précocité et de la facilité à l’engraissement. Comme on le voit, c’est surtout à l’endroit de nos races bovines que nous rencontrons des adversaires. Quant à nous, nous voulons amener aux mêmes termes nos différentes espèces, persuadé que ce qui est possible pour une espèce l’est aussi pour les autres.
Si nous jetons un coup d’œil sur ce qui s’est fait au delà de la Manche, nous verrons que nos voisins ont dû mettre d’accord les principes de la physiologie avec les nécessités économiques et sociales de notre époque. Nous verrons que chaque race, à quelque espèce qu’elle appartienne, a été dirigée le plus promptement possible vers la fin fatale de l’animal de boucherie, l’abattoir. Nous verrons que l’aptitude à la précocité, ausi bien que celle à un engraissement rapide, a été le but constant des efforts des éleveurs les plus distingués, des Bakewell, des Colliug, des Ellman, des Jonas Webb et des FisherHobbs. C’est ainsi que les Hereford, les Devon, les Angus, les Westhyland ont perdu insensiblement leurs formes natives, pour prendre celles du Durham. Aucune, parmi ces races, il faut le dire, ne réunit au même degré les qualités qui distinguent celle des bords de la Tees; mais quelques-unes ont atteint la précocité de cette dernière. Quant à la sécrétion du lait, c’est toujours la vache durham qui l’emporte sur les autres.
Les pratiques zootechniques des Anglais, essentiellement variables selon les circonstances, ont amené leur industrie agricole à une prospérité qui n’a encore été atteinte nulle part ailleurs. Eh bien, de semblables résultats, que personne ne conteste, ne sont-ils pas de nature à prouver que la voie que nous indiquons est celle qui nous conduira le plus promptement et, peut-être aussi, le plus sûrement aux heureux résultats auxquels nous convient le sol et le climat de notre patrie.
Nous venons de montrer par des exemples que le croisement et le métissage avaient formé des races possédant les caractères qui répondent à la définition de la race selon nos adversaires, et que le croisement est compatible avec le maintien de la spécialisation des aptitudes. Nous allons maintenant examiner, en les comparant, les deux moyens d’amélioration: la sélection ou le régime et le croisement.