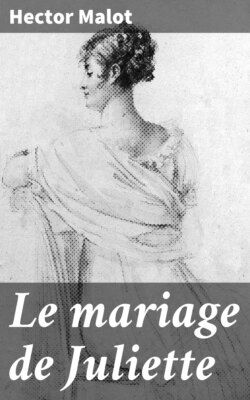Читать книгу Le mariage de Juliette - Hector Malot - Страница 3
I
ОглавлениеLe quartier du Temple se présente sous un double aspect. Dans la partie qui confine au Marais, on trouve des rues larges, bordées de belles maisons qui ont été autrefois bâties pour la noblesse ou la magistrature. Dans la partie qui touche au quartier Saint-Martin, on ne rencontre au contraire que des rues étroites, dont les maisons laides et sales sont occupées par le commerce et la petite industrie parisienne.
La rue des Vieilles-Haudriettes, qui va de la rue du Chaume à la rue du Grand-Chantier, participe de ces deux caractères: par quelques-unes de ses constructions, qui sont vastes et architecturales, elle appartient au Marais; par sa population ouvrière, au quartier du Temple. Elle est frontière, et comme telle elle tient de ses deux voisins, sans avoir une physionomie propre.
Nulle part on ne trouvera plus d’enseignes aux façades et d’écriteaux aux grandes portes: larges tableaux noirs s’étalant d’étages en étages, petites plaques de cuivre, écussons en tôle vernie, panonceaux, armoiries.
Si le curieux qui passe pour la première fois dans cette rue lève les yeux sur les enseignes qui ont pour but de provoquer son attention ou de le guider, il verra qu’il est en plein dans le quartier de l’industrie des bijoux; pour un écusson qui lui indiquera les magasins d’un marchand de peaux de lapin ou les bureaux du journal hébraïque le Libanon, il trouvera vingt plaques de bijoutiers en or, en argent, en plaqué, de lapidaires, d’orfévres, de fabricants de bagues, de boutons, d’épingles, de broches, de pendants, de colliers, de médaillons, de chaînes, de pendeloques, de breloques, de croix, de reliquaires, de cassolettes, de tabatières, d’étuis, de briquets.
Seule au milieu de ces enseignes, qui dans leur confusion peuvent troubler l’acheteur indécis, se montre au-dessus d’une porte cochère une longue plaque en marbre noir sur laquelle on lit en lettres d’or gravées en creux, un simple nom:
DALIPHARE
Pas d’autres indications. Ce nom tout seul en dit assez sans doute et les explications ne sont pas nécessaires.
Pour les habitants du quartier ou pour ceux qui connaissent l’industrie des métaux, cela est possible; mais pour le passant ou l’étranger, ce nom propre ne dit rien de précis, malgré sa physionomie originale. Que vend-on, que fabrique-t-on dans la maison Daliphare?
Si l’on regarde par la grande porte, on aperçoit une cour plus large que longue, autour de laquelle s’élève au fond une maison à deux étages, et de chaque côté, en retour d’équerre, des bâtiments qui paraissent occupés par des ateliers.
La maison, construite au XVIIe siècle, dans les jardins du couvent des religieuses hospitalières qui ont donné leur nom à la rue, est un vieil hôtel qui a dû avoir belle apparence avant d’être approprié aux besoins de l’industrie moderne. De sa splendeur passée il conserve des fenêtres décorées de rinceaux, et çà et là quelques morceaux de sculpture qui n’ont point encore disparu sous les nombreux tuyaux de tôle et de poterie appliqués sur sa façade, contre laquelle ils ont laissé couler, dans les jours de grande pluie, des traînées de suie et de rouille. Élevées en brique et en carreaux de plâtre, les deux constructions latérales n’ont aucun caractère; elles sont occupées par des hangars et des ateliers.
Au-dessus de celui de gauche se dresse une haute cheminée en tôle, semblable à celle d’un bateau à vapeur, et du matin au soir elle vomit des tourbillons de fumée qui vont noircir la cime d’un vieux peuplier planté au milieu de la cour.
Un appareil de transmission traverse cette cour et va se perdre dans les bâtiments de droite, d’où sortent les ronflements de plusieurs cylindres en mouvement.
Cette rapide inspection ne permet pas, bien entendu, de deviner quel est le genre d’industrie de cette maison; cependant elle fait comprendre que ce vieil hôtel est occupé, au rez-de-chaussée et au premier étage, par des comptoirs et des bureaux, et que dans les bâtiments annexes se trouve une pompe à feu avec des machines. Mais que vend-on dans ces comptoirs? à quoi servent ces machines? Les cylindres qu’on entend tourner écrasent-ils du cacao? lustrent-ils des étoffes ou bien laminent-ils des métaux? Ces questions ne peuvent pas être résolues par un simple coup d’œil.
Mais si le passant arrêté devant cette porte est un curieux qui sait par lui-même se rendre compte des choses, il n’aura pas besoin d’interroger les voisins pour connaître l’industrie de la maison Daliphare: en restant quelques instants en observation devant cette maison, en examinant et en écoutant ceux qui entrent et qui sortent par la grande porte, il aura bien vite une réponse aux questions que se posait son esprit.
Un jeune homme de tournure plus élégante que distinguée, le visage pâli et flétri, l’œil éteint, se promène sur le trottoir, allant de la rue du Chaume à la rue du Grand-Chantier. Son pas est impatient; en marchant, il se retourne souvent pour regarder derrière lui. Il fouette l’air avec sa canne et murmure entre ses lèvres serrées des mots inintelligibles; dans chaque voiture qui passe il plonge un regard curieux. A mesure que l’attente se prolonge, son impatience s’accroît et les mouvements de sa canne sont plus saccadés.
Enfin une voiture de remise arrive par la rue du Chaume, les stores baissés, et elle s’arrête devant la porte de la maison Daliphare. Une femme ouvre la portière et descend sur le trottoir. Elle est vêtue d’une toilette sombre, une voilette de laine empêche de distinguer les traits de son visage: à travers les mailles étroites de la voilette on aperçoit seulement deux yeux brillants et un teint pâle.
Le jeune homme accourt vivement près d’elle.
— Encore en retard!
— Il ne voulait pas sortir.
— Alors tu n’as rien?
— Le coffre est dans la voiture; vous pouvez le prendre.
Le jeune homme prend dans la voiture un coffret recouvert de maroquin qui paraît peser un poids assez lourd, et, suivi de la femme voilée, il entre dans la maison.
Ils ont disparu sous le vestibule du rez-de-chaussée. Deux hommes les remplacent devant la porte cochère. L’un est un petit vieillard sec et nerveux, au nez busqué, aux cheveux crépus, qui porte des bagues à tous les doigts, des anneaux d’or aux oreilles, et autour du cou une grosse chaîne qui s’arrondit sur son ventre proéminent; en tout, l’apparence d’un marchand de lorgnettes qui fait des affaires. L’autre est un grand jeune homme imberbe, qui peut être peint d’un mot: «un pâle voyou».
— J’étais sûr de te voir ici, dit le petit vieux.
— Et vous me guettiez, père Meyer?
— Oui, mon garçon, depuis une heure, dans ton intérêt, pour t’empêcher de faire une bêtise qui pourrait, passage gratis, te mener loin, au delà des mers, comme qui dirait du côté de Cayenne.
— Vous savez, je n’aime pas ces plaisanteries-là. En tous cas, je préfère risquer le coup plutôt que de me faire encore recurer par vous. Vous n’êtes pas raisonnable non plus.
— Tu ne sais pas ce que tu dis.
— Je sais que l’or vaut 1500 fr. les 500 grammes et que vous ne voulez le payer que 1 fr. 75 cent. le gramme, ce qui met la livre pour vous à 875 fr. Vous gagnez trop et sans risques.
— Et toi, mon petit, tu veux aussi gagner trop, mais avec risques, et entre nous deux voilà la différence. Pour le moment, ça n’a l’air de rien, mais plus tard ça pourrait être sensible, très-sensible pour toi, je veux dire. Crois-tu qu’ils vont t’acheter ton magot sans te questionner?
— Je dirai que c’est de la cassure que j’ai fondue.
— Comment ça, fondue?
— Dans une marmite.
— Et où l’auras-tu eue, ta cassure? Tu t’embrouilleras dans tes réponses et tu seras pincé. Hs tiennent leurs comptes dans des livres; moi je tiens les miens dans ma tête, et quand la rousse veut me faire causer, je réponds pour le mieux de mes amis. Combien pèse ton culot?
— 1 kilogramme 500 grammes.
— Je t’en donne 2 francs le gramme; en tout, 3000 francs.
— Au lieu de 4500 francs.
— Tu calcules bien, mais tu raisonnes mal, puisque dans ton compte tu oublies la tranquillité que tu trouves avec moi. Estime-la ce qu’elle vaut pour toi, et viens chez le marchand de vin de la rue du Chaume: c’est moi qui paye. Nous ferons nos comptes ensemble.
Pendant ce dialogue, le mouvement des entrées et des sorties sous la porte cochère a continué.
On a vu passer des apprentis qui sur leurs blouses noires portent des petites boîtes suspendues à leur cou par des chaînes de fer; — des femmes pâlies par la misère, qui entrent là comme au mont-de-piété ; — des hommes au teint bronzé qui parlent entre eux de placers et de poudre d’or: un défilé de brocanteurs.
Alors, si l’on rapproche ces diverses observations et si on les complète les unes par les autres, on trouve que les cheminées au-dessus des ateliers sont celles d’une fonderie, — que les cylindres sont des laminoirs à métaux, — que la caisse en maroquin apportée par la femme voilée devait contenir de l’argenterie qu’on venait vendre, — que le marchand de lorgnettes était un recéleur, et le pâle voyou un filou qui cherchait à se débarrasser d’un lingot volé ; — que les hommes qui parlaient de placers étaient des mineurs californiens ou australiens qui voulaient vendre leur poudre d’or avant de rentrer dans leur village, — que les apprentis en blouses noires venaient chercher des matières d’or et d’argent pour être travaillées chez les orfévres et les bijoutiers, et l’on arrive à cette conclusion que la maison Daliphare fait le commerce des métaux précieux, qu’elle achète de toutes mains, à l’état de vieille argenterie, de galon, de cassures, de poudre, de résidus, de déchets, l’or et l’argent; qu’elle fond ces métaux, et qu’après les avoir affinés, elle les revend pour la bijouterie.
Telle est en effet son industrie, et, par le chiffre de ses affaires, l’étendue de sa clientèle, son honorabilité, sa fortune, elle se trouve à la tête du commerce parisien.