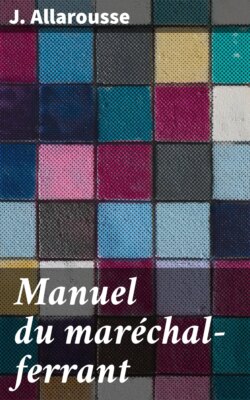Читать книгу Manuel du maréchal-ferrant - J. Allarousse - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FONCTIONS DU PIED ET ROLE DE SES PARTIES CONSTITUANTES
ОглавлениеLa fonction principale du pied est d’offrir au membre un appui solide et élastique; son rôle est non moins important dans la locomotion. L’agencement de ses diverses parties constituantes se prête parfaitement à l’atténuation des pressions et chocs, qui agissent sur lui à l’appui et pendant la progression, par l’élasticité qui lui est propre et par la disposition de la face intérieure du sabot. Voyons, tout d’abord, comment s’effectue le renouvellement de la corne.
Croissance du sabot et avalure. — Le sabot s’accroît en permanence par la secretion cornée qui a lieu continuellement à la surface du bourrelet et de la chair veloutée, de telle sorte que si l’usure et la parure ne venaient compenser l’allongement du pied, celui-ci atteindrait des proportions exagérées (fig. 15).
Le gros bourrelet seul secrète la paroi, dont il est la matrice. La corne élaborée à si surface sous une forme pâteuse, chasse devant elle les couches plus anciennes, qui se durcissent progressivement sous l’influence de l’air. Au contact des villosités, elle prend la disposition tubulée, reconnaissable sur certains sabots à l’aspect fibrillaire et effiloché du bord plantaire de la muraille.
La corne, au fur et à mesure de sa production à la surface du bourrelet et des villosités, descend insensiblement en ligne droite, en glissant en quelque sorte sur la chair feuilletée; cette dernière ne participe pas à la formation de la paroi qui conserve la même épaisseur de son bord supérieur à son bord inférieur. Mais, si la chair cannelée ne forme pas les feuillets de corne de la muraille, quand elle est mise à nu accidentellement, elle se couvre rapidement d’une sécrétion cornée qui se durcit et vient combler la brèche faite; cette corne cicatricielle reste sèche, cassante, non tubulée et ne se confond jamais avec celle sécrétée par le bourrelet: elle constitue ce que l’on appelle le faux quartier.
Fig. 15. — Accroissement anormal d’un sabot.
L’avalure, en maréchalerie, désigne le mouvement de descente de la paroi, le long du pied. Il ne faut donc pas établir de confusion entre la production cornée et l’avalure; ce sont deux phénomènes distincts, agissant conjointement et en parfaite harmonie, pour assurer un accroissement régulier du sabot dans toutes ses régions; mais, s’il se produit une discordance sous l’influence d’une irritation passagère ou permanente, entre la sécrétion cornée et l’avalure, des cercles apparaissent à la surface de la paroi, en creux si la formation de la corne est ralentie, en relief dans le cas contraire (fig. 16).
L’avalure sur un pied normal se fait également aux différentes régions de la paroi. La vitesse de descente de la corne est en moyenne de 1 centimètre par mois. Pour effectuer son renouvellement complet, le sabot met en général neuf à dix me is en pince et quatre à cinq mois en talons. Les pieds de derrière croissent plus vite que ceux de devant.
Fig. 16. — Sabot avec cercles.
La chair veloutée sécrète la sole et la fourchette. La sole, solidement soudée à la muraille, pousse dans les mêmes proportions que cette dernière, sans toutefois atteindre une trop grande épaisseur, à cause des écailles qui se détachent naturellement de sa face inférieure.
Le bourrelet périoplique sécrète en permanence une corne qui fait office de vernis protecteur à la surface de la paroi.
Les barres descendent en glissant sur la chair feuilletée de la partie repliée des extrémités de la paroi; leur avalure est plus lente que celle de la muraille.
Influences modificatrices de la sécrétion cornée et de l’avalure. — De nombreuses influences peuvent modifier l’accroissement régulier du sabot par manque de concordance entre l’avalure et la sécrétion cornée. Toutes les causes agissant sur le bourrelet ont une réaction marquée sur la pousse de la corne; de même, toutes celles qui exercent une action directe sur le podophylle (chair feuilletée) ralentissent l’avalure. C’est ainsi que les pieds petits et à corne dure des chevaux de sang poussent moins vite que ceux des races communes; de même, dans une même race, les sabots de certains chevaux croissent à peine d’une ferrure à l’autre, tandis que sur d’autres ils s’accroissent d’une longueur exagérée; enfin,les pieds à corne blanche poussent moins vite que ceux à corne noire.
Le jeune âge et le bon état de santé sont favorables à la sécrétion cornée et à l’avalure. La maladie, au contraire, retarde l’avalure et l’exagère pendant la convalescence.
En hiver, le sabot pousse plus lentement que pendant la belle saison. La mise au pâturage et, en général, tout changement brusque de température amènent l’apparition de cercles à la surface de la paroi.
L’exercice active également la sécrétion cornée; le repos la ralentit. C’est ce qui permet sur le cheval qui travaille de pouvoir renouveler sa ferrure plusieurs fois dans le cours d’un mois, car on estime que le pied paré périodiquement par la ferrure de l’excédent de corne, croît autant en six à sept mois que celui qui n’éprouve aucune perte naturelle ou accidentelle en douze mois.
Certains médicaments qui activent la nutrition, tels que l’acide arsénieux, le soufre, l’huile de foie de morue, le sel marin, exercent une influence marquée sur la production cornée.
Caractères de la corne. — La corne est une matière solide, plus ou moins dure, élastique, d’apparence fibreuse à la paroi, écailleuse à la sole et filandreuse à la fourchette.
Extérieurement, la couleur du sabot est habituellement la même que celle des poils tandis que la partie profonde de la corne, en contact avec la chair feuilletée, est toujours de couleur blanche ou jaune clair, et aussi moins consistante, plus souple et plus molle qu’en dehors. Cette consistance de la corne, variant avec la profondeur, a l’avantage de former un manchon moelleux pour les parties intérieures du pied et à l’extérieur une enveloppe protectrice, résistant à l’usure. La souplesse et la mollesse des parties profondes du sabot sont dues à leur imbibition séreuse au contact de la chair.
La saison chaude, la sécheresse, les sols sablonneux ou caillouteux durcissent le pied. La saison pluvieuse, les sols humides l’assouplissent. Ces derniers effets sont la plupart du temps favorables; ils deviennent pernicieux par leur durée, en rendant la corne friable.
La corne jouit de la propriété d’être hygroscopique ou hygrométrique, mais toutes les régions du sabot ne le sont pas au même degré. Le périople est la partie, en s’imbibant d’eau, qui se gonfle le plus rapidement, ensuite la sole, la fourchette et la paroi.
En maréchalerie, la faculté que possède la corne de se ramollir sous l’influence de l’imbibition aqueuse est utile à connaître pour l’application des bains et cataplasmes.
L’eau chaude ou tiède pénètre et assouplit plus rapidement la corne que l’eau froide. Même observation pour les cataplasmes chauds.
Le goudron de bois, l’onguent de pied, les corps gras, ramollisent la corne, mais à la surface seulement. Le lysol a sur elle une action émolliente, qui permet de la tailler ou la couper avec beaucoup plus de facilité.
La potasse, la soude, l’ammoniaque, les acides dilués gonflent et dissolvent la corne. La glycérine anhydre, le carbure de calcium, au contraire, la durcissent en la desséchant.
La corne est encore flexible et élastique, et c’est grâce à cette propriété qu’il est permis de combattre, à l’aide d’un amincissement jusqu’à pellicule, la vive douleur qui accompagne toujours l’inflammation des tissus sensibles, lorsqu’ils sont comprimés dans le sabot.
Enfin, la corne conduit mal le calorique. Le fer porté au rouge sombre la ramollit en la boursouflant et en donnant une fumée jaune très odorante. Au rouge blanc, le fer l’enflamme et la fond, en formant un charbon isolateur protecteur des tissus vivants.
La mauvaise conductibilité de la chaleur de la corne permet au pied du cheval de résister non seulement sur les sables brûlants d’Afrique, mais encore aux sols gelés et couverts de neige des pays froids.
Élasticité du pied et son mécanisme. — Le pied ne fournit pas seulement un appui solide au membre, mais il possède aussi la propriété de réagir par son appareil d’amortissement et par l’agencement des parties constitutives du sabot aux pressions et chocs qu’il reçoit pendant la locomotion. On ne comprendrait pas, en effet, que le pied pourvu en arrière d’organes essentiellement élastiques, tels que le coussinet plantaire, les cartilages et la fourchette, n’ait aucune influence sur l’enveloppe cornée, elle-même élastique.
Pour neutraliser les chocs et pressions, le sabot possède la propriété de se dilater en arrière au moment de l’appui et de revenir à sa forme-primitive au moment du lever, par le jeu des organes d’amortissement. Ce mouvement alternatif d’expansion et de resserrement des talons, résultat d’une réaction réciproque du contenu et du contenant, est surtout apparent au niveau du bord supérieur de la paroi, en talon juqu’au milieu des quartiers et au niveau des glomes de la fourchette où la lacune médiane s’ouvre visiblement; cette expansion est au plus de 3 millimètres. Quant au bord inférieur de la muraille, il est inexpansible dans la plus grande partie de son étendue, parce que soudé à la sole; il ne peut s’élargir que près des talons, et encore dans de bien faibles limites, même quand la fourchette appuie sur le sol.
La sole participe aussi à l’élasticité du sabot par un léger affaissement de sa partie centrale.
L’élasticité du pied ne fait donc aucun doute, et on ne peut la paralyser sans causer une vive souffrance; il suffit d’appliquer un lien inextensible autour d’un des sabots d’un cheval pour que ce dernier se mette à boîter.
De nombreuses expériences ont, en outre, démontré que la fourchette joue un rôle important dans l’amortissement des chocs par sa participation à l’appui, et que c’est une erreur trop longtemps entretenue dans beaucoup d’ateliers de maréchalerie que de la parer à fond pour l’empêcher de porter sur le sol.
On peut se rendre compte facilement de l’écartement des talons, en pratiquant un point de repère au milieu de chacun; puis, sur le pied levé, on prend, à l’aide d’un compas, la distance séparant les deux points de repère. Le pied servant d’expérience étant mis à terre est surchargé en levant le membre opposé. On observe alors, que le pied, dont la fourchette appuie largement sur le sol, s’ouvre de 1 à 3 millimètres dans la région des talons; si la fourchette est parée à fond, les talons ne s’ouvrent pas ou peu.
Pour constater l’abaissement du dessous du pied, on se sert d’une plaque de tô e épaisse (fig. 17) percée de petits trous ronds, laquelle est fixée sur un fer à trois crampons. Dans chacun des orifices, on introduit une cheville en bois venant toucher le plancher du sabot; l’extrémité libre, qui fait saillie extérieurement à la surface de la plaque, est rasée très exactement. Après un appui plus ou moins prolongé du pied muni de cette sorte de fer à herse, le membre opposé étant levé, on constate que chaque cheville a opéré un mouvement de descente de 2 à 3 millimètres à hauteur des glomes de la fourchette, de 1 à 2 millimètres à sa pointe et au centre de la sole.
Fig. 17. — Fer à plaque de tôle avec chevilles de bois.
Pour mesurer l’écartement des talons à l’appui, on peut appliquer le même principe, en se servant d’un fer à herse modifié, portant sur chaque extrémité de ses branches un dispositif en conséquence.
En résumé, pour que l’appareil d’amortissement des pressions et chocs du pied puisse fonctionner normalement, il est indispensable que la fourchette participe à l’appui sur le sol; le coussinet plantaire fortement comprimé entre elle et le tendonfléch sseur profond de la troisième phalange fait effort latéralement sur les cartilages et la paroi, soulevant davantage cette dernière à son bord supérieur qu’à l’inférieur qui est fixé à la sole et aux barres. u contraire, si la fourchette a été parée à fond et qu’elle n’appuie pas sur le sol, la dilatation des talons ne s’effectue plus que partiellement, le dessous du pied s’affaisse légèrement en arrière, la neutralisation des chocs n’a lieu que par un très faible glissement, les uns sur les autres, des feuillets de corne de la face interne de la paroi et des feuillets de chair du podophylle.
Sensibilité générale et tactile du pied. — L’enveloppe cornée est absolument insensible, ce qui permet la parure du sabot et l’application du fer. Mais les tissus vivants qu’elle recouvre et protège reçoivent de nombreuses ramifications nerveuses qui, se subdivisant à l’infini, pénètrent en fins, filaments dans les feuillets de chair, les villosités du bourrelet et du tissu velouté, et font du pied un organe de-plus délicats du sens du toucher, en même temps q e doué d’une grande sensibilité, lors de blessures ou lésions inflammatoires comprimées dans le sabot.
C’est cette faculté de perception du pied qui renseigne le cheval sur la nature du terrain sur lequel il se meut, sa consistance, ses inégalités et les obstacles dont il est hérissé. Sur un terrain glissant, gelé, grâce à sa sensibilité tactile, le cheval ralentit son allure et marche avec précaution; aveugle, il lève haut les membres de devant et semble sonder l’espace, comme le ferait un homme atteint de cécité avec son bâton, quand il l’appuie sur le sol.
En maréchalerie, le siège de la douleur ressentie par le pied a une grande importance, l’attitude du cheval boiteux étant variable suivant la région sensible: serré par un clou au quartier externe, il écarte le membre en dehors, pour faire son appui en dedans et inversement si la compression existe au quartier interne; la région de la pince est elle douloureuse l’appui se fait en talons. Si la lésion est étendue, grave, et que la sensibilité soit générale, l’appui du pied sur le sol n’a lieu qu’en pince, il peut même être supprimé entièrement.
Il importe donc beaucoup que l’ouvrier ne transforme pas la ferrure en une intervention douloureuse et qu’il sauvegarde au mieux la sensibilité tactile du pied du cheval.
Transpiration du pied. — L’enveloppe de chair, intermédiaire entre les parties internes du pied et le sabot, laisse exhaler a sa surface un liquide séreux, qui, en imprégnant la corne, la maintient dans un état d’humidité constant et assure ainsi la conservation de sa souplesse. En s’imbibant d’eau en permanence, la paroi, la sole et la fourchette sont d’autant plus souples que leurs couches profondes sont plus rapprochées de la source d’humidité représentée par l’enveloppe de chair.
La transpiration du pied est donc un acte naturel, qui, en neutralisant la dessiccation de l’enveloppe cornée, conserve au sabot les propriétés élastiques qui lui sont indispensables pour assurer le libre mouvement d’expansion des talons. L’eau exhalée pénètre la corne de dedans en dehors et s’évapore à la surface extérieure du pied, au fur et à mesure qu’elle se renouvelle en profondeur. Il suffit d’entourer le sabot d’une enveloppe imperméable, le mettant à l’abri du contact de l’air, pour voir peu après la muraille recouverte d’une humidité provenant des vapeurs qui s’y sont condensées
Au niveau de la lacune médiane de la fourchette existent de véritables glandes sudoripares, entretenant en permanence une abondante sécrétion, qui, lorsqu’elle s’exagère sous l’influence d’une cause irritante, provoque réchauffement et la pourriture de cette partie du pied.