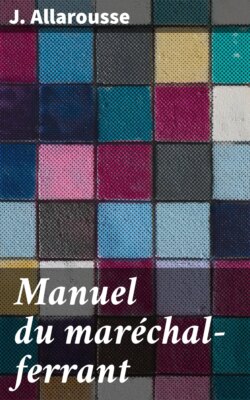Читать книгу Manuel du maréchal-ferrant - J. Allarousse - Страница 19
LA FORGE
ОглавлениеL’atelier de maréchalerie est habituellement divisé en deux parties: la forge en tant qu’atelier, et le hangar à ferrer.
La forge. — Elle doit réunir certaines conditions: être bien aérée et éclairée, sans courant d’air, suffisamment spacieuse pour que les ouvriers puissent travailler avec aisance, sans se gêner.
Le plafond, formé par la couverture du bâtiment, doit être élevé et pourvu de châssis à tabatière, pour permettre l’évacuation de l’air chaud et de la fumée. Le sol sera uni, pavé, bétonné ou cimenté, sauf autour des enclumes où une aire circulaire en terre argileuse battue est ordinairement aménagée, pour amortir les secousses et les vibrations ressenties par le frappeur et diminuer aussi sa fatigue. Les fenêtres vitrées pourront être protégées contre les éclats à l’aide d’un grillage.
Le hangar à ferrer. — Il communique avec la forge par une ou plusieurs ouvertures suivant son étendue. En principe, il n’est jamais trop vaste. On estime nécessaire que deux chevaux par foyer puissent y être attachés, et qu’autour de chacun d’eux soit ménagé un espace suffisant pour que les ouvriers circulent librement, sans être exposés aux ruades.
A titre de renseignements, on peut fixer les dimensions suivantes du hangar à ferrer: dans le sens de la longueur, 4 mètres par cheval et 6 mètres pour la profondeur. Les anneaux mobiles, pour attacher les chevaux, seront scellés dans le mur à une distance approximative de 1m,50 les uns des antres et à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol.
Le sol doit être uni, horizontal, ni trop dur, ni trop lisse, pour eviter que les chevaux ne se détériorent les sabots lorsqu’ils sont déferrés ou ne glissent; trop tendre et friable, il ne résisterait pas à l’action des animaux qui ont la mauvaise habitude de gratter avec leurs pieds.
Le sol argileux battu est bon, quand il est bien entretenu; celui en ciment est trop glissant. Le pavage en bois est solide et élastique, mais il a le défaut d’être glissant dès qu’il est mouillé. La brique sur champ paraît réunir les meilleures conditions; elle est peu glissante et à l’usure se remplace facilement.
Matériel de la forge. — Il comprend: la forge qui sert au maréchal à forger et à ajuster les fers. Elle est dite simple ou double suivant qu’elle est à un ou deux foyers. Les forges doubles sont installées le long des murs ou dans les angles (fig. 60). La disposition des lieux commande ordinairement l’emplacement des forges. Dans les ateliers importants, la forge est à multiples foyers et occupe le centre du bâtiment; tout autour d’une volumineuse cheminée sont groupés les foyers.
La forge se compose d’un bâti en maçonnerie ou en fonte terminé à sa partie supérieure par une surface horizontale qui supporte le foyer, sur le côté duquel est une auge qui sert à mouiller la houille; en dessous existe une fosse destinée à recevoir le combustible.
Dans les villes, les maréchaux adoptent de plus en plus la forge métallique, parce que moins encombrante et d’un entretien moins coûteux.
Le foyer est constitué par un tronc de pyramide régulier à section carrée; la plus grande base étant supérieure et entièrement ouverte, la plus petite, inférieure, est percée d’une ouverture destinée au passage de la tuyère.
La tuyère sert de conduite d’amenée et de distribution de l’air sous pression; elle est dite verticale ou horizontale suivant que la direction de l’arrivée d’air au foyer a lieu horizontalement ou verticalement.
Fig. 60. — Forge double, d’angle.
On abandonne de plus en plus la tuyère horizontale en fonte, qui résiste peu de temps à l’action destructive du feu et qui, en outre, ne permet pas de régler l’arrivée de l’air dans les conditions les plus économiques et les plus favorables au chauffage. On préfère la tuyère anglaise, à vent central et à régulateur d’air, dont la zone de combustion la plus parfaite se trouve plus éloignée de l’orifice d’arrivée de l’air.
La hotte, destinée à activer le tirage et faciliter l’évacuation de la fumée, est en brique et plus souvent en tôle galvanisée; sa forme varie suivant la disposition des foyers; ce qui importe c’est qu’elle recouvre la partie supérieure de la forge à une hauteur qui ne saurait dépasser 80 centimètres.
Le soufflet est destiné à fournir au foyer la quantité d’air nécessaire à la combustion. L’ancien soufflet en cuir et bois a l’inconvénient d’être encombrant, coûteux d’achat et d’entretien. Les préférences actuelles vont au soufflet en tôle, à double vent, peu volumineux, plus solide et d’un prix moins élevé que le précédent. Il existe de nombreux modèles perfectionnés, qui ont leur place marquée dans un atelier moderne de maréchalerie.
Le ventilateur à ailettes est aussi utilisé comme appareil de soufflage. Il est placé à portée de la main de l’ouvrier chargé de le mettre en action. Cet appareil est surtout employé pour les fours à réchauffer.
L’enclume maréchale est différente de celle des forgerons et serruriers, par sa table supérieure légèrement bombée au lieu d’être plate, et par l’extrémité de la table, appelée talon, coupée d’équerre; l’extrémité opposée est conique: c’est la bigorne (fig. 61).
La mortaise ou œil de l’enclume est le petit trou carré de la table, qui sert à contre-percer les fers et à recevoir le tranchet. Le poids de l’enclume est d’environ 150 kilogrammes.
Le billot sur lequel repose l’enclume est généralement en bois debout; on attribue à son élasticité la grande résonance des enclumes, sous le choc du marteau, si gênante pour l’entourage. Aussi, en vue d’atténuer cet inconvénient, on a songé à remplacer le bois par la fonte. Le billot en fonte, creux intérieurement, a une très longue durée; son emploi ne s’est pas généralisé parce que les ouvriers se plaignent qu’une enclume qui n’a pas de son fatigue et «coupe les bras».
Fig. 61. — Enclume maréchale.
La hauteur de la table de l’enclume doit atteindre le poignet de l’ouvrier, celui-ci se tenant droit et laissant tomber naturellement ses bras.
La bigorne est une petite enclume portative, à table plane, présentant à la place du talon une pyramide quadrangulaire qui fait pendant à la bigorne du côté opposé ; elle sert à ajuster et à rectifier les fers. On estime qu’une bigorne suffit pour deux ou trois feux.
L’établi est une longue et forte table, de 60 centimètres environ de largeur, fixée le long du mur le mieux éclairé de la forge, notamment celui portant une ou plusieurs baies. Destiné à porter les étaux, la hauteur de l’établi doit être telle que leurs mâchoires arrivent à la hauteur du coude de l’ouvrier placé devant elles (fig. 62).
Fig. 62. — Hauteur d’un étau.
Les étaux servent à déboucher et à limer les fers. Le modèle ordinaire est celui employé en maréchalerie. Un étau suffit pour deux feux. Pour en assurer la conservation, il faut éviter de placer entre les mors des fers trop chauds.
Le billot à contre-percer est un tronc de bois dur placé debout, sur lequel le maréchal ouvre avec un poinçon les étampures du fer. Il sert aussi, si l’on n’utilise pas l’étau, à déboucher les contre-perçures. Pour procéder plus commodément à cette dernière opération, on fixe de champ, sur la table du billot, deux ou trois râpes hors d’usage parallèlement et à 1 ou 2 centimètres les unes aux autres; on peut aussi adopter une disposition en V. Pour déboucher le fer, on le place au-dessus de ce petit appareil, les étampures en dessus.
Outillage mobile de la forge. — Chaque foyer et enclume doivent être pourvus d’instruments pour l’allumage et l’entretien du feu et aussi pour forger.
Une pelle (fig. 63) servant à alimenter le foyer en charbon et à enlever les résidus de la combustion.
Un tisonnier, tige en fer rond, repliée en œil à une de ses extrémités, terminée en pointe à l’autre, cette dernière destinée à pratiquer une petite ouverture dans la voûte du foyer, pour permettre de suivre la chauffe du lopin (fig. 63).
Un pique-feu, sorte de tisonnier dont l’extrémité est recourbée en crochet pour retirer le mâchefer du feu (fig. 63).
Une mouillette ou écouvette, tige en fer rond, qui porte emprisonnés à une de ses extrémités quelques chiffons ou autres matières propres à arroser le charbon du foyer (fig. 64).
Les lopinières ou tenailles à mettre au feu ont les mors épais et allongés, parce que s’usant rapidement en maintenant et retournant le lopin dans le foyer.
Pour permettre au chauffeur de surveiller le feu sans trop s’en approcher, ces tenailles doivent avoir environ un mètre de longueur.
Les tenailles à main sont de deux sortes: les enailles justes (fig. 66), et les tenailles goulues (fig. 67); les premières servent forger la deuxième branche du fer et à l’ajuster; les autres à mors plus ou moins ouverts sont employées pour le forgeage des lopins.
Fig. 63. — Pelle; tisonnier pointu; tisonnier à crochet.
Fig. 64. Mouillette.
Fig. 65. Lopinière.
Fig. 66. Tenaille juste.
Fig. 67. Tenaille goulue.
Un ferretier (fig. 68), marteau de forme lenticulaire servant à forger et à étirer les lopins. Pour ajuster les fers on emploie un ferretier plus petit.
Dans quelques ateliers des villes, on utilise le ferretier-bibouche, marteau qui présente deux bouches: l’une de forme ovale, semblable à celle du ferretier ordinaire et l’autre rectangulaire, plate comme celle du marteau à main. L’ouvrier peut ainsi allonger les lopins, bigorner, étamper et planer le fer, en se servant de l’une ou l’autre face, ce qui lui fait gagner du temps.
Fig. 68. — Ferretier.
Fig. 69. — Etampe.
Deux marteaux: celui à frapper devant, à panne et à bouche carrée, que le frappeur tient à deux mains; l’autre, dit marteau à main, pour faire les lopins, bigorner et finir le fer.
Fig. 70. — Four à lopins (Barrio).
Les étampes (fig. 69), à section carrée ou rectangulaire, servent à étamper; leurs dimensions varient suivant la couverture et l’épaisseur du fer à forger. Pour que les étampes correspondent exactement à la tête des clous, on utilise des matrices qui donnent le calibre désiré.
Les grands poinçons sont nécessaires pour contre-percer le fond des étampures.
Les tranches à froid et à chaud diffèrent l’une de l’autre parleur angle de coupe, plus grand pour la première que pour la seconde; elles servent à couper le fer.
Enfin, le seau à refroidir, placé près de chaque enclume, sert à refroidir les étampes, les poinçons et la tranche à chaud, pour éviter que ces outils ne se détrempent.
Le petit outillage de l’établi se compose de limes ordinaires demi-rondes, de petits poinçons pour déboucher à froid le fer, de petits marteaux à main, dits rivoirs, et d’un affiloir, toute petite enclume destinée à redresser les clous.
Modernisation de l’outillage de la forge. — Dans les ateliers de maréchalerie d’une certaine importance, on a introduit depuis quelques années, en vue d’obtenir une économie de combustible et de temps, un outillage nouveau qui marque un progrès.
Les fours à lopins et fours à réchauffer sont de plusieurs modèles. Tous permettent de chauffer facilement les lopins en barre; mais, lorsqu’il s’agit des lopins bourrus, la conduite du feu présente un peu plus de difficultés.
Le four Bario (fig. 70), un des plus perfectionnés, est à tirage continu et porte à sa partie supérieure une cuve en fonte avec robinet, permettant d’avoir de l’eau chaude en permanence. Il jouit des avan tages suivants: chauffage rapide des lopins en barre; même avantage pour l’ajustage des fers et la confection des lopins; son fonctionnement est aisé et il fait réaliser des économies de charbon.
La cisaille-guillotine destinée à couper les barres de fer.
La poinçonneuse à chaud à double action, pour mortaises à crampons à vis et pour sectionner les éponges.
La machine à percer à froid pour mortaiser les fers.
La machine à tarauder les mortaises qui donne un filetage rapide.
Le martinet à ressort servant à l’étirage des lopins bourrus, pour lesquels souvent deux frappeurs devant sont nécessaires, procure une économie de main-d’œuvre et supprime un travail exténuant.
Instruments de ferrure. — Les instruments dont se sert le maréchal pour le ferrage des animaux, sont contenus dans la boîte à ferrer divisée en trois compartiments: le plus grand reçoit les instruments et les vieux fers retirés du pied du cheval; les plus petits sont destinés, l’un aux clous neufs et l’autre aux caboches, clous usés provenant des déferres.
Les instruments se composent:
La mailloche, M et le brochoir, Br, sont deux petits marteaux de forme spéciale qui servent indistinctement à l’ouvrier pour l’implantation des clous dans la paroi, au moment de fixer le fer au sabot. La mailloche convient mieux pour parer le pied; le brochoir, au contraire, avec sa panne recourbée et fendue, permet l’arrachement des clous coudés ou mal implantés, sans le secours des tricoises.
Le rogne-pied, Ro, sorte de couteau en forme de lame de sabre, de 0m,30 environ de longueur, affûté en tranchant à une de ses extrémités, émoussé à l’autre, sert à parer le pied, à dériver les clous et aussi de repoussoir.
Fig. 71. — Instruments de ferrure.
Le boutoir, Bo, est un instrument tranchant employé au nivellement du bord plantaire de la paroi et à la toilette de la fourchette; il agit à la façon du rabot. Entre des mains inhabiles, il est aussi dangereux pour le teneur de pied que pour le cheval, en raison des blessures qu’il peut occasionner. Cet instrument est de moins en moins utilisé, parce que trop souvent employé abusivement à parer à fond la sole et la fourchette.
Les tricoises, T, fortes pinces à mors recourbés et tranchants, servant à enlever les vieux fers du pied, à arracher les souches, à retirer, couper et river les clous et à faire porter le fer.
La râpe du maréchal, Ra, est une lime à gros grains avec ses deux surfaces planes; elle sert pour dresser et niveler la face plantaire du pied et arrondir le contour du sabot. La râpe-lime, râpe d’un côté et lime de l’autre; elle est utilisée à deux fins.
Le repoussoir, petit poinçon rectangulaire destiné à chasser les vieilles souches qui sont cassées dans la muraille, ou à repousser les clous dont on ne peut saisir la tête avec les tricoises.
Le chevalet, espèce de trépied en bois ou en fer, sur lequel on fait reposer le pied du cheval pour râper le bord de la paroi.
Le tablier de forge ou basane sert à protéger le maréchal contre les brûlures en forgeant et pendant le ferrage.
Il convient de signaler aussi le phare-casquette (Barbe), ingénieux petit appareil d’éclairage à l’acétylène, s’adaptant à la coiffure du ferreur et lui permettant de ferrer en hiver dans les ateliers dépourvus de lumière ou ne disposant que d’un mauvais éclairage de fortune.
Enfin, dans tout atelier bien tenu, on ne saurait trop recommander d’installer un vestiaire et un lavabo, pour que les ouvriers puissent y déposer leurs vêtements et faire leur toilette après le travail.