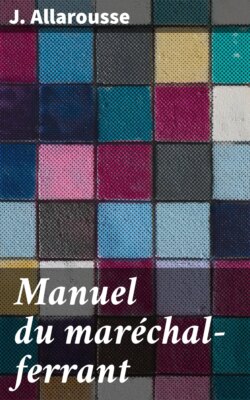Читать книгу Manuel du maréchal-ferrant - J. Allarousse - Страница 17
2° Aplombs du pied.
ОглавлениеEn maréchalerie, la connaissance des aplombs du pied du cheval est de première importance: c’est elle qui sert de base aux principes sur lesquels repose la ferrure normale, rationnelle, conservatrice du pied.
Sur un pied déferré ou sur un pied vierge de ferrure, l’usure naturelle de la corne maintient le sabot dans ses aplombs réguliers et l’assiette du pied a toujours la base qui lui convient. On peut dire aussi que l’aplomb du membre commande l’aplomb du pied, et qu’à l’extrémité d’un membre bien d’aplomb, panard ou cagneux, il doit nécessairement se trouver un pied bien conformé, panard ou cagneux, dont la surface d’usure de chacun est toujours horizontale.
Mais, sur un pied ferré, les conditions ne sont plus les mêmes; c’est l’ouvrier qui, armé du rogne-pied, dispose à son gré de l’aplomb du pied. En parant périodiquement le sabot, au moment du renouvellement de la ferrure, il peut, s’il est habile, maintenir au sabot son appui normal, le rectifier ou le redresser s’il a été faussé au cours d’une ferrure précédente. S’il est routinier et maladroit, il y a tout à craindre de lui, même de mettre un pied de travers à l’extrémité d’un membre bien d’aplomb.
L’influence que le maréchal exerce sur la conservation ou la déformation du sabot est donc importante. On sait, en effet, que sur un pied normal et d’aplomb, le poids supporté se distribue également sur toute la surface d’appui et que la corne du sabot pousse régulièrement, uniformément, en parfaite harmonie avec l’avalure; au contraire, que par ignorance l’ouvrier détruise l’aplomb régulier, la répartition du poids sur l’assiette du pied devient inégale et la pousse de la corne est d’autant plus ralentie que les régions du pied qui assurent son renouvellement sont elles-mêmes plus surchargées.
En conséquence, l’aplomb normal existe toutes les fois que la semelle de corne, représentée par le plancher du sabot, est d’égale épaisseur à tous les points saillants du bord plantaire, de la pince aux talons. Quand ces conditions sont réunies, le plan passant par la surface d’appui du pied est parallèle à celui du pied de chair, c’est-à-dire à la face inférieure de la troisième phalange.
L’aplomb du pied se juge au poser et au lever, dans le sens transversal et longitudinal.
APLOMB TRANSVERSAL. — Vu de face, le cheval placé sur un sol horizontal et uni, le pied est d’aplomb lorsque la surface d’appui est, elle aussi, naturellement horizontale; dans ce cas, l’axe du sabot et du paturon sont dans le prolongement l’un de l’autre, et si le membre est vertical, les rayons osseux sont aussi dans le prolongement rectiligne l’un de l’autre (fig. 49).
Dans le cas où le membre serait cagneux ou panard dans toute sa longueur ou seulement à partir du boulet, le pied est encore d’aplomb si le prolongement de son axe se confond avec celui de la partie déviée ou du membre tout entier. Pour s’en rendre compte, il faut se placer en face de la région de la pince et non en face de la tete.
Mais si l’axe du pied est dévié en dehors ou en dedans de l’axe du paturon, l’un des côtés du sabot est plus haut que l’autre; le pied n’est pas d’aplomb parce que son assiette n’est plus horizontale (fig. 50 et 51).
Vu de derrière, le pied est d’aplomb, quand sa fente postérieure a la même direction que celle du paturon. Cette règle souffre cependant de nombreuses exceptions. On peut observer quelquefois, sur un pied déformé par l’encastelure, la déviation de la fente postérieure du sabot, sans que pour cela l’aplomb naturel du pied soit faussé. Dans la pratique l’ouvrier apprend rapidement à discerner les différents cas qui se présentent à lui, en prêtant un peu d’attention.
Fig. 50. — Pied panard (oblique en dehors).
Fig. 49. — Aplomb normal.
Fig. 51. — Pied cagneux (oblique en dedans).
Vu au lever, un membre d’aplomb a toujours sa surface d’appui perpendiculaire à la direction de ce membre. C’est sur ce principe que repose l’examen de l’aplomb transversal du pied au lever. Les renseigments qu’il donne permettent, par leur exactitude, de formuler une conclusion avec toute la précision nécessaire. C’est le procédé de choix, qui, devenu classique, est appliqué dans tous les ateliers.
Fig. 52. — Aplomb tranversal.
Pour l’employer, on fait lever et soutenir au canon le membre en demi-flexion, le boulet, le paturon et le sabot tombant naturellement (fig. 52). On se place ensuite près du cheval, bien en face du pied, le corps incliné en avant, et saisissant le sabot avec les deux mains, un pouce sur chaque talon, on place la face plantaire verticalement au sol. Si la surface d’appui coupe à angle droit le plan vertical passant par l’axe de la partie inférieure du membre, le pied est d’aplomb. L’aplomb est défectueux si ces deux plans ne se coupent pas à angle droit.
A ce procède, on préfère le suivant; plus simple parce qu’il ne nécessite pas l’assistance d’un aide. L’opérateur, placé à hauteur de l’épaule du cheval, soulève le membre et, faisant face en arrière, il soutient horizontalement le canon par son milieu, l’avant-. bras restant, vertical. Dans cette position, la face plantaire du sabot étant verticale, le maréchal regarde si la surface d’appui coupe à angle droit le plan vertical partageant en deux parties égales la partie inférieure du membre.
Fig. 53. — Examen de l’aplomb sans aide.
Dans la pratique, l’ouvrier juge encore rapidement l’aplomb du pied à l’aide de deux ligues: l’une passant par la lacune médiane et la pointe de la fourchette, l’autre tangente aux talons. Si ces deux lignes se croisent à angle droit, l’aplomb transversal du pied est bon (fig. 54).
Ce procédé ne donne de bons résultats que sur les pieds bien conformés. Sur les sabots déformés, il donne lieu à des erreurs.
Fig. 54. — Examen de l’aplomb avec deux lignes.
Enfin, il convient de signaler que sur les pieds à talons chevauchés, ce n’est pas le talon chevauchant qui doit être abaissé et paré, mais son voisin, le chevauché. Par suite de vieux errements encore très répandus, le maréchal est souvent enclin à opérer d’une façon contraire; il doit donc être mis en garde contre cette méprise.
APLOMB LONGITUDINAL. — Encore appelé antéropostérieur, l’aplomb longitudinal est celui qui sert à déterminer la hauteur respective de la pince et des talons.
Vu de profil, le pied est d’aplomb (fig. 55) quand la ligne de pince est dans le prolongement de la ligne du paturon. Si la ligne de pince est brisée et forme un angle au niveau de la couronne, le pied n’est pas d’aplomb; le paturon se redresse ou s’abaisse sur le sabot.
Fig. 55. Aplomb normal.
Fig. 56. — Pince trop longue ou talons trop bas.
Fig. 57. — Pince trop courte ou talons trop hauts.
Si l’angle est ouvert en avant, les talons sont trop bas ou la pince trop longue (fig. 56).
Si l’angle est ouvert en arrière, les talons sont trop hauts ou la pince trop courte (fig. 57).
L’examen de l’aplomb de profil fournit à l’ouvrier des indications sur la quantité de corne qu’il doit enlever pour donner à la pince et aux talons les hauteurs respectives qu’ils doivent avoir.
Il semble à première vue que l’examen de l’aplomb longitudinal du pied ne présente aucune difficulté. Il demande cependant de la part de l’ouvrier beaucoup d’attention et un coup d’œil qui ne s’acquiert qu’avec le temps. Il n’existe, en effet, qu’un rapport variable entre la hauteur des talons et la longueur de la pince, car ces deux régions du sabot restent subordonnées à la direction du paturon; d’autre part, aux pieds ayant naturellement la pince inclinée et les talons bas, on la pince droite et les talons hauts, il est interdit tout redressement pour éviter des tiraillements ligamenteux, tendineux et articulaires douloureux.
Répartition de la pression d’appui. — Cette répartition doit être envisagée dans l’ensemble des pieds et dans chaque pied en particulier.
Les quatre pieds reçoivent, en outre du poids qu’ils supportent normalement, une certaine somme de pression variable suivant les attitudes et les allures, pression qui augmente en raison de la charge et de la vitesse.
Les sabots de devant supportent toujours une plus forte pression que ceux de derrière, le centre de gravité du corps Étant plus rapproché des membres antérieurs que des postérieurs. C’est ce qui explique pourquoi ceux-là sont construits en colonne de soutien et ceux-ci destinés à donner l’impulsion sont formés d’articulations anguleuses, plus favorables à chasser le corps en avant qu’à le soutenir.
L’expérimentation et l’observation apprennent aussi que pour le pied dont l’appui est normal, les régions antérieures du sabot sont plus surchargées que les postérieures. Il suffit d’examiner des empreintes en terrain mou, pour constater qu’elles sont toujours plus profondes en pince qu’en talons. Cette particularité trouve son explication dans la conformation naturelle du sabot, qui à sa muraille plus épaisse, plus résistante en pince et en mamelles qu’en quartiers et, toute proportion gardée, le quartier externe plus fort que l’interne parce que plus chargé.
Sur les pieds bien conformés, la résultante des pressions supportées par le pied passerait, en un point qui a été situé un peu en dehors du croisement des axes transversal et longitudinal de la face plantaire du sabot et de la pointe de la fourchette (fig. 58).
Fig. 58. — Axes longitudinal et transversal du pied.
Mais, si ce mode de répartition des pressions de l’appui vient à être modifié, certaines régions du sabot sont surchargées proportionnellement au déplacement du centre de pression pendant que d’autres sont allégées d’autant; il y a rupture de l’équilibre, avec pour conséquence une cause de fatigue et de maladie des membres et du pied.
De ces considérations, il découle la nécessité de conserver au pied son aplomb régulier, ainsi que toute l’étendue de sa surface d’appui. Toute modification brusque, irraisonnée de l’aplomb du sabot amène des changements dans la répartition des pressions supportées, et il est évident que la pression sur une région du pied est d’autant plus grande que la surface d’appui est plus réduite.
Il est donc indispensable de toujours maintenir au contact du fer ou du sol toutes les parties du sabot qui normalement servent à l’appui: fourchette, barres et muraille.
Pendant les diverses allures, les pressions ressenties dans les diverses régions du sabot donnent aussi d’utiles indications pour l’exécution d’une bonne ferrure. Aux allures modérées, la pince et les mamelles, surtout celle du dehors, font tout d’abord leur appui et ensuite les quartiers et les talons. Au contraire, aux allures vives, ce sont les talons qui arrivent les premiers au contact du sol et, recevant une plus forte pression, ils laissent une empreinte plus profonde sur le terrain (fig. 59).
L’examen des aplombs en marche, surtout pour les pieds défectueux, donnent des indications précieuses au maréchal pour expliquer l’usure irrégulière du fer. Toute dénivellation de l’appui normal du sabot retentit sur les allures et ralentit la marche par la douleur plus ou moins vive des régions du pied, supportant un excès de pression.
Fig. 59. — Empreintes du pied du cheval sur le sol.
En règle générale, lorsque l’aplomb est faussé dans un sens ou dans un autre, le cheval réagit par un mouvement spécial de ses membres, toujours préjudiciable à la répartition uniforme des pressions; l’usure prématurée de l’animal en est souvent la conséquence, telle est la conclusion qu’il faut retenir.