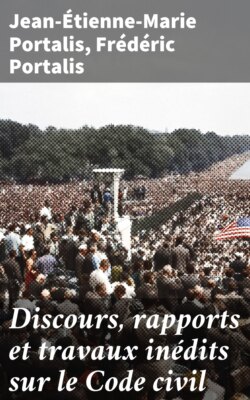Читать книгу Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil - Jean-Étienne-Marie Portalis - Страница 4
ESSAI SUR L’UTILITÉ DE LA CODIFICATION, ET COMPARAISON DES DIVERS PROJETS DE CODE CIVIL, SUCCESSIVEMENT PRÉSENTÉS A NOS ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES JUSQUES ET Y COMPRIS LE PROJET DU CODE NAPOLÉON.
ОглавлениеSi nous en croyons Vico, la société humaine parcourt un cercle fatal. Après s’être élevées par une suite de modifications progressives, les nations sont inévitablement ramenées à la décadence et à la barbarie. Cependant tout n’est pas fini, une autre race sort des ruines que le temps a faites autour d’elle; elle réveille les dernières étincelles d’un feu qui s’éteint, rallume le flambeau sacré de la civilisation et le fait luire d’une clarté nouvelle.
L’histoire nous fournit des faits à l’appui de cette théorie; seulement, le monde ne recommence pas à nouveau; le passé influe toujours sur l’avenir; chaque peuple qui se civilise et s’éclaire n’est pas abandonné à ses propres forces, il profite de l’expérience et des travaux de ceux qui l’ont devancé. C’est ainsi que partant toujours d’un peu plus haut, guidée par des principes plus sûrs et mieux éprouvés, chaque nation qui s’élève et brille à son tour dans l’univers parvient à une civilisation plus perfectionnée et plus complète. Telle nous paraît être la marche du progrès humain.
Il est donc nécessaire qu’un jour ou l’autre les sociétés comptent avec elles-mêmes, et fassent l’inventaire de leurs richesses acquises; c’est un fait que l’on retrouve presque dans l’histoire de chaque nation. Ce consentement à peu près unanime des peuples démontre, jusqu’à l’évidence, l’utilité de réunir en faisceau la totalité des lois d’un état, à de certaines époques de son existence politique, et d’en former des collections officielles plus ou moins méthodiques auxquelles on donne le nom de Codes, et où disparaissent les textes inutiles ou contradictoires. Ce n’est pas un besoin de nos temps modernes; tous les états en ont été successivement travaillés; et Tacite, dans ses Annales, se plaint de la multitude de lois qui gênaient, de son temps, la marche du gouvernement et le cours de la justice.
L’amélioration et le progrès des législations par les Codes est un fait important dans l’histoire de la civilisation des peuples.
Vainement l’école historique prétendrait-elle en contester les avantages: les exemples parlent plus haut qu’elle. Lorsque les progrès ont accru les besoins, diversifié les transactions et multiplié les intérêts, il arrive toujours un moment chez une nation, où le grand nombre des lois rendues pour y satisfaire ne présente plus qu’un inextricable labyrinthe, où l’esprit du juge s’égare au milieu d’un nombre infini de dispositions en désordre, souvent opposées entre elles. Alors, suivant les formes de gouvernement du peuple qui est réduit à cette nécessité, surviennent soit un prince, soit des magistrats qui ordonnent la refonte de la législation. Un choix dicté par la force des choses s’opère; on classe, on réunit les règles et les coutumes qui sont d’une utilité actuelle et pratique, on y en ajoute de nouvelles conformes à l’esprit du temps et aux nécessités présentes. On abolit celles qui sont devenues inutiles ou nuisibles, au grand regret sans doute de l’antiquaire ou de l’historien, mais à l’avantage immense des populations, dont les lois, mieux en harmonie avec les hommes et les choses qu’elles doivent régir, reprennent une vie et une autorité toutes nouvelles.
D’autres motifs plus puissants et qui tiennent à la politique même, commandent aussi quelquefois à la puissance publique cette refonte générale d’une législation tout entière.
Les lois règlent les conditions de la société civile; elles stipulent toutes les clauses du contrat qui lie les hommes réunis en corps de nation, elles sont donc naturellement uniformes pour toutes les parties d’un même état. Originairement chaque société politique a ses coutumes ou son droit civil. Plus tard, avec l’accroissement successif des empires, plusieurs peuples venant à se confondre par la conquête, les fédérations, les héritages, les échanges, les cessions ou autres manières d’acquérir du droit politique, la législation se complique.
L’état qui prédomine chez ses alliés, ou qui réduit à l’obéissance des provinces étrangères, tantôt respecte les lois et les institutions locales pour obtenir plus facilement la soumission; tantôt, transformant l’égalité légale en privilège, refuse le droit de cité aux peuples qu’il a domptés et qu’il veut affaiblir. Ces circonstances deviennent une source féconde de la diversité des coutumes et des lois. Mais lorsqu’une longue existence parallèle, une même prospérité, de nombreux croisements opérés par les mariages dans des races diverses, ont créé une communauté d’intérêts entre elles, cette identité d’intérêts amène une cohésion plus complète entre les sujets d’un même état, et les populations ainsi soudées ne forment plus en réalité qu’un peuple, dont les idées, les gloires, la fortune, le nom et le langage deviennent communs. La nécessité de les relier par une même législation se fait sentir alors; le moment est venu de consommer en droit, au moyen de l’uniformité de législation, cette fusion, qui existe déjà de fait, et de réunir par un lien de confraternité nationale, sous le joug d’une loi commune, ces populations qui ne forment désormais qu’un seul peuple. La confiance des citoyens dans les institutions s’augmente par l’application à tous d’une justice égale, comme celle de Dieu, par l’équitable répartition des droits, et la soumission de tous aux charges et aux. obligations communes, selon la hiérarchie et la forme du gouvernement qui les régit.
Ce n’est qu’après la promulgation de cette législation perfectionnée, appropriée aux besoins nouveaux des contrées réunies sous une même souveraineté, que l’action du pouvoir est libre et complète, que ses ordres et son autorité ont l’indépendance et l’unité d’action nécessaire pour favoriser et diriger l’accroissement et le progrès naturel de la puissance nationale. Alors seulement l’homogénéité du corps social est établie et sa nationalité définitivement constituée.
L’expérience a démontré avec quelle facilité les savants du siècle dernier se sont habilement approprié, grâce aux progrès de l’esprit philosophique et de méthode, les observations de leurs devanciers; il en est de même dans le droit et la jurisprudence. C’est aussi lors de ces grandes et utiles révisions ou réformations que la philosophie pénètre dans les lois et les fait participer aux progrès de l’esprit humain; nous avons été les témoins de l’avénement de l’esprit de méthode, dont elle a doté la science des lois. Qu’est-ce en effet que la codification, si ce n’est l’esprit de méthode appliqué à la législation? Et dans quelle science cet esprit est-il plus nécessaire à introduire que dans celle qui doit être à la portée de toutes les intelligences, puisqu’elle enregistre et détermine les devoirs de chacun à l’égard de ses concitoyens et de l’état? Lorsque cette direction est imprimée à la législation, une voie simple et facile est ouverte au citoyen qui a besoin de connaître les dispositions de la loi; chacun peut aller droit à celles qui l’intéressent, et s’instruire par lui-même de la marche qu’il doit suivre pour la conservation de ses droits.
Nul ne peut prétendre ignorer ses obligations morales, parce que la loi naturelle est cette lumière intérieure qui éclaire la conscience de tout homme venant en ce monde; de là, et par assimilation, est sorti cet adage, salutaire fondement de l’ordre public, que nul n’est censé ignorer la loi; mais, si l’on veut le maintenir, et ne pas mettre la fiction légale en opposition avec le fait, il faut veiller à la bonne composition des lois. Il convient d’écarter soigneusement des textes législatifs toute distinction subtile, toute inutile superfétation, toute interprétation douteuse; il faut s’efforcer de faire ressortir de leurs dispositions mêmes les motifs d’équité qui les ont dictés, classer les préceptes selon l’ordre logique, et les déduire les uns des autres, afin qu’ils se prêtent un mutuel appui.
Sans doute un travail de cette nature pourrait être l’ouvrage de jurisconsultes et de docteurs qui ne seraient revêtus d’aucune autorité officielle; presque toujours c’est par eux que l’exemple en a été donné : tel Gaius chez les Romains, tels Brisson, Lamoignon et Domat chez les Français. Mais l’autorité dogmatique de l’école serait insuffisante: sous son empire, chacun pourrait adopter un système différent; la science serait mieux faite peut-être, mais ses progrès seraient plus ou moins infructueux, puisque les règles déclarées ne seraient point obligatoires, les décrets de la raison n’étant point exécutoires de plein droit. Pour que les avantages d’une bonne classification, d’une réforme éclairée et d’un remaniement critique profitent à la société, il faut donc qu’ils soient consacrés par l’autorité irréfragable de la loi; ils ont besoin d’emprunter d’elle ces caractères d’uniformité , d’authenticité et d’empire, cette sanction souveraine qui commande la confiance et ordonne la soumission. Il demeure, dès lors, suffisamment démontré pour nous, que la codification est une conséquence nécessaire et inévitable de ces modifications, insensibles d’abord, mais constantes, que la marche irrésistible du temps apporte à toutes les institutions humaines. Lors donc que le moment est venu d’opérer ces grands changements, ceux qui osent les entreprendre et qui ont recours, pour les accomplir, aux lumières de l’équité naturelle et d’une philosophie sage et élevée, doivent être placés par les populations reconnaissantes au nombre des bienfaiteurs de l’humanité.
Telle fut la tâche glorieuse entreprise chez les Lacédémoniens par Lycurgue, chez les Athéniens par Dracon et Solon, chez les Romains, après Numa, par les décemvirs, Théodose et Justiniens, et parmi nous par Charlemagne, saint Louis et Napoléon. Les lois de Manou, les codes chinois et japonais, les assises de Jérusalem, ce code féodal de la croisade, les codes plus récents de Prusse, d’Autriche, de Bavière, de Sardaigne, ont une origine analogue. Quelques codes religieux seuls, tels que les tables de la loi chez les Juifs, ce divin résumé de tous les devoirs des hommes, et le Coran chez les Musulmans, ont été formés d’un seul jet, non toutefois sans emprunter quelques dogmes aux religions plus anciennes, et sans conserver l’empreinte de ces règles de justice universelle qui, bien avant leur promulgation, éclairaient la conscience des peuples.
C’est à cette règle constante du progrès humain, c’est à cette nécessité sociale et pressante d’un lien commun entre les citoyens d’un même état, qu’obéissaient en France, même à leur insu, les princes et les magistrats, lorsque les appels au roi recevaient chaque jour, sous notre vieille monarchie, une nouvelle extension, lorsque, dans l’absence de toute coutume spéciale, la coutume de Paris était réputée le droit commun des pays coutumiers, comme les lois romaines elles-mêmes dans les contrées régies par le droit écrit.
Cet instinct d’unité et d’uniformité, cette tendance intime à assimiler la législation à la justice universelle, à l’élever à la dignité de cette loi divine de la conscience qui est la même en tous lieux et pour tous les hommes, animait Beaumanoir dans ses beaux travaux sur la coutume de Beauvoisis, lorsqu’il s’efforçait d’y faire pénétrer les principes du droit commun et de l’éclairer de leur lumière; il inspirait Loisel et d’Aguesseau dans leurs immortels ouvrages, et dirigeait le sage et philosophe Domat dans son admirable Traité des lois et dans le classement et la composition de ses Lois civiles; aussi le vœu d’une législation civile uniforme fut-il un de ceux qui furent le plus solennellement et le plus généralement exprimés dans les cahiers des trois ordres remis par les divers bailliages aux députés qui devaient siéger aux états généraux convoqués par le roi Louis XVI en 1789.
A cette époque surtout, un immense désir d’instruction et de liberté demandait à se satisfaire. La philosophie s’était emparée de l’examen et de la critique des lois; elle avait fait rentrer la législation dans le domaine des connaissances humaines: il fallait qu’elle fût mise en harmonie avec l’état des lumières. C’était sous ce point de vue qu’on envisageait toutes choses.
La connaissance de la loi est pour chaque citoyen un profitable enseignement; en apprenant à connaître ses devoirs envers le corps social, en pénétrant la raison et l’utilité de chaque prescription légale, l’homme agrandit son jugement, il rectifie ses idées et réduit à leurs justes proportions des prétentions souvent exagérées, faute de bien comprendre qu’il est une portion de ses libertés et de ses droits à laquelle chacun de nous doit renoncer, afin que la liberté et les droits de tous soient suffisamment garantis.
Pour ne pas compromettre la possession des avantages que nous devons à la codification, peut-être serait-il à désirer, aujourd’hui, qu’une commission permanente, composée de magistrats et d’hommes d’état choisis dans les deux chambres, fût chargée de veiller à la conservation et au développement progressif de nos codes; cette commission colligerait les lois nouvellement rendues, les comparerait entre elles, les classerait et les répartirait sous forme de supplément chacune en son lieu, et sous les titres auxquels elles se rapporteraient. Ce travail mettrait à portée de proposer la suppression ou l’amendement de dispositions désormais inutiles ou incomplètes. A des époques déterminées, cette commission ferait un rapport au gouvernement, qui proposerait à l’adoption du roi et des chambres les rectifications jugées utiles et indispensables pour l’amélioration de nos lois; par ce moyen se perpétuerait parmi nous le bienfait de la codification, et se compléterait pour l’avenir le beau travail entrepris et presque achevé par la savante commission de révision des lois, créée sous la restauration et qui fut dissoute en 1830.
Cette collection du système entier des lois d’une nation, par ordre de matière et en forme de code, a surtout l’avantage philosophique de faire remonter plus aisément ceux qui en font l’objet de leurs méditations aux principes d’où découle la loi elle-même; aussi est-il permis de penser que pour compléter cet avantage et comme pour lui servir d’introduction il est utile de placer en tête du livre des lois un exposé rapide des principes de morale et de justice éternelles qui président à toutes les actions humaines, quelles que soient d’ailleurs les croyances et les institutions politiques qui régissent chaque nation.
«Le législateur, disait Cambacérès à la convention nationale, en lui présentant son remarquable travail sur le premier projet de Code civil, ne doit pas aspirer à tout dire; mais après avoir posé des principes féconds qui écartent d’avance beaucoup de doutes, il doit saisir les développements qui laissent subsister peu de questions.» (Exposé des motifs du premier projet du Code civil.)
C’est dans cette vue que les rédacteurs du projet de Code civil de l’an VIII avaient chargé Portails de rédiger un livre préliminaire qui devait rattacher les commandements de la loi à ces maximes du droit, indépendantes de la volonté toujours ambulatoire de l’homme. Un point de départ pris de si haut devait relever la loi dans l’esprit des peuples. Ses principes, puisés hors de la sphère orageuse des passions humaines, auraient emprunté à leur sublime origine ce caractère de fixité qui est une partie si considérable de l’autorité des lois.
Ce livre préliminaire devait être plus développé dans la pensée de son auteur. La timidité qui se remarque dans sa rédaction indique la difficulté de l’exécution d’un tel travail, et fait pressentir le sort qui lui était réservé. Le moment n’était pas venu de proclamer les axiomes du droit; la saine doctrine ne se dégageait que laborieusement des sophismes qui l’avaient obscurcie durant le dix-huitième siècle. Nous reproduisons en entier le texte de ce livre et la discussion à laquelle il a donné lieu. Quelque étroit que fût le cadre, dans lequel Portalis fut contraint de se renfermer, les principes qu’il contient étaient largement exprimés; ils étaient empreints d’une haute philosophie et portent le cachet de cette doctrine spiritualiste qui donne à nos codes une physionomie propre et qu’il était si utile de proclamer après le long et fatal triomphe du système étroit et égoïste de l’utilité.
Aussi y a-t-il lieu de s’étonner qu’un savant professeur, dans son discours préliminaire sur l’étude générale du droit, ait approuvé la suppression d’un livre si bien en harmonie, cependant, avec les théories élevées qu’il développe dans ses savantes leçons . Un frontispice grave et religieux était d’autant plus nécessaire à placer en tête de notre législation nouvelle, que les idées de morale et de justice avaient été plus profondément ébranlées dans les cœurs, durant le cours de nos tempêtes politiques, et qu’il importait de montrer aux populations que les principes sacrés de la morale et de la justice avaient une autorité souveraine indépendante des révolutions.
A quelle époque, en effet, la rédaction de nos lois civiles fut-elle entreprise?
Une société, dont les institutions chancelantes étaient à la fois minées par le progrès des idées nouvelles et la rouille des anciens abus, ébranlée dans ses croyances, corrompue dans ses mœurs, divisée entre deux partis, dont l’un résistait à toute réforme, et l’autre aspirait à tout renverser, venait de s’écrouler tout entière; ceux qui avaient été appelés à la réformer, irrités par les résistances, et cédant au mouvement de réaction révolutionnaire qui entraînait tout, avaient sapé indistinctement les bases d’une antique monarchie; ils avaient fait table rase; l’œil ne voyait plus autour de lui que des ruines fumantes encore du sang des victimes immolées au nom de la régénération sociale; il fallait redonner des lois à une nation au nom de laquelle on avait abdiqué jusqu’à ses souvenirs; on essaya vainement de composer du nouveau; toutes les tentatives avortèrent.
Quelle que soit la violence des passions qui agitent la société, lorsqu’il s’agit de reconstruire l’édifice social tout entier, la pensée se reporte en arrière, malgré l’esprit d’innovation qui domine; le passé se fait jour, il revit et se mêle à tout. En vain voudrait-on en effacer les dernières traces, il réagit sur le présent et sur l’avenir. Il fallait donc, en consommant et en ratifiant l’abolition des dispositions surannées, des préceptes devenus inapplicables, rajeunir et relever celles de nos institutions anciennes qui, à cause de leur sagesse, de leur justice et de leur convenance, tenaient au sol et n’avaient pu être entièrement déracinées; il fallait leur rendre le mouvement et la vie.
Guidés par un savoir profond, une haute raison, un patriotisme ardent, les législateurs chargés de la difficile mission de rédiger nos lois civiles, devaient se pénétrer à la fois des grands principes des lois romaines, des dispositions des coutumes provinciales et des ordonnances de nos rois, consulter les législations étrangères, la législation révolutionnaire elle-même, extraire de tous ces documents habilement comparés les règles les plus appropriées à l’état de notre société moderne.
Ils devaient avant tout consolider la principale et la plus profitable conquête de la révolution, celle de l’unité nationale; il fallait pour cela effacer, sans blesser cependant, ni les esprits, ni les mœurs, ce caractère profondément tranché d’originalité et de spécialité qui distinguait nos coutumes et qui faisait en quelque sorte de chacune de nos provinces un état indépendant, un corps politique isolé. Cette manière d’être rappelait sans doute l’époque et le motif de la réunion de chacune de ces contrées à la couronne de France, mais elle divisait le royaume en autant de fractions dont les intérêts et même le langage étaient presque toujours différents et quelquefois opposés. Il était temps d’apprendre aux citoyens de chaque province qu’ils étaient Français vant tout, soumis aux mêmes charges et en possession des mêmes droits.
L’équité, la morale, la raison, demandent des lois égales pour tous; la politique en réclame surtout de semblables pour tous les citoyens d’un même empire. Plus les membres d’une société s’identifient, plus ils ont de rapports nécessaires, de liens communs, plus ils se groupent avec énergie en corps de nation et sont faciles à diriger vers un même but; cette uniformité de position leur fait sentir plus vivement, par la comparaison constante de leurs situations respectives, le fort et le faible des institutions qui les régissent, et les modifications utiles à introduire dans la marche du gouvernement pour assurer la prospérité publique. La communauté de lois et de langage resserre intimement les liens de la nationalité , elle accoutume les habitants d’une même patrie à se considérer entre eux comme membres d’une seule famille, et cette étroite confraternité qu’elle établit rend un peuple merveilleusement propre, s’il est d’ailleurs intelligent et actif, à se placer, en réunissant toutes les forces dont il dispose, à la tête de la civilisation et du progrès, à imposer son caractère particulier à une des grandes époques de l’histoire contemporaine, et à exercer une puissante influence sur les destinées du monde.
Telle étoit la tâche immense, redoutable, qui fut imposée, à cette époque, aux hommes d’état et aux jurisconsultes appelés à remanier nos lois. La haute sagesse de notre Code civil, à laquelle l’Europe entière a rendu hommage, les inspirations qu’y puisent sans cesse, depuis sa publication, les nations voisines qui refondent leurs anciennes lois, le respect avec lequel on exécute ses dispositions encore aujourd’hui dans plusieurs états, où il avait été introduit par la conquête et qui ne font plus partie de la France, attestent assez hautement que les grands citoyens chargés de sa rédaction ont su dignement atteindre le but qu’ils se proposaient.
Mais par quelles épreuves diverses a passé ce grand ouvrage? quelles élaborations successives a-t-il subies? quelles métamorphoses l’ont successivement transformé, depuis que les cahiers des bailliages eurent donné à leurs députés la mission d’en provoquer la création, et que la Convention nationale eut annoncé le désir de le promulguer? quels changements furent apportés à son économie et à ses principes, depuis que Cambacérès en eut soumis à cette assemblée le premier projet jusqu’à sa promulgation définitive? C’est ce que nous allons essayer de faire connaître. Nous n’analyserons pas seulement les principales dispositions des projets successivement proposés, nous rappellerons les noms historiques des personnes choisies durant les phases diverses de la révolution pour accomplir de tels travaux. Ces noms révéleront déjà l’esprit dans lequel ces travaux furent entrepris; mais nous irons plus avant, et nous rechercherons avec soin la raison des modifications apportées au plan primitif, selon les différentes crises révolutionnaires que traversa cette préparation et ce long enfantement de notre législation. Nous constaterons les changements qui s’opéraient chaque jour dans l’esprit des législateurs eux-mêmes, à mesure qu’ils se mûrissaient à la rude école de l’expérience, que le bon sens public reprenait son empire naturel, et que son influence les ramenait, peu à peu, des systèmes absolus et impraticables dictés par l’inexpérience des affaires, l’ignorance de la science des lois et l’esprit d’innovation, à une plus saine appréciation de l’état normal des sociétés.
Cette exposition consciencieuse des faits assignera à chacun d’eux le caractère qui lui est propre. Elle pourra fournir à la fois, sous le rapport de la physiologie sociale, si l’on peut parler ainsi, une étude curieuse de la marche de l’esprit humain au milieu des commotions sociales qui ébranlent les empires, et une leçon utile à ceux qui se laissent entraîner par la hardiesse ou les illusions décevantes d’une ingénieuse utopie. On y verra qu’il faut, avant tout, tenir compte des difficultés souvent insurmontables que présentent dans la pratique les instincts et les passions de l’humanité, et ces résistances inévitables qui tiennent aux circonstances de chaque jour; on se convaincra que la saine appréciation de ces difficultés assure seule l’avenir de l’œuvre du législateur, et qu’elle est une grande part de son génie. C’est une vérité banale, que les hommes qui ont reçu de la Providence le pouvoir ou la mission de détruire, sont profondément impropres à réédifier. Les événements qui se sont accomplis en France depuis 1789 en ont fourni de frappants exemples.
Il serait effectivement bien difficile de comprendre comment, au milieu de l’effervescence générale, lorsque les sentiments les plus outrés et les plus divers se heurtaient avec violence, les têtes volcanisées par ce torrent d’idées nouvelles mises en circulation depuis cinquante ans, et échauffées par ce débordement de philanthropie aveugle, de rancunes invétérées, de lâches envies, d’ambitions effrénées et de théories aussi absolues qu’elles étaient vaines, eussent pu imposer silence aux voix confuses de tant de passions ardentes, pour écouter les conseils de l’expérience et de la sagesse.
Un tel miracle était impossible.
Profondément ulcéré des dédains et des exclusions auxquels l’avait condamné la vieille hiérarchie sociale, pendant une longue suite de générations; fier de son émancipation soudaine, confiant dans sa force, son habileté et ses lumières, imbu des doctrines d’égalité et d’indépendance promulguées par la philosophie moderne, le tiers état fut mis en possession du pouvoir par la violence autant que par le droit. L’esprit naturel d’opposition et d’indépendance du clergé, la dédaigneuse paresse et la générosité présomptueuse ou irréfléchie de la noblesse, l’attachement aveugle de ces deux ordres à des priviléges qui étaient devenus des effets sans causes, avaient préparé et précipité l’avénement de la classe moyenne. Son premier soin dut être de renverser toutes les barrières qui s’étaient si longuement opposées à son élévation, et de rendre désormais impraticable et impossible tout retour aux institutions fondées sur l’inégalité et le privilège, dont elle dispersait les derniers débris.
Aussi se montra-t-on bien plus jaloux de proclamer fièrement à la face de l’Europe les droits imprescriptibles de l’homme et du citoyen, que de s’assurer des moyens utiles d’en assurer l’exercice dans le présent et pour l’avenir; et ces jours-là même consacré à discuter avec éclat les principes imposants de cette déclaration solennelle, offrirent-ils le triste contraste de la violation effrontée des droits les plus essentiels ou les plus sacrés, et furent-ils le prélude d’une époque, où les abus du pouvoir populaire furent sans mesure comme sans excuse.
Ce moment était peu favorable pour discuter avec maturité les principes d’une législation civile, et l’assemblée nationale, malgré son désir sincère de déférer en ce point aux vœux bien connus des électeurs, ne put parvenir à arrêter les bases d’un pareil travail.
Elle se borna à nommer un comité de jurisprudence, et à décréter dans la séance du 5 juillet 1790, que les lois civiles seraient revues et réformées par les législateurs, et qu’il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution, disposition répétée en ces termes dans la constitution de 1791: «Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume.»
L’assemblée législative fit moins encore. Cependant les réclamations et les provocations ne manquèrent pas. L’illustre et infortuné de Larochefoucault, président du département de Paris, vint inutilement à sa barre le vendredi 7 octobre 1791, rappeler l’engagement pris par l’Assemblée constituante pour les législateurs à venir, de refondre les lois civiles en un code, comme l’avait proposé Franklin en Pensylvanie, afin de cimenter le principe de l’égalité des citoyens. En vain l’abbé Audouin demanda-t-il, le 8 octobre de la même année, la nomination d’un comité de Code civil. La législature écouta avec aussi peu de faveur les propositions de Couthon et de Ramon qui, le 10 du même mois, sollicitèrent, le premier la formation d’un comité de jurisprudence, le second la création de deux comités, l’un de législation civile, l’autre de législation criminelle: sourde à la voix des hommes de tous les partis, elle se borna, on a peine à le croire, tant on traitait puérilement à cette époque les choses les plus sérieuses! à inviter tous les citoyens et même les étrangers à publier leurs vues sur la formation d’un nouveau Code .
La Convention, plus résolue et décidée à ne rien laisser en arrière, mais non moins incertaine sur les principes fondamentaux de la législation, ayant succédé à l’Assemblée législative le 21 septembre 1792, se divisa aussitôt en douze comités, dont un de législation .
A la date du 24 juin 1793, elle inséra dans son acte constitutionnel un article portant que le Code des lois civiles et criminelles serait uniforme pour toute la république, et le 25 elle décréta que son comité de législation serait tenu de lui présenter dans un mois un projet de Code civil.
Le 7 août de la même année, Cambacérès, dont la science complaisante et le facile talent avaient en si peu de temps improvisé l’ensemble d’une législation civile tout entière, vint annoncer que le projet de code existait, et demanda l’autorisation d’en donner lecture le vendredi suivant.
Le 9 août eut lieu la lecture de ce prodigieux travail, dont l’impression et la distribution furent ordonnées le même jour. La discussion fut fixée au 22 du même mois; mais après de vaines et orageuses discussions, où l’assemblée, toujours divisée sur le fond même des principes, et entraînée par la marche rapide des événements, ne put s’arrêter à aucun système, toute délibération sur ce sujet fut ajournée.
Ce projet, du reste, est digne d’attention; il fait connaître jusqu’où on était parvenu dans l’œuvre de la décomposition sociale et d’où il a fallu revenir.
Parcourons rapidement, pour en avoir une juste idée, les dispositions qui règlent ce qui a rapport à la famille, c’est-à-dire la puissance paternelle, la filiation des enfants légitimes et naturels, la puissance maritale, les causes de dissolution admises pour le mariage, enfin les restrictions apportées au droit de tester et de disposer pour cause de mort ou par donation.
Plus tard nous les rapprocherons des dispositions qui concernent ces grandes bases de la société civile, telles qu’elles se comportent dans chacun des projets proposés aux votes de nos assemblées législatives, y compris celui du Code Napoléon.
Ce parallèle indiquera le mouvement des opinions sur ces importantes matières durant environ dix années: il mérite d’être étudié par les philosophes qui consacrent leurs veilles à l’avancement des sciences morales et politiques.
Les principes exprimés dans l’exposé des motifs sont un remarquable commentaire des dispositions elles-mêmes; ils indiquent la situation violente des esprits, et de quel artifice de langage le rédacteur fut coutraint d’user quelquefois, pour faire seulement supporter la lecture des dispositions qui ne se pliaient pas assez complaisamment encore aux exigences des factions anarchiques qui opprimaient la société.
Ecoutons le rapporteur.
«La vérité est une et indivisible: portons dans le corps de
» nos lois le même esprit que dans notre corps politique; l’égalité,
» l’unité, l’indivisibilité ont présidé à la formation de la république,
» que l’unité et l’égalité président à l’établissement de
» notre Code civil.....
» Le pacte matrimonial doit son origine au droit naturel; la
» volonté des époux, en fait la substance: le changement de.cette
» volonté en amène la dissolution.....
» Les époux ne peuvent dans le pacte matrimonial éluder
» les mesures arrêtées pour opérer la division des fortunes, ni
» contrevenir au principe qui a pour but l’égalité dans les partages.....
» Nous avons adopté l’usage de l’administration commune,
» en vertu du principe d’égalité qui doit régler tous les actes de
» notre organisation sociale.....
» Il n’y a plus de puissance paternelle; c’est tromper la nature
» que d’établir ses droits sur la contrainte.....
» Quant à l’éducation, la Convention en décrétera le mode et
» les principes.....
» Les enfants seront dotés en apprenant, dès leur tendre enfance,
» un métier d’agriculture ou d’art mécanique.....
» La bâtardise doit son origine aux erreurs religieuses et aux
» invasions féodales.....
» Tous les hommes sont égaux devant la nature... Nous
» avons mis au même rang tous les enfants qui seront reconnus
» par leurs pères.....
» Vous avez déjà mis l’adoption au nombre de vos lois, il ne
» nous restait plus qu’à en régler l’exercice... Admirable institution
» qui se lie si naturellement à la constitution de la république,
» puisqu’elle amène sans crise la division des grandes
» fortunes .....»
Le projet accorde cependant au propriétaire le droit de disposer d’une minime partie de ses biens pour cause de mort, mais à la condition que cette disposition ne sera jamais dictée par une injuste préférence pour un des enfants, puis continue le rapporteur:
«Pour les donations, il répugne de donner à un riche lorsqu’on
» a sous les yeux l’image de la misère et du malheur. Ces considérations
» attendrissantes nous ont déterminé à arrêter un point
» fixe, une sorte de maximum qui ne permet pas de donner à
» ceux qui l’ont atteint.....
» Dans les contrats il a fallu imprimer un grand caractère aux
» conventions, et ne pas permettre que leur stabilité fût légèrement
» compromise; ainsi on a rejeté la faculté de rachat des
» immeubles et les plaintes en lésion.....»
Les présomptions et commencements de preuve par écrit et l’hypothèque tacite sont supprimés.
Voici maintenant les dispositions du projet, qui répondent à ces prémisses:
« Le mariage peut être dissous par la volonté d’un seul des
» époux.....
» L’expatriation pendant deux ans sans nouvelles est une cause
» de divorce .....
» Les époux ont et exercent un droit égal pour l’administration
» de leurs biens.....
» L’état des enfants est le même, soit que les solennités légales
» aient précédé leur naissance, soit qu’il se trouve acquis
» par les moyens ci-dessus exprimés .....
» Les enfants reconnus par la loi et leurs descendants jouissent
» des mêmes droits, pour les successions directes et collatérales,
» que les enfants nés du mariage .....
» Celui qui ne connaît pas ses parents est appelé orphelin,
» comme celui qui les a perdus.....
» L’enfant mineur est placé par la nature et par la loi sous
» la surveillance et la protection de ses père et mère; le soin de
» son éducation leur appartient; ils ne peuvent en être privés
» que pour les causes et dans les cas que la loi détermine.....
» A l’égard des père et mère, aïeuls et aïeules, la tutelle est
» une suite de leurs obligations envers leurs enfants mineurs, ils
» en sont les tuteurs naturels.....
» Il n’y a plus ni testaments, ni legs, ni codicilles, ni aucune
» autre manière de disposer, que celle énoncée au premier paragraphe .....
» On ne peut donner à cause de mort que le dixième de son
» bien, si on a des héritiers en ligne directe, et que le sixième
» si on a des héritiers collatéraux.....
» Il n’est pas permis de donner, soit entre vifs, soit à cause
» de mort, à celui dont le revenu excède la valeur de mille quintaux
» de blé, il est dans l’état d’opulence; ni à aucun célibataire
» au-dessus de vingt-un ans, qui a un revenu excédant la
» valeur de cinquante quintaux de blé, s’il n’a adopté un ou
» plusieurs enfants, ou s’il ne nourrit pas son père, sa mère, un
» de ses aïeuls ou un vieillard indigent.....
» Il n’est permis de donner, soit entre vifs, soit à cause de
» mort, à aucun de ses héritiers. La loi veut qu’ils soient tous
» également apportionnés dans la même hérédité.....»
En lisant ces lignes on aperçoit clairement sous l’invocation de quel génie avait été tracé ce plan de législation antisociale. On comprendra comment et pourquoi un homme doué d’un esprit si juste et d’un sens si profond n’avait pas osé s’en écarter, quoique mieux que tant d’autres, comme il l’a prouvé plus tard, il en comprît l’extravagance.
Il fallait aux démagogues régnants à cette époque l’égalité à tout prix, l’égalité poussée à l’extrême, l’égalité sans limites et sans mesure: elle procédait par assimilation, son niveau était un joug absolu sous lequel elle courbait et rangeait sur la même ligne l’incapacité et le génie, la vertu et la débauche, l’inceste et la fidélité conjugale. De la loi morale, il n’en était tenu aucun compte, tout devait être viager et déterminé d’avance par la loi républicaine; c’était à elle qu’il appartenait de régler les inspirations de la conscience du citoyen comme la disposition de ses biens; il ne pouvait récompenser la piété filiale d’un fils reconnaissant et soumis, ni infliger une peine à l’enfant dénaturé. Indifférente pour l’ingratitude et le dévouement, la loi, sans entrailles, tenait entre elles la balance égale. Ce qui lui importait par-dessus tout, c’était le nivellement des fortunes. Non-seulement l’autorité, mais la révérence paternelle était abolie. Les dispositions projetées attestaient que le législateur ne considérait point le mariage comme contracté en vue de la procréation des enfants, sous l’inspiration de ce désir si naturel de perpétuer son nom, ses croyances, ses sentiments, de se voir renaître dans sa postérité ; on eût dit plutôt qu’il prétendait l’arracher du cœur de l’homme.
En réduisant à un dixième la portion disponible du père, il ne lui laissait la liberté d’en disposer qu’en faveur d’étrangers pauvres. L’éducation de ses propres enfants ne lui était confiée qu’en attendant que la république en eût ordonné autrement.
La tutelle était pour lui une obligation et non un droit, et il n’avait pas la puissance de la déférer.
L’autorité maritale était traitée à l’égal de la puissance paternelle. Le mari était destitué du pouvoir domestique: la famille était sans direction et sans gouvernement, la femme ne trouvait dans le mariage nul appui pour sa faiblesse, seulement une liberté illimitée qu’aucune barrière ne séparait de la licence. Celui qui conférait à une épouse le soin de son nom et de son honneur, ne recevait du législateur aucun moyen pour assurer la conservation de ce dépôt précieux, contre la légèreté, l’inconstance, ou les séductions du vice.
Ce système inégal qui plaçait sur la tête d’une seule des parties une responsabilité si pesante, était cependant introduit dans la loi au nom de l’égalité ; il reposait évidemment sur le mépris des mœurs. Le mariage, ce contrat dans lequel la société civile est toujours partie, qui constitue les familles et intéresse un si grand nombre de tiers, était abandonné aux caprices des contractants. Il pouvait se dissoudre par le mutuel consentement des époux, ou même par la volonté d’un seul. Deux ans d’absence sans nouvelles de la part d’un des conjoints suffisaient pour faire prononcer le divorce. On eût dit que le divorce n’était pas introduit pour le mariage, mais le mariage pour le divorce; et cependant la loi veillait à la stabilité des autres contrats, et à l’exécution des obligations avec un zèle attentif et minutieux: on tendait évidemment à jeter la société hors de ses conditions essentielles.
L’égalité partout, nous le répétons encore, parce que c’est une vérité importante à signaler, l’égalité, même aux dépens de la morale la plus vulgaire, la divisibilité des biens partout, partout une soumission aveugle et passive à la loi, tant que la loi qui pouvait cependant être abrogée à chaque instant était en vigueur. Voilà ce que proclamait le nouveau Code; il tendait à constituer la société dans cet état précaire où tout devoir né d’hier est prêt à finir demain, et qui dans le tumulte des passions et le mouvement continuel de la machine politique, laisse tous les esprits en proie à une inquiétude vague et constante, parce qu’il laisse incertaines toutes les existences. Situation mortelle pour les sciences, les lettres, les arts, qui ont besoin avant tout de stabilité et de repos, et, par conséquent, contraire à tous progrès social et individuel.
Une telle tentative porta ses fruits; les efforts de quelques hommes éclairés que renfermait la Convention lui arrachèrent, sans doute, quelques mesures salutaires. Mais l’établissement de cette prodigieuse école normale où des maîtres distingués se trouvaient parmi les disciples, la fondation de l’Institut où l’on recueillit, sous l’invocation de l’universalité des connaissances humaines, tous les débris vivants de la gloire éclipsée du dix-huitième siècle, l’établissement des écoles centrales, s’ils témoignèrent du zèle des hommes qui avaient conservé le feu sacré, ne purent arrêter le torrent. Quelques esprits d’élite répondirent seuls à l’appel; le plus grand nombre, absorbé par la gravité des événements, la mobilité du sol, le bruit des armes et des révolutions politiques, prêtait peu d’attention à ces réminiscences de philosophie, de littérature ou de science. Les arts de la guerre, et ces parties des sciences physiques et mathématiques qui s’y rapportent, mises en réquisition pour venir à leur aide, fleurirent isolément. Lorsque Napoléon réorganisa l’université, l’instruction était tombée en oubli, et les études classiques n’existaient plus que de nom; neuf ans d’un pareil régime avaient presque suffi pour nous replonger dans l’ignorance.
Cependant, ce projet de Code civil qui nous semble si bien en harmonie avec l’esprit du temps ne fut pas adopté ; il parut à la Convention trop développé dans ses détails, trop peu philosophique dans son ensemble .
Cette assemblée créa, le 3 novembre 1793, une commission de six membres pour le réviser. Cette commission, nommée sur la présentation du comité de salut public, fut composée des citoyens Couthon, Montaut, Meaulle, Seconds, Richard et Raffron. Une nouvelle impression du projet fut ordonnée.
Mais la nouvelle rédaction ne fut présentée que le 23 fructidor an II (9 septembre 1794), malgré l’invitation faite à la Convention, au nom de divers départements, de hâter l’examen de ce travail.
Quoique proposé après le 9 thermidor, ce second projet était à peu de chose près la reproduction du premier. Les passages du rapport et les dispositions du projet qui répondent aux citations que nous avons précédemment faites, suffiront pour le démontrer.
«Trois choses, dit le rapporteur Cambacérès, sont nécessaires
» et suffisent à l’homme en société :
» Être maître de sa personne, avoir des biens pour remplir
» ses besoins;
» Pouvoir disposer pour son plus grand intérêt, de sa personne
» et de ses biens.
» Ainsi les personnes, les propriétés et les conventions, sont
» les trois objets de la législation civile.»
Passant ensuite aux points qui sont plus particulièrement l’objet de cet examen, il ajoute:
«Le droit de liberté personnelle est le droit de disposer de
» soi; il est juste qu’une union formée pour le bonheur de deux
» individus, cesse dès que les deux individus, ou que l’un d’eux
» n’y trouve plus le bonheur qu’on y a cherché.....
» Tel est donc l’avantage du divorce.....»
La loi n’interdisait la reconnaissance d’aucun enfant, quelle que fut la nature de l’union qui lui avait donné naissance.
«Une loi sage a déjà fait disparaître toute différence entre ceux
» dont la condition devait être la même... Mais en mettant sur
» le même rang tous les enfants qui sont reconnus par leur père,
» il faut bannir l’odieuse recherche de la paternité.....
» Qu’on ne parle plus de puissance paternelle... Loin de
» nous ces termes de plein pouvoir, d’autorité absolue, formule
» de tyran, système ambitieux que la nature indignée repousse,
» qui n’a que trop déshonoré la tutelle paternelle en changeant
» la protection en domination, les devoirs en droits et l’amour
» en empire.....
» Le pouvoir des pères... ne sera parmi nous que le devoir
» de la protection... les premiers tuteurs sont les père et mère.»
A ces passages si bien empreints des idées de l’époque, répondaient les dispositions suivantes:
» Le divorce a lieu, ou par le consentement mutuel des époux
» ou par la volonté d’un seul.»
La cause du divorce fondée sur deux ans d’absence sans nouvelles, n’est plus reproduite.
« L’enfant est placé par la loi sous la surveillance de son
» père et de sa mère... ils ne peuvent en être privés que dans
» des cas et pour des causes déterminés.....
« Ils se conforment pour son éducation aux lois sur l’instruction
» publique.....
» L’enfant reconnu dans les formes prescrites, a les mêmes
» droits de successibilité que l’enfant né dans le mariage.....»
Le droit de disposer pour cause de mort ou par donation était renfermé dans les mêmes limites que dans le projet précédent.
Comme on le voit, l’esprit du premier projet se retrouvait en grande partie dans le second; toutefois, le divorce n’était plus admis après une absence de deux ans sans nouvelles. Un droit quelconque de surveillance était accordé aux parents sur leurs enfants; mais en revanche la main de fer de la loi semblait plus disposée que jamais à s’emparer des rênes de l’éducation, et à priver le pouvoir domestique du droit précieux de la diriger: le progrès était lent et timide.
Du reste, cette reproduction du premier système formulée en phrases courtes et laconiques, était plutôt la table des matières d’un code qu’un code même; aussi la Convention, qui avait jugé l’autre trop diffus, repoussa-t-elle celui-ci comme trop concis, et écrit en quelque sorte en style lapidaire. Il fallut recommencer sur nouveaux frais, et on eut recours comme de coutume à une nouvelle commission. Les assemblées qui gouvernent ne peuvent le faire que par commissaires; cette commission fut composée de sept membres. Avant d’avoir commencé ses travaux elle fut dissoute, et le Code civil renvoyé à la commission des onze, sorte de commission centrale chargée de la préparation des lois, à laquelle Cambacérès et Merlin (de Douai) furent adjoints. Ce fut le dernier effort tenté par la Convention pour réaliser le vœu de la France, sur la refonte de nos lois civiles.
Comment en effet auraient-ils reconnu la nécessité de consacrer ces trois conditions indispensables de toute société civile, la liberté individuelle, la famille, la propriété, ces hommes qui,! dans leur délire métaphysique, et prenant le plus souvent, grâces à ces principes vagues et destructeurs de toute obligation morale, proclamés par la philosophie du dix-huitième siècle et les publicistes de 1789, la possibilité pour le droit et le besoin pour l’unique devoir, n’hésitaient pas à déclarer: qu’un peuple a le droit toujours et en tout temps, d’adopter, lorsqu’il le désire, un nouveau système d’institutions et de lois, et d’abroger celles qui existent; et que l’homme, dans l’état de nature, n’est ni libre ni esclave, et n’a ni droit à exercer ni devoir à remplir.
Pouvaient-ils comprendre une telle obligation, ces rêveurs fanatiques du sein desquels sortirent plus tard les communistes de Babeuf, qui marchaient ouvertement à la destruction du principe même de toute propriété ? Ces hommes qui adoptèrent le divorce par consentement mutuel et sans formalités, et l’égalité de droits entre les enfants incestueux, adultérins, naturels et légitimes, appelant ainsi les populations à l’oubli de toute pudeur et à une rebutante promiscuité, qui devait éteindre à la fois le respect des mœurs et anéantir parmi les hommes tous les rapports de paternité et de filiation. Pouvait-on conserver quelque foi dans l’utilité de leurs œuvres, lorsque cette légende dérisoire: liberté, égalité, fraternité ou la mort, inscrite sur nos monuments publics et tracée autour des portes des propriétés violées, signalait l’extension odieuse donnée au régime des confiscations, annonçait effrontément, par la cruelle ironie de sa rédaction, qu’il ne restait plus aux Français de leur indépendance et de leur liberté que de vains noms tracés sur de froides murailles; tandis que nos assemblées politiques retentissaient chaque jour de l’éclat souvent éloquent, quelquefois sublime, des passions tumultueuses qui dominaient les législateurs, tour à tour défenseurs et victimes de quelques ambitieux hypocrites ou de fanatiques exaltés; était-il possible que les hommes politiques qui composaient à cette époque l’assemblée souveraine où éclataient tant d’orages, et qui subissait de si sanglantes catastrophes, pussent adorer l’écho dans la tempête et se livrer dans le calme et le silence à la composition de lois durables? La refonte de notre législation était-elle pour eux autre chose qu’un prétexte pour mettre en pratique leurs odieuses et imprudentes théories, et pousser avec une ignorante et criminelle témérité notre malheureuse patrie dans les voies de la dissolution sociale?
Heureusement, le 4 brumaire an IX (26 octobre 1795), la Convention cessa d’exister; deux conseils législatifs lui succédèrent. Le 24 prairial de la même année (12 juin 1796), un nouveau projet de Code civil fut déposé par Cambacérès sur la tribune du conseil des Cinq-Cents, au nom de la section civile et de la commission de classification des lois.
Les deux premières lectures n’eurent lieu que les 15 et 29 frimaire an v (5 et 19 décembre 1796), et le conseil ne commença la discussion que le 9 pluviôse suivant (30 janvier 1797). La réimpression du projet fut votée le 1er prairial an VI (20 mai 1798).
Le 8 prairial an VII (28 mai 1799), une autre commission fut instituée pour reprendre une besogne si péniblement tentée et si souvent interrompue; mais elle n’avait pas achevé ses travaux, quand les événements des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799) vinrent y mettre un terme.
Les choses et les idées avaient marché depuis l’époque où le second projet de code avait été présenté à la Convention nationale. L’établissement de la constitution de l’an III, bien qu’elle eût été violée, avant même d’être exécutée, ranima cependant la confiance du pays. L’opinion publique, longtemps comprimée, _put enfin se manifester, et la plupart des choix nouveaux tombèrent sur des hommes éclairés, expérimentés dans les affaires et dévoués au bien public. Quoiqu’ils fussent en minorité dans les deux conseils, ils suffirent pour modifier l’attitude, l’esprit et le langage de ces assemblées. En présence du nouveau tiers on n’eût osé énoncer crûment les principes d’égalité extrême, et les doctrines désordonnées qui souillaient le projet primitif présenté à la Convention nationale.
Aussi voit-on le rapporteur, dépouillant cette fois ce charlatanisme d’expression et cette exagération de pensée qui répugnaient à la nature sévère et calme de son talent, modifier profondément ses doctrines, quoique encore gêné, dans son allure, par de pénibles antécédents.
Rapprochons les parties de son discours qui répondent à celles de ses discours précédents que nous avons rapportées, afin de continuer le parallèle et de suivre le progrès du droit.
«Nous plaçons dans la famille, dit-il, l’enfant reconnu parle
» père, lorsque celui-ci, libre de tout engagement, a manifesté
» son caractère devant le ministre de la loi, et lorsque sa déclaration
» n’a point été désavouée par la mère; ainsi toute distinction
» cessera entre ceux dont la condition doit être la même.
» Cependant, il doit y avoir quelque différence, quant aux droits
» de successibilité, entre les enfants nés dans le mariage et ceux
» dont la reconnaissance a été postérieure au lien conjugal;
» quoique nés avant cette époque, les premiers ont un droit
» acquis aux biens de leurs parents.....
» Cette considération ne doit pas être légèrement écartée;
» elle exige, en pareille occurrence, que dans le partage des successions
» il soit attribué une portion avantageuse aux enfants
» nés dans le mariage.....
» La meilleure législation est celle qui favorise l’intérêt général
» de la société et les progrès de la morale publique.....
» Qu’importe que quelques individus soient privés de leurs
» droits de famille et élevés aux dépens de l’état, si par ce sacrifice,
» le libertinage est proscrit, la tranquillité domestique assurée,
» les unions légitimes encouragées.....
» L’autorité du père et de la mère sur leurs enfants est dans
» son essence la même que celle du tuteur.....
» Il convient aussi de rappeler aux parents que leurs enfants
» appartenant à la patrie, ils doivent, pour leur éducation, se conformer
» aux règles qu’elle prescrit.....»
En parlant du divorce, il ajoute:
«La seule cause d’incompatibilité d’humeur et de caractère
» a paru effrayer par son étendue, par les conséquences qu’elle
» peut entraîner, par les désordres dont elle est la source.....
» Le divorce aura donc lieu par le consentement mutuel des
» époux et sur la demande de l’un d’eux, soit que l’incompatibilité
» d’humeur ou de caractère en soit le motif, soit que
» l’on se fonde sur des causes déterminées, ou sur des faits spécifiés
» par la loi. Ces trois espèces de divorce seront assujetties
» à différents modes et produiront des effets divers.....»
Des dispositions du projet parfaitement en harmonie avec cet exposé, étaient ainsi conçues:
« L’enfant d’une femme non mariée ne peut être reconnu
» que par un homme qui n’était pas marié, deux cent quatre
» vingt-six jours avant la naissance de cet enfant.....
« La portion de l’enfant reconnu postérieurement au mariage
» de son père et de sa mère, est de la moitié de celle de
» l’enfant né dans le mariage, s’il y a concours entre ces enfants.....»
Les dispositions relatives à l’éducation des enfants et à la tutelle sont conservées. Cependant la tutelle déférée par les parents est admise avec certaines modifications.
« Le survivant des père et mère ne peut choisir un tuteur
» que par acte de dernière volonté, ou par déclaration faite devant
» le juge de paix de son domicile, ou devant un notaire assisté
» de deux témoins
» Le divorce a lieu par consentement mutuel, ou sur la demande
» de l’un des époux.....
» Le divorce qui s’opère par le consentement mutuel... n’est
» soumis à aucune allégation de motifs.....
» Le divorce est prononcé sur la demande de l’un des époux,
» par les causes suivantes:.....
» Incompatibilité d’humeur ou de caractère.....
» L’interdiction.....
» La condamnation à des peines afflictives ou infamantes, etc.,
» les crimes, sévices ou injures graves de l’un des époux envers
» l’autre.....
» L’abandon résultant de la séparation de fait, non interrompue
» pendant deux ans au moins.....
» L’absence, depuis cinq ans, sans nouvelles.....
» Les testaments et les codicilles sont abolis.....»
La disposition qui fixe la portion disponible au dixième seulement des biens du donateur, s’il y a des enfants, est maintenue; mais s’il n’y a que des collatéraux, il peut disposer de la moitié de sa fortune par donation entre vifs, et du tiers par donation pour cause de mort.
Une autre disposition du livre Ier, litre 6, relatif aux droits des époux, contenue dans l’art. 298, porte que: la femme ne peut s’obliger sans le consentement de son mari, à moins qu’elle ne fasse publiquement un commerce étranger à l’état de son mari; toutefois, rien n’est stipulé sur l’obligation de l’habitation commune.
Ce projet était beaucoup plus développé que les deux premiers, et contenait même un formulaire des actes de l’état civil.
Du reste, on y voit renaître un certain respect pour la morale universelle. La nécessité d’établir une distinction salutaire entre les enfants illégitimes et ceux nés du mariage, y est reconnue. Le dernier survivant des père et mère peut dans un acte revêtu de certaines formalités déférer la tutelle de ses enfants.
La femme ne peut obliger son mari, ni s’obliger elle-même, si elle n’exerce de son chef et publiquement le commerce; au reste, on s’aperçoit facilement que l’orateur parle devant une assemblée où des voix éloquentes stigmatisèrent les abus révoltants qui avaient été faits du divorce, et chaque jour assiégée par des pétitions nombreuses qui demandaient qu’il y fut porté remède. Il s’excuse en quelque sorte de proposer le maintien du divorce par consentement mutuel; il en reconnaît les dangers; ce n’est plus que l’abandon volontaire prolongé pendant deux ans, ou une absence de cinq années sans nouvelles, qui peuvent motiver la dissolution du mariage. La portion disponible, toujours restreinte au dixième de la totalité des biens du donateur lorsqu’il y a des enfants, s’étend à la moitié et non plus au sixième seulement s’il n’y a que des collatéraux; on élève aussi la somme des biens qui, constituant l’état d’opulence, rendent inhabile celui qui les possède à recevoir une donation. La prohibition n’atteint que celui qui possède en propriété la valeur de cent cinquante mille myriagrammes de froment. C’est aux héritiers à faire la preuve que la fortune du donataire excède ou atteint ce taux; en un mot, le besoin et le désir de revenir à de meilleures, à de plus saines maximes, perce évidemment dans l’ensemble et dans les détails; mais Cambacérès n’ose encore s’abandonner à lui-même; il suit les vicissitudes des révolutions, et il ne procède qu’avec une extrême timidité à ce retour salutaire vers les principes immuables sur lesquels la société repose.
Les événements des 18 et 19 brumaire vinrent interrompre une discussion dont le conseil des Cinq-Cents s’occupait sérieusement.
Les deux conseils s’ajournèrent au 1er ventôse suivant (20 février 1799); mais avant de se séparer, ils instituèrent chacun une commission de vingt-cinq membres, pour statuer sur la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgents, de police, de législation, de finance, et pour préparer un Code civil.
Ces commissions se divisèrent chacune en sections; la section de code civil formée parmi les membres du conseil des Anciens, fut composée de Cornudet, Goupil-Préfeln, Porcher, Vernier et Vimar; Jacqueminot, Girot-Pouzol, Gaudin, Bara, Thiessé, Chollet, Ludot et Villetard étaient membres de la section de législation, code civil et police, choisie parmi les membres du conseil des Cinq-Cents.
Dans la séance du 28 brumaire an VIII (22 novembre 1799), la commission arrêta: «Que les membres de la section se con
» certeraient avec le ministre de la justice, afin de choisir trois
» jurisconsultes des plus éclairés et des plus affectionnés à la
» république, pour coopérer aux travaux généraux de la section;
» que chacun des membres de la commission pourrait s’adjoindre
» un collaborateur à son choix pour travailler de concert
» avec lui à la partie de législation dont il était spécialement
» chargé ; que pour conserver à la commission et à chacun de ses
» membres la plus entière liberté, les collaborateurs ainsi choisis
» seraient pris en dehors du corps législatif.»
Le choix, fait de concert entre la commission législative et le ministre de la justice, porta sur Tronchet, Crassous et Vermeil. Il fut confirmé dans la séance du 1er frimaire an VIII (22 novembre 1799).
Par un dernier arrêté du 25 frimaire de la même année ( 16 décembre 1799), la commission autorisa ceux de ses membres qui auraient quelque travail prêt ou non encore terminé, relatif au Code civil, à le livrer à l’impression, même après que la commission serait dissoute. On reconnaissait à la fin l’urgence de s’occuper des intérêts fondamentaux de la société, et la vanité des questions purement relatives à la forme politique du gouvernement, quand on néglige la constitution civile de la cité.
C’est à la suite de cet arrêté et pour obéir à ses prescriptions que Jacqueminot présenta le 30 frimaire an VIII (21 décembre 1799), au nom de la section de législation, les projets de différents titres du Code civil; il les fit précéder d’un exposé de motifs dont nous citerons quelques passages; nous choisissons ceux qui se rapportent aux matières qui ont fixé notre attention dans nos précédentes analyses. Le rapporteur passe d’abord en revue l’histoire des discussions et des interruptions subies jusqu’ alors par les divers projets du Code civil.
Voici en quels termes la part qu’y prit la Convention y est caractérisée:
«La Convention fut plus hardie en chargeant ses comités de
» l’entière confection d’un code civil; chacun des partis qui s’y
» disputèrent l’empire affecta de vouloir attacher son nom à ce
» grand ouvrage; mais il était difficile à la raison et à la sagesse
» de faire percer leurs voix au milieu des éclats de la foudre et
» du tumulte des factions sans cesse aux prises.....
» Le fanatisme d’une égalité follement interprétée régnait,
» comme auparavant le fanatisme des privilèges; la dépravation
» des idées politiques était parvenue au comble... Les représentants
» les plus vertueux et les plus éclairés ne pouvaient tout
» à fait échapper à la contagion universelle......»
Sur les projets de Cambacérès, il dit:
«Le jurisconsulte familiarisé avec les hautes et profondes
» méditations s’y montre à chaque page; mais on y voit aussi
» quelquefois le sage lui-même obligé de payer tribut aux erreurs
» qui l’assiégeaient.»
Ce jugement équitable est suivi des motifs d’un nouveau projet; on y trouve entre autres dispositions celles qui suivent...
« Les enfants nés et non reconnus avant le mariage ne sont
» légitimés qu’autant qu’ils sont reconnus dans l’acte même de
» célébration......
» Le mariage subséquent ne légitime pas les enfants adul
» térins.
» Les enfants naturels, même légalement reconnus, ne
» peuvent recevoir de leur père et mère au delà de la portion
» que la loi leur confère ab intestat.
» L’enfant naturel n’est point héritier; il ne succède
» qu’autant qu’il a été légalement reconnu.....
» Après la dissolution du mariage, par le décès de l’un des
» époux, les enfants mineurs et non émancipés demeurent sous
» la garde du père ou de la mère survivant, auquel appartient le
» gouvernement de leur personne et l’administration de leurs
» biens, des revenus desquels l’un ou l’autre jouit, sous la seule
» charge de fournir aux frais de leur entretien et éducation.....
» Le mari a le droit d’obliger sa femme à le suivre partout où
» il juge à propos de demeurer ou de résider. Si le mari voulait
» quitter le sol continental ou colonial de la république, il ne
» pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce n’est dans le
» cas où il serait chargé par le gouvernement d’une mission à
» l’étranger exigeant résidence.
» En cas de testament ou de donation pour cause de mort,
» la quotité disponible est d’un quart pour celui qui a des enfants,
» de la moitié s’il ne laisse que des frères ou sœurs; des trois
» quarts s’il laisse des oncles, tantes ou cousins-germains; de la
» totalité s’il ne reste ni enfants, ni oncles, ni cousins.....»
Les dispositions relatives au divorce et à la tutelle ne sont pas modifiées; mais l’autorité maritale renaît avec l’obligation imposée à la femme d’habiter avec son mari. Il y a un titre à part des successions irrégulières; l’enfant naturel n’est plus héritier; l’enfant adultérin ne peut plus être légitimé ; l’autorité paternelle est reconnue dans les dispositions qui concernent la tutelle; le droit de disposer de ses biens après soi est consacré ; la portion disponible est considérablement augmentée.
C’est un progrès sensible, considérable; mais on ne tente encore que des améliorations partielles, on n’ose pas s’élever à une vue d’ensemble, à une pensée générale; les premiers principes, qui sont la clef de la voûte de toute législation civile, ne ressortent pas encore de la combinaison des dispositions; la puissance du père, l’autorité du mari, la sainteté du mariage, le gouvernement de la famille, la libre disposition de la propriété dans de sages limites, ne sont pas encore le fond de la doctrine et la sanction de la morale civile.
On aperçoit un vœu de conservation et de durée plutôt qu’une volonté ferme d’adopter les moyens de les obtenir.
Mais lorsque le jour de la discussion approchait, une nouvelle organisation politique de la république vint faire cesser les pouvoirs des commissions législatives par l’établissement définitif du gouvernement consulaire, le 4 nivôse de la même année (25 décembre 1799).
Sous la nouvelle constitution, ce n’était plus à de simples commissions qu’appartenaient le vote et la discussion des lois.
Les projets proposés par les consuls étaient rédigés et débattus au conseil d’état. Ces projets étaient ensuite présentés au tribunat, qui émettait son vœu. Soit qu’il se fût prononcé pour leur admission ou pour leur rejet, il nommait trois de ses membres pour soutenir, devant le corps législatif, en concurrence avec les conseillers d’état, orateurs du gouvernement, l’opinion du tribunat. Le corps législatif jugeait ensuite, lorsque la cause était entendue, et décrétait l’adoption ou le rejet du projet de loi.
Le 24 thermidor an VIII (12 août 1800), les consuls rendirent l’arrêté suivant:
«Le ministre de la justice réunira dans la maison du ministère
» MM. Tronchet, président du tribunal de cassation; Bigot
» Préameneu, commissaire du gouvernement près ce tribunal,
» et Portalis, commissaire au conseil des prises, pour y tenir
» des conférences sur la rédaction du Code civil.
» Art. 2. Il appellera à ces conférences M. Malleville, membre
» du tribunal de cassation, lequel remplira les fonctions de
» secrétaire-rédacteur.
» Art. 3. Le ministre de la justice remettra, à l’ouverture
» des conférences, les trois projets de Code civil rédigés par
» ordre de la Convention nationale, et celui qui a été présenté
» par la section de législation des commissions législatives.
» Art. 4. MM. Tronchet, Bigot-Préameneu et Portalis
» compareront l’ordre suivi dans la rédaction des projets du
» Code civil publiés jusqu’à ce jour, et détermineront le plan
» qu’il leur paraîtra le plus convenable d’adopter.
» Art. 5. Ils discuteront ensuite, dans l’ordre des divisions
» qu’ils auront fixées, les principales bases de la législation en
» matière civile.
» Art. 6. Le travail sera terminé dans la dernière décade de
» brumaire an IX, et présenté à cette époque aux consuls par le
» ministre de la justice.
» Art. 7. MM. Tronchet, Bigot-Préameneu et Portalis assisteront
» aux séances du conseil d’état dans lesquelles la discussion
» sur le Code civil aura lieu.»
Le 1er vendémiaire suivant, Portalis fut nommé conseiller d’état et put se livrer sans partage aux travaux relatifs à la confection du Code civil.
Ce premier travail marcha avec une étonnante rapidité. Malleville, qui, par un décret postérieur, fut admis comme ses collègues à assister aux séances du conseil d’état, l’atteste.
«L’ordre des titres fut bientôt trouvé, dit-il; les matières
» partagées, les jours de réunion fixés chez M. Tronchet, notre
» digne président, pour l’examen de l’ouvrage de chaque commissaire,
» et à force de travail, nous parvînmes à faire un code
» civil en quatre mois; il fut achevé d’imprimer le 1er pluviôse » an IX (21 janvier 1801 ).» Quoique le temps ne fasse rien à l’affaire, cette célérité est une preuve de l’application et du zèle de ces illustres jurisconsultes.
Les consuls, avant de soumettre le travail de la commission au conseil d’état, recueillirent les observations du tribunal de cassation et celles de tous les tribunaux d’appel de la république. Le projet de Code leur fut à tous distribué ; et ce n’est qu’après avoir reçu leurs remarques et leurs critiques, qu’il fut renvoyé à l’examen de la section de législation du conseil d’état. Malgré ces précautions, un certain nombre d’esprits n’étaient pas encore revenus de leurs préoccupations favorites, et ne renonçaient que difficilement à la chimérique espérance de façonner la société à l’image de leurs idées. D’autres, attachant au fond peu d’importance à ce qu’il y a de plus essentiel et de plus fondamental dans l’ordre social, saisissaient cette occasion de faire de l’opposition politique, et s’emparant des doctrines opposées à celles que les auteurs du projet de Code civil avaient adoptées, s’en servaient comme d’une arme puissante pour combattre ou renverser le gouvernement, ou le forcer à traiter avec eux, si ce n’est à leur céder le pouvoir.
La discussion du projet du premier titre relatif à la publication, aux effets et à l’application des lois, s’ouvrit au conseil d’état dans la séance du 4 thermidor an IX (23 juillet 1801 ) .
Le 5 frimaire an x (24 novembre 1801), ce titre fut présenté au corps législatif, et aussitôt communiqué officieusement au tribunat; après que les orateurs du tribunat et ceux du conseil d’état eurent été entendus, dans la séance du 21 du même mois, le corps législatif rendit, le 24, un décret de rejet.
Le tribunat émit de même un vœu de rejet sur le projet du second titre, dans la séance du 11 nivôse de la même année; mais cette fois le corps législatif n’eut pas à statuer sur ce vœu. Le premier consul y répondit par le message suivant:
« Législateurs, le gouvernement a arrêté de retirer le projet
» de Code civil.
» C’est avec peine qu’il se trouve obligé de remettre à une
» autre époque les lois attendues avec tant d’intérêt par la nation;
» mais il s’est convaincu que le temps n’est pas encore venu
» où l’on portera dans ces grandes discussions le calme et l’unité
» d’intention qu’elles demandent.»
Ce ne fut pas le projet de Code civil que l’on remania, ce fut la constitution politique. L’institution du tribunat, créée pour donner en quelque sorte une existence officielle à l’opposition constitutionnelle et établir ainsi une utile contradiction aux projets du gouvernement, suscitait par l’esprit de résistance systématique, qui semblait animer ses membres, de graves obstacles à la marche réparatrice du gouvernement; cette institution fut profondément modifiée. Les sections temporaires que le tribunat choisissait, dans son sein, pour la discussion des projets de loi, devinrent permanentes et répondirent, par leurs attributions, aux diverses sections du conseil d’état; des communications et des conférences officieuses furent établies, entre les sections de ces deux corps, pour la discussion préalable des projets de loi, avant leur présentation aucorps législatif. Ce n’est pas tout: le tribunat devait être renouvelé par vingtième à une époque indiquée; cette époque fut devancée, le renouvellement eut lieu immédiatement; il y fut procédé d’autorité par une sorte de coup d’état: on usait alors contre la révolution de ses propres procédés .
Le gouvernement, qui avait raison au fond, sembla se soucier peu d’avoir raison dans la forme. La discussion du projet de code fut alors reprise et poursuivie sans désemparer jusqu’à son terme; et le 28 ventôse an XII ( 12 mars 1804), Portalis, chargé de présenter au corps législatif le projet de réunion de toutes les lois civiles, déjà votées sous le titre de Code civil, put commencer son exposé par ces mots:
«Législateurs, le 30 pluviôse an XI (19 février 1803), le
» titre préliminaire du Code civil fut présenté à votre sanction.
» Une année s’est à peine écoulée, et nous vous apportons le
» projet de loi qui termine ce vaste ouvrage.»
Les passages suivants, tirés du discours préliminaire de Portalis, et les citations du Code qui l’accompagnent, feront parfaitement connaître en quoi le dernier projet différait sur les points importants que nous avons choisis comme base d’appréciation de ceux que nous venons d’analyser.
«Ce magistrat, dit-il en parlant de Cambacérès, aussi sage
» qu’éclairé, ne nous eût rien laissé à faire, s’il eût pu donner
» un libre essor à ses lumières et à ses principes, et si des circonstances
» impérieuses et passagères n’eussent érigé en axiome
» de droit des erreurs qu’il ne partageait pas.....»
Après avoir développé les principes du mariage, il continue:
«Tel est le mariage considéré en lui-même et dans ses effets
» naturels, indépendamment de toute loi positive. Il nous offre
» l’idée fondamentale d’un contrat perpétuel par sa destination.....
» Les lois ne doivent jamais être plus parfaites que les
» hommes à qui elles sont destinées ne peuvent le comporter....
» Aujourd’hui la liberté des cultes est une loi fondamentale, et
» la plupart des doctrines religieuses favorisent le divorce; nous
» avons cru qu’il ne fallait pas prohiber le divorce parmi nous....
» Le mari est le chef du gouvernement domestique; mais l’influence
» du mari se résout bien plus en protection qu’en autorité ;
» son administration doit être sage et sa surveillance modérée.
» Les enfants doivent être soumis au père..... Son nom est à
» la fois un nom d’amour, de dignité et de puissance..... Sa
» magistrature, qui a été si religieusement appelée piété paternelle,
» ne comporte d’autre sévérité que celle qui peut ramener
» le repentir dans un cœur égaré.....
» Dans ces derniers temps, on a beaucoup déclamé contre la
» faculté de tester, et dans le système de nos nouvelles lois françaises,
» cette faculté avait été si restreinte, qu’elle n’existait
» presque plus..... Ne donne-t-elle pas une sanction aux vertus
» domestiques, à l’autorité paternelle, au gouvernement de la
» famille?...
» La faveur du mariage, le maintien des bonnes mœurs,
» l’intérêt de la société, veulent que les enfants naturels ne soient
» pas traités à l’égal des enfants légitimes. Il est d’ailleurs contre
» l’ordre des choses que le droit de succéder, qui est considéré
» par toutes les nations policées non comme un droit de cité,
» mais comme un droit de famille, puisse appartenir à des êtres
» qui sont sans doute membres de la cité, mais que la loi qui
» établit les mariages ne peut reconnaître comme membre d’aucune
» famille; il faut seulement leur garantir dans une mesure
» équitable ce que l’humanité sollicite pour eux.»
Le texte du Code répond à cette théorie:
«Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à
» son mari..... Elle est obligée d’habiter avec son mari et de le
» suivre partout où il juge à propos de résider..... Elle ne peut
» ester en justice sans son autorisation.»
Un titre spécial est consacré à la puissance paternelle:
«L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et
» mère; il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou à l’émancipation;
» il ne peut quitter la maison paternelle sans permission,
» sauf pour enrôlement volontaire et après l’âge de dix
» huit ans révolus.....»
L’enfant a besoin du consentement du père pour se marier, pour entrer dans les ordres, lorsque sa majorité est accomplie; il est encore tenu toute sa vie à lui faire des actes respectueux....
«La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants
» nés d’un commerce adultérin ou incestueux..... L’enfant naturel
» reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime.
» Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des successions.....
» La tutelle naturelle des ascendants, la tutelle déférée par
» le père et la mère, y sont reconnues et réglées.....
» Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur
» accorde de droits sur les biens de leurs père et mère décédés,
» que lorsqu’ils ont été légalement reconnus..... Ce droit est
» réglé ainsi qu’il suit: Si le père ou la mère ont laissé des descendants
» légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire
» que l’enfant aurait eue s’il eût été légitime; il est de
» moitié lorsque les père et mère ne laissent que des ascendants
» ou des frères et sœurs; il est des trois quarts s’ils ne laissent
» ni descendants, ni frères, ni sœurs; il est de la totalité s’ils ne
» laissent aucun parent au degré successible.
» Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament,
» ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne
» laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse
» deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand
» nombre .»
Ainsi le maximum de la quotité disponible, établie par le précédent projet, en devient ici le minimum.
Un titre, intitulé de la propriété, détermine et spécifie les caractères de ce droit.....
«La propriété, y est-il dit, est le droit de jouir et de disposer
» des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse
» pas un usage prohibé par la loi. Nul ne peut être contraint de
» céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et
» moyennant une juste et préalable indemnité.»
Tel est le cercle d’idées diverses, de doctrines opposées, parcouru par nos législateurs durant l’espace de onze années de travaux interrompus et d’efforts impuissants, laborieusement renouvelés avant de toucher au but qu’ils se proposaient d’atteindre et de satisfaire au vœu le plus ardent et le plus constamment renouvelé du pays.
Les deux projets de code, soumis à la Convention nationale, sont plus ou moins calqués l’un sur l’autre. Ils tendaient à consommer la révolution sociale la plus complète, par le relâchement des liens de famille; l’abolition de la puissance paternelle, de l’autorité maritale et de la sainteté du lien conjugal; l’éducation des enfants, ravie aux parents et transportée aux magistrats; le droit de propriété transformé en une possession viagère par l’abolition de la faculté de disposer, et une tendance constante à égaliser les patrimoines, et à faire intervenir la loi dans la répartition des richesses.
Ce n’est que lorsque les idées de morale et d’ordre furent activement représentées par les députés du nouveau tiers, et que leur présence en rendant le courage de leur opinion à ceux des membres de la Convention qui avaient supporté le poids de l’oppression et combattu l’anarchie, eût vivifié les conseils, qu’il fut permis de regarder en arrière, et de mesurer la profondeur de l’abîme sur les bords duquel on avait été entraîné. Ce fut alors que l’orateur, qui avait présenté les premiers projets de code civil, en proposa un troisième. Si l’on n’y trouve que des améliorations peu considérables, il fut précédé d’un discours très-remarquable par la réforme des doctrines, surtout en ce qui touche le respect dû aux mœurs et à la puissance paternelle; mais ce ne fut qu’après le 18 brumaire et lorsque Jacqueminot, au nom des commissions législatives, rédigea son projet de code, que le progrès fut grand et qu’on entra définitivement dans la bonne voie. C’est un honneur légitime qui s’attache à son nom. En ce moment, la chute du Directoire, l’établissement d’un gouvernement fort et protecteur avaient ranimé la confiance du pays; les consciences, jusqu’alors opprimées ou intimidées, respiraient librement, les nobles instincts de l’humanité pouvaient se manifester et se produire.
Ce ne fut même qu’après la réformation du tribunat que la discussion put marcher sérieusement et sans entraves, et arriver à son terme.
Une distance immense, en effet, sépare le dernier projet de ceux qui l’ont précédé.
Il ne s’agissait plus de vaines utopies: un majestueux corps de lois, où respire une sagesse profonde et une morale pure, rétablit la législation sur ses véritables bases.
L’enfance se trouve placée sous l’égide protectrice de la puissance paternelle, et la règle antique qui impose le nom du père aux enfants nés du mariage, redevint juste et morale du moment que l’époux put exiger de sa compagne la résidence au domicile conjugal et une raisonnable soumission.
Si le divorce, résultant du consentement mutuel des deux époux, est conservé uniquement par respect pour la liberté des cultes, l’indissolubilité naturelle du contrat de mariage n’en est pas moins reconnue et proclamée.
Le droit sacré de la propriété est remis en honneur; la propriété elle-même, bien définie, et garantie par la loi. L’ordre des successions, réglé selon le droit naturel, distribue les biens conformément à l’intention présumée de celui qui meurt sans tester; mais il laisse au citoyen le droit de disposer du fruit de ses travaux ou du patrimoine de sa famille par ses dernières volontés; il peut donner à un enfant, à un bienfaiteur ou à un ami des marques durables et précieuses de son affection. L’accomplissement des obligations et des contrats est assuré par des dispositions claires et précises.
La jouissance et la garantie des droits civils, les causes qui en font perdre l’usage, sont nettement définies. Consacrant l’étroite alliance de l’ordre moral et de l’ordre civil, la loi prescrit aux époux la fidélité; aux enfants, la piété filiale; aux donataires, aux héritiers et aux légataires, la reconnaissance; aux usufruitiers, le bon et équitable usage de la chose d’autrui; aux mandataires, la vigilance et l’exactitude; à tous, dans leurs conventions, l’honnêteté, la sincérité, la bonne foi, l’équité, le respect pour l’ordre public et les bonnes mœurs; en abandonnant aux lumières et à la conscience des magistrats l’appréciation des présomptions qui ne sont point établies par la loi, et la décision des faits litigieux, à l’affirmation des parties, sous la foi du serment, elle joint au rappel à l’ordre moral, le rappel à l’ordre religieux.
Le Code Napoléon porte l’empreinte du génie de ce prince; il a ce caractère de grandeur et de puissance que l’empereur savait imprimer à ses œuvres; on y reconnaît ce regard d’aigle qui pénètre au fond des choses et jusqu’au foyer de la justice incréée. On semble s’accorder à louer-en lui le grand capitaine, mais serait-il vrai qu’il ne doit sa gloire qu’à ses triomphes? On comprend que ce soit le jugement de ses ennemis, car s’il fut grand parla guerre, c’est par la guerre qu’il fut injuste, qu’il compromit les intérêts de la France, et ce fut la guerre qui le perdit. Mais c’est surtout dans ses conseils qu’il faut l’admirer; c’est là qu’on le voit, avec une rare justesse d’esprit, avec une volonté ferme, une énergique propriété d’expression, présider à la rédaction de ses lois, et comme dans une sorte d’Olympe, fonder des institutions, organiser l’administration, recomposer l’ordre judiciaire, mettre en action la liberté religieuse, instituer le corps enseignant, restaurer l’ordre social tout entier, donner le mouvement et la vie à ce vaste empire, qui n’eut dans le temps une si courte durée, que parce qu’il ne sut pas le renfermer, dans l’espace, en de sages limites.
Pour obtenir de tels résultats, le génie ne suffit pas: il a besoin de collaborateurs dignes de lui. Ces hommes d’élite ne firent pas défaut à Napoléon, sa bonne fortune les lui réserva, et il sut les discerner. L’éloge des doctes rédacteurs du Code civil serait ici déplacé ; toute comparaison entre des hommes dont la parfaite harmonie d’opinions et de sentiments et une réciproque et constante estime jusqu’à la mort, ajouta à la gloire de leur vie, est interdite à celui qui trace ces lignes; mais il doit lui être permis, en tête d’un recueil consacré à la mémoire vénérée de son illustre aïeul, de résumer en quelques mots la part qu’il prit à ce grand ouvrage.
Doué d’un esprit éminemment philosophique et généralisateur, Portalis exposa noblement la philosophie du Code civil, son plan, sa marche, ses principes, sa morale, dans l’admirable discours qui en est le préambule. Il avait posé dans un livre préliminaire les axiomes de droit, dont, selon lui, les dispositions du Code ne devaient être que les corollaires. Il croyait avec Platon et Cicéron, qu’il est bon et utile pour ceux qui les portent et pour ceux qui les supportent, de rattacher les lois des hommes aux lois de l’humanité. Il défendit ce livre avec énergie dans un discours remarquable, où il en développe l’esprit en réfutant les sophismes de ses contradicteurs. Il avait longtemps médité sur l’institution du mariage; ce recueil en contiendra la preuve. Cette matière lui fut dévolue dans la préparation du Code civil. Fruit d’études approfondies, son beau discours de présentation du titre du mariage rappelle avec éloquence le plan, la constitution et les règles du gouvernement domestique.
Tout ce qui concernait le droit de propriété lui fut aussi réservé ; il traita ce sujet important en philosophe et en publiciste. Il exposa avec puissance et clarté les véritables fondements de ce droit, source féconde de tant d’autres: de ce droit pour la conservation duquel lia société fut fondée et sur lequel elle repose. La théorie des contrats, celle de l’obligation morale qui en est la substance, et de l’obligation légale qui en est l’effet, sont exposées avec précision dans ses discours sur le titre de la vente et sur les contrats aléatoires. Jamais l’étroite union de la morale et du droit civil ne fut mise plus évidemment en relief, et le respect dû aux engagements sérieux, à la foi donnée ou promise, plus énergiquement commandé.
L’exposé des motifs du projet de loi, qui réunit en un seul Code tous les titres successivement votés, couronne dignement cette série et rappelle à grands traits l’ensemble d’un si vaste travail, l’harmonie de ses proportions, son influence sur le présent et sur l’avenir de la patrie. Plein de vues nouvelles et profondes, il donne, dans un langage élevé, une juste idée de la grandeur de l’entreprise exécutée.
Au conseil d’état, pendant toute la discussion du Code, Portalis prit fréquemment la parole; et ses observations savantes, pleines de justesse, énoncées avec simplicité, dictées par une profonde connaissance des hommes, tiennent une grande place dans le dramatique recueil qui en reproduit les mémorables scènes. Nous avons jugé convenable de reproduire ces observations dans notre collection; elles dissiperont une erreur qui s’était propagée. On a supposé trop légèrement que, distrait de ses premiers travaux par les fonctions administratives qu’il remplissait avec tant d’application et qui le faisaient participer au gouvernement de l’état, après avoir préparé le projet du Code civil, Portalis n’avait plus coopéré à sa confection que par ses discours publics. Nous prouvons par pièces qu’il n’en est point allé ainsi, et qu’il n’a jamais cessé de prendre une part active et efficace aux travaux préparatoires du Code civil.
Nous avons inséré aussi, dans ce volume, une consultation célèbre dans laquelle, jeune encore (il n’avait alors que vingt-quatre ans), Portalis développa avec toute la puissance d’une doctrine solide, d’une philosophie religieuse, d’une parole éloquente et d’une âme élevée, la théorie du contrat de mariage selon le droit naturel, les conditions essentielles de sa validité et leur indépendance de toute cérémonie religieuse instituée pour le bénir.
Dans cette lumineuse dissertation, l’auteur pose les principes d’une tolérance généreuse et efficace. Loin d’emprunter ses arguments à l’indifférence ou au mépris de la religion, il fonde sa doctrine sur la religion elle-même.
Sans remonter aux brillantes luttes qu’il eut à soutenir au barreau dans ses jeunes années, alors qu’émule et adversaire de Mirabeau, il eut l’honneur de se mesurer avec lui; sans parler de ses mémorables harangues à la tribune du conseil des Anciens, et de ses fermes et nettes conclusions comme commissaire du gouvernement au conseil des prises; sans même nous prévaloir de la part considérable qu’il prit à l’organisation des cultes, l’une des plus grandes et des plus difficiles entreprises qu’ait accompli Napoléon, ni de l’habileté, de la science, de l’éloquence qu’il y déploya; qu’il nous soit permis de dire que les discours recueillis dans ce volume suffiraient seuls à sa gloire.
Aussi, lorsqu’une mort prématurée vint l’arracher à sa famille, à ses amis, à son pays, et mettre un terme à ses nobles et utiles travaux, un sentiment universel de deuil et de regrets se manifesta dans la France entière. A la voix de ses anciens collègues dans les assemblées politiques, le corps législatif s’émut et s’associa solennellement à la douleur de son épouse et de ses fils. De toute part les sentiments d’une touchante sympathie éclatèrent: des temples des divers cultes, un concert unanime de prières s’éleva vers le ciel, et partout des honneurs civils et religieux furent rendus à sa mémoire. Nous avons cru devoir conserver et reproduire ici ces témoignages spontanés de l’estime et de la vénération publiques; un tel hommage décerné librement pour des services rendus à l’état, à la mémoire d’un citoyen qui meurt revêtu de hautes fonctions, est un puissant encouragement à bien faire. Nous croyons faire une chose utile en le rappelant.
A ceux qui pourraient être tentés de supposer que cette publication nous a été conseillée par une vanité déplacée, nous n’hésiterions pas à répondre qu’il y a peut-être quelque courage et certainement une véritable humilité, à accepter publiquement le pesant fardeau d’un si glorieux héritage.
FRÉD. PORTALIS.