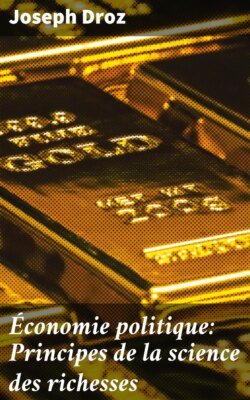Читать книгу Économie politique: Principes de la science des richesses - Joseph Droz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DE LA PRODUCTION.
ОглавлениеDONNER de l’utilité, de la valeur aux objets qui n’en ont pas, accroître l’utilité, la valeur de ceux qui en avaient déjà, c’est produire.
On produit, soit en changeant de forme les objets, soit en les changeant de lieu. L’industrie emploie le premier moyen lorsqu’elle fait croître du blé ou le broie sous la meule; elle emploie le second, lorsqu’elle transporte des grains d’un lieu où ils abondent, dans un autre où le besoin les rendra plus utiles.
C’était faute d’avoir une idée juste de la production que tant d’écrivains ont répété que le commerce ne produit rien, parce qu’il n’ajoute pas de nouveaux objets à la masse de ceux qui existaient avant ses opérations. Le commerce, en rapprochant de nos besoins une foule de marchandises, ajoute à leur utilité, à leur valeur: il produit. Ces idées, qui d’abord paraissent être de pure théorie, ne sont point dénuées d’importance pratique. Une erreur des économistes pouvait avoir, sur la manière d’établir l’impôt, une influence désastreuse.
L’industrie ne produit qu’autant que ses efforts sont dirigés avec une habile sagesse. Fabriquer n’est pas toujours produire; et même, en fabriquant, on peut détruire. Par exemple, on imprime un livre: le papier est beau, le caractère net, le tirage soigné ; mais les ouvrages d’esprit vivent par des qualités que l’industrie ne peut suppléer. Si le livre est dépourvu de ces qualités, vainement l’imprimeur a-t-il bien fabriqué ; il a détruit de la valeur. La rame de papier, qui valait quinze francs, lorsqu’elle était blanche, n’en vaut plus que six. Le travail de l’entrepreneur et de ses ouvriers, l’emploi d’un capital sont perdus; il en résulte une destruction réelle, qu’on peut évaluer par ce qu’auraient produit ce travail et ce capital utilement employés.
Le commerçant détruit de même lorsque, abusé par des renseignemens inexacts, sans doute pris avec légèreté, il fait passer des marchandises d’un lieu où elles avaient de la valeur, dans un autre où elles en ont moins. Si leur prix reste le même, ses frais et son travail sont encore perdus. S’il est vrai qu’un négociant de Londres ait expédié une cargaison de patins pour un pays où la glace est inconnue., ce négociant est un homme habile à détruire de la valeur.
Il y a, pour l’industrie ignorante ou imprudente, bien des manières d’anéantir de la valeur; Je ne sais si je les passerai toutes en revue, mais voici les principales. Au lieu de produire, on détruit en travaillant: 1° si les matières premières n’ont pas les qualités nécessaires, puisqu’on perdra, en totalité ou en partie, le prix d’achat et celui de la façon; 2° si les matières premières sont bonnes, mais que la fabrication soit mauvaise: elle est mauvaise d’une manière absolue, quand l’ouvrage ne peut servir à rien, et d’une manière relative, quand l’ouvrage, bien fait en lui-même, n’est pas du goût des consommateurs; 3° si les frais de fabrication ou de transport sont trop élevés pour qu’on puisse soutenir la concurrence; 4° si les marchandises qu’on voulait vendre se trouvent surabondantes, soit parce que les besoins sont déjà satisfaits, soit, comme il arrive plus souvent, parce que les hommes auxquels on les présente ne sont point en état de les acheter.
Il est rare que la destruction de valeur soit totale; quelque utilité résulte presque toujours du travail. On ne jette pas des marchandises qui surabondent, ou dont les frais ont été trop couteux pour qu’on puisse en être remboursé ; plutôt que de perdre tout, on vend à vil prix, et quelques gens profitent de ce qui fait la désolation de l’entrepreneur. On aurait tort cependant de prétendre qu’il y a compensation, que les uns gagnent ce que les autres perdent. Le gain est léger d’un coté, la perte est considérable de l’autre. Les travaux dirigés avec sagesse sont les seuls qui fondent la prospérité publique; et c’est s’abuser étrangement que de vouloir excuser l’imprudence on la dissipation, en montrant les avantages qu’en recueillent quelques personnes: de tels avantages prouvent seulement qu’un mal n’est jamais absolu. Quand les fausses spéculations deviennent générales, bientôt de nombreux ateliers sont fermés, la plupart des branches de commerce languissent, la sociétémanque de travail et de produits. Comment des maux si graves seraient-ils compensés par les avantages que peuvent offrir quelques encans à bas prix?
Les vérités précédentes sont de tous les temps; je les crois plus que jamais utiles à présenter aujourd’hui qu’une forte impulsion est donnée aux esprits, et que le défaut d’un grand nombre d’hommes est une aveugle confiance en eux-mêmes. L’impulsion dont je parle est précieuse; mais, pour qu’elle soit durable et toujours plus féconde, il faut que les lumières la dirigent. C’est surtout quand de nombreux navires sont lancés sur les mers, qu’il importe d’allumer les fanaux.
L’économie politique ne traite point des connaissances spéciales qu’exigent les divers travaux de l’industrie; mais elle dit aux hommes disposés à former des entreprises que ce n’est point avec de l’imagination et de la vanité qu’on réussit, qu’ils doivent d’abord se livrer à des études positives, pour acquérir sur les choses et sur les hommes les connaissances sans lesquelles ils hasarderaient leur fortune et leur honneur.
A ces connaissances, les hommes industrieux doivent unir de sages principes de conduite. Je ne viens point leur prêcher une morale désintéressée. J’écoute avec impatience ces oisifs qui, s’ils voient un manufacturier créer un établissement utile, disent aussitôt: Ce n’est pas pour le public, c’est pour lui qu’il fait cette entreprise. Eh! sans doute, c’est pour lui: un établissement d’industrie doit rapporter des bénéfices à celui qui le fonde; rien n’est plus nécessaire, et rien n’est plus juste. Cependant, c’est aussi pour la société que cet homme intelligent et laborieux travaille; les deux intérêts s’unissent; le second vient ennoblir le premier; et plus d’une fois, il a seul dirigé de vrais négocians. La morale ne blâmera jamais qu’on veuille recueillir le fruit de ses travaux; mais, ce qu’elle réprouve, c’est la cupidité, c’est cette ardeur de s’enrichir en quelques mois, qui fait entreprendre à tant de gens au-delà de leurs forces, et les jette dans la misère et l’opprobre; tandis que la modération pouvait, avec le temps, leur assurer une opulence honorable. La morale voudrait éteindre aussi ce fatal amour-propre qu’on voit chaque jour entraîner des commerçans, soit à des spéculations téméraires, soit à de folles dépenses d’ostentation. La soif du gain ruine beaucoup de gens, mais la vanité fait peut-être encore plus de victimes.
Quand l’homme laborieux a des connaissances positives et des principes sages, qu’il se livre à son activité, il produira. Si les circonstances deviennent peu favorables, ce n’est pas en restant oisif qu’on pourrait les améliorer et changer sa position. Il faut parvenir à fabriquer mieux ou à plus bas prix; il faut s’ouvrir de nouveaux débouchés, ou tenter d’autres genres de travaux. Plus il y a d’obstacles, plus l’activité doit se montrer persévérante et devenir ingénieuse.
Plusieurs écrivains reprochent à M. Say d’avoir dit qu’on ne peut trop produire. Eh quoi! pourrait-on créer trop d’utilité, de valeur? Ces écrivains ont des idées confuses sur la production; ils ont cru que M. Say disait qu’on ne peut trop fabriquer. Tout observateur s’aperçoit aisément qu’on peut fabriquer trop de telle ou telle marchandise, ou bien en diriger trop vers tel ou tel marché. C’est pour prévenir ces travaux stériles et même destructeurs que les études spéciales sont si nécessaires. Mais la production, j’attache à ce mot un sens exact, la production ne saurait devenir trop abondante. Dire: craignez de trop produire, c’est dire à des marchands: prenez garde de trop vendre.
Un des plus éminens services rendus par M. Say à l’économie politique, un de ceux qui lui feront un éternel honneur, est d’avoir porté au plus haut degré d’évidence cette vérité fondamentale: les produits ne s’achètent qu’avec des produits. Nous voulons répandre l’aisance, nous voulons enseigner aux hommes à se procurer les biens qui leur sont utiles ou agréables; un des premiers principes à leur démontrer, c’est qu’on ne peut acheter des produits qu’en ayant d’autres produits à donner en échange.
Cette vérité, qui doit jeter une vive lumière sur les intérêts matériels de la société, est cependant obscure au premier coup-d’œil. Habitués que nous sommes à voir l’argent figurer dans la plupart des échanges, il nous semble qu’on se laisse séduire par une idée subtile en disant que les produits s’achètent avec des produits. La première réponse qui s’offre à notre esprit, c’est que les hommes qui consomment le plus sont, en général, des hommes qui ne produisent rien.
Je vous suppose, lecteur, vivant dans un heureux loisir, du seul revenu de vos domaines. Vous ne produisez point; mais d’autres produisent pour vous. Qu’est - ce en effet que votre revenu? C’est une part des produits que les cultivateurs de vos terres on fait naître. Vous pouviez recevoir cette part en nature: vous avez trouvé plus commode qu’elle fût convertie en numéraire; mais les pièces de monnaie qui servent à vos dépenses représentent les denrées contre lesquelles vos fermiers les échangèrent; et c’est réel. lement avec ces denrées que vous payez les diverses marchandises qu’il vous convient d’acheter. Etes-vous un de ces riches capitalistes qui vivent de la rente des sommes qu’ils ont prêtées? Si vos fonds se trouvent dans les mains d’un entrepreneur d’industrie, les intérêts qu’il vous compte sont une partie des objets qu’il a fabriqués et vendus. Si vous avez pour emprunteur un oisif, il ne vous paiera pas, ou il prendra sur des produits, par exemple sur le loyer de ses fermes. L’argent même est un produit pour le possesseur d’une mine; et lorsqu’on n’est pas propriétaire de mines, comment se le procurer, sinon en donnant d’autres produits en échange? Les toiles, les draps, les vins d’Europe achètent les métaux d’Amérique.
«Il n’est pas du tout vrai, dit M. Malthus, que des produits soient toujours échangés contre d’autres produits. La plus grande partie des produits s’échange contre du travail,»
On n’achète pas le travail pour le travail même, on l’achète pour les résultats qu’on veut en obtenir. Le pauvre ouvrier qui sollicite de l’emploi s’exprimerait très exactement s’il disait: Je n’ai pas de produits à vous offrir en échange de ceux dont j’ai besoin pour vivre; mais je travaillerai de manière à créer pour vous des produits qui surpasseront en valeur ceux que je vous demande. Les ouvriers donnent leur travail, les entrepreneurs leur donnent de l’argent; ce travail et cet argent sont des intermédiaires qui font arriver les hommes aux produits qu’ils désirent.
M. de Sismondi pense que le revenu est tout-à-fait distinct de la production, et que les produits s’achètent, non avec des produits, mais avec du revenu . L’analyse prouve que les revenus font partie de la production, qu’ils naissent tous de cette source commune, quelle que soit la manière dont se déguise leur origine. Les appointemens des fonctionnaires publics sont pris sur les contributions, qui ne sont autre chose que des produits donnés par chaque particulier pour subvenir aux dépenses générales. Les honoraires des médecins et des avocats, les gains des acteurs, des musiciens, etc., sont également une part de nos produits convertis en argent.
Mais, dira-t-on, sans doute, la manière dont le magistrat, le médecin, l’avocat, etc., obtiennent un revenu, dément votre principe: ces hommes voués aux seuls travaux de l’intelligence, n’ont pas d’industrie qui leur crée des produits; ils ne peuvent donc en échanger contre les nôtres. Assurément ceux qu’ils nous offrent ne sont pas de même nature que ceux des cultivateurs et des fabricans; mais leurs nobles méditations en font naître de précieux. Tous nos besoins ne sont pas matériels; il en est de même des produits. Les travaux des hommes qui veillent au bien public, et ceux des gens qui contribuent à nos plaisirs, donnent des produits immatériels. Ces travaux nous étant nécessaires ou agréables, et les hommes auxquels nous les devons ayant des besoins physiques, les produits immatériels s’échangent contre des produits matériels.
Vainement épuiserait - on les combinaisons: pour acquérir des produits, il faut en avoir d’autres à donner en échange. C’est ce que le bon sens, qui n’est même, dans ce cas, qu’un véritable instinct, apprend à tous les hommes pressés par la misère de trouver des moyens d’existence. A moins qu’ils ne se fassent mendians ou voleurs, ils cherchent comment ils pourraient créer quelques produits matériels ou immatériels, pour les échanger et pour vivre. Ce que le bon sens révèle aux êtres les plus ignorans, les hautes méditations sur l’économie politique ne font que le développer et l’étendre à toutes ses conséquences.
Il y a dans la production une puissance qui excite à produire. La vue des ouvrages de l’industrie, des objets propres à satisfaire des besoins naturels ou factices, éveille les désirs, et rend les hommes ingénieux à trouver les moyens de se procurer ces objets. Si les denrées, par exemple, sont plus abondantes qu’autrefois en Europe, une grande cause de cette amélioration, c’est qu’il se fabrique plus de draps, de toiles, de bijoux, etc. On a redoublé d’efforts et multiplié les produits de la terre, afin d’obtenir en échange ces objets qui faisaient sentir l’aiguillon de nouveaux besoins. A mesure que l’industrie recevra d’heureux développemens, les échanges deviendront plus nombreux, et répandront l’aisance. Plus il naîtra de produits variés sur les différens points du globe, moins il y aura de souffrances causées par des besoins non satisfaits.
On n’a déjà que trop fabriqué, disent MM. Malthus et de Sismondi! Des marchandises anglaises restent invendues en Italie, au Brésil, et des étoffes ont été laissées au Kamschatka au-dessous du prix que leur fabrication coûtait à Londres!
Les faits très réels et très fâcheux que citent ces écrivains confirment tous les principes énoncés dans ce chapitre. D’abord, ils prouvent qu’en fabriquant on peut détruire, ils prouvent la nécessité où sont les entrepreneurs d’acquérir toutes les connaissances qui doivent les guider. Le pouvoir de fabriquer dans tel pays ne donne pas le pouvoir de faire produire dans tel autre. Les négocians de la Grande-Bretagne auraient du mieux connaître la situation de contrées lointaines, dont ils ne pouvaient rendre les habitans plus industrieux et plus riches.
Ensuite, des milliers de spéculateurs ignorans ou imprudens feraient fabriquer trop de telles marchandises, en transporteraient trop dans tels pays, leurs fautes ne prouveraient rien contre cette vérité qu’il est à desirer que les produits se multiplient. Ces fautes, au contraire, serviraient à démontrer que les produits ne s’achètent qu’avec des produits. Si les habitans du Kamschatka, du Brésil, de l’Italie étaient plus industrieux, ils acheteraient les marchandises de la Grande - Bretagne, car ils en auraient les moyens. Lorsqu’on ne parvient pas à vendre des marchandises bien confectionnées et à bas prix, c’est parce que les hommes auxquels on les présente n’en ont pas besoin, ou parce qu’ils ne sont pas en état de les payer. La seconde hypothèse est la plus probable. Hélas les besoins sont nombreux; mais, pour les apaiser, on manque d’objets à donner en échange de ceux qu’on voudrait obtenir. L’encombrement d’une marchandise n’est en général que le résultat du défaut de production d’autres marchandises. Je dis en général, parce que deux peuples que leurs fabrications mettraient en état de s’enrichir mutuellement peuvent voir leur commerce gêné ou même anéanti par les obstacles dont le fisc hérisse leurs frontières.
Les conséquences de la théorie sur laquelle je viens de jeter un coup - d’œil sont d’une extrême importance. Cette théorie démontre que le genre humain ne peut atteindre au degré de richesse dont il est appelé à jouir que lorsque l’industrie, favorisée chez tous les peuples par la paix et par la liberté, fera naître de toutes parts des produits abondans et variés. Jamais les amis de l’humanité ne doivent se départir des vérités que nous venons de reconnaître. Ce sont elles qui commencent à changer une diplomatie tracassière en politique généreuse, et qui finiront par amener les hommes d’état à seconder la grande loi de la solidarité des peuples, établie par la justice éternelle.