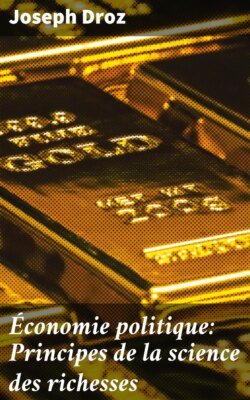Читать книгу Économie politique: Principes de la science des richesses - Joseph Droz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DE L’ÉPARGNE ET DES CAPITAUX.
ОглавлениеUN troisième agent est essentiel pour produire. Cet agent est l’épargne qui fournit au travail les instrumens sans lesquels son activité ne pourrait se déployer.
Il y a plusieurs sortes d’épargnes. Celle de l’ayare qui enfouit son argent n’est du ressort d’aucune science; l’épargne faite pour subvenir aux besoins de la famille appartient à l’économie domestique; l’épargne qui concourt à développer l’industrie, en créant des capitaux, est celle dont s’occupe spécialement l’économie politique.
Il faut concevoir nettement ce que c’est qu’un capital. Tous les auteurs n’attachent pas le même sens à ce mot: selon les uns, les capitaux sont des sommes d’argent; selon les autres, ils se composent non-seulement des sommes qui servent ou peuvent servir aux entreprises d’industrie, mais encore de tous les objets, tels que bâtimens, outils, etc., qui sont destinés à créer de nouvelles richesses. Les premiers emploient le langage vulgaire; les autres parlent une langue scientifique, dont l’exactitude est facile à prouver.
Une somme d’argent est un capital très commode, puisque le possesseur l’échange, pour ainsi dire à volonté, contre les objets qui lui conviennent. Mais, les capitaux en numéraire ne sont qu’une partie très faible de ceux qu’emploie l’industrie. Par exemple, cent mille francs passent successivement dans les mains de sept ou huit entrepreneurs, qui tous font exécuter des constructions, des machines, etc. En supposant que cette somme continue de rester dans le commerce, elle ne sera toujours qu’un capital de cent mille francs; et il existera pour sept ou huit cent mille francs d’autres capitaux. Si l’on conçoit différemment ce sujet, on n’aura pas une idée juste des richesses que l’industrie accumule pour en créer de nouvelles. La seule portion de nos capitaux agricoles, qui consiste en bestiaux, était évaluée, en 1812, à plus d’un milliard et demi : or, je doute que la France ait deux milliards monnayés; encore verrons-nous qu’il ne faut pas confondre les capitaux en argent avec la totalité du numéraire qui se trouve dans l’état.
L’homme qui veut former une entreprise d’industrie a dans les mains une somme qui lui appartient ou qu’il a empruntée, et dont il se sert pour acquérir les divers objets nécessaires à ses travaux. Cette somme est un capital, mais elle n’est, pour ainsi dire, qu’un capital intermédiaire, qu’il faut promptement échanger contre des capitaux d’une utilité plus directe.
Un jeune ouvrier n’a d’abord pour exister que sa seule industrie: il concourt à la production, il a part aux produits. S’il dissipe la totalité des salaires qu’il reçoit, sa position ne peut s’améliorer. S’il est intelligent et d’une bonne conduite, il économise; il se procure des outils, des matières premières, et ces avances le mettent en état de travailler pour son compte. Alors, il gagne davantage; il fait de plus grosses épargnes qui finissent par lui donner les moyens de louer un atelier, d’avoir des ouvriers, de leur fournir des matières brutes, des outils, et de leur payer des salaires. Nous venons de voir un capital se former et s’accroître; les capitaux sont des produits épargnés.
Selon les genres d’industrie, il y a des capitaux très minces, il y en a d’énormes. L’instrument de fer que le petit savoyard emploie pour nettoyer les cheminées, ses genouillères en cuir, le sac dans lequel il emporte la suie, quelques pièces de monnaie pour subsister jusqu’à ce qu’il obtienne un salaire, voilà tout le capital du pauvre enfant qui sort des montagnes de la Savoie pour aller au loin gagner sa vie. Nous voyons le besoin d’avances s’étendre, s’agrandir, à mesure que nous dirigeons nos regards vers des genres d’industrie plus importans. Combien de vastes constructions, d’outils variés, de machines puissantes sont nécessaires pour tirer le minerai de la terre, pour le changer en fonte, pour transformer la fonte en fer et le fer en acier! Que les capitaux soient faibles ou considérables, ils sont toujours de même nature; ce sont toujours des produits épargnés.
Le lecteur doit commencer à juger de quelle utilité les capitaux sont à l’industrie. C’est un fait remarquable que des produits sont nécessaires pour créer des produits. Assemblez des ouvriers sur un sol qui recèle une mine abondante; s’ils manquent des instrumens d’exploitation, leurs efforts seront nuls. Supposons l’Europe dépouillée tout-à-coup des produits accumulés qui forment ses immenses capitaux, son industrie sera frappée de mort. Sans doute ses habitans, puisqu’ils conserveraient leur intelligence et leur force, finiraient par recouvrer les ressources perdues; mais, dans quelle longue misère ils végéteraient! Ils n’auraient d’abord que leurs mains pour se fabriquer de grossiers outils; ils recueilleraient péniblement les produits spontanés de la terre, pour essayer de les multiplier ou de les façonner. Privé des avances nécessaires au travail, le genre humain retournerait aux jours de son enfance.
On a formé soi-même les capitaux qu’on emploie, ou on les a reçus de ses pères, ou on les a empruntés; mais toujours il faut qu’un entrepreneur, grâce à ses épargnes ou à celles d’autrui, possède les avances qu’exigent ses travaux.
Dans une entreprise d’industrie, les capitaux sont les bâtimens d’exploitation, les outils, les machines, les matières brutes, le numéraire que demandent les paiemens courans, enfin, les matières fabriquées non encore vendues.
Les bâtimens, les outils, les machines s’usent avec lenteur, et forment ce qu’on nomme le capital fixe. Les matières brutes, l’argent destiné aux salaires, aux achats, disparaissent avec rapidité, et même ne peuvent donner un profit sans sortir des mains de l’entrepreneur: ces avances sont, avec les marchandises non vendues, ce qu’on appelle le capital circulant.
Sous le point de vue que nous considérons, tous les genres d’industrie se ressemblent. L’agriculture, de même que les fabriques, a des capitaux fixes et des capitaux circulans. La plus grande partie des capitaux du commerce sont de la seconde espèce, puisqu’ils consistent en marchandises; cependant le commerce aussi a des capitaux fixes; il a ses magasins, ses navires, ses chariots, ses chevaux, etc.
Le capital change continuellement de forme, soit avec lenteur, soit avec rapidité. Les matières premières, par exemple, deviennent objets manufacturés, puis, argent monnayé ou lettres de change, puis, redeviennent matières brutes, pour éprouver encore les mêmes métamorphoses.
La portion des capitaux absorbée par la fabrication doit se retrouver dans les ouvrages fabriqués; autrement, ces ouvrages onéreux coûteraient plus qu’ils ne vaudraient. Quand les produits sont vendus, si l’entrepreneur dissipe la totalité de leur prix, il se ruine: une partie de son capital fixe est tout ce qui lui reste; il a tari la source d’une production nouvelle. S’il remplace ses capitaux avec une partie du prix de la vente, et qu’il emploie à son usage, à ses plaisirs, l’autre partie qui constitue son revenu, il n’est ni plus riche ni plus pauvre qu’en commençant; il peut continuer de travailler et de vivre. S’il épargne sur son revenu pour grossir ses capitaux, il s’enrichit; et le développement progressif de l’industrie qu’il dirige atteste sa sagesse, ainsi que son activité.
Les observations suivantes achèveront de jeter quelque lumière sur les fonctions des capitaux. Étendons nos regards plus que nousne l’avons fait encore. Tous les produits matériels que possèdent les hommes, peuvent se diviser en trois classes: capitaux, fonds de consommation, revenus. Examinons rapidement chacune de ces classes.
Tous les capitaux sont des produits amassés par l’épargne; mais il n’ont pas tous la même destination. Ceux qui servent à créer de nouveaux produits sont les plus utiles pour la société. D’autres rapportent seulement un revenu à leurs possesseurs. Une somme qu’on prête est un capital, bien qu’elle ne soit employée à produire de nouvelles richesses ni par le prêteur qui veut vivre avec les intérêts, ni par l’emprunteur qui fait des acquisitions frivoles. L’exemple suivant donnera des idées plus complètes. Une maison d’agrément, habitée par le propriétaire, fait partie du fonds de consommation. Si le propriétaire loue cette maison, elle devient un capital qui lui procure un revenu; s’il la transforme en manufacture, c’est un capital qui lui donne un revenu et qui multiplie les richesses de la société.
Les capitaux qui remplissent cette double destination sont les seuls vraiment productifs; on pourrait dire que les autres sont seulement lucratifs.
Enfin, il y a des capitaux oisifs: ce sont ceux dont les possesseurs ne font pas usage, par l’effet ou des circonstances ou de leur volonté. Les scellés sont sur des ateliers; voilà des capitaux momentanément oisifs. Il y en a toujours en stagnation par suite des désordres qu’enfantent l’ignorance, l’irréflexion, la cupidité, qui sont les trois grandes causes de ruine pour l’industrie. La volonté des possesseurs de capitaux en rend oisive une certaine quantité. L’avare enterre les siens; mais son ignoble aberration d’esprit est peu contagieuse, elle est sans influence sur les richesses de la société : elle doit être combattue par le moraliste plus que par l’économiste. Sans être avare, un homme opulent peut aimer à tenir une forte somme en réserve; elle lui procure de la sécurité. Beaucoup de personnes, déterminées par le même avantage, conservent aussi des sommes proportionnées à leur fortune. Il est bien difficile que la prévoyance des particuliers soit préjudiciable au public. En général, ces sommes sont trop faibles pour qu’on doive les considérer comme des capitaux enlevés à la circulation; elles servent bien plutôt, en s’accroissant par des épargnes successives, à former des capitaux qui circuleront un jour. Ajoutons que la plupart des hommes assez prudens pour économiser, ne laissent pas sans emploi des sommes capables d’ajouter au bien-être de leurs familles. Il ne faut donc point, dans des vues d’intérêt pour le commerce, déclamer contre la prévoyance et l’épargne. Ce qui paralyse surtout les capitaux, ce sont les circonstances où, mécontens du présent, inquiets de l’avenir, les hommes industrieux suspendent leurs projets, et même craignent de prêter leurs fonds à ceux qui se montrent plus confians ou plus téméraires. Alors, les capitaux se resserrent, le travail languit, la misère devient générale.
Le fonds de consommation se compose des produits qui servent immédiatement à nos besoins naturels ou factices. Des caractères qui me paraissent faciles à remarquer, distinguent les produits employés en capitaux de ceux qui se trouvent dans le fonds de consommation. Tous sont destinés à nous procurer des jouissances; mais les capitaux, qui concourent si puissamment à ce but, n’y contribuent cependant que d’une manière indirecte, tandis que les objets livrés à la consommation y contribuent directement. Ensuite, les premiers servent à produire de nouvelles richesses, ou du moins ils donnent une rente qui peut être employée à les accroître; les seconds s’usent, se détruisent, sans rien laisser après eux. Voilà des caractères bien distincts qui prouvent la justesse de la division sur laquelle nous jetons un coup-d’œil.
Le fonds de consommation a cette ressemblance avec les capitaux, qu’il est aussi composé d’objets dont les uns se détruisent rapidement, tels que les denrées, les boissons consommées dans nos ménages; et dont les autres s’usent avec lenteur, tels que les meubles, les maisons d’habitation, etc. Cette qualité de s’user lentement permet de les accumuler; leur nombre est considérable chez les peuples dès long-temps civilisés, et l’on ne saurait dire à quel point il le deviendrait, si l’industrie recevait, durant une suite d’années, tous les développemens que la raison peut lui supposer.
Les revenus sont les produits, ordinairement convertis en argent, que les hommes reçoivent, soit pour loyer de leurs propriétés, soit pour émolumens, ou profits, ou salaires de leurs travaux. Les revenus se dirigent nécessairement vers les capitaux ou vers les objets de consommation. J’aurai plus tard à examiner les effets qui résultent de ces deux emplois différens.
Nous acheverons de nous former des idées justes sur cette classification des produits matériels, si nous observons qu’un grand nombre de produits passent continuellement d’une classe dans une autre. Telle marchandise non vendue est dans le capital d’un manufacturier; je l’achète avec une partie de mon revenu, elle passe dans le fonds de consommation; au même instant, la portion de revenu que j’ai donnée au manufacturier peut entrer dans son capital. Ce mouvement continuel ne change rien à notre division; un produit est toujours dans une des trois classes qui viennent d’être indiquées.
Lorsqu’on a vu quels services rendent les capitaux, on conçoit les avantages qui résultent de leur accumulation; on se les représente comme des leviers qui, devenant plus forts et plus nombreux, donnent toujours plus de facilité pour vaincre les obstacles qui s’opposent au développement de l’industrie. Ce n’est pas seulement par le progrès des lumières, c’est aussi par l’accumulation des capitaux que les peuples modernes ont les moyens de se livrer à des fabrications si variées, d’envoyer leurs produits à des contrées lointaines, et d’en rapporter des richesses nouvelles.
J’aurai, dans la suite de cet ouvrage, à parler encore des capitaux; ici, je n’avais à montrer que leur usage pour la formation des richesses. Smith pense qu’elles sont produites uniquement par le travail; et les partisans de cette opinion attaquent M. Say pour avoir soutenu que les capitaux sont un des agens de la production. Les capitaux, disent-ils, sont des produits qu’un travail antérieur a fait naître; le travail, par conséquent, est le seul producteur.
Je m’éloigne de l’opinion de Smith, et je diffère de celle de M. Say. Le travail n’est pas le seul producteur des richesses; il a besoin de capitaux; or, il ne peut les créer, il n’en fournit pour ainsi dire que la matière première. En effet, le travail peut bien donner quelques produits; mais, si la dissipation les anéantit ou les disperse, l’homme restera toujours au même point de misère. Il faut que l’épargne réunisse, conserve ces produits; elle seule a le pouvoir de les transformer en capitaux. L’auteur anglais exagère donc la puissance du travail. Mais, l’auteur français fait jouer aux capitaux un rôle actif que ne comporte point leur nature; ce sont des instrumens inertes par eux-mêmes. L’épargne reçoit du travail la matière première des capitaux; elle les forme, et les donne au travail qui les emploie. Voilà ce que l’observation fait reconnaître. Ainsi, les agens de la production sont le travail de la nature, le travail de l’homme, et l’épargne qui forme les capitaux.
FIN DU PREMIER LIVRE.