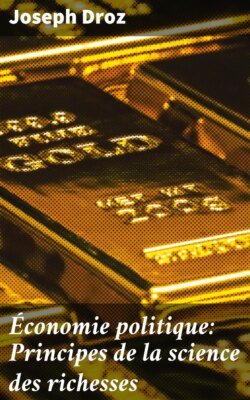Читать книгу Économie politique: Principes de la science des richesses - Joseph Droz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE II.
Table des matières
DES RICHESSES.
LORSQUE VOUS parcourez un pays, si vous apercevez des habitations misérables, où l’air et la lumière ne pénètrent que par d’étroites ouvertures, et dont l’intérieur ne renferme que des meubles grossiers; si dans les villes, ainsi que dans les campagnes, vous voyez beaucoup d’hommes qui sont mal vêtus, et dont la nourriture est à peine suffisante, alors même qu’on vous apprendrait que, dans chaque province, il existe plusieurs familles opulentes, et que le prince a de l’or en abondance, prononcez que ce pays est pauvre. Si vous en traversez un autre où les demeures sont commodes et proprement meublées, où la nourriture et les vêtemens des cultivateurs, des ouvriers, annoncent qu’ils gagnent facilement leur vie, ne vous informez pas si ce pays est riche: vous en avez la preuve sous les yeux.
Les richesses sont tous les biens matériels qui servent aux besoins des hommes. Un état est riche lorsque ces biens y sont très répandus.
Parmi les objets utiles, les uns servent immédiatement à nos besoins, tels sont les alimens, les habits, etc. Les autres ne contribuent à satisfaire nos besoins que d’une manière indirecte, tels sont les outils, la monnaie, etc.
Les métaux précieux sont une partie fort utile des richesses, mais ne sont pas les richesses, comme on l’a supposé long-temps. Si, pour enrichir un pays, il suffisait d’y verser de l’or, quelle terre eût été plus florissante que l’Espagne? En vain, cependant, voyait-elle affluer dans ses ports les métaux que lui livrait l’Amérique; en vain, pour les conserver, s’armait-elle de lois sanguinaires contre l’exportation; la pauvreté de ses habitans déshonorait son sol fertile. Cette contrée malheureuse eût arraché vingt fois plus d’or à ses colonies, que sa situation n’eût point changé. Le prince, les gens de cour auraient eu plus de pièces de monnaie, ils auraient pu tirer de l’étranger plus d’objets propres à satisfaire leurs caprices; mais la multitude ignorante et paresseuse, ne travaillant point, ne produisant rien, eût continué d’être nourrie par la superstition et dévorée par la misère.
A ce tableau, opposons celui que M. de Humboldt trace des colonies espagnoles que le travail anime. «Les sources principales de la richesse du Mexique, dit-il, ne sont pas les mines, mais une agriculture sensiblement améliorée depuis la fin du dernier siècle..... La fondation d’une ville suit immédiatement la découverte d’une mine considérable. Si la mine est placée sur le flanc aride ou sur la crête des Cordillières, les nouveaux colons ne peuvent tirer que de loin ce qu’il leur faut pour leur subsistance. Bientôt, le besoin éveille l’industrie. On commence à labourer le sol dans les ravins, et sur les pointes des montagnes voisines; partout le roc est couvert de terreau. Des fermes s’établissent dans le voisinage de la mine. La cherté des vivres, le prix considérable auquel la concurrence des acheteurs maintient tous les produits de l’agriculture, dédommagent le cultivateur des privations auxquelles l’expose la vie pénible des montagnes. C’est ainsi que par le seul espoir du gain, par les motifs d’intérêt mutuel, qui sont les liens puissans de la société, et sans que le gouvernement se mêle de la colonisation, une mine, qui paraissait d’abord isolée au milieu de montagnes désertes et sauvages, se rattache en peu de temps aux terres anciennement labourées. Il y a plus encore, cette influence des mines sur le défrichement progressif du pays, est plus durable qu’elles ne le sont elles-mêmes.»
Si l’on voit les principales richesses dans les objets qui servent à nourrir, à vêtir, à loger les hommes, on juge que le travail est nécessaire pour multiplier ces objets, que par conséquent il faut rendre les hommes plus intelligens, plus laborieux, et les laisser exercer librement leur industrie, afin que chacun d’eux soit excité par l’espoir de recueillir le fruit de son activité. Si l’on pense, au contraire, que les richesses consistent uniquement dans les métaux précieux, on regarde d’abord la guerre, le pillage, comme un moyen rapide et sûr d’enrichir un pays. Lorsqu’ensuite on commence à sortir de la barbarie, l’oppression change d’objet; on s’efforce de soumettre l’industrie aux vues d’une administration inquiète qui voudrait toujours faire entrer du numéraire dans l’état, et n’en jamais laisser sortir. On gène le travail par une foule de réglemens; tantôt on décourage des genres de production qui feraient vivre beaucoup d’hommes, mais qui paraissent moins propres que d’autres à solliciter l’or de l’étranger; tantôt on force les arts et le commerce à suivre des routes dont les éloigneraient l’intérêt privé et l’intérêt général, mais par lesquelles on espère arriver à s’emparer du numéraire des autres contrées. Ainsi s’est formé le système mercantile que nous voyons aujourd’hui s’affaiblir en Europe, mais qui s’y maintient encore, soutenu par deux causes puissantes: le préjugé, toujours lent à céder aux leçons de l’expérience; et la raison même qui, voyant les calamités qu’enfantent les brusques changemens, n’appelle que des améliorations successives.
Vers le milieu du siècle dernier, une nouvelle théorie de la richesse fut imaginée par Quesnay, et soutenue avec un zèle presque religieux, par les écrivains français désignés sous le nom d’Economistes. En peu de mots, voici leur opinion.
Les divers objets qui servent à nos besoins tirent leur origine de la terre; en elle seule réside un pouvoir créateur. Quand toutes les avances faites par le cultivateur, dans le cours de ses travaux, ont été remplacées par les récoltes, il reste un excédant de produits, un produit net. Cet excédant qui ne représente aucune avance, cet excédant, fruit du travail que fait la terre elle-même, est seul la richesse, car lui seul augmente le fonds que la société possédait. Les manufacturiers et les commerçans peuvent bien ajouter à la valeur des objets qu’ils façonnent ou transportent, mais cet accroissement de valeur représente ce qu’ils ont consommé , ou pu consommer; pendant la durée de leurs travaux; il n’en résulte donc point une augmentation de richesses pour la société. Ainsi l’industrie manufacturière et commerciale, détruisant en même temps qu’elle travaille, doit être regardée comme stérile. L’industrie agricole est la seule productive, puisqu’elle seule fait naître un produit nouveau.
Cette subtile théorie ne peut soutenir un mûr examen. La terre n’est pas plus que l’homme douée d’un pouvoir créateur; toute son active fécondité est impuissante à créer un atome. Pour savoir comment elle produit, choisissons un exemple. Ce cultivateur jette des grains de chenevis sur le sol qu’il vient de labourer; la terre les transforme en tiges de chanvre; elle ajoute ainsi à leur utilité, à nos richesses. Que font les hommes dont l’industrie s’exerce sur le chanvre? Ils le soumettent à diverses transformations; les uns le changent en fil, d’autres en toile; et tous ajoutent à son utilité, à nos richesses. Sous le rapport que je considère, il y a plus que de l’analogie, il y a identité entre les opérations de l’homme et celles de la nature. Je n’en vois pas qui soient créatrices; je vois une suite de transformations dont chacune rend l’objet qu’elle modifie plus propre à satisfaire nos besoins, et lui fait acquérir un nouveau degré dans l’ordre des richesses.
S’il est incontestable que tous les produits des arts tirent de la terre leur première origine, il est d’une égale évidence que le travail de l’homme ajoute prodigieusement au travail de la nature. Le chanvre, le lin seraient des végétaux sans valeur, si l’art ne savait les changer en fil, en tissus, en dentelles, et les approprier à nos goûts. Les plus précieuses denrées que la terre produise cessent d’être des richesses, lorsqu’elles surabondent et ne trouvent plus de besoins à satisfaire. Une puissance féconde, le commerce, vient leur rendre de l’utilité, les replacer parmi les richesses, en les transportant où de nouveaux besoins les appellent.
Mais, disent les économistes, la valeur que le manufacturier donne aux objets de son industrie représente la valeur qu’il a consommée en travaillant. Eh quoi! ces prodiges d’industrie dont le prix élevé est dû presque entièrement à la main d’œuvre, ne seraient que l’équivalent des consommations du fabricant et de ses ouvriers! Les économistes sont obligés de dire que la valeur produite par le manufacturier, représente celle qu’il a consommée ou pu consommer. Les hommes livrés à l’industrie, épargnent donc sur ce qu’ils pourraient consommer: alors, la valeur représentée et celle qui la représente, existent en même temps; il y a donc accroissement de richesses par le fait des hommes industrieux. Si l’on s’arrêtait à cette idée, on n’apprécierait pas encore avec justesse les résultats de leurs travaux; et nous verrons mieux, dans la suite de cet ouvrage, que les transformations opérées par les arts produisent des richesses aussi bien que les transformations opérées parla nature.
Nous venons de jeter un coup-d’œil sur deux systèmes qui donnent des richesses une idée incomplète; l’un, en les faisant consister dans les métaux précieux; l’autre, dans le produit net de la terre: il est un système où le mot richesse est pris dans un sens trop étendu. Plusieurs écrivains désignent par ce mot tout ce que l’homme peut desirer d’utile ou d’agréable. D’après leur théorie, les qualités de l’âme, la bienveillance, la générosité, l’héroïsme sont des richesses. Un système qui tend à confondre les biens intellectuels et moraux avec les objets les plus matériels, me semble moins ennoblir les seconds que dégrader les premiers. On parle d’une manière très intelligible sans doute, si l’on dit que la vertu est la plus desirable des richesses. Ces mots sont justes parce qu’ils offrent un sens métaphorique; mais, au sens propre, ils seraient absurdes. Les sages qui nous révèlent des moyens de bonheur, nous font découvrir les jouissances morales dans une sphère supérieure à celle des plaisirs physiques. C’est nuire à leurs nobles leçons que de porter la confusion dans le langage, et d’assimiler, au moins en apparence, les vertus aux richesses. Pense-t-on agrandir ainsi le domaine de l’économie politique, et lui donner plus d’éclat? Cette science n’a pas besoin d’étendre ses limites; une assez haute importance résulte pour elle de ce que les richesses, qu’elle enseigne à répandre, préviennent ou dissipent des souffrances, chassent les vices que la misère enfante, et sont d’utiles auxiliaires des biens plus précieux, avec lesquels il faudrait rougir de les confondre.
Parmi les opinions que je viens d’examiner, la plus simple et la plus vraie nous fait voir les richesses dans tous les biens matériels qui servent aux besoins des hommes.