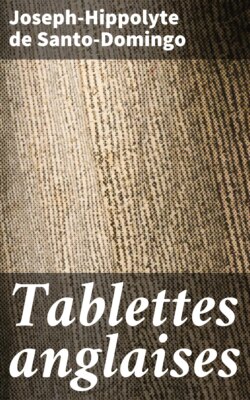Читать книгу Tablettes anglaises - Joseph-Hippolyte de Santo-Domingo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DOWNING-STREET.
ОглавлениеTable des matières
La bureaucratie est une puissance en France; c’est le ver rongeur du budjet. Elle finira par ruiner l’Etat, en frais de bureaux.
Discours de M. CAMLEY.
En France, tout voyageur doit un tribut à la gendarmerie. Ce corps respectable y exerce la surveillance la plus rigoureuse et la plus étendue. Les gendarmes veillent à la tranquillité des spectacles et à la sûreté des grandes routes. On les rencontre à la porte d’un bal, devant un monument public, ou dans l’enceinte des tribunaux; ils escortent les prisonniers et précèdent les processions; enfin ces messieurs se glissent partout, et l’on ne peut faire un pas sans être victime de leur obséquieuse sollicitude.
N’est-il pas ridicule, de ne pouvoir faire quatre lieues en France sans que des légions de gendarmes viennent demander, viser, parapher et enregistrer votre passeport? Donné, au nom du roi, par un de ses ministres, revêtu de la signature d’une autre excellence, il ne vous servirait à rien à vingt-cinq lieues de la capitale, si un brigadier de la gendarmerie n’y avoit apposé son visa, et un commissaire de police son cachet. Vive l’Angleterre pour n’y point sentir l’influence de la bureaucratie, et le despotisme de la police! Si l’on en excepte la tyrannie des douaniers et les premières formalités de l’arrivée, un étranger peut rester dix ans à Londres sans se douter qu’il existe une police dans les trois royaumes. Lord Sidmouth, chargé de ce soin, n’en laisse apercevoir que tout juste ce qu’il en faut pour tranquilliser ses concitoyens, et conserver son ministère.
En débarquant à Douvres, on remet à chaque voyageur une espèce de passe passe sur une longue bande de papier, en lui enjoignant, sous peine de quinze jours de prison, de l’aller montrer à Londres, à l’Alien-Office, ou bureau des étrangers.
Le jeune L*** était à Londres depuis un mois, et n’avait point songé à son permis de séjour. En jetant les yeux sur le petit avertissement qui était en marge de son certificate d’arrival, il se crut déjà dans les prisons anglaises; il jugea donc prudent de se présenter à l’Alien-Office; mais comme il redoutait d’y aller seul, il vint me faire part de son embarras. «N’ayez aucune crainte, lui dis-je, le commis auquel vous avez affaire est un honnête homme, chargé d’une nombreuse famille; il recevra facilement vos excuses, si vous les accompagnez d’une légère indemnité, dont le total ne doit pas excéder un écu (crown).–Vous me parlez du garçon de bureau?–Non, c’est du chef. Les nôtres sont de meilleure composition que les commis de votre pays. On fait de grands frais en France pour séduire le plus mince employé; on relève la modicité du cadeau qu’on hasarde par une foule d’attentions qui ménagent la délicatesse de celui qu’on achète. Ce raffinement de corruption est inconnu chez nous; aussi les services y sont-ils à meilleur marché: le commis ne rougit pas de vendre sa protection à un homme qui, dans une autre circonstance, lui vendra la sienne à son tour. D’ailleurs, les personnages élevés lui donnent l’exemple d’un pareil commerce: la conduite est la même chez tous, ils ne diffèrent que sur le prix. Celui auquel vous allez adresser votre réclamation est un des plus modestes, il ne se surfait pas.»
J’offris d’accompagner le jeune L***. Il me refusa honnêtement, en me disant que je l’avais pleinement rassuré sur les moyens d’éviter les quinze jours de prison dont il était menacé, et que d’ailleurs il se rendrait à l’Alien-Office avec un autre voyageur français de ses amis qui n’avait rien à redouter de la sévérité anglaise. Je le priai de me faire connaître le résultat de sa démarche; et le lendemain il le fit en ces termes:
«Nous nous acheminâmes, mon compatriote et moi, vers Withehall, C’est là, dans une ruelle au fond de laquelle est une petite porte d’allée, que se trouve la préfecture de police de Londres. Un homme d’une quarantaine d’années recevait les étrangers dans une chambre où quinze personnes auraient eu de la peine à tenir. Nous lui présentâmes en même tems nos deux passeports: il jeta un coup d’œil dédaigneux sur celui qui était en règle, et parut satisfait d’en trouver un qui ne l’était pas. «Qui de vous deux est à Londres depuis un mois? nous demanda-t-il en mauvais français, affectant une sévérité dont il aurait pu se dispenser--Moi, répliquai-je, en glissant la mai droite dans mon gousset. » Il me regarda du coin de l’œil, et radoucissant un peu sa voix: «Vous avez été bien négligent, mais enfi nous tâcherons d’arranger cela.» Sur sa première interpellation, j’avais pris une douzaine de schellings dans ma main; le ton poli qu’il employa pour me répondre fit que j’en laissai retomber trois ou quatre dans mon gousset. Ce son argentin flattait une oreille habituée à l’entendre, et notre homme était loin de se douter de mon calcul économique; le pauvre diable n’imaginait pas ce que lui coûtait sa politesse. Plus ses attentions augmentaient, plus la part que je lui destinais diminuait; je ne sais pas ce qu’elle serait devenue s’il ne se fût empressé de me remettre mon passeport visé. Je lui glissai quatre schellings dans la main; il les serra dans sa poche sans les compter, et me reconduisit jusqu’à la porte de son bureau. Quant à mon compagnon, qui, se trouvant en règle, n’avait pas besoin de racheter sa négligence, le chef le traita avec la justice la plus scrupuleuse. L’heure du visa étant passée, il le remit assez sèchement au lendemain. D’après ce qui m’était arrivé, mon compatriote se décida à ne retourner à l’Alien–Office qu’au bout de trois semaines.»
» Il devait partir pour l’Écosse dès que les affaires qui réclamaient sa présence à Londres seraient terminées. Un chef de bureau du ministère des affaires étrangères était chargé de lui remettre pour Edimbourg des lettres de recommandation qu’il voulut aller prendre. Je sollicitai de mon compatriote la faveur de le suivre. J’étais impatient de voir ces hommes fameux, ce ministère étonnant qui, du fond de ses bureaux, organise la paix ou la guerre, gouverne l’Europe, divise les peuples, soumet les rois et dont la vaste politique exploite à son bénéfice l’or, la gloire et l’industrie des deux mondes.
» Nous demandâmes à un Anglais que nous rencontrâmes en sortant de l’Alien-Office, où était situé l’hôtel du ministère. Nous en étions à deux pas, et, au détour de la rue, nous trouvâmes Downing–Street. Au bout d’une rue courte et étroite, assez semblable à un cul-de-sac, est un bâtiment carré, d’une assez médiocre dimension, formé par la réunion de quatre à cinq petites maisons bourgeoises que l’on a baptisées du nom d’hôtels. Cette collection de maisons réunit tous les ministères de la Grande-Bretagne. Celui des affaires étrangères, où nous entrâmes, ne se distingue des autres que par une porte avec une espèce de perron composé de trois marches. Un vestibule obscur sert de salle à deux ou trois garçons de bureau, occupés à cacheter des lettres ou à classer des paquets.
» Sur la porte était un homme en habit bleu, causant avec un bourgeois d’un certain âge, vêtu de noir. Je m’avançai, et demandai à ce dernier où était le bureau de la personne à laquelle nous avions affaire. Le bourgeois de Londres, trop préoccupé pour me répondre, se contenta de nous indiquer du doigt un garçon de bureau qui, sur ce geste, s’empressa de venir au devant de nous. Il nous fit traverser un corridor obscur pour arriver à une petite chambre, ou il nous laissa avec un monsieur qui, nous montrant la seule chaise et le tabouret qui se trouvaient dans cette pièce, nous invita à nous asseoir en attendant qu’il eût terminé une petite affaire très-pressée qu’on venait de lui remettre à l’instant même.
Cette petite affaire était la cession de Parga, arrêtée en conseil par une note en marge du rapport du général Maitland. Tout en causant avec nous, le chef de bureau expédia l’exil de trente mille familles. Huit ou dix lignes, conçues et rédigées en moins d’un quart-d’heure, suffirent pour décider le sort d’un pays entier, et porter le désespoir dans l’ame de ceux qui l’habitaient. «Que de malédictions s’accumulent sur ma tête! murmura tout bas le chef de bureau en passant le blotting-paper (papier brouillard) sur le paraphe qui venait de clore sa décision; mais si les hommes d’État s’arrêtaient à de pareilles niaise«ries, ils reculeraient devant le plus léger obstacle...» Je fis compliment de la candeur et de la rapidité de la politique du cabinet de Saint-James à M. Camley. «Oui, me dit-il, nous expédions promptement les affaires chez nous; si nous nous apitoyions sur le sort de quelques milliers d’hommes, nous n’en finirions pas. L’intérêt des individus disparaît devant l’intérêt général; le sacrifice d’une population n’est rien quand il s’agit d’augmenter la puissance et la richesse d’un royaume. C’est pour cela que tout se décide chez nous avec promptitude et que jamais on ne s’écarte d’un principe adopté. Rien n’est ailleurs moins compliqué que ce que vous voyez ici. Quatre ou cinq bureaux composent le ministère des affaires étrangères, et l’on parle à notre ministre plus aisément qu’en France on ne parle aux com-mis. On est en quelque sorte obligé à cette simplicité dans un pays où le prince ne sort jamais qu’en voiture à deux chevaux, avec un seul domestique; elle exerce son influence sur toutes les classes de la nation, depuis Carlton-House jusque dans le bureau du plus mince banquier de la cité. Vous êtes dans le pays de la conséquence; vous trouverez souvent ici de la bizarrerie, jamais de contre-sens.
Je suis allé en France, nous dit M. Camley, et j’ai vu que, dans ce pays, on sacrifie beaucoup aux apparences ainsi qu’à l’ostentation. Vos ministres ont des hôtels, des suisses, des postes d’honneur, etc.; vos commis sont installés dans de vastes salons..; le nombre des employés est immense. La bureaucratie est une puissance en France: c’est le ver rongeur du budget; elle finira par ruiner l’État en frais de bureaux.» Tout en parlant ainsi, M. Camley venait de remettre au garçon le petit paquet qui renfermait l’arrêt des Parganiotes. Comme il devait dîner avec nous, nous sortîmes ensemble. Nous traversâmes, en moins de deux minutes, tous les bureaux des affaires étrangères. Les deux personnes que nous avions rencontrées sur le perron y étaient encore. Je demandai à M. Camley le nom du bourgeois de Londres qui chiffonnait entre ses doigts un bout de lettre.... «C’est, me dit-il, lord Castlereagh qui s’entretient avec M. Hamilton, le sous-secrétaire d’État. On dirait, à l’expression de leur physionomie, qu’il s’agit du bal donné par lord Fife avant-hier, ou de la soirée de lady Gersay; eh bien! il ne s’agit de rien moins que de l’indépendance du Nouveau-Monde. De cette seule conversation va résulter le départ de la flotte qui est en rade de Portsmouth, et que, depuis quelques années, on promet au roi d’Espagne de mettre à sa disposition. Sa grâce, lord Castlereagh cause là, dans la rue, parce que les ouvriers travaillent à réparer une cheminée dans le cabinet du ministre; et si la pluie, qui commence à tomber, ne les dérange pas, le sort du Nouveau–Monde pourrait bien être décidé sur le perron de l’hôtel.» » Je ne pouvais en croire mes yeux.... Le premier ministre de l’Angleterre, traitant les affaires de l’Europe dans la rue comme un courtier marron, était pour moi une chose miraculeuse. Nous sommes tellement habitués au luxe, nous autres Français, que nous ne pouvons pas penser qu’il existe un ministre sans habit brodé, un chef de bureau sans portefeuille de maroquin rouge.
» Dans un coin de la cour, un jokey monté tenait en bride un joli cheval simplement harnaché; le noble lord y monta lestement, et d’un air distrait, appuyé de la main droite sur la croupière, il continua quelques instans sa conversation avec M. Hamilton. Dans le moment arriva, à cheval, suivi d’un seul domestique, un gentlemen de bonne mine qui aborda cavalièrement lord Castlereagh; M. Camley nous apprit que c’était lord Bathurst, le secrétaire d’Etat de la guerre et des colonies. Leurs seigneuries s’entretinrent ensemble en caressant nonchalamment le museau de leur cheval avec le bout de leurs cravaches. Elles sortirent ensuite de Downing-Street, à côté l’une de l’autre. Elles se dirigèrent vers le parc Saint-James, décidant au trot, du destin de quelque rajah ou nabab de l’Inde. Peut-être qu’avant d’être arrivés au bout de la grande allée du parc, l’Angleterre avait, d’après les projets de ses ministres, ajouté à ses possessions asiatiques un ou deux royaumes.
» J’étais émerveillé de voir de si petits rouages faire mouvoir une si grande machine. Cette habitude de traiter si lestement les nations, et de conclure, chemin faisant, un marché de peuples, me parut le nec plus ultrà de la diplomatie européenne. Nous mettons plus de tems chez nous à examiner des affaires moins importantes; et, comme dit Beaumarchais, nos premiers commis s’enferment souvent des heures entières pour tailler des plumes. Je doute que nous adoptions jamais l’usage de discuter le sort des empires, au pied levé, dans une promenade ou dans une partie de cheval.
» Nous étions restés seuls sur la petite place de Downing-Street; mon compatriote avait affaire dans les bureaux de la chancellerie et M. Camley offrit de nous y conduire. Nous frappâmes trois coups à une petite porte en face de la maison des affaires étrangères. Une jeune bonne anglaise vint nous ouvrir. Nous traversâmes une salle à manger, dans laquelle on venait de dresser une table de quatre couverts, et nous arrivâmes dans une chambre où travaillaient trois commis. Nous étions chez le lord-chancelier. Il aurait fallu six mois en France pour mettre en règle des papiers qu’à la première vue le commis auquel nous nous adressâmes classa par ordre de matières. Il nous annonça que la créance de M..... (notre compagnon) était juste; et il se disposait à la mettre sous les yeux du chancelier, lorsque lord Eldon sortit de son cabinet. Le commis lui remit la liasse de papiers. Sa grâce les examina avec plus d’attention encore que son secrétaire; elle prit une mauvaise plume, et, après l’avoir essayée deux fois, elle signa, sur le coin du bureau, un ordre de paiement qui avait déjà coûté plus d’un an de démarches et de sollicitations. Nous prîmes congé de sa grâce, à qui la bonne vint annoncer qu’on avait servi.
» Eh quoi! dis-je à M. Camley, qui souriait de mon étonnement, voilà tout votre ministère.... Dans un coin de rue, où ne voudrait pas se loger le moins riche de nos banquiers de Paris, sont réunis les hôtels de vos ministres!.... Chacun d’eux emploie moins de commis que la plupart de nos maisons de commerce!… Et c’est dans ce petit carré de quelques toises que l’Angleterre a renfermé tous ses ateliers politiques; c’est là que se sont organisées ces coalitions qui ont bouleversé l’Europe; c’est de là que sont parties toutes ces combinaisons qui ont changé la face du monde; c’est là que se décident la chute des empires, la vie des nations, l’achat des conquêtes; et c’est contre ce petit tas de maisons réunies qu’est venue échouer la puissance du plus grand despote de l’univers!.... «Ne vous y trompez pas, me dit M. Camley, la force du levier d’Archimède est dans sa simplicité, et vous êtes dans le pays de Newton, qui ne demandait qu’un point d’appui pour remuer le monde.»