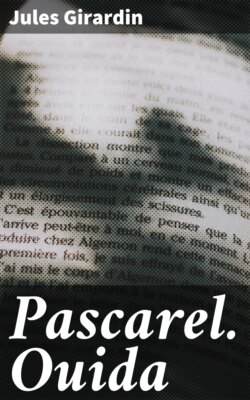Читать книгу Pascarel. Ouida - Jules Girardin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
UNE SOMBRE HISTOIRE.
ОглавлениеTable des matières
Je ne fréquentais plus les peintres, depuis que mon père me l’avait défendu; et, comme il n’envoyait plus d’argent, je ne suivais plus aucun cours, excepté celui d’Ambrogio Rufi.
Comme il faisait froid chez lui!
Le toit était couvert d’une neige épaisse; la bise des montagnes soufflait dans le pauvre réduit. Le vieux maître était si pauvre qu’il ne pouvait se donner le luxe d’un poêle; la brique du plancher était froide comme de la glace sous nos pieds. Je ne pouvais m’empêcher de frissonner en chantant.
Et cependant, lorsque je repense aux douces mélodies du violon au milieu du silence de l’hiver; quand je revois les yeux rêveurs de Raffaelino, ces yeux humides qui exprimaient si bien ce mélange de tristesse et de bonheur que cause la musique à ses vrais fidèles; quand je me représente le vieil Ambrogio entouré de son demi-cercle d’élèves, et ce petit rouge-gorge qui venait sur la gouttière picorer les miettes que le maëstro avait mises en réserve pour lui, et qui mêlait ses chants aux nôtres, il me semble que ces heures-là étaient véritablement heureuses.
«Si seulement, lorsque nous sommes heureux, nous savions que nous le sommes!» a dit mélancoliquement un poëte.
On pourrait tout aussi bien dire:
«Ah! si nous pouvions conserver la goutte de rosée avec nos diamants! si nous pouvions fixer l’arc-en-ciel à la voûte des cieux!»
C’est pendant ce temps de privations et de misère qu’il me fut donné de jeter un coup d’œil sur la vie passée du vieux maëstro.
Pour les gens de Vérone, qu’est-ce qu’était Ambrogio Rufi?
Un vieux bonhomme maigre, qui se traînait péniblement, matin et soir, à son théâtre; qui marchandait au marché pour une poignée de charbon et un morceau de fromage de chèvre; qui portait ses habits jusqu’au jour où ils tombaient en loques; qui n’aimait pas les fausses notes et qui n’était chiche ni d’amères réprimandes, ni de bons coups d’archet, quand on ne chantait pas à sa guise.
Moi, j’avais toujours pensé ou imaginé (c’est tout un chez un enfant) qu’il y avait chez Ambrogio quelque chose de plus triste, de plus noble que ce que l’on connaissait de lui.
C’était peut-être parce qu’il me préférait aux autres, ou du moins parce que ma voix lui plaisait davantage, car, pour lui, toute créature humaine se résumait en une voix.
Quoi qu’il en soit, en présence de moi seule, il laissait parfois échapper des mots qui me paraissaient au-dessus de tout ce que j’entendais dire ailleurs. Mariuccia était intraitable sur ce sujet; elle était un peu jalouse du respect que j’avais pour lui.
Un soir, assez tard, je m’avisai, contrairement à mes habitudes, d’aller voir mon vieux maître.
J’étais excédée de ma triste condition; j’étais mal à mon aise, impatiente; je désirais je ne saurais trop dire quoi.
C’était une soirée où l’on ne jouait pas à son théâtre. Il était seul, examinant quelques vieilles partitions à la lueur de sa misérable lampe, devant son foyer sans feu.
Quand j’ouvris la porte, il leva les yeux. Je crois qu’il était content de me voir, bien qu’il n’en fit rien paraître.
«Vous ne devriez pas être dehors à pareille heure!»
C’est ainsi qu’il me souhaita la bienvenue.
Je lui dis que l’ Ave Maria venait seulement de sonner, et je le priai de m’expliquer quelque chose que je n’avais pas bien compris à la dernière leçon. Il m’expliqua ce que je lui demandais et moi je l’écoutais avec une patience qui n’était guère dans mon caractère. Impatiente en effet pour tout le reste, j’avais de la patience quand il s’agissait de musique. Quand il eut fini, je n’avais plus de prétexte pour rester, et cependant je restai. J’appuyai mes coudes sur la vieille table nue; je mis ma tête dans mes mains, et je regardai la mèche rougeâtre et sombre de sa lampe.
«Parlez-moi un peu, maëstro!» lui dis-je à brûle-pourpoint.
Il ôta doucement ses lunettes et se mit à me regarder avec stupéfaction.
«Parler!» répéta-t-il comme un écho.
Jamais on ne lui demandait de parler; ce qu’il avait à dire, il l’expliquait sur son violon.
«Oui, parlez, repris-je avec l’insistance d’un enfant gâté, car la pauvre Mariuccia m’avait déplorablement gâtée, malgré ses prétentions à la sévérité. Vous avez certainement vu le monde dans votre vie. Dites-moi quelque chose sur le monde.
–Le monde!
–Oui, le monde. A quoi cela ressemble-t-il?
–Entrez dans un couvent plutôt que de l’apprendre, dit-il avec une amère brusquerie.
–Le monde est-il donc si mauvais?
–Mauvais... Bon... Des phrases. Les fous seuls s’en servent. Le monde est comme la cage aux singes du Jardin zoologique. Les noix sont pour le plus leste et le plus malin, voilà tout. On ne dit pas pour cela que les singes sont méchants.»
Une cage à singes, c’était une assez triste perspective pour moi qui ne rêvais que d’entrer dans le monde.
«Expliquez-vous un peu mieux, lui dis-je. Vous devez certainement avoir vu beaucoup le monde, quand vous étiez jeune.
–Non, me répondit-il, je ne l’ai jamais beaucoup vu. Celui qui est pauvre ne voit le monde que par la lucarne de son grenier. Il voit le ciel, le soleil, la lune, les nuages changeants, mieux que personne; mais c’est tout ce qu’il voit.
–Cependant il peut sortir.
–Le peut-il? Les souliers coûtent cher; c’était bon de marcher nu-pieds dans le sable du désert, aux anciens jours des saints; cela ne se fait plus sur les cailloux de la grande route royale.»
Je ne pus m’empêcher de songer combien cela était vrai en jetant un coup d’œil sur mes souliers délabrés. Ce monde, dans lequel j’étais si pressée d’entrer une minute auparavant, m’inspirait un effroi qui me glaçait; je repris cependant:
«Vous en savez toujours plus que moi sur le monde. Dites-moi quelque chose: racontez-moi quelque histoire de votre passé.»
Ses yeux s’attristèrent quand il reprit:
«Enfant, il ne faut jamais ouvrir les tombes des morts.»
Sa voix était brève et sèche, et il frissonnait.
«Je vous dirai que j’ai toujours été pauvre. Quand on est pauvre, on s’avancé à tâtons dans la vie; on se heurte et l’on se blesse à chaque angle.
–Mais vous aviez du génie?»
Il haussa les épaules.
Quelle tristesse désespérée dans ce geste de résignation!
Malgré mon égoïsme et ma légèreté, j’en fus profondément touchée.
«J’ai été bien malheureux, dit-il avec simplicité. Oui, vous avez raison, j’avais certainement du génie.
–Alors, repris-je, pourquoi votre nom n’est-il pas illustre?»
Il sourit avec tristesse.
«Pourquoi? Eh bien, j’aimais l’art et non le monde, et je puis dire que j’étais honnête. Il y a eu un moment, lorsque j’étais jeune, où j’ai rêvé de devenir, comme vous dites, illustre. A vingt-cinq ans, j’étais, ma foi oui! j’étais heureux. Il est vrai que j’étais pauvre; en hiver, je gardais le lit, pour ne pas mourir de froid, et, en été, j’aurais été heureux de disputer les glands aux pourceaux. Mais j’étais heureux. J’avais mon art et aussi un ami que j’aimais plus qu’un frère. C’était un Allemand, Karl Rothwald; nous étudiions ensemble la musique à Milan. Il n’avait pas un vrai talent, mais seulement du goût et de la grâce. Moi... eh bien! Oui, j’avais du génie, que Dieu me protège! et l’étude la plus acharnée ne pouvait me fatiguer.
«A vingt-six ans, j’eus assez de confiance en mes propres forces pour composer mon premier grand ouvrage; j’avais choisi pour sujet Alceste. J’y travaillai assidûment pendant deux années. Ce furent les deux années les plus heureuses de ma vie. Rothwald et moi, nous habitions la même chambre; le matin et le soir, nous faisions de longues promenades; ensuite, nous veillions la moitié de la nuit; tout le temps, je méditais mon Alceste, et je donnais une forme musicale aux créations qui hantaient mon esprit; je faisais appel à sa sympathie, et je l’invitais à se réjouir avec moi toutes les fois que mon oreille et mon esprit étaient satisfaits.
«Jamais il ne se montrait fatigué; jamais il ne manquait de se réjouir avec moi. Bien des fois, quand nous errions à travers les champs de millet, au soleil levant, ou quand nous étions dans notre galetas, pendant les longues nuits sans lune, lorsque la puissance musicale qui était en moi se faisait jour au dehors et me remplissait d’une triomphante énergie, lui... mon ami... riait et pleurait comme un enfant; il se jetait dans mes bras, se récriait sur la beauté de ma musique, et me prédisait que je prendrais place à côté de Bach, de Gluck et de Palestrina.
«Mon opéra était à peine terminé, que Rothwald fut rappelé d’auprès de moi; quelqu’un de sa famille, je crois, était malade. Je le suppliai de revenir promptement, et je lui donnai ma parole de ne pas présenter mon opéra à la direction de la Scala avant son retour. «La moitié de la joie du triomphe serait perdue pour moi, si vous n’étiez pas là pour en prendre votre part!» voilà ce que je lui dis au moment des adieux. Nous étions alors en automne.
«Je trouvais le temps long, car j’aurais désiré voir mon Alceste à la scène l’hiver suivant. Mais je ne songeai pas un seul instant à manquer à ma parole.
«Le commencement de l’hiver est dur à Milan; il fut particulièrement dur pour moi; mais je recevais de lui des lettres si affectueuses que j’en oubliais mes soucis et mes souffrances. Je m’absorbais dans le travail, et je perfectionnais jusque dans le moindre détail l’œuvre sur laquelle était fondé mon avenir. Personne n’en avait encore entendu une note; mais, à la Scala, on me connaissait et on m’estimait, et j’étais sûr que mon œuvre serait acceptée. J’avais pour moi le chef d’orchestre, qui m’aimait à cause de mon talent de violoniste.
«Un jour que je grelottais dans mon grenier, il vint me voir et me dit: «Ambrogio, vous avez du génie; vous ne pouvez donc demeurer sous ma direction toute votre vie. Je sais que vous avez composé quelque chose. C’est vrai, n’est-ce pas? Laissez-moi voir votre partition; cela doit être quelque chose de grand; vous êtes sans égal pour le contre-point.» Il insista si longtemps et avec tant de bonté, que je lui donnai mon œuvre à emporter, pour qu’il en prît connaissance. «Alceste? Alceste? me dit-il quand il vit le titre. Est-ce là votre sujet? C’est fâcheux. Cette semaine, on a représenté sur le théâtre de Vienne un opéra sur le même sujet.»
«Je fus vivement contrarié d’avoir été devancé, et je lui demandai le nom de l’auteur de cet autre Alceste. «Ou je l’ai oublié, ou on ne me l’a pas dit, me répondit-il. Mais ce que vous avez de mieux à faire, c’est d’aller à Vienne et de juger par vous-même. Si c’est une pauvreté et si le public ne goûte pas cet opéra, alors nous pourrons jouer le vôtre; sinon, il faudra adapter votre musique à un autro libretto. Donc, partez pour Vienne. Non, non, ne soyez pas si fier. Permettez-moi de vous avancer l’argent du voyage. Vous me payerez quand la Scala montera votre opéra. Pas de si ni de mais; il faut partir. Il faut absolument que vous jugiez vous-même du mérite de votre rival.»
«Quand j’arrivai à Vienne, c’était le soir; mais la ville étincelait de lumières; elle était aussi gaie qu’en plein jour. Sans prendre une minute de repos, je me rendis au théâtre où l’on jouait Alceste. La salle retentissait d’un tonnerre d’aplaudissements. Quand les cris cessèrent, la musique recommença. C’était la mienne. Phrase après phrase, chœur après chœur, solo, septuor, récitatif, j’écoutais tout cela comme un homme privé de sa raison par un coup violent. Tout était de moi. Le rideau tomba; le public enthousiasmé se mit à crier: «Rothwald! Rothwald!»
«Alors je compris tout. Je tombai comme une pierre, à ce que l’on m’a dit, et l’on me releva comme mort. Il m’avait tout volé. Il avait copié en secret toute la partition. Son nom est devenu illustre; vous avez pu l’entendre citer. Il n’a jamais rien fait de grand depuis; le monde s’en étonne; mais il a trouvé moyen d’étendre sur toute sa vie l’éclat de son premier triomphe et de s’en servir pour couvrir toutes ses défaillances.
«Il est difficile de se faire un nom; mais une fois qu’on en a un, rien de plus facile que de vivre dessus. Quant à moi, j’étais mort. Mon cœur, mon cerveau, mon génie, tout fut tué d’un seul coup. Il n’y a plus que mon corps qui ait continué à se traîner à travers la vie. Je ne l’ai jamais dénoncé, non, car je l’avais aimé. D’ailleurs, quand je l’aurais dénoncé, quelle preuve aurais-je pu fournir! Je n’aurais trouvé personne pour me croire.»
Comme il prononçait ces dernières paroles, sa tête se pencha sur sa poitrine, ses yeux se couvrirent d’un nuage, et il repensa sans doute aux longues et douloureuses années pendant lesquelles il avait gardé le silence, isolé au milieu des autres hommes.
En vain je m’agenouillai devant lui; en vain je caressai ses mains flétries; en vain je lui parlai pour lui demander pardon d’avoir réveillé de si cruels souvenirs.
Il ne me répondit pas un mot; seulement il regardait fixement la lampe sans la voir, et il murmurait des fragments de mélodies, de son Alceste sans doute. Le lendemain, il eut l’air d’avoir tout oublié, et jamais, depuis, ni lui ni moi nous ne fîmes allusion à la confidence qu’il m’avait faite.
Mais, depuis ce jour-là, il fut sacré pour moi; volontiers, je me serais agenouillée devant lui, et j’aurais baisé par affection, par respect, par pitié, ses pauvres mains flétries. Ce fut pour moi un héros et un martyr, et, tant qu’il vécut, je ne communiquai son secret à personne, pas même à Raffaelino,