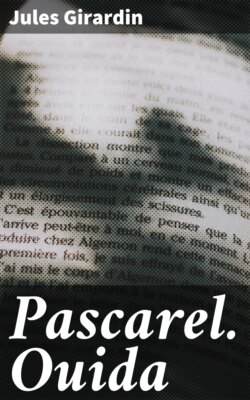Читать книгу Pascarel. Ouida - Jules Girardin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
LES PLUMES DE PAON.
ОглавлениеTable des matières
Nous n’étions jamais si heureux que quand nous étions seuls avec Mariuccia. Nous étions des enfants forts et bien portants; le soleil nous enveloppait de sa brillante lumière, et l’avenir était pour nous plein de promesses. Mais c’était toute autre chose quand mon père venait en compagnie de Florio.
Sans nous rendre compte pourquoi, nous nous sentions gênés et mal à l’aise quand ils étaient là.
Les exclamations et les réflexions de Florio nous faisaient sentir notre misère, à laquelle nous n’aurions jamais songé sans lui.
«C’est terrible, disait-il un jour, en accommodant deux petites alouettes et des champignons, avec tant d’art qu’on eût pris les alouettes pour des ortolans et les champignons pour des mousserons; cela va de mal en pis, vous savez, d’année en année. Il gagne moins souvent et boit plus de brandy quand il perd. C’est toujours de la sorte que cela se passe. C’est toute une affaire de vivre, et Dieu sait quelle vie nous menons; la moitié des villes nous sont interdites. Des dettes, des dettes, et encore des dettes! Aussi, comme on vous ferme la porte au nez! Presque nulle part maintenant on n’a confiance en lui. Cela finira comme cela, un de ces jours.»
En disant: «comme cela», il imita le geste de quelqu’un qui se coupe la gorge.
Mariuccia secoua la tête.
«Finir comme cela?... finir?… répéta-t-elle. Eh! dites-moi, Florio, qu’est-ce qui attend ces enfants, dans ce cas-là? C’est bien commode de dire: «Cela finira», comme s’il n’était question que de lui seul dans toute cette affaire. Quatre enfants, et pas un liard, excepté les billets qu’il me laisse en allant et venant; cela ne va pas loin; il y a à peine de quoi engraisser une oie pour le jour de la Saint-Jean. Et je suis seule pour nourrir quatre grands enfants affamés depuis un carême jusqu’à l’autre.»
Ces propos, recueillis par bribes, nous donnaient l’idée vague qu’un grand malheur nous menaçait. Quant à moi, malgré l’enthousiasme que je ressentais pour mon père, je finis par comprendre qu’il ne venait à nous que quand il lui était absolument impossible de vivre ailleurs.
Dans l’univers entier, il nous eût été impossible de trouver, pour protéger nos têtes, un asile qui fût à meilleur marché que le vieux palais nu et sordide.
Quand mon père y venait chercher un refuge temporaire, la fidélité de ses deux serviteurs arrivait encore à l’entourer d’une espèce de cérémonial et de comfort. Comment ils s’y prenaient, je n’en sais rien, et je n’ai jamais pu le deviner.
Un homme comme mon père ne pouvait vivre sans compagnons. La noblesse et les gens bien élevés du pays ne le fréquentaient pas; mais souvent, le soir, on voyait dans notre sombre escalier les uniformes blancs des Autrichiens. Ils passaient la nuit dans sa chambre et ne sortaient qu’au point du jour. Toute la nuit, Florio allait et venait avec des bouteilles de chartreuse et d’eau-de-vie.
Je connaissais ces Autrichiens qui m’avaient fait valser cent fois au son de leur musique militaire; mais, comme je devenais grande, mon père défendit à Mariuccia de me laisser errer dans les escaliers à ses heures de réception.
Mariuccia me tenait emprisonnée auprès d’elle sous la lampe; ou bien je faisais de la dentelle, ce qui me déplaisait horriblement; ou bien je déchiffrais des partitions d’Ambrogio Rufi, ce que j’aimais beaucoup.
Voilà encore un des plaisirs auxquels je dus renoncer à cette époque.
Le printemps était charmant en Lombardie, presque aussi charmant que sous les orangers de Sorrente. Partout les crocus sortis de terre par millions donnaient aux prairies des teintes blanches et orangées. Ils étaient suivis de près par les violettes, qui formaient de grandes plaques dans l’herbe, sous les vignes.
L’érable et le mûrier déployaient leurs petites feuilles délicates, même dans la sombre Vérone; il y avait de jolies taches de couleurs à l’endroit où les asphodèles jaunes et les œillets fleurissaient sur le rebord des fenêtres et sur les balcons.
Dans la direction du nord, on apercevait les Alpes, pareilles à un nuage d’argent. Les étudiants s’y rendaient et en revenaient, ayant encore la fraîcheur du vent dans les cheveux, et dans les mains une profusion de gentianes bleues. Au printemps, même notre plate campagne de Lombardie, qui n’avait pas la beauté de la montagne ni celle de la vallée, ne manquait pas d’un certain charme, dû à la grâce des branches de vigne bourgeonnantes et des rameaux délicats des acacias.
Nous passions nos journées aux champs, mes frères, Raffaelino et moi, jouant jusqu’à en être fatigués, nous étendant sur l’herbe pour nous reposer et contemplant le ciel bleu qui était comme une mer sans bornes.
Un jour que je rentrais avec une brassée de violettes, je grimpai à l’atelier d’un de mes amis. Il aimait beaucoup les fleurs; il en introduisait dans toutes ses esquisses; j’avais coutume de partager avec lui mon butin.
C’était un grand gaillard brun, la meilleure créature du monde; il était fils de paysans et s’appelait Cecco. Les camarades l’appelaient il Squarcionino, comme qui dirait le petit Squarcione, en souvenir de cet ancien maître de Padoue qui, le premier parmi les maîtres primitifs, imagina de composer des arabesques avec des fruits et des fleurs.
Je grimpai donc l’escalier de Cecco, et j’entrai dans son atelier, qui était plus vaste qu’une grange, mais pas moitié aussi propre. Cecco n’était pas seul: il avait avec lui trois ou quatre camarades qui fumaient, riaient et bavardaient tout en travaillant. Comme son atelier recevait une belle lumière, ses camarades moins favorisés apportaient leurs chevalets chez lui, et ils travaillaient ainsi en commun.
Ils m’accueillirent avec enthousiasme, se mirent à genoux devant moi et mes violettes, et abandonnèrent le travail commencé pour faire une esquisse d’après moi.
«Restez comme vous êtes, signorina! me crièrent-ils. Non, ne changez rien; c’est parfait. Mais regardez-la donc avec la lumière dans ses cheveux ébouriffés, ce jupon de couleur gaie tout rempli de violettes, et ses joues roses et animées par le souffle du vent! Ah! Bellina, Bellina!»
J’étais si habituée à leurs compliments, que je ne les entendais même plus. Je le savais bien que j’étais belle; mais quand on me le disait, je haussais les épaules, et je n’y pensais plus, sinon pour prendre en pitié ceux qui n’étaient pas aussi bien doués que moi.
On me mit sur la plate-forme aux modèles; les quatre chevalets furent disposés aux quatre coins de l’atelier, et les quatre peintres commencèrent leurs esquisses.
Au bout de deux heures, ils mirent leurs brosses de côté.
«J’en ai fait le Génie du Printemps, dit Bernardino Scalchi, en regardant son œuvre, la tête de côté comme un rouge-gorge.
–Moi, j’en ai fait la Primavera della vita, la Gioventu dell’anno, dit Beppo Lavo, qui faisait de jolis vers et qui les chantait agréablement.
–Eh bien! moi, j’en ai fait la Renaissance de l’Italie, le type de l’aurore de la liberté, le symbole de l’avenir,» reprit Neri Castagno, qui était patriote et républicain rouge.
Ce vieux maladroit de Cecco se mit à rire, en se tournant vers eux:
«Je suis bien prosaïque auprès de vous. J’en ai fait tout simplement ce qu’elle est, une enfant.»
Comparaison faite des esquisses, il fut décidé d’une voix unanime que c’était lui qui avait le mieux réussi; son esquisse sans prétention était celle où il y avait le plus de poésie.
On me fit descendre de la plate-forme, on mit les violettes dans un vase, et on décida qu’il y aurait une fête en mon honneur. Justement, Cecco avait eu de la chance ce jour-là: il avait vendu un petit panneau à un amateur.
Il dégringola lestement les cent marches et revint triomphalement avec deux bouteilles de chiante, une casserole pleine de châtaignes fumantes, un gâteau aux amandes et un gros paquet de cigares.
Il me plaça dans un vieux fauteuil tendu de tapisseries fanées, jeta sur moi une magnifique robe de brocart, très-ancienne, que les juifs lui auraient achetée volontiers, rien que pour faire fondre l’or des fils; il me mit dans la main un sceptre de plumes de paon, et sur la tête une couronne de papier argenté dont il coiffait les modèles qui posaient pour la Madone; alors commença la petite fête.
Etions-nous heureux d’être ensemble! Quel bavardage et quels éclats de rire! Comme ce vin paraissait exquis! comme ces châtaignes fondaient sous la dent! De quel cœur nous criions: Fuori gli stranieri! (A la porte les étrangers!) Nous chantions tout ce qui nous passait par la tête, depuis les motifs de Rossini et de Bellini jusqu’au refrain de la dernière chanson des rues.
Au moment où nous étions le plus gais, le son d’une voix inconnue fit sauter brusquement Cecco du plancher où il était étendu tout de son long. Il commença par s’excuser de son mieux, alluma une lampe et souhaita la bienvenue à trois étrangers qui, ayant entrepris de faire le tour des ateliers, étaient arrivés au sien.
Moi, toujours assise sur mon trône, avec ma robe de brocart, ma couronne de Madone sur mes cheveux épars, mon plat de châtaignes sur les genoux, je cessai de chanter et je me mis à regarder.
Deux des étrangers étaient des Autrichiens; le troisième était mon père.
Toute tremblante, je me glissai à bas du fauteuil, et je me tins devant lui comme une petite coupable; les plis du brocart s’étaient enroulés à mes pieds comme autant de serpents aux mille couleurs.
Au fond, j’avais la conscience de n’avoir rien fait de mal; mais mon père était pour moi un mystère si effrayant et si attrayant, que j’étais épouvantée de me trouver brusquement en face de lui.
C’était la première fois de ma vie que je le rencontrais en dehors de notre maison.
Il me reconnut tout de suite, mais il n’en laissa rien paraître. Un des Autrichiens me regarda à la lumière de la lampe et à la lueur du soleil couchant
«Charmante figure, s’écria-t-il, bizarre, mais charmante. Un modèle naturellement avec ce clinquant et ce brocart.»
J’aurais voulu être à cent pieds sous terre, lorsque mon père fit semblant de me remarquer pour la première fois et dit d’un ton froid:
«Jolie petite mendiante.»
Je lus dans sa pensée; il était bien décidé à ne pas me reconnaître.
Mes joues se couvrirent d’une rougeur brûlante; j’oubliai à l’instant la crainte qu’il m’inspirait.
J’arrachai ma couronne de papier d’argent; je repoussai loin de moi les plis du brocart, et je laissai traîner sur les briques du plancher mon pauvre sceptre de plumes de paon.
«Si je suis une mendiante, lui dis-je hardiment, ce n’est pas ma faute ni celle de Mariuccia.»
Mes paroles me causaient une horrible sensation; il me semblait que j’étais en train de commettre un crime, et j’étais profondément humiliée.
«Nous souffrons souvent de la faim et du froid, nous tous. On n’ose pas vous le dire; mais c’est la vérité. Et si j’oublie tout cela, en riant un peu ici, où est le mal? Je n’en rougis pas.»
Son visage si froid et si impassible changea de couleur; était-ce sous l’action de la colère? était-ce sous l’action d’un sentiment plus tendre? Je ne saurais le dire. Il m’attira sur le palier et me dit:
«Quoi qu’il en soit de tout cela, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous permettre de semblables déclamations?»
Je me précipitai dans la rue pour aller conter mes griefs à Mariuccia. Tout en courant, je sanglotais, et mes pauvres plumes de paon balayaient la boue et la poussière.
Je sentais profondément l’outrage que je venais de recevoir, et en même temps mon cœur brûlait d’une méprisante indignation. Mon père n’avait pas honte de me faire mourir de faim; mais il avait honte de me reconnaître, parce qu’il me trouvait dans un grenier, occupée à rire et à chanter, couronnée d’un diadème de papier, ayant devant moi un verre de vin à bon marché et une poignée de châtaignes! Non, certes, je n’avais rien fait de mal, et cependant quelque chose comme une vague intuition me disait que je serais jugée plus tard par le monde comme je venais de l’être par mon père.
Mariuccia me consola de son mieux avec sa tendresse habituelle. Ensuite, elle essuya les plumes de paon et les plaça au-dessus du poêle, à côté de la feuille de palmier du dimanche des Rameaux.
Le soir, elle m’apprit d’un air triste que mon père m’interdisait de fréquenter les ateliers. Je me révoltai intérieurement; je pleurai, et, à partir de ce jour, je cessai d’être franche avec mon père.
Je ne pouvais jeter les yeux sur le sceptre de plumes de paon sans me dire:
«Si tu avais été d’ivoire et d’or, il n’aurait pas eu assez de louanges pour toi.»
En conséquence, je m’épris d’une sorte de passion pour mon sceptre, justement parce qu’on l’avait méprisé; j’en vins à mépriser mon père, d’un mépris raisonné, qui tua en moi l’affection que j’avais eue pour lui.