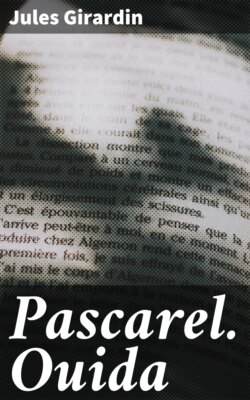Читать книгу Pascarel. Ouida - Jules Girardin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
LA PETITE BOÎTE ROUGE.
ОглавлениеTable des matières
L’hiver était rude, cette année-là, par toute l’Italie, mais particulièrement à Vérone. C’était une terrible épreuve pour Mariuccia et pour moi; nous n’avions pas un sou.
Il y avait plus d’un an que nous n’avions rien reçu de mon père, et la dernière lettre de Florio avait six mois de date. Mariuccia gagnait quelque chose à filer; mais c’était bien peu de chose, juste de quoi ne pas mourir de faim.
Elle continuait à me tailler des vêtements dans la garde-robe de ma mère; mais les étoffes en étaient si riches et si éclatantes que j’avais toujours l’air de sortir d’un bal masqué. Heureusement qu’en Italie ces choses-là se remarquent moins que partout ailleurs.
J’avais quinze ans; j’étais donc en âge de comprendre combien il est terrible d’être sans amis et sans argent en ce monde. Quelle triste chose d’être là à croiser et à nouer sans fin ni trêve les fils de ma dentelle, sans pouvoir débrouiller un seul des fils de ma destinée. Si seulement je pouvais quitter Vérone! Il me semble que, une fois hors de ses portes, les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes.
Les fêtes de Noël arrivèrent, et les cloches se mirent à sonner du matin au soir; les gens du peuple étaient en liesse; ils buvaient, ils mangeaient, ils échangeaient des confetti et des vœux de prospérité.
Pendant ce temps-là, Mariuccia et moi nous étions sans bois, sans pain, absolument isolées.
Nous allâmes à la messe de minuit, A nous voir proprement et soigneusement vêtues, qui aurait imaginé que nous mourions de faim?
Le jour suivant, nous n’eûmes rien à manger, et nous nous serions couchées sans souper, si la padrona n’eût grimpé notre escalier pour apporter un plat de macaroni et ne nous eût suppliées d’en prendre notre part, pour l’amour de Dieu.
La nouvelle année était déjà loin; il continuait à faire grand froid, mais la journée était belle. Le soleil brillait, les cloches sonnaient. Il y avait foule dans les rues; on entendait des pas pressés et des éclats de rire.
Le carnaval était commencé: c’était le premier jour du Corso di Gala.
Mariuccia et moi, nous nous regardions avec des yeux secs et désespérés. Elle alla à une grande armoire de noyer et prit dans un des tiroirs une petite boîte rouge; elle tira de la boîte quelques menus bijoux, des objets de corail et des mosaïques.
«C’était à votre mère, me dit-elle avec tendresse. Elle avait beaucoup de bijoux lorsque je suis entrée à son service. Après sa mort, votre père les a pris et vendus, j’en suis sûre, car je ne les ai jamais revus depuis. Il n’a épargné que ceux-là; c’est bien peu de chose; je les ai gardés pour vous. Je pensais que ce serait mal à vous de les vendre. Mais, maintenant, il faut vous en séparer ou mourir de faim. Vous êtes en âge de prendre une décision; parlez.»,
Pendant qu’elle me parlait, je tenais les bijoux dans ma main; il y avait des boucles d’oreilles, des médaillons et un bracelet, le tout en mosaïque.
Ma pauvre jeune mère! Je n’avais jamais ressenti tant de pitié pour elle; je ne m’étais jamais sentie si rapprochée d’elle.
Je me jetai en pleurant au cou de Mariuccia.
«Gardez-les aujourd’hui, murmurai-je à son oreille; seulement aujourd’hui, il m’est venu une idée. Je vais aller trouver Ambrogio.»
Le soleil brillait sur la terre durcie.
C’était le quatorzième jour de la nouvelle année, le premier du carnaval.
Le froid mettait tout le monde en mouvement; les gens se serraient contre des brasiers allumés et s’enveloppaient jusqu’aux yeux dans leurs grands manteaux; il était à peine midi, et déjà l’on voyait apparaître des masques eh brillant costume.
Les cloches sonnaient à toute volée; on entendait de la musique par échappées; je vis passer près de moi une bande de Tedeschi en costume tyrolien; ils étaient drapés dans des étoffes rouges et enveloppés de martre zibeline; leurs chevaux avaient de grandes housses et des clochettes; au moment où ils passaient au galop sous un balcon, une femme leur lança en souriant une véritable pluie de violettes et de roses de serre. Là-dessus, les postillons tyroliens exécutèrent une fanfare avec leurs trompes ornées de glands.
Comme c’était brillant et comme c’était gai!
La procession était à peine commencée, et déjà toute la ville était dehors en habits de fête et en humeur de fête aussi.
C’était un mélange des couleurs les plus vives, reliées entre elles par des demi-tons discrets, comme si une peinture habile eût présidé à la composition de ce tableau; sur cette masse de couleurs se détachait vivement soit la blancheur des coiffes de femmes, soit l’éclair des paillettes.
A chaque instant, la foule s’ouvrait pour donner passage à quelque bande de masques qui portaient sur leurs habits toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, avec un magicien vêtu de rouge qui les touchait de sa baguette.
Au milieu de ce fourmillement commencèrent à paraître les équipages des nobles, que l’on introduisait avec toute la pompe surannée de l’ancien carnaval.
Les enfants des nobles, vêtus comme leurs ancêtres, s’avançaient poudrés à blanc, parés de bijoux et portant l’épée au côté. Les balcons ornés de tentures et les profondes embrasures des fenêtres étaient remplis d’enfants aux yeux brillants, de femmes aux sourcils noirs et de vieillards en cheveux gris dont les traits pleins de noblesse auraient pu servir de modèle à Prospero ou à Bellincion Berti.
Je me précipitai dans les petites rues tortueuses qui conduisaient à la demeure d’Ambrogio. Il n’était pas chez lui; les gens de la maison me dirent qu’il était à son théâtre pour une répétition.
Je courus à la boutique du père de Raffaelino, avec l’intention de demander l’aumône d’un morceau de pain et d’une tasse de café pour la pauvre Mariuccia. Là encore, il n’y avait personne.
Tout le monde, même la vieille aveugle, était à la fête.
Je songeai à mon vieil ami Cecco; mais il était inutile de monter à son atelier: Cecco et ses amis couraient certainement la ville, un jour pareil.
Le cœur brisé, mourant de faim, les joues couvertes de larmes, je me mis à errer au hasard, ne sachant plus que faire et n’osant plus rentrer. Jamais je ne me suis sentie si malheureuse et si seule qu’au milieu de cette foule en gaîté. Tout à coup, une douce voix m’appela.
«Ah! chère donzella, montez ici, montez. Je vous ai cherchée partout. Ma mère est avec mes grands frères; je suis allé chez vous pour vous chercher; vous étiez sortie depuis plus d’une heure, à ce que m’a dit la padrona. Montez; la place est bonne. On voit tout d’ici, et la cohue devient énorme.»
Celui qui m’appelait, c’était Raffaelino. Il était au sommet d’un perron de marbre, sous une des arcades d’un vieux palais.
Je le rejoignis, et voilà comment ce jour-là je chantai sur la Grande-Place, comment je fis une recette si abondante et comment j’entendis les masques affolés crier:
«Pascarello! Pascarel!»