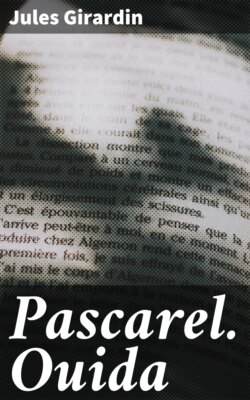Читать книгу Pascarel. Ouida - Jules Girardin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
A CÔTÉ DE LA STATUE MUTILÉE.
ОглавлениеTable des matières
Mon plus ancien souvenir d’enfance, c’est que nous étions pauvres, horriblement pauvres.
Lorsque j’allai prendre à quatre ans ma première leçon de danse, j’avais des trous à ma petite robe de dentelle, et je portais des souliers bleus fanés qui menaçaient ruine à l’endroit des orteils. Je pleurais amèrement de pure honte.
«N’y faites pas attention, carina, me disait la vieille Mariuccia, ma nourrice. N’y faites pas attention. Si vous dansez avec un cœur joyeux, qu’importe qu’il y ait quelques accrocs par-ci par-là à votre jupe! Il vaut mieux avoir des trous à ses souliers qu’un poids de plomb aux pieds, croyez-moi.»
Comme je la trouvais folle, malgré ses soixante ans, moi qui n’en avais que six!
Mais quand Florio, le domestique de mon père, venait dans notre galetas, il me prenait dans ses bras, m’élevait jusqu’au vieux miroir délabré et murmurait dans son idiome, si flatteur à l’oreille:
«Qu’est-ce que cela fait de porter une robe fanée quand on a une figure d’ange comme la signorina! Les autres petites demoiselles peuvent se couvrir de rubis et de perles si cela leur fait plaisir; personne ne songera seulement à les regarder tant que la signorina sera là!»
A la bonne heure, voilà qui s’appelle raisonner; aussi Florio me paraissait-il un personnage si avisé, que je me laissais convaincre; je consentais alors à me laisser conduire à la grande pièce nue, ornée de fresques, qui servait d’école de danse, où grinçait un petit violon criard pour mettre en mouvement des bandes de petites filles lombardes, toutes plus nobles les unes que les autres, du moins je le suppose.
Nous habitions alors Vérone.
Pauvre Vérone! si complétement oubliée du monde après avoir tant fait pour lui. La patrie de l’amoureux de Lesbie n’est que désolation aujourd’hui, malgré les trésors cachés auxquels on ne pense peut-être pas une fois en dix ans.
Rues étroites, brûlées par le soleil; tristes fortifications couvertes de poussière; petites rangées d’arbres rabougris; tourbillons de poussière calcaire; vents des montagnes aigres et pénétrants; gazons jaunis qui fourmillent de lézards bruns; hautes maisons désolées, à la fois palais et prisons; vignes éparses, occupées à étrangler des érables, et puis la plaine triste et ennuyeuse, la plaine sans ondulation, comme tout cela est misérable aujourd’hui! comme tout cela était misérable dans ce temps-là!
Vérone ne m’a jamais produit l’effet d’une ville italienne.
C’est peut-être parce que je l’ai toujours vue sous la domination de ces étrangers vêtus de blanc, qui savaient exploiter à leur profit la gourmandise de ses prêtres et la paresse de ses prolétaires, qui se mettaient dans mes bonnes grâces en me faisant valser au son de la musique militaire et en me prodiguant les friandises.
Et cependant la vieille Mariuccia, quand elle me voyait ainsi souillée par le contact des étrangers, m’arrachait brusquement de leurs bras et leur lançait de terribles regards, avec ses yeux toscans qui avaient encore leur éloquence.
Mariuccia m’avait fait bien des récits sur l’ancienne splendeur de Vérone, et j’avais l’habitude de parcourir la ville, regardant de tous mes yeux son amphithéâtre et ses haies d’acacias, le vert Adige et les deux paladins qui sont à la porte du Dôme, rêvant de Marius et de Théodoric, de Catulle, de Charlemagne, de Roméo, d’Ezzelino, de Vitruve, de Paul Véronèse, et mêlant dans la plus étrange confusion la fable et la vérité.
Je n’ai jamais aimé Vérone.
Les quatre premières années de ma vie, je les ai passées avec Mariuccia dans une ferme, bien loin de là, en Romagne. Dans cette ferme, j’avais vécu en plein air, me roulant dans le gazon, glanant le millet doré, m’enivrant en toute innocence des raisins de la vendange, les mains pleines de fleurs sauvages, d’un bout à l’autre de l’année.
Lorsque, à l’âge de quatre ans, on me prit pour me claquemurer dans l’obscurité et la poussière de la patrie de Juliette, je me révoltai, puis je m’abandonnai à mon chagrin sans vouloir être consolée. Puis, insensiblement, le temps fit son office, et je me réconciliai un peu avec mon sort.
Mais je n’oublierai jamais la vraie Italie, mon Italie à moi, là-bas, vers le sud, dans l’océan bleuâtre de la Romagne.
A l’époque où j’allais, en souliers troués, danser aux sons aigus du petit violon, nous étions à Vérone, et nous y restions pour l’unique raison que nous n’avions pas le moyen d’en sortir. Nous occupions le second étage d’un vieux.palais; un palais avec de superbes escaliers sales et enfumés, des cours dont chacune eût pu contenir un escadron armé et monté, mais qui étaient abandonnées en toute propriété aux lézards et aux mille-pieds; des chambres aux tapisseries de Rosts, d’après les cartons de Bronzino, où l’on entrait jusqu’à la cheville dans la poussière et dans l’ordure; des murs bâtis sur des dessins de Fra Giocondo, le long desquels la padrona mettait sécher ses hardes après les avoir lavées dans l’Adige.
«Peintures aux plafonds, ordures aux pieds.»
C’est George Sand, si je ne me trompe, qui a écrit cette parole amère, ou quelque chose d’approchant sur l’Italie. C’est d’autant plus amer que c’est parfois terriblement vrai.
Notre palais ne faisait pas exception à la règle. Il était magnifique comme un rêve; je parle, bien entendu, des plafonds; ici, une femme au regard merveilleux, digne de Léonard lui-même, vous souriait du haut de ses fresques de roses; là, c’était un cénacle ou une apothéose de Gentile ou de Pisanello, qui conservait encore l’éclat de ses couleurs, malgré les ravages du temps, la négligence, le feu et la poussière.
Il était magnifique encore, à cause de cette beauté de proportions qui fait que, par suite d’une sorte d’instinct infaillible de la symétrie, tant de constructions italiennes conservent leur beauté tant qu’il y reste pierre sur pierre.
Il en est de même de certains visages italiens: comme leur beauté ne tient pas à la couleur, mais aux lignes, l’âge ne peut rien sur eux, et la mort n’en détruit pas l’harmonie. On peut citer comme exemple cette Faustina qui fut retrouvée, cent ans après sa mort, aussi belle que de son vivant, dans les profondeurs ténébreuses de Santa Croce.
Mais, en même temps, ce palais était sombre, sale, triste, lugubre, incommode. On entendait dans les passages les bruissements d’ailes des chauves-souris; les hiboux, au plumage cotonneux, hantaient les charpentes du toit. Les étages supérieurs étaient occupés par des gens qui travaillaient; ou plutôt ils faisaient semblant de travailler, mais, en réalité, ils vivaient des largesses des Autrichiens.
Les chambres d’en bas étaient occupées par la padrona et ses huit enfants.
La padrona était une brave femme, solidement bâtie, avec de noirs sourcils; c’était la meilleure créature du monde; ses enfants se vautraient au soleil, jouaient à la boccetta, ou se battaient à propos des marrons qui grillaient sur le poële, ou faisaient ce que bon leur semblait, tout le long du jour, au milieu de querelles et de batailles sans fin.
La padrona était très-pauvre; elle lavait et battait elle-même son linge à la rivière, cuisait, balayait, cuisinait; tout cela sans aide. Elle ajoutait quelque chose à ses maigres ressources en rembourrant des matelas avec de la laine et de l’herbe; elle excellait dans ce genre d’industrie. C’est bien souvent grâce à la padrona que Mariuccia pouvait donner à manger à ses petits illustrissimi. Nous étions quatre illustrissimi, mes trois frères et moi. Mes frères étaient de beaux enfants qu’on aurait crus sortis d’une toile du Titien ou de Giorgione: gais, bons enfants, turbulents, entreprenants, très-populaires dans tout le voisinage, s’inquiétant peu des accrocs de leurs blouses, enchantés de s’asseoir à la table de la paclrona et de manger pour tout potage une polenta avec la femme d’en bas et ses huit enfants malpropres.
Mes pauvres frères! ils étaient si gais, si hardis, si heureux d’un rien, si pleins de bienveillance pour tout le monde; et ils moururent si jeunes, car ils étaient encore enfants. L’un mourut de la fièvre à Vérone même; un autre, d’un coup de couteau dans une rixe en pleine rue, à Rome; le dernier, dans une bourrasque près de Cagliari; la felouque qui le portait fut engloutie en vue de la côte.
Mais à l’époque dont je parle, tandis qu’ils étaient encore autour de moi, ils étaient à la fois le tourment et l’orgueil de Mariuccia, les délices de la padrona, l’admiration de la ville, pour l’adresse et l’habileté avec laquelle, eux, bambini inglesi, de simples gamins anglais, lançaient aux gens des brocards ou des sarcasmes en pur dialecte et à la manière de Vérone.
Ils aimaient à taquiner les femmes du marché, à grimper dans les chariots traînés par des buffles, à lancer le ballon, à pêcher avec les pêcheurs, à danser la tarentelle dans les cabarets, à jouer aux dominos avec Pepe, Zoto, et Gian et toute la couvée de la padrona.
De nous quatre, moi seule avais le sentiment de notre dégradation.
Avec les gamins des rues, mes frères étaient encore les jeunes signori; leurs habits râpés ne diminuaient en rien leur distinction, du moment qu’ils excellaient à la toupie, à la morra.
Pour moi, ce n’était pas la même chose, dans la société des petites aristocrates que je rencontrais aux leçons de danse.
Pour elles, j’étais une détestable étrangère, avec des souliers troués et une robe déchirée, et j’avais par-dessus le marché l’insupportable insolence de ne pas être aussi laide que j’étais pauvre et de danser beaucoup mieux qu’elles. Les éloges que le maître me prodiguait ne contribuaient pas peu à accroître mon impopularité.
Cher vieux Fortunato! Il m’enseignait la danse pour le seul plaisir de me l’enseigner. Après m’avoir souvent rencontrée dans la rue, il finit par persuadera Mariuccia que c’était un meurtre de ne pas enseigner à une jeune fille les secrets et les artifices de Terpsichore. Il m’instruisait par amour pour l’art et un peu aussi par affection pour moi.
Seulement, ses éloges me mettaient tout le monde à dos.
Ces petites Lombardes n’osaient rien dire, parce que Fortunato n’avait pas son pareil pour cingler de bons coups d’archet sur les mains ou sur les pieds quand on montrait de l’obstination et de la maladresse; mais elles me regardaient de travers; elles se groupaient dans un coin, formant contre moi une ligue offensive et défensive; et, tout en grignotant leurs bonbons de chocolat, elles marmottaient toutes sortes de choses désobligeantes sur moi et sur les miens.
Malheureusement, tout le mal qu’on pouvait dire de nous était trop vrai pour n’être pas blessant. Nous étions tous beaux; de tout temps, dit-on, la race d’où nous sortions avait eu quelque chose de fatal dans la physionomie.
Tous nos avantages se bornaient à cela.
C’était une vieille, vieille histoire; je me faisais souvent raconter par Mariuccia tout ce qu’elle en savait, quand elle était assise, le soir, dans le grand escalier, occupée à écosser des haricots, au pied d’une statue mutilée, qui, disait-on, était l’œuvre de Donatello.
Je la vois d’ici; elle avait sur les genoux un grand bassin de cuivre; son jupon était d’un rouge foncé, et son fichu était jaune. Elle portait toujours le même costume; une grosse épingle d’argent traversait ses cheveux blancs. Elle avait la noble et franche physionomie de ses compatriotes et de bons yeux mobiles et doux. Sa peau, sans cessé exposée aux intempéries des saisons, avait pris le ton brun de la châtaigne, malgré le large chapeau qui aurait dû la protéger contre la lumière qui arrivait à travers la vigne et les barreaux de la fenêtre.
Le bassin de cuivre brillait comme de l’or; bien au-dessus de nos têtes s’étalait une fresque qui représentait les travaux d’Hercule; d’en bas montaient des odeurs d’ail et de friture, de coriandre et d’étable. Les haricots, à mesure qu’elle les écossait, faisaient crac, crac, crac, avec la régularité d’un balancier de pendule.
Le chapeau de paille grossière s’agitait de lui-même avec un mouvement doux et triste pendant qu’elle me disait:
«Si je me souviens de votre mère? Vous me faites souvent la même question, Nella; sûrement, je m’en souviens. J’étais près d’elle à la naissance de chacun de vous. J’étais déjà une vieille femme. Elle était belle; oui! autrement, votre père ne l’aurait pas même regardée. C’est plutôt à lui que vous ressemblez. Oh! vous êtes belle; il n’y a pas à dire le contraire; vous le savez bien, quoique vous soyez toute petite. Tout le monde vous gâte; on vous tournera la tête à force de compliments. Vous finirez comme cette malheureuse Speronella, de Padoue, dont on chante encore la complainte dans toute la Romagne. C’est d’un fâcheux présage pour vous que de porter ce nom; je l’ai toujours dit; mais votre pauvre mère y tenait absolument; ç’avait été le nom de sa mère, à elle, à ce qu’elle disait. Il est inutile de me tourmenter pour m’en faire dire plus long; je vous ai dit cent fois tout ce que je sais là-dessus, et il n’y a pas grand’chose de bon dans tout cela. Lorsque je suis venue chez votre mère, il n’y avait pas longtemps qu’elle était mariée; elle était heureuse alors; elles le sont toujours au moins pour une semaine! Il y a eu des embarras! J’ai vu cela tout de suite; mais ils n’étaient pas encore très-pressants. Votre père l’avait rencontrée à Florence: c’était une cantatrice; lui, c’était un grand seigneur, dans son pays, à ce que l’on disait; les unions de ce genre sont toujours des méprises. Il avait le double de son âge; mais il était si beau, milordo Maurice! Il n’est plus que l’ombre de ce qu’il était; mais, tel qu’il est, vous pouvez encore juger...
–Et je lui ressemble!» m’écriai-je, assise au pied de la statue mutilée et versant dans le bassin des haricots que j’avais écossés.
Mariuccia fit un signe de tête.
«Oui, oui, vous lui ressemblez, dit-elle d’un ton grave, et en plus d’un point encore. Quand vous serez plus âgée, gardez-vous de gaspiller votre vie, comme il a fait la sienne. C’est un noble dans son pays, et je suis obligée de mendier pour ses enfants auprès de la femme d’en bas.»
Mon père n’était pas un noble, quoique Mariuccia, dans son ignorance, lui donnât ce titre: c’était le quatrième fils d’un marquis du Nord. Dieu lui soit en aide! mais, à cette époque, je n’en savais même pas si long sur son compte.
J’aimais mon père sans trop savoir pourquoi; je le voyais environ dix fois par an, et chaque fois, en moyenne, il m’adressait bien six paroles indifférentes; mais il était si beau, son humeur était si heureuse et si enjouée, il était si indifférent pour toutes choses et pour tout ce qui pouvait lui arriver, que je le considérais comme l’idéal de la perfection humaine.
Je l’adorais, à distance, bien entendu; chaque fois que je l’apercevais, c’était juste au moment où j’étais en train de manger des figues dans l’escalier ou de casser des noix dans la cour; quoi qu’il en soit, je l’adorais. Et voyez l’inconséquence et l’ingratitude de l’âme humaine; un reproche ou une rebuffade de lui, en me montrant qu’il daignait s’apercevoir que j’existais, me faisait beaucoup plus d’effet que l’infatigable bonté de Mariuccia.
Elle, la bonne âme, était parfois bien irritée contre lui et ne pouvait s’empêcher de me laisser voir qu’elle était en colère. Mariuccia n’avait pas une très-haute idée du devoir filial, vu que ses parents, un savetier ambulant et sa maîtresse, s’étaient débarrassés d’elle en la laissant tout simplement aux Innocents.
Elle croyait donc sincèrement n’enfreindre aucune règle de morale en lançant en ma présence, sur le vieil escalier, des invectives contre les procédés de mon père. Elle croyait accomplir un devoir en cherchant à me détourner du culte d’un faux dieu; c’était, d’ailleurs, un dieu qui ne pourvoyait à rien, ou presque à rien; il la laissait se creuser la tête pour trouver moyen de nourrir trois garçons affamés et transformer la garde-robe fanée de ma mère en vêtements à ma taille.
«Il a brisé le cœur de votre mère,» disait-elle quelquefois.
Et moi, cela me faisait quelque chose, et en même temps j’éprouvais un mouvement d’incrédulité. Ma mère n’était pour moi qu’un vain nom; je n’avais même pas son portrait.
«Qu’a-t-il donc fait?» demandais-je.
Mariuccia répondait avec colère:
«Demandez-moi plutôt ce qu’il n’a pas fait? Il faisait ce qu’il fait maintenant. Il s’en allait s’amuser, perdait au jeu le peu d’argent qu’il avait, et nous laissait mourir de faim pendant des semaines et des mois dans quelque trou. Pendant ce temps-là, il menait joyeuse vie dans les villes d’eaux et de jeu; il dépensait le peu d’or qu’il gagnait avec des créatures aussi mauvaises et aussi inutiles qu’il l’était lui-même. Oh! cela ne vous servira à rien de faire cette moue, signorina, et de devenir rouge comme du feu. C’est la vérité; vous l’apprendrez un jour à vos dépens. Pourquoi me faites-vous des questions sur votre mère, si vous ne croyez pas ce que je vous dis? Cela vous chagrine beaucoup d’être pauvre; à qui la faute, sinon à votre père? Et à quoi pourrait-il être utile? Je serais bien heureuse de l’apprendre, puisque personne de sa famille ne s’informe s’il vit; on le laisse de côté, comme on passe avec mépris devant une figue écrasée ou un chien mort sur la chaussée.»
A ces sorties de Mariuccia, je ne trouvais rien à répondre, car je voyais bien qu’elle disait vrai. Je continuais à écosser les haricots dans un silence obstiné. Alors Mariuccia s’adoucissait et me disait avec tendresse:
«Carina, pourquoi vous blesser à propos de votre père? Ma petite, il s’intéresse autant à vous qu’à ce lézard que voilà. Faites votre devoir envers lui, c’est convenable, mais n’en faites pas un dieu. Si vous vous tourmentez, que ce soit pour un amour qui en vaille la peine et non pas pour celui-là.»
Là-dessus, elle disparaissait dans la crypte mystérieuse qu’elle appelait sa cuisine et faisait frire des haricots dans l’huile ou les faisait cuire à l’étuvée en compagnie d’un chou. C’était là notre menu ordinaire.
On voyait bien chez nous de bons petits oiseaux bien délicats et des petits pots de crème au chocolat, préparés par Florio, qui était une manière de génie universel, mais seulement quand mon père y était; toutes ces friandises étaient pour lui; nous n’y goûtions jamais.
Envier à mon père ses cailles, ses grives et ses muges, j’aurais regardé cela comme une sorte d’impiété. Toutes les fois que Florio était chez nous, ce qui était rare, j’avais le plaisir d’entendre dire du bien de mon père.
Florio, en véritable Italien, s’était attaché à nous; une fois attaché, rien ne put le séparer de nous, pas même les ennuis et les déboires de la pauvreté. Un jour, sur l’escalier, j’entendis la padrona lui demander comment il pouvait perdre ainsi ses plus belles années dans un service aussi peu lucratif où il n’avait, pour le moment du moins, que des privations pour tout salaire. Florio haussa les épaules: c’était la pantomime la plus expressive du monde.
«Eh! que voulez-vous? lui répondit-il, je les aime, voilà tout.»
Florio partageait mon enthousiasme à propos de mon père, quoiqu’il prît parfois un air assez grave quand nous parlions de lui. Si je cherchais à lui faire dire où et comment mon père passait tout le temps qu’il vivait loin de nous, au lieu de me répondre, il tournait la chose en plaisanterie et se contentait de me montrer en riant ses dents blanches.
«Non, non, non! criait-il. Quand le moment sera venu, la donzella saura comment vivent les hommes; elle n’y comprendrait rien pour le moment. Non, non, non!»
Une fois, je l’entendis qui disait à Mariuccia:
«Nous ne sommes plus aussi heureux qu’autrefois. Quand il a la veine et qu’il gagne un peu d’or, nous vivons comme des coqs en pâte. Mais on se défie de lui. Ainsi, à Nice, on lui a insinué de ne plus reparaître au Cercle Masséna. Franchement, se faire exclure même du Cercle Masséna!»
A cette époque, Florio pouvait avoir quarante ans; c’était un petit homme grassouillet, rond comme une boule; ses yeux riaient; son sourire était plein de franchise et de tendresse, un vrai sourire italien. C’était une charmante créature. Il savait tout faire: il pouvait mettre un tablier blanc et cuisiner dans la perfection, parler plusieurs langues avec plus ou moins de correction, dessiner des charges inimitables; il ne dédaignait pas de cirer un parquet et de frotter avec des brosses aux pieds, en guise de patins; il faisait même de la dentelle; il savait mettre des cordes à un luth et chanter d’une jolie voix de ténor; une fois au marché, le panier au bras, il savait marchander le beurre et le fromage de façon à effrayer la plus terrible mégère qui ait jamais siégé sous un parapluie rouge ou vert au milieu d’une place inondée de soleil.
Quant à ses principes, je doute qu’il connût même de nom l’existence de ces sortes de choses. Il mentait avec la plus souriante sérénité et savait voler, du moins pour nous rendre service, avec la plus exquise dextérité.
En d’autres occasions, il avait la franchise ingénue d’un petit enfant, et il était si facile à émouvoir qu’il donnait des deux mains sans aucune arrière-pensée égoïste. Tel qu’il était, Florio nous aimait de toute son âme. Eh bien! Florio lui-même blâmait mon père. Quelle perplexité pour moi! Quel mal pouvait-il donc faire?
J’y songeais la nuit, dans mon petit lit à roulettes, et j’y songeais encore en me réveillant dans la grande chambre où étaient représentées à fresque les amours d’Orphée et d’Eurydice. Je ne pouvais me figurer en aucune façon qu’on pût le blâmer de jouer. Tout le monde ne joue-t-il pas en effet?
Les enfants de la padrona dans la cour d’en bas, les gens dans les rues et dans les loteries publiques, les hommes dans les cafés et les cabarets, les gamins sur les places publiques, les vieux mendiants sur les degrés des églises?
On joue aux cartes, aux dés; on joue avec des balles, avec des noix, ou même avec des petits fromages; on joue aux dominos sur les dalles; on joue au tarot; on joue tout simplement avec les doigts, quand on n’a pas d’autres instruments, comme les gens qui jouent à la morra. Un passe-temps si universel et dont on se cache si peu ne pouvait être l’occasion d’un blâme.
J’en vins à croire que mon père était victime de la plus criante injustice de la part de son monde et de ses parents. On l’appelait Milordo; notre nom de famille était Tempesta, du moins à ce que j’entendais dire par les Italiens. Voilà tout ce que je savais.
Dans la confusion de mes idées, je me figurais qu’il avait quelque chose de commun avec ce grand Tempesta qui, d’un bout à l’autre de l’Italie a laissé sa marque sur tant de toiles et de fresques, qui se réfugia dans l’Isola Bella avec son fatal amour et le remords de son crime, et y vécut entre le ciel et l’eau.
Les anachronismes et les improbabilités ne me troublaient pas le moins du monde, et ma légende me plaisait.
Un hiver, il séjourna à Vérone plus longtemps que d’habitude.
Il ne se portait pas très-bien, à ce que nous dit Florio, et puis il avait trouvé là quelques Autrichiens dont la société l’amusait. Il sortait le soir et ne rentrait qu’au petit jour; il demeurait ensuite au lit toute la journée.
Un soir, j’étais sur l’escalier, au moment où il descendait.
L’escalier était très-obscur.
Je revenais de ma leçon de danse; il faisait froid; j’étais enveloppée dans un petit manteau à capuchon, en velours écarlate, que Mariuccia m’avait taillé dans un des costumes de ma mère; mes joues étaient brûlantes, parce que j’avais couru; je tenais à la main une couronne de laurier en papier d’argent. C’était le prix de danse que, pour la quatrième fois, Fortunato venait de me décerner en grande pompe.
En voyant descendre mon père, je m’arrêtai; mon cœur battit violemment, et je me dis:
«S’il pouvait seulement regarder ma couronne de laurier?»
Ce fut comme un miracle; il s’arrêta aussi.
«Est-ce vous, Nella? Attendez donc que je vous regarde un peu.»
Il m’attira sous la lanterne et se mit à me regarder avec la plus profonde attention.
Je tremblais de la tête aux pieds, et cependant j’étais une enfant hardie; mais j’avais peur de lui, parce que je l’aimais, parce qu’il était pour moi un mystère impénétrable.
Après m’avoir regardée longtemps:
«Ciel! s’écria-t-il, comme vous ressemblez à votre mère! et cependant vous ressemblez aussi à la famille. Quel âge avez-vous?
–Bientôt dix ans.
–Oui, oui, dit-il négligemment. Vous avez beaucoup grandi ces temps derniers. Vous serez une belle femme, Nella. Vous le dit-on quelquefois?
–Souvent,» murmurai-je.
Mes jambes tremblaient; mes joues étaient rouges et brûlantes; mon cœur battait comme celui d’un oiseau effarouché; il m’avait adressé un éloge!
Il fit entendre un petit rire nonchalant.
«Déjà? Très-bien! Bonne nuit, ma petite!»
Il glissa une petite pièce de monnaie dans les plis de mon vêtement; et, pour la première fois depuis que je le connaissais, il m’embrassa, pas bien fort; mais enfin il m’embrassa.
Dès qu’il fut descendu, je m’assis dans la poussière du grand escalier, et je me mis à verser des larmes de joie, d’une joie passionnée.
Mais quand Mariuccia me découvrit, elle me trouva sanglotant amèrement, avec mon laurier jeté négligemment sur la pierre.