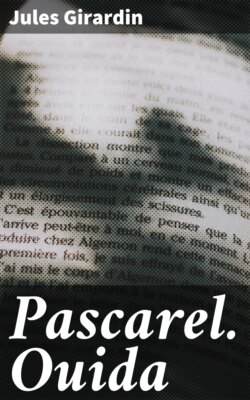Читать книгу Pascarel. Ouida - Jules Girardin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
AVEC LES GENS DU PEUPLE.
ОглавлениеTable des matières
La petite pièce d’or que mon père m’avait donnée, je la perçai et je la suspendis à mon cou; c’était pour moi un trésor.
Aucune tentation, si grande qu’elle fût, qu’elle se présentât sous la forme de confetti de Naples ou de dolci de Florence, ne put jamais me décider à la tirer de sa cachette.
Le lendemain, Florio introduisit Mariuccia dans la chambre de mon père, qui lui remit une petite somme d’argent, avec prière de s’en servir pour me faire donner la meilleure éducation possible.
Mariuccia m’avait appris à lire, Fortunato m’avait appris à danser, Florio m’avait appris à chanter des refrains avec accompagnement de mandoline.
Voilà tout ce que je savais; c’est-à-dire que, pour mon âge, j’étais d’une monstrueuse ignorance.
J’avais cependant glané par-ci par-là quelques bribes de connaissances dans des volumes dépareillés de Vasari et d’Ammirato, de Villani et de Muratori abandonnés dans un coin par un des locataires précédents.
Quand Mariuccia reçut l’argent, elle se mit à grommeler:
«C’est l’argent des Tedeschi.»
Et sa figure prit une expression de répugnance et d’horreur.
Florio montra ses dents blanches.
«Qu’est-ce que cela vous fait? répondit-il; votre affaire à vous, c’est de le dépenser; voilà tout.»
Florio, en théorie, détestait les Autrichiens autant qu’elle; mais, en pratique, il pensait que le meilleur usage à faire d’un Tedesco, c’est de le dépouiller.
«Ce sont des étrangers, des êtres détestables, nos tyrans et nos oppresseurs, et nous les mettrons à la porte un de ces jours; voilà ce qu’il disait souvent: mais tant qu’ils sont ici, ce que nous avons de mieux à faire, c’est d’en tirer tout le parti possible. Voilà du vrai patriotisme.»
C’était, en tout cas, de la vraie philosophie, qui n’était pas sans avantages pour le philosophe.
Quant à moi, je ne comprenais pas bien comment l’argent de mon père pouvait être de l’argent autrichien.
«N’importe, dit Mariuccia à Florio, qui plumait une perdrix piémontaise aussi dodue que lui-même, n’importe, j’ai profité de l’occasion pour demander au signor ce qu’il comptait faire pour les garçons. «Les garçons! m’at-il répondu en riant; ma foi, les garçons feront comme ils pourront. Quand ils seront grands, vos amis les Tedeschi les fourreront dans quelque régiment, je suppose, et il n’y a pas besoin d’une grande instruction pour cela.» Voilà ce qu’il m’a dit. Voyons, Florio, a-t-on idée d’une réponse pareille. Comme si les chers enfants pouvaient jamais consentir à porter les armes contre l’Italie! Mais je n’en ai rien tiré de plus; il m’a mise à la porte avec ses manières douces et polies, contre lesquelles il n’y a pas moyen de se fâcher. N’est-ce pas horrible? continua-t-elle en soulevant le couvercle d’une casserole qui bouillait sur le fourneau. Les nobles enfants! Je suis sûre qu’on les couperait en morceaux avant de les décider à porter l’uniforme blanc et à asservir l’Italie qui a été leur mère nourricière.»
Florio sourit. Sa perdrix était plumée; il répondit avant de la trousser:
«Bien sûr! bien sûr! Naturellement, personne de nous ne s’y déciderait. Néanmoins, dans les cafés, la bière de Vienne est bonne et légère, à ce qu’on dit, surtout quand elle ne coûte rien, et j’ai vu des Italiens le nez enseveli dans des pots de bière.»
Mariuccia souhaita charitablement que tout Italien qui boirait cet horrible breuvage tombât à l’instant suffoqué.
«C’est se montrer plus vil et plus traître que Judas que de boire cette mixture étrangère quand Dieu vous a donné par faveur spéciale le jus de la vigne.»
Voilà pourquoi et comment je fus mise à même d’apprendre ce qu’on pouvait m’enseigner à Vérone, pendant que mes frères s’élevaient en toute ignorance et en toute liberté, comme des poulains sauvages.
Mariuccia mit sous clef la somme qu’elle avait reçue de mon père et en tira tout ce qu’il était humainement possible d’en tirer.
La somme fut donc, jusqu’au dernier sou, dépensée loyalement, parce que Mariuccia était une honnête femme, et habilement, parce que c’était une Florentine.
Si je n’ai pas profité de cette dépense autant que je l’aurais dû, c’est ma faute et non celle de Mariuccia.
J’étais impatiente de toute contrainte, jusqu’à l’impertinence; j’aimais trop à me chauffer au soleil et à jouir du farniente; j’étais décidément ce qu’on appelle une méchante pièce: je n’en faisais jamais qu’à ma tête.
Les péchés que j’entassais par omission ou par commission étaient si nombreux et si variés, que la veille de l’Epiphanie j’écoutais avec angoisse la clochette qui résonnait dans les rues; je redoutais horriblement le sac de cendres et la longue canne dont la Befana, à la face noircie, se sert pour punir les entêtés.
Mariuccia, dans sa sagesse, décida que mon éducation ne serait pas faite par des femmes ni dans des écoles.
Il y avait à Vérone quantité de vieux professeurs, do vieux savants qui étaient dans une affreuse misère; ils étaient remplis d’érudition et ne trouvaient pas au-dessous de leur dignité de recevoir quelque chose en échange de leurs leçons.
Elle alla les trouver et me mit à même d’acquérir une instruction bien supérieure à celle que reçoivent les femmes dans les couvents.
Malheureusement, il n’y en eut qu’un parmi eux auquel je consentis à accorder quelque attention et à montrer quelque obéissance: c’était mon maître de chant.
J’adorais la musique; je crois d’ailleurs qu’il est impossible de ne pas l’adorer quand on a été élevé en Italie.
Tout semble chanter en Italie.
Toutes ces mélodies populaires qui n’ont jamais été notées sont quelque chose d’exquis.
Souvent, dans les rues ou dans quelque mansarde, vous entendez les sons d’une voix divine; vous cherchez le musicien dans les petites cours malpropres, dans des escaliers qui ressemblent à des coupe-gorge, dans des chambres sombres, tristes, sans air, et vous finissez par découvrir que c’est tout bonnement Pasqua la blanchisseuse qui chante auprès de son cuveau, ou Gillo le portefaix qui s’amuse à chanter en montant du bois.
J’avais la voix de ma mère, du moins à ce que disait Mariuccia.
Il paraît qu’elle donnait les plus belles espérances comme cantatrice, lorsque mon père, éperdûment épris d’elle, pour le moment, l’arracha au théâtre, l’année qui suivit ses débuts, au moment où elle se faisait entendre pour la première fois à la Pergola.
Ce que ma voix était pour les autres, je n’en sais rien; tout ce que je sais, c’est que, toute ma vie, le chant a été pour moi chose aussi naturelle que pour la grive et le bouvreuil.
Les Véronais m’appelaient l’Uccello (l’oiseau).
Dans un pays où il y a tant d’oiseaux et si bien doués, ce surnom seul était un honneur et une distinction.
Que de fois, à Vérone, quand je sortais seule, je m’étais trouvée entourée d’une troupe d’amateurs de chant qui se mettaient à me suivre, parce que je m’étais mise à chanter, sans y songer.
Pour les satisfaire, je finissais par sauter sur un parapet ou sur une saillie de pierre, et je répétais mes stornelli à un cercle enthousiaste de forgerons, de palefreniers, de portefaix et de mendiants.
Mariuccia ne savait rien de tout cela.
Ils m’escortaient jusqu’à la maison, chantant les refrains en chœur, me traitant avec ce mélange de familiarité charmante et de respect parfait dont seules les nations de race latine ont le secret.
Ils ne me disaient pas un mot qui pût blesser les oreilles d’une jeune princesse; mais ils agitaient leurs chapeaux et me faisaient offrir par quelque vieux boucher ou quelque jeune valet d’écurie un bouquet de roses de la Chine, une branche de lis ou de verveine, avec la grâce la plus parfaite et les plus charmants sourires du monde.
Ah! cher peuple, cher peuple! quand je songe à toi, je me repens d’avoir dit que je détestais ta vilaine ville, car, en vérité, je t’aimais et tu m’aimais aussi.
Mon maître de musique était un vieillard nommé Ambrogio Rufi, qui était dans la dernière misère; il habitait une petite mansarde dans une maison qui menaçait ruine.
Il était négligé, râpé et laid au delà de toute expression.
Le monde n’avait jamais entendu parler de lui, et il gagnait juste de quoi vivre, comme premier violon au théâtre.
Dans sa jeunesse, il avait créé des choses que le monde n’entendra jamais; en revanche, il était devenu l’interprète des créations des autres. C’était un maître inexorable, mais admirable en même temps. Sous sa sévérité, il y avait un enthousiasme et même une tendresse qui faisaient qu’on la supportait facilement.
On savait que, s’il était dur, c’était par respect pour l’art. Il était lui-même un grand maître, oui, quoiqu’il ne se fût jamais fait un nom et qu’il gagnât à peine de quoi vivre.
J’ai vu des fortunes princières et les hommages d’une société dédaigneuse prodigués à des gens qui n’étaient pas dignes de dénouer les cordons des souliers de mon vieux maître.
Ambrogio avait très-peu d’élèves.
La plupart étaient de jeunes enfants de chœur qui promettaient; il les avait choisis pour élèves en les entendant chanter à quelque office de San Zanone et les instruisait par amour de son art, comme Fortunato m’avait appris la danse.
Il était très-sévère, mais sa méthode était excellente, et il tirait de ses élèves tout ce qu’il était possible d’en tirer.
Je crois que ce que Mariuccia lui payait pour moi était tout ce qu’il recevait de ses élèves.
Les autres étaient si pauvres! tous, enfants de chaudronniers, de tonneliers, de vignerons et de décorateurs de poteries. Nous nous tenions en demi-cercle autour de lui, et, pendant des heures entières, il nous forçait à chanter la gamme sans nous permettre de passer à aucun autre exercice jusqu’à ce que nos gammes fussent irréprochables.
Dans sa mansarde, on étouffait en été, l’on gelait en hiver. Cette mansarde n’avait rien de poétique ni de pittoresque. Notre maître était vieux, laid, et nous jetait des regards terribles à travers ses lunettes, toutes les fois que nous osions lui infliger la torture d’une fausse note.
Malgré tout cela, nous avions foi en lui; jamais nous ne nous révoltions contre ses exigences, ou du moins cela arrivait bien rarement.
Il avait deux élèves favoris, moi et Raffaele Battista.
Raffaele était le fils d’un chaudronnier de Vérone, qui habitait, tout près de la cathédrale, un vieux bâtiment voûté, rempli de chaudrons de toutes les formes et de toutes les grandeurs, qui luisaient d’un éclat rougeâtre au soleil. Cette pièce servait tout à la fois de boutique et d’habitation; tous les jours, elle retentissait de coups de marteau et de la sonnerie des cloches.
Au milieu de ce vacarme, Raffaele était né avec l’instinct le plus parfait et le plus délicat de la mélodie; cet instinct ne s’était point altéré au vacarme des marteaux et des cloches; il découvrait une fausse note avec autant de sûreté que le maître, et il en souffrait autant que lui.
Ce n’était pas comme chanteur, mais comme violoniste, que le petit Battista était le plus extraordinaire.
Sa voix avait de la franchise et de la pureté, mais elle manquait d’étendue.
Ce fut son talent de violoniste qui lui gagna le cœur du vieil Ambrogio. Il composait des choses charmantes; mais, tout en me les jouant, il me suppliait de ne pas les dévoiler à notre maître.
C’était celui que j’aimais le plus de tous les enfants de Vérone, d’abord à cause de sa tendresse pour sa mère; elle était aveuglé, et il veillait sur elle avec une patience inépuisable; de plus, il me rendait un véritable culte: il ne se présentait jamais devant la donzella, comme il m’appelait, sans un bouquet de roses ou de violettes, ou une branche de citronnier qu’il avait volée dans les haies ou demandée à quelque voisin.
J’étais très-fière à ma façon; Mariuccia me le reprochait bien souvent mais jamais ma fierté ne m’aurait fait rougir de l’amitié de Raffaele Battista, sous prétexte que son père était chaudronnier et que lui-même courait les rues sans souliers. J’avais vécu trop longtemps parmi le peuple, et j’avais moi-même des instincts trop bohémiens pour cela.
J’aimais à marcher à côté de lui, ma main dans sa main, après la leçon d’Ambrogio, à l’heure où les élèves de Fortunato sortaient de son cours, que j’avais cessé de suivre.
Ces jeunes personnes respectables, nos ennemies naturelles, toutes fières de leur empois et de leurs rubans, de leurs colliers de corail et de leurs bas de soie, me lançaient des regards pleins de dignité et se rapprochaient les unes des autres comme pour se mieux défendre contre moi. Moi, je leur riais au nez, et je n’en serrais que plus fort la main d’Ino.
Mariuccia ne voyait pas d’un mauvais œil ma liaison avec Raffaele. En sa qualité de Florentine, elle avait des sentiments démocratiques, et puis la mère de Raffaele était une de ses bonnes amies.
«C’est un brave garçon!» disait-elle souvent.
Quand elle avait par hasard un peu de loisir, elle traversait la place pour aller boire, dans la boutique du chaudronnier, une tasse de café noir, avec la femme aveugle. Du reste, elle ne perdait pas une minute; elle filait sa quenouille tout en bavardant.
Pendant ce temps-là, Raffaele et moi, nous jouions aux dominos sur le fond d’un chaudron renversé, ou bien il allait chercher son violon; la clarté de la lune se répandait à flots sur le sol et donnait une teinte d’argent aux marbres des. édifices. Mariuccia battait la mesure avec son fuseau et la femme aveugle avec sa tête.
J’étais en grande faveur auprès des jeunes artistes qui vivaient dans les greniers et les mansardes de la ville et qui gagnaient leur vie à faire soit des copies, soit des contrefaçons des anciens maîtres.
Que de fois, je leur ai servi de modèle! Je n’aimais rien tant que d’être juchée sur une table, dans un de leurs greniers qui ressemblaient à des granges, parée de plumes de paon, de vieilles dentelles, d’antiques brocarts.
Je crois que les marchands de tableaux et les amateurs de la ville finissaient par être fatigués de retrouver toujours mes yeux noirs et mes cheveux blonds, dont ces artistes abusaient dans leurs tableaux d’enfants et dans leurs allégories.
Ces jeunes peintres ne s’accordaient pas toujours très-bien ensemble; mais ils étaient tous très-bons pour moi.
Ils habitaient tous à des hauteurs prodigieuses; leurs greniers étaient de vrais greniers, où l’on voyait tout à son aise l’enchevêtrement des poutres, que rien ne dissimulait.
En revanche, ils jouissaient d’une merveilleuse lumière, de vues magnifiques et d’horizons sans limites; au sud, c’était la plaine, et au nord la montagne.
Ils me gàtaient de toutes les façons, dansaient avec moi dans les bals en plein vent, me menaient voir les marionnettes, dont les mouvements raides me faisaient rire aux larmes; ils me chantaient toutes sortes de folles chansonnettes qui débordaient de bonne humeur et de gaîté.
Quand je leur servais de modèle, il leur arrivait, par la chaleur de l’après-midi, de descendre en courant leurs six étages pour me rapporter une tasse de café ou des petits gâteaux bien croquants.
Ces prodigalités, j’en ai bien peur, étaient une véritable ruine pour des gens qui vivaient à raison de trois sous par jour, un pour la nourriture, un pour le théâtre, et l’autre pour le club où ils allaient fumer le soir.
Comme c’étaient tous d’honnêtes garçons, et que les Italiens ont le bon esprit de ne pas voir de mal où il n’y en a pas, Mariuccia ne voyait aucun inconvénient à me laisser fréquenter les ateliers.
Nous nous amusions, et Mariuccia trouvait que la-jeunesse a besoin d’amusements.
D’ailleurs, elle répétait souvent:
«La signorina est fière; voyez comme elle sait se faire respecter!»
Peut-être cependant qu’une personne mieux au fait des convenances y eût regardé à deux fois avant de laisser une petite illustrissima de dix ans grimper dans les greniers pour chanter des chansons dans un fouillis de peintures et de pots, de bidons et de vieille friperie, au centre d’un cercle de bohémiens barbus.
Elle aurait frémi de me voir redescendre l’escalier en compagnie d’une paysanne solidement bâtie, portant anneaux d’or aux oreilles et jupon écarlate, avec une tête à grands traits comme la Judith de Donatello, et dont la profession avouée était tout uniment la profession de modèle.
Il est vrai de dire que pas une des chansons ne contenait un seul mot qui pût blesser mes oreilles.
Le modèle était quelque bonne paysanne bien honnête et bien douce qui avait des enfants et qui faisait de son mieux pour gagner honnêtement de quoi les nourrir.
Ma vieille Mariuccia était elle-même trop bonne et trop simple pour songer à mal.
Même quelquefois, le soir, quand elle se déshabillait, avant de se jeter sur son petit lit de paille, je l’entendais qui marmottait:
«Après tout, ce qu’elle a de mieux à faire, c’est d’aimer les gens du peuple; et ce serait bien heureux pour elle, quand le moment sera venu, d’épouser un homme du peuple, car il ne faut pas seulement songer à une dot, et la famille ne donne pas signe de vie.»
Ces paroles me faisaient sourire de mépris sous mon méchant drap de grosse toile.
«Jamais! jamais!» disais-je en moi-même.
A la fin de chacun de ses soliloques, Mariuccia s’agenouillait devant une image de la Madone des Douleurs et la priait de veiller sur mon avenir. Moi, silencieuse sous mon drap, je pensais comme une petite impie:
«A quoi sert d’être belle, si l’on ne peut se tirer d’affaire toute seule, sans invoquer la Madone?... »
Selon moi, la Madone était faite pour tout ce qui était vieux, laid, pauvre, sans espoir et sans amis; mais moi!
Il y avait un petit débris de miroir suspendu dans un coin de ma chambre. J’ai le regret de dire que j’ai fait mes dévotions devant ce miroir bien plus souvent que devant la Madone.
Certes, j’aimais le peuple, car il n’y a rien au monde de plus aimable, de plus gracieux, de plus courtois que le peuple d’Italie; mais jamais, même dans mes meilleurs moments, je n’ai songé, comme Mariuccia, à me chercher un mari et à vivre dans les rangs du peuple.
C’était, après tout, un heureux temps, quoique la pauvreté se fît sentir parfois bien durement. Mes frères et moi, nous lisions, le soir, Vasari, ou le vieux Pulci, ou les Chroniques de Compagni, ou Ferretto, ou les meilleures histoires de Croce, cet Homère des enfants; mais c’était à la lueur d’une pauvre misérable petite lampe; l’hiver, nous n’avions pas toujours assez de charbon pour entretenir nos chaufferettes l’été, nous avions bien souvent, pour toute nourriture, un petit pain et un bouillon d’herbes, quelques figues mûres du vieux figuier d’en bas, ou une tranche do la polenta de la padrona.