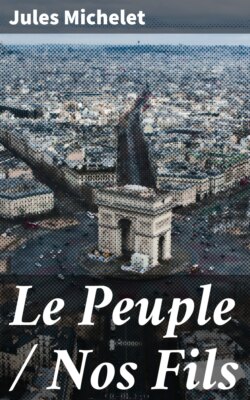Читать книгу Le Peuple / Nos Fils - Jules Michelet - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VIII
Revue de la première partie.—Introduction à la seconde.
ОглавлениеTable des matières
En repassant des yeux cette longue échelle sociale, indiquée en si peu de pages, une foule d'idées, de sentiments pénibles m'obsède, un monde de tristesse... Tant de douleurs physiques! mais combien plus de souffrances morales!... Peu me sont inconnues; je sais, je sens, j'ai eu ma bonne part... Je dois néanmoins écarter et mes sentiments et mes souvenirs, et suivre dans ce nuage ma petite lumière.
Ma lumière d'abord, qui ne me trompera pas, c'est la France. Le sentiment français, le dévouement du citoyen à la patrie, est ma mesure pour juger ces hommes et ces classes; mesure morale, mais naturelle aussi; en toute chose vivante chaque partie vaut surtout par son rapport avec l'ensemble.
En nationalité, c'est tout comme en géologie, la chaleur est en bas. Descendez, vous trouverez qu'elle augmente; aux couches inférieures, elle brûle.
Les pauvres aiment la France, comme lui ayant obligation, ayant des devoirs envers elle. Les riches l'aiment comme leur appartenant, leur étant obligée. Le patriotisme des premiers, c'est le sentiment du devoir; celui des autres, l'exigence, la prétention d'un droit.
Le paysan, nous l'avons dit, a épousé la France en légitime mariage; c'est sa femme, à toujours; il est un avec elle. Pour l'ouvrier, c'est sa belle maîtresse; il n'a rien, mais il a la France, son noble passé, sa gloire. Libre d'idées locales, il adore la grande unité. Il faut qu'il soit bien misérable, asservi par la faim, le travail, lorsque ce sentiment faiblit en lui; jamais il ne s'éteint.
Le malheureux servage des intérêts augmente encore, si nous montons aux fabricants, aux marchands. Ils se sentent toujours en péril, marchent comme sur la corde tendue... La faillite! pour l'éviter partielle, ils risqueraient plutôt de la faire générale... Ils ont fait et défait Juillet.
Et pourtant peut-on dire que dans cette grande classe de plusieurs millions d'âmes, le feu sacré soit éteint, décidément et sans remède? Non, je croirais plus volontiers que la flamme est chez eux à l'état latent. La rivalité étrangère, l'Anglais, les empêchera d'en perdre l'étincelle.
Quel froid, si je monte plus haut! c'est comme dans les Alpes. J'atteins la région des neiges. La végétation morale disparaît peu à peu, la fleur de nationalité pâlit. C'est comme un monde saisi en une nuit d'un froid subit d'égoïsme et de peur... Que je monte encore un degré, la peur même a cessé, c'est l'égoïsme pur du calculateur sans patrie; plus d'hommes, mais des chiffres... Vrai glacier abandonné de la nature[56]... Qu'on me permette de descendre, le froid est trop grand ici pour moi, je ne respire plus.
Si, comme je le crois, l'amour est la vie même, on vit bien peu là-haut. Il semble qu'au point de vue du sentiment national, qui fait qu'un homme étend sa vie de toute la grande vie de la France, plus on monte vers les classes supérieures, moins on est vivant.
Du moins, en récompense, est-on moins sensible aux souffrances, plus libre, plus heureux? j'en doute. Je vois par exemple que le grand manufacturier, tellement supérieur au misérable petit propriétaire rural, est comme lui, et plus souvent encore que lui, esclave du banquier. Je vois que le petit marchand qui a mis son épargne aux hasards du commerce, qui y compromet sa famille (comme j'ai expliqué), qui sèche d'attente inquiète, d'envie, de concurrence, n'est pas beaucoup plus heureux que l'ouvrier. Celui-ci, s'il est célibataire, s'il peut, sur sa journée de quatre francs, épargner trente sols pour les chômages, est sans comparaison plus gai que l'homme de boutique, et plus indépendant.
Le riche, dira-t-on, ne souffre que de ses vices.—Cela déjà, c'est beaucoup; mais il faut ajouter l'ennui, la défaillance morale, le sentiment d'un homme qui valut mieux, et qui conserve assez de vie pour sentir qu'elle baisse, pour voir dans les moments lucides qu'il enfonce dans les misères et les ridicules du petit esprit... Baisser, ne plus pouvoir faire acte de volonté qui vous relève, quoi de plus triste? Du Français, tomber au cosmopolite, à l'homme quelconque, et de l'homme au mollusque!
Qu'ai-je voulu dire, en tout ceci? que le pauvre est heureux? Que toute destinée est égale? «Qu'il y a compensation?» Dieu me garde de soutenir une thèse si fausse, si propre à tuer le cœur, à rassurer l'égoïsme!... Ne vois-je pas, ne sais-je pas d'expérience que la souffrance physique, loin d'exclure la souffrance morale, s'unit le plus souvent à elle? terribles sœurs qui s'entendent si bien pour écraser le pauvre!... Voyez, par exemple, le destin de la femme dans nos quartiers indigents; elle n'enfante presque que pour la mort, et trouve dans le besoin matériel une cause infinie de douleurs morales.
Au moral, au physique, cette société a, par-dessus les autres, un mal qui lui est propre: elle est devenue infiniment sensible. Que les maux ordinaires à l'homme aient diminué, je le crois, l'histoire le prouve assez. Ils ont diminué toutefois dans une proportion finie, et la sensibilité a augmenté infiniment. Pendant que la pensée agrandie ouvrait une sphère nouvelle à la douleur, le cœur donnait, par l'amour, par les liens de famille, de nouvelles prises à la fortune... Chères occasions de souffrir, que personne, à coup sûr, ne veut sacrifier... Mais combien elles ont rendu la vie plus inquiète! On ne souffre plus du présent seulement, mais de l'avenir, du possible. L'âme, tout endolorie d'avance, sent et pressent le mal qui doit venir, celui parfois qui ne viendra jamais.
Pour comble, cet âge d'extrême sensibilité individuelle est justement celui où tout se fait par les moyens collectifs qui se prêtent le moins à ménager l'individu. L'action, en tout genre, se centralise autour de quelque grande force, et bon gré, mal gré, l'homme entre dans ce tourbillon. Combien peu il y pèse, ce que deviennent, dans ces vastes systèmes impersonnels, ses pensées les plus chères, ses poignantes douleurs, hélas! qui peut le dire?... La machine roule immense, majestueuse, indifférente, sans savoir seulement que ses petits rouages, si durement froissés, ce sont des hommes vivants.
Ces roues animées qui fonctionnent sous une même impulsion, se connaissent-elles au moins les unes les autres? Leur rapport nécessaire de coopération produit-il un rapport moral?... Nullement. C'est le mystère étrange de cet âge; le temps où l'on agit le plus ensemble, est peut-être celui où les cœurs sont le moins unis. Les moyens collectifs qui mettent en commun la pensée, la font circuler, la répandent, n'ont jamais été plus grands: jamais l'isolement plus profond.
Le mystère reste inexplicable, pour qui n'observe pas historiquement le progrès du système dont il résulte. Ce système, je l'appelle d'un mot: le Machinisme; qu'on me permette d'en rappeler l'origine.
Le Moyen-âge posa une formule d'amour, et il n'aboutit qu'à la haine. Il consacrait l'inégalité, l'injustice, qui rendait l'amour impossible. La violente réaction de l'amour et de la nature qu'on appelle la Renaissance, ne fonda point l'ordre nouveau, et parut un désordre. Le monde, pour qui l'ordre était un besoin, dit alors: «Eh bien! n'aimons pas; c'est assez d'une expérience de mille ans. Cherchons l'ordre et la force dans l'union des forces; nous trouverons des machines qui les tiendront assemblées sans amour, qui encadreront, serreront si bien les hommes, cloués, rivés, vissés, que, tout en se détestant, ils agiront d'ensemble.» Et alors, on refit des machines administratives, analogues à celles du vieil Empire romain, bureaucratie à la Colbert, armées à la Louvois. Ces machines avaient l'avantage d'employer l'homme comme force régulière, la vie, moins ses caprices, ses inégalités.
Toutefois, ce sont encore des hommes, ils en gardent quelque chose. La merveille du Machinisme, ce serait de se passer d'hommes. Cherchons des forces qui, une fois mues par nous, puissent agir sans nous, comme les roues de l'horlogerie.
Mues par nous? c'est encore de l'homme, c'est un défaut. Que la nature fournisse, non seulement les éléments de la machine, mais le moteur... C'est alors qu'on créa ces ouvriers de fer qui, de cent mille bras, cent mille dents, peignent, tissent, filent, ouvrent de toute façon; la force, ils la prennent, comme Antée, au sein de leur mère, la nature, aux éléments, à l'eau qui tombe, ou qui, captive, distendue en vapeur, les anime, les soulève, de son puissant soupir.
Machines politiques pour rendre nos actes sociaux uniformément automatiques, nous dispenser de patriotisme; machines industrielles qui, créées une fois, multiplient à l'infini des produits monotones, et qui, par l'art d'un jour, nous dispensent d'être artistes tous les jours... Cela, c'est déjà bien, l'homme ne paraît plus beaucoup. Le Machinisme néanmoins veut davantage; l'homme n'est pas encore mécanisé assez profondément.
Il garde la réflexion solitaire, la méditation philosophique, la pensée pure du Vrai. Là, on ne peut l'atteindre, à moins qu'une scolastique d'emprunt ne le tire de lui-même pour l'engager dans ses formules. Une fois qu'il aura mis le pied dans cette roue qui tourne à vide, la Machine à penser, engrenée dans la machine politique, roulera triomphante et s'appellera philosophie d'État.
La fantaisie reste encore libre, la vaine poésie, qui aime et crée à son caprice... Inutile mouvement! fâcheuse déperdition de forces!... Les objets que la fantaisie va suivant au hasard sont-ils donc si nombreux qu'on ne puisse, en les classant bien, frapper pour chaque classe un moule, où nous n'aurons plus qu'à couler, au besoin du jour, tel roman ou tel drame, toute œuvre qu'on commandera? Plus d'hommes alors dans le travail littéraire, plus de passion, plus de caprice... L'économie anglaise rêvait, comme idéal industriel, une seule machine, un seul homme pour la remonter. Combien le triomphe est plus beau, pour le Machinisme, d'avoir mécanisé le monde ailé de la fantaisie!
Résumons cette histoire:
L'État, moins la patrie; l'industrie et la littérature, moins l'art; la philosophie, moins l'examen; l'humanité, moins l'homme.
Comment s'étonner si le monde souffre, ne respire plus sous cette machine pneumatique; il a trouvé moyen de se passer de ce qui est son âme, sa vie: je parle de l'amour.
Trompé par le Moyen-âge, qui promit l'union et ne tint pas parole, il a renoncé et cherché, dans son découragement, des arts pour n'aimer pas.
Les machines (je n'excepte pas les plus belles, industrielles, administratives) ont donné, à l'homme, parmi tant d'avantages[57], une malheureuse faculté, celle d'unir les forces sans avoir besoin d'unir les cœurs, de coopérer sans aimer, d'agir et vivre ensemble sans se connaître; la puissance morale d'association a perdu tout ce que gagnait la concentration mécanique.
Isolement sauvage dans la coopération même, contact ingrat, sans volonté, sans chaleur, qu'on ne ressent qu'à la dureté des frottements. Le résultat n'est pas l'indifférence, comme on croirait, mais l'antipathie et la haine, non la simple négation de la société, mais son contraire, la société travaillant activement à devenir insociable.
J'ai sous les yeux, j'ai dans le cœur, la grande revue de nos misères qu'on a faite avec moi. Eh bien! j'affirmerais sous serment qu'entre toutes ces misères, très réelles, que je n'atténue pas, la pire encore, c'est la misère d'esprit. J'entends par là l'ignorance incroyable où nous vivons, les uns à l'égard des autres, les hommes pratiques aussi bien que les spéculatifs. Et de cette ignorance, la cause principale, c'est que nous ne croyons pas avoir besoin de nous connaître; mille moyens mécaniques d'agir sans l'âme nous dispensent de savoir ce que c'est que l'homme, de le voir autrement que comme force, comme chiffre... Chiffre nous-mêmes et chose abstraite, débarrassés de l'action vitale par le secours du Machinisme, nous nous sentons chaque jour baisser et tourner à zéro.
J'ai observé cent fois la parfaite ignorance où chaque classe vit à l'égard des autres, ne voyant pas, et ne voulant pas voir.
Nous, par exemple, les esprits cultivés, que de peine nous avons à reconnaître ce qu'il y a de bon dans le peuple! Nous lui imputons mille choses qui tiennent, presque fatalement, à sa situation: un habit vieux ou sale, un excès après l'abstinence, un mot grossier, de rudes mains, que sais-je?... Et que deviendrions-nous, s'ils les avaient moins rudes?... Nous nous arrêtons à des choses extérieures, à des misères de forme, et nous ne voyons pas le bon cœur, le grand cœur qui est souvent dessous.
Eux, d'autre part, ils ne soupçonnent pas qu'une âme énergique puisse se trouver dans un corps faible. Ils se moquent de la vie de cul-de-jatte que mène le savant. C'est un fainéant, à leur sens. Ils n'ont aucune idée des puissances de la réflexion, de la méditation, de la force de calcul décuplée par la science. Toute supériorité qui n'est point gagnée à la guerre, leur semble mal gagnée. Que de fois j'ai entrevu en souriant que la Légion d'honneur leur semblait mal placée sur un homme chétif, de pâle et triste mine...
Oui, il y a malentendu. Ils méconnaissent les puissances de l'étude, de la réflexion persévérante, qui font les inventeurs. Nous méconnaissons l'instinct, l'inspiration, l'énergie qui font les héros.
C'est là, soyez-en sûrs, le plus grand mal du monde. Nous nous haïssons, nous nous méprisons, c'est-à-dire nous nous ignorons.
Les remèdes partiels qu'on pourra appliquer, sont bons, sans doute, mais le remède essentiel est un remède général. Il faudrait guérir l'âme.
Le pauvre suppose qu'en liant le riche par telle loi tout est fini, que le monde ira bien. Le riche croit qu'en ramenant le pauvre à telle forme religieuse, morte depuis deux siècles, il raffermit la société... Beaux topiques! Ils imaginent apparemment que ces formules, politiques ou religieuses, ont une certaine force cabalistique pour lier le monde, comme si leur puissance n'était pas dans l'accord qu'elles trouvent ou ne trouvent pas dans le cœur!
Le mal est dans le cœur. Que le remède soit aussi dans le cœur! Laissez là vos vieilles recettes. Il faut que le cœur s'ouvre, et les bras... Eh! ce sont vos frères, après tout. L'avez vous oublié?...
Je ne dis pas que telle ou telle forme d'association ne puisse être excellente. Mais il s'agit bien moins d'abord de formes que de fonds. Les formes les plus ingénieuses ne vous serviront guère si vous êtes insociables.
Entre les hommes d'étude, de réflexion, et les hommes d'instinct, qui fera le premier pas? Nous, les hommes d'étude. L'obstacle (répugnance? paresse? indifférence?) est frivole de notre côté. Du leur, l'obstacle est vraiment grave, c'est la fatalité d'ignorance, c'est la souffrance qui ferme et sèche le cœur.
Le peuple réfléchit, sans doute, et souvent plus que nous. Néanmoins, ce qui le caractérise, ce sont les puissances instinctives, qui touchent également à la pensée et à l'activité. L'homme du peuple, c'est surtout l'homme d'instinct et d'action.
Le divorce du monde est principalement l'absurde opposition qui s'est faite aujourd'hui, dans l'âge machiniste, entre l'instinct et la réflexion; c'est le mépris de celle-ci pour les facultés instinctives, dont elle croit pouvoir se passer.
Donc, il faut que j'explique ce que c'est que l'instinct, l'inspiration, que je pose leur droit. Suivez-moi, je vous prie, dans cette recherche. C'est la condition de mon sujet. La cité politique ne se connaîtra en soi, dans ses maux et dans ses remèdes, que quand elle se sera vue au miroir de la cité morale.