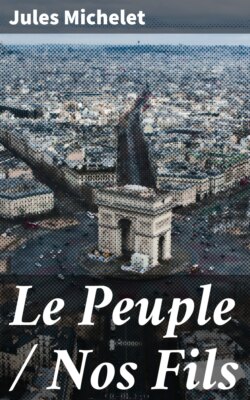Читать книгу Le Peuple / Nos Fils - Jules Michelet - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
Servitudes du paysan.
ОглавлениеTable des matières
Si nous voulons connaître la pensée intime, la passion du paysan de France, cela est fort aisé. Promenons-nous le dimanche dans la campagne, suivons-le. Le voilà qui s'en va là-bas devant nous. Il est deux heures; sa femme est à vêpres; il est endimanché; je réponds qu'il va voir sa maîtresse.
Quelle maîtresse? Sa terre.
Je ne dis pas qu'il y aille tout droit. Non, il est libre ce jour-là, il est maître d'y aller ou de n'y pas aller. N'y va-t-il pas assez tous les jours de la semaine?... Aussi il se détourne, il va ailleurs, il a affaire ailleurs... Et pourtant, il y va.
Il est vrai qu'il passait bien près; c'était une occasion. Il la regarde, mais apparemment il n'y entrera pas; qu'y ferait-il?... Et pourtant il y entre.
Du moins, il est probable qu'il n'y travaillera pas; il est endimanché; il a blouse et chemise blanches.—Rien n'empêche cependant d'ôter quelque mauvaise herbe, de rejeter cette pierre. Il y a bien encore cette souche qui gêne, mais il n'a pas sa pioche, ce sera pour demain.
Alors, il croise ses bras et s'arrête, regarde, sérieux, soucieux. Il regarde longtemps, très longtemps, et semble s'oublier. À la fin, s'il se croit observé, s'il aperçoit un passant, il s'éloigne à pas lents. À trente pas encore, il s'arrête, se retourne, et jette sur sa terre un dernier regard, regard profond et sombre; mais pour qui sait bien voir, il est tout passionné, ce regard, tout de cœur, plein de dévotion.
Si ce n'est là l'amour, à quel signe donc le reconnaîtrez-vous en ce monde? C'est lui, n'en riez point... La terre le veut ainsi, pour produire; autrement, elle ne donnerait rien, cette pauvre terre de France, sans bestiaux presque et sans engrais. Elle rapporte, parce qu'elle est aimée.
La terre de France appartient à quinze ou vingt millions de paysans qui la cultivent; la terre d'Angleterre, à une aristocratie de trente-deux mille personnes qui la font cultiver[7].
Les Anglais, n'ayant pas les mêmes racines dans le sol, émigrent où il y a profit. Ils disent le pays; nous disons la patrie[8]. Chez nous, l'homme et la terre se tiennent, et ils ne se quitteront pas; il y a entre eux légitime mariage, à la vie, à la mort. Le Français a épousé la France.
La France est une terre d'équité. Elle a généralement, en cas douteux, adjugé la terre à celui qui travaillait la terre[9]. L'Angleterre au contraire a prononcé pour le seigneur, chassé le paysan; elle n'est plus cultivée que par des ouvriers.
Grave différence morale! Que la propriété soit grande ou soit petite, elle relève le cœur. Tel qui ne se serait point respecté pour lui-même, se respecte et s'estime pour sa propriété. Ce sentiment ajoute au juste orgueil que donne à ce peuple son incomparable tradition militaire. Prenez au hasard dans cette foule un petit journalier qui possède un vingtième d'arpent, vous n'y trouverez point les sentiments du journalier, du mercenaire; c'est un propriétaire, un soldat (il l'a été, et le serait demain); son père fut de la grande armée.
La petite propriété n'est pas nouvelle en France. On se figure à tort qu'elle a été constituée dernièrement, dans une seule crise, qu'elle est un accident de la Révolution. Erreur. La Révolution trouva ce mouvement très avancé, et elle-même en sortait. En 1785, un excellent observateur, Arthur Young, s'étonne et s'effraie de voir ici la terre tellement divisée. En 1738, l'abbé de Saint-Pierre remarque qu'en France «les journaliers ont presque tous un jardin ou quelque morceau de vigne ou de terre[10].» En 1697, Boisguilbert déplore la nécessité où les petits propriétaires se sont trouvés sous Louis XIV de vendre une grande partie des biens acquis aux seizième et dix-septième siècles.
Cette grande histoire, si peu connue, offre ce caractère singulier: aux temps les plus mauvais, aux moments de pauvreté universelle où le riche même est pauvre et vend par force, alors le pauvre se trouve en état d'acheter; nul acquéreur ne se présentant, le paysan en guenilles arrive avec sa pièce d'or, et il acquiert un bout de terre.
Mystère étrange; il faut que cet homme ait un trésor caché... Et il en a un, en effet: le travail persistant, la sobriété et le jeûne. Dieu semble avoir donné pour patrimoine à cette indestructible race le don de travailler, de combattre, au besoin, sans manger, de vivre d'espérance, de gaieté courageuse.
Ces moments de désastre où le paysan a pu acquérir la terre à bon marché, ont toujours été suivis d'un élan subit de fécondité qu'on ne s'expliquait pas. Vers 1500, par exemple, quand la France épuisée par Louis XI semble achever sa ruine en Italie, la noblesse qui part est obligée de vendre; la terre, passant à de nouvelles mains, refleurit tout à coup; on travaille, on bâtit. Ce beau moment (dans le style de l'histoire monarchique) s'est appelé le bon Louis XII.
Il dure peu malheureusement. La terre est à peine remise en bon état, le fisc fond dessus; les guerres de religion arrivent qui semblent raser tout jusqu'au sol[11], misères horribles, famines atroces où les mères mangeaient leurs enfants!... Qui croirait que le pays se relève de là? Eh bien, la guerre finit à peine, de ce champ ravagé, de cette chaumière encore noire et brûlée, sort l'épargne du paysan. Il achète; en dix ans la France a changé de face; en vingt ou trente tous les biens ont doublé, triplé de valeur. Ce moment, encore baptisé d'un nom royal, s'appelle le bon Henri IV et le grand Richelieu.
Beau mouvement! quel cœur d'homme n'y prendrait part! Et pourquoi donc faut-il qu'il s'arrête toujours, et que tant d'efforts, à peine récompensés, soient presque perdus?... Ces mots: le pauvre épargne, le paysan achète, ces simples mots qu'on dit si vite, sait-on bien tout ce qu'ils contiennent de travaux et de sacrifices, de mortelles privations? La sueur vient au front, quand on observe dans le détail les accidents divers, les succès et les chutes de cette lutte obstinée; quand on voit l'invincible effort dont cet homme misérable a saisi, lâché, repris la terre de France... Comme le pauvre naufragé qui touche le rivage, s'y attache, mais toujours le flot l'emporte en mer; il s'y reprend encore, et s'y déchire, et il n'en serre pas moins le roc de ses mains sanglantes.
Le mouvement, je suis obligé de le dire, se ralentit, ou s'arrêta, vers 1650. Les nobles qui avaient vendu, trouvèrent moyen de racheter à vil prix. Au moment où nos ministres italiens, un Mazarin, un Emeri, doublaient les taxes, les nobles qui remplissaient la cour, obtinrent aisément d'être exemptés, de sorte que le fardeau doublé tomba d'aplomb sur les épaules des faibles et des pauvres qui furent bien obligés de vendre ou donner cette terre à peine acquise, et de redevenir des mercenaires, fermiers, métayers, journaliers. Par quels incroyables efforts purent-ils, à travers les guerres et les banqueroutes du grand roi, du régent, garder ou reprendre les terres que nous avons vues plus haut se trouver dans leurs mains au dix-huitième siècle, c'est ce qu'on ne peut s'expliquer.
Je prie et je supplie ceux qui nous font des lois ou les appliquent, de lire le détail de la funeste réaction de Mazarin et de Louis XIV dans les pages pleines d'indignation et de douleur où l'a consignée un grand citoyen, Pesant de Boisguilbert[12]. Puisse cette histoire les avertir, dans un moment où diverses influences travaillent à l'envi pour arrêter l'œuvre capitale de la France: l'acquisition de la terre par le travailleur.
Nos magistrats spécialement ont besoin de s'éclairer là-dessus, d'armer leur conscience; la ruse les assiège. Les grands propriétaires, tirés de leur apathie naturelle par les gens de loi, se sont jetés dernièrement dans mille procès injustes. Il s'est créé contre les communes, contre les petits propriétaires, une spécialité d'avocats antiquaires qui travaillent tous ensemble à fausser l'histoire pour tromper la justice. Ils savent que rarement les juges auront le temps d'examiner ces œuvres de mensonge. Ils savent que ceux qu'ils attaquent n'ont presque jamais de titres en règle. Les communes surtout les ont mal conservés, ou n'en ont jamais eu; pourquoi? Justement parce que leur droit est souvent très antique, et d'une époque où l'on se fiait à la tradition.
Dans tous les pays de frontière spécialement[13], les droits des pauvres gens sont d'autant plus sacrés que personne sans eux n'aurait habité des marches si dangereuses; la terre eût été déserte, il n'y eût eu ni peuple ni culture. Et voilà qu'aujourd'hui, à une époque de paix et de sécurité, vous venez disputer la terre à ceux sans lesquels la terre n'existerait pas! Vous demandez leurs titres; ils sont enfouis; ce sont les os de leurs aïeux qui ont gardé votre frontière, et qui en occupent encore la ligne sacrée.
Il est plus d'un pays en France où le cultivateur a sur la terre un droit qui certes est le premier de tous, celui de l'avoir faite. Je parle sans figure. Voyez ces rocs brûlés, ces arides sommets du Midi; là, je vous prie, où serait la terre sans l'homme? La propriété y est toute dans le propriétaire. Elle est dans le bras infatigable qui brise le caillou tout le jour, et mêle cette poussière d'un peu d'humus. Elle est dans la forte échine du vigneron qui, du bas de la côte, remonte toujours son champ qui s'écoule toujours. Elle est dans la docilité, dans l'ardeur patiente de la femme et de l'enfant qui tirent à la charrue avec un âne... Chose pénible à voir... Et la nature y compatit elle-même. Entre le roc et le roc, s'accroche la petite vigne. Le châtaignier, sans terre, se tient en serrant le pur caillou de ses racines, sobre et courageux végétal; il semble vivre de l'air, et, comme son maître, produit tout en jeûnant[14].
Oui, l'homme fait la terre; on peut le dire, même des pays moins pauvres. Ne l'oublions jamais, si nous voulons comprendre combien il l'aime et de quelle passion. Songeons que, des siècles durant, les générations ont mis là la sueur des vivants, les os des morts, leur épargne, leur nourriture... Cette terre, où l'homme a si longtemps déposé le meilleur de l'homme, son suc et sa substance, son effort, sa vertu, il sent bien que c'est une terre humaine, et il l'aime comme une personne.
Il l'aime; pour l'acquérir, il consent à tout, même à ne plus la voir; il émigre, il s'éloigne, s'il le faut, soutenu de cette pensée et de ce souvenir. À quoi supposez-vous que rêve, à votre porte, assis sur une borne, le commissionnaire savoyard? il rêve au petit champ de seigle, au maigre pâturage qu'au retour il achètera dans sa montagne. Il faut dix ans! n'importe[15]... L'Alsacien, pour avoir de la terre dans sept ans, vend sa vie, va mourir en Afrique[16]. Pour avoir quelques pieds de vigne, la femme de Bourgogne ôte son sein de la bouche de son enfant, met à la place un enfant étranger, sèvre le sien, trop jeune: «Tu vivras, dit le père, ou tu mourras, mon fils; mais si tu vis, tu auras de la terre!»
N'est-ce pas là une chose bien dure à dire, et presque impie?... Songeons-y bien avant de décider. «Tu auras de la terre», cela veut dire: «Tu ne seras point un mercenaire qu'on prend et qu'on renvoie demain; tu ne seras point serf pour ta nourriture quotidienne, tu seras libre!...» Libre! grande parole, qui contient en effet toute dignité humaine: nulle vertu sans la liberté.
Les poètes ont souvent parlé des attractions de l'eau, de ces dangereuses fascinations qui attiraient le pêcheur imprudent. Plus dangereuse, s'il se peut, est l'attraction de la terre. Grande ou petite, elle a cela d'étrange, et qui attire, qu'elle est toujours incomplète; elle demande toujours qu'on l'arrondisse. Il y manque très peu, ce quartier seulement, ou moins encore, ce coin... Voilà la tentation: s'arrondir, acheter, emprunter. «Amasse, si tu peux, n'emprunte pas», dit la raison. Mais cela est trop long, la passion dit: «Emprunte!»—Le propriétaire, homme timide, ne se soucie pas de prêter; quoique le paysan lui montre une terre bien nette et qui jusque-là ne doit rien, il a peur que du sol ne surgissent (car nos lois sont telles) une femme, un pupille, dont les droits supérieurs emportent toute la valeur du gage. Donc, il n'ose prêter.—Qui prêtera? l'usurier du lieu, ou l'homme de loi qui a tous les papiers du paysan, qui connaît ses affaires mieux que lui, qui ne sait ne rien risquer, et qui voudra bien, d'amitié, lui prêter? non, lui faire prêter, à sept, à huit, à dix!
Prendra-t-il cet argent funeste? Rarement sa femme en est d'avis. Son grand-père, s'il le consultait, ne le lui conseillerait pas. Ses aïeux, nos vieux paysans de France, à coup sûr, ne l'auraient pas fait. Race humble et patiente, ils ne comptaient jamais que sur leur épargne personnelle, sur un sou qu'ils ôtaient à leur nourriture, sur la petite pièce que parfois ils sauvaient, au retour du marché, et qui la même nuit allait (comme on en trouve encore) dormir avec ses sœurs au fond d'un pot, enterré dans la cave.
Celui d'aujourd'hui n'est plus cet homme-là; il a le cœur plus haut, il a été soldat. Les grandes choses qu'il a faites en ce siècle l'ont habitué à croire sans difficulté l'impossible. Cette acquisition de terre, pour lui, c'est un combat; il y va comme à la charge, il ne reculera pas. C'est sa bataille d'Austerlitz; il la gagnera, il y aura du mal, il le sait, il en a vu bien d'autres sous l'Ancien.
S'il a combattu d'un grand cœur, quand il n'y avait à gagner que des balles, croyez-vous qu'il y aille mollement ici, dans ce combat contre la terre? Suivez-le: avant jour, vous trouverez votre homme au travail, lui, les siens, sa femme qui vient d'accoucher, qui se traîne sur la terre humide. À midi, lorsque les rocs se fendent, lorsque le planteur fait reposer son nègre, le nègre volontaire ne se repose pas... Voyez sa nourriture, et comparez-la à celle de l'ouvrier; celui-ci a mieux tous les jours que le paysan le dimanche.
Cet homme héroïque a cru, par la grandeur de sa volonté, pouvoir tout, jusqu'à supprimer le temps. Mais ici ce n'est pas comme en guerre; le temps ne se supprime pas; il pèse, la lutte dure et se prolonge entre l'usure que le temps accumule, et la force de l'homme qui baisse. La terre lui rapporte deux, l'usure demande huit, c'est-à-dire que l'usure combat contre lui comme quatre hommes contre un. Chaque année d'intérêt enlève quatre années de travail.
Étonnez-vous maintenant si ce Français, ce rieur, ce chanteur d'autrefois, ne rit plus aujourd'hui! Étonnez-vous, si, le rencontrant sur cette terre qui le dévore, vous le trouvez si sombre... Vous passez, vous le saluez cordialement; il ne veut pas vous voir, il enfonce son chapeau. Ne lui demandez pas le chemin; il pourrait bien, s'il vous répond, vous faire tourner le dos au lieu où vous allez.
Ainsi le paysan s'isole, s'aigrit de plus en plus. Il a le cœur trop serré pour l'ouvrir à aucun sentiment de bienveillance. Il hait le riche, il hait son voisin, et le monde. Seul, dans cette misérable propriété, comme dans une île déserte, il devient un sauvage. Son insociabilité, née du sentiment de sa misère, la rend irrémédiable; elle l'empêche de s'entendre avec ceux qui devraient être ses aides et amis naturels[17], les autres paysans; il mourrait plutôt que de faire un pas vers eux. D'autre part, l'habitant des villes n'a garde d'approcher de cet homme farouche; il en a presque peur: «Le paysan est méchant, haineux, il est capable de tout... Il n'y a pas de sûreté à être son voisin...» Ainsi, de plus en plus les gens aisés s'éloignent, ils passent quelque temps à la campagne, mais ils n'y habitent pas d'une manière fixe; leur domicile est à la ville. Ils laissent le champ libre au banquier de village, à l'homme de loi, confesseur occulte de tous et qui gagne sur tous. «Je ne veux plus avoir affaire à ces gens-là, dit le propriétaire; le notaire arrangera tout, je m'en rapporte à lui; il comptera avec moi, et donnera, divisera, comme il voudra, le fermage.» Le notaire, dans plusieurs endroits, devient ainsi le seul fermier, l'unique intermédiaire entre le propriétaire riche et le laboureur. Grand malheur pour le paysan. Pour échapper au servage du propriétaire qui, généralement, savait attendre, et se laissait payer très longtemps de paroles, il a pris pour maître l'homme de loi, l'homme d'argent, qui ne connaît que l'échéance.
La malveillance du propriétaire ne manque guère d'être justifiée près de lui par les pieux personnages que reçoit sa femme. Le matérialisme du paysan est le texte ordinaire de leurs lamentations: «Âge impie, disent-ils, race matérielle! ces gens-là n'aiment que la terre! c'est toute leur religion! ils n'adorent que le fumier de leur champ!...» Malheureux pharisiens, si cette terre n'était que de la terre, ils ne l'achèteraient pas à ces prix insensés, elle n'entraînerait pas pour eux ces égarements, ces illusions. Vous, hommes de l'esprit et point matériels, on ne vous y prendrait pas; vous calculez, à un franc près, ce que ce champ donne en blé ou en vin. Et lui, le paysan, il y ajoute un prix infini d'imagination; c'est lui qui donne ici trop à l'esprit, lui qui est le poète... Dans cette terre sale, infime, obscure, il voit distinctement reluire l'or de la liberté. La liberté, pour qui connaît les vices obligés de l'esclave, c'est la vertu possible. Une famille qui, de mercenaire devient propriétaire, se respecte, s'élève dans son estime, et la voilà changée; elle récolte de sa terre une moisson de vertus. La sobriété du père, l'économie de la mère, le travail courageux du fils, la chasteté de la fille, tous ces fruits de la liberté, sont-ce là, je vous prie, des biens matériels, sont-ce des trésors que l'on peut payer trop cher[18]?
Hommes du passé, qui vous dites les hommes de la foi, si vous l'êtes vraiment, reconnaissez que ce fut une foi celle qui, de nos jours, par le bras de ce peuple, défendit la liberté du monde contre le monde même. Ne parlez pas toujours, je vous prie, de chevalerie. Ce fut une chevalerie, et la plus fière, celle de nos paysans-soldats... On dit que la Révolution a supprimé la noblesse; mais c'est tout le contraire, elle a fait trente-quatre millions de nobles... Un émigré opposait la gloire de ses ancêtres; un paysan, qui avait gagné des batailles, répondit: «Je suis un ancêtre!»
Ce peuple est noble, après ces grandes choses; l'Europe est restée roturière. Mais cette noblesse, il faut que nous la défendions sérieusement: elle est en péril. Le paysan, devenant le serf de l'usurier, ne serait pas misérable seulement, il baisserait de cœur. Un triste débiteur, inquiet, tremblant, qui a peur de rencontrer son créancier et qui se cache, croyez-vous que cet homme-là garde beaucoup de courage? Que serait-ce d'une race élevée ainsi, sous la terreur des juifs, et dont les émotions seraient celles de la contrainte, de la saisie, de l'expropriation?
Il faut que les lois changent; il faut que le droit subisse cette haute nécessité politique et morale.
Si vous étiez des Allemands, des Italiens, je vous dirais: «Consultez les légistes: vous n'avez rien à observer que les règles de l'équité civile.»—Mais vous êtes la France; vous n'êtes pas une nation seulement, vous êtes un principe, un grand principe politique. Il faut le défendre à tout prix. Comme principe, il vous faut vivre. Vivez pour le salut du monde!
Au second rang par l'industrie, vous êtes au premier dans l'Europe par cette vaste et profonde légion de paysans-propriétaires-soldats, la plus forte base qu'aucune nation ait eue depuis l'Empire romain. C'est par là que la France est formidable au monde, et secourable aussi; c'est là, ce qu'il regarde avec crainte et espoir. Qu'est-ce en effet? l'armée de l'avenir, au jour où viendront les Barbares.
Une chose rassure nos ennemis; c'est que cette grande France muette qui est dessous, est depuis longtemps dominée par une petite France, bruyante et remuante. Nul gouvernement, depuis la Révolution, ne s'est préoccupé de l'intérêt agricole. L'industrie, sœur cadette de l'agriculture, a fait oublier son aînée. La Restauration favorisa la propriété, mais la grande propriété. Napoléon même, si cher au paysan et qui le comprit bien, commença par supprimer l'impôt du revenu qui atteignait le capitaliste et soulageait la terre; il effaça les lois hypothécaires que la Révolution avait faites pour rapprocher l'argent du laboureur.
Aujourd'hui, le capitaliste et l'industriel gouvernent seuls. L'agriculture, qui compte pour moitié et plus dans nos recettes, n'obtient dans nos dépenses qu'un cent-huitième! La théorie ne la traite guère mieux que l'administration; elle s'inquiète surtout de l'industrie et des industriels. Plusieurs de nos économistes disent le travailleur pour dire l'ouvrier, oubliant seulement vingt-quatre millions de travailleurs agricoles.
Et cependant le paysan n'est pas seulement la partie la plus nombreuse de la nation, c'est la plus forte, la plus saine, et, en balançant bien le physique et le moral, au total la meilleure[19]. Dans l'affaiblissement des croyances qui le soutinrent jadis, abandonné à lui-même, entre la foi ancienne qu'il n'a plus et la lumière moderne qu'on ne lui donne pas, il garde pour soutien le sentiment national, la grande tradition militaire, quelque chose de l'honneur du soldat. Il est intéressé, âpre en affaires sans doute; qui peut y trouver à dire, quand on sait ce qu'il souffre?... Tel qu'il est, quoi qu'on puisse lui reprocher parfois, comparez-le, je vous en prie, dans la vie habituelle, à vos marchands qui mentent tout le jour, à la tourbe des manufactures.
Homme de la terre, et vivant tout en elle, il semble fait à son image. Comme elle, il est avide; la terre ne dit jamais: Assez. Il est obstiné, autant qu'elle est ferme et persistante; il est patient, à son exemple, et, non moins qu'elle, indestructible; tout passe, et lui, il reste... Appelez-vous cela des défauts? Eh! s'il ne les avait pas, depuis longtemps vous n'auriez plus de France.
Voulez-vous juger nos paysans? Regardez-les, au retour du service militaire! vous voyez ces soldats terribles, les premiers du monde, qui, revenant à peine d'Afrique, de la guerre des lions, se mettent doucement à travailler, entre leur sœur et leur mère, reprennent la vie paternelle d'épargne et de jeûne, ne font plus de guerre qu'à eux-mêmes. Vous les voyez, sans plainte, sans violence, chercher par les moyens les plus honorables l'accomplissement de l'œuvre sainte qui fait la force de la France: je veux dire le mariage de l'homme et de la terre.
La France tout entière, si elle avait le vrai sentiment de sa mission, aiderait à ceux qui continuent cette œuvre. Par quelle fatalité faut-il qu'elle s'arrête aujourd'hui dans leurs mains[20]!... Si la situation présente continuait, le paysan, loin d'acquérir, vendrait, comme il fit au milieu du dix-septième siècle, et redeviendrait mercenaire. Deux cents ans de perdus!... Ce ne serait pas là la chute d'une classe d'hommes, mais celle de la patrie.
Ils paient plus d'un demi-milliard à l'État chaque année! un milliard à l'usure! Est-ce tout? Non, la charge indirecte est peut-être aussi forte, celle que l'industrie impose au paysan par ses douanes, qui, repoussant les produits étrangers, empêchent aussi nos denrées de sortir.
Ces hommes si laborieux sont les plus mal nourris. Point de viande; nos éleveurs (qui sont au fond des industriels) empêchent l'agriculteur d'en manger[21], dans l'intérêt de l'agriculture. Le dernier ouvrier mange du pain blanc; mais celui qui fait venir le blé, ne le mange que noir. Ils font le vin, et la ville le boit. Que dis-je! le monde entier boit la joie à la coupe de la France, excepté le vigneron français[22].
L'industrie de nos villes a obtenu récemment un soulagement considérable, dont le poids retombe sur la terre, au moment où la petite industrie des campagnes, l'humble travail de la fileuse, est tué par la machine à lin.
Le paysan, perdant ainsi, une à une, ses industries, aujourd'hui le lin, demain la soie peut-être, a grand'peine à garder la terre; elle lui échappe, et elle emporte avec elle tout ce qu'il y a mis d'années laborieuses, d'épargne, de sacrifices. C'est de sa vie elle-même qu'il est exproprié. S'il reste quelque chose, les spéculateurs l'en débarrassent; il écoute, avec la crédulité du malheur, toutes les fables qu'ils débitent; Alger produit le sucre et le café; tout homme en Amérique gagne dix francs par jour; il faut passer la mer; qu'importe? L'Alsacien croit, sur leur parole, que l'Océan n'est guère plus large que le Rhin[23].
Avant d'en venir là, avant de quitter la France, toute ressource sera employée. Le fils se vendra[24]. La fille se fera domestique. Le jeune enfant entrera dans la manufacture voisine. La femme se placera comme nourrice dans la maison du bourgeois[25], ou prendra chez elle l'enfant du petit marchand, de l'ouvrier même.
L'ouvrier, pour peu qu'il gagne bien sa vie, est l'objet de l'envie du paysan. Lui qui appelle bourgeois le fabricant, il est un bourgeois pour l'homme de campagne. Celui-ci le voit le dimanche se promener vêtu comme un Monsieur. Attaché à la terre, il croit qu'un homme qui porte avec lui son métier, qui travaille sans s'inquiéter des saisons, de la gelée ni de la grêle, est libre comme l'oiseau. Il ignore et ne veut point voir les servitudes de l'homme d'industrie. Il en juge d'après le jeune ouvrier voyageur qu'il rencontre sur les routes, faisant son tour de France, qui gagne à chaque halte pour le séjour et le voyage, puis, reprenant sa longue canne de compagnonnage et le petit paquet, s'achemine vers une autre ville en chantant ses chansons.