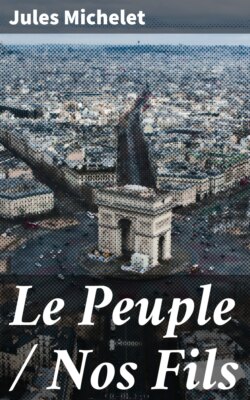Читать книгу Le Peuple / Nos Fils - Jules Michelet - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
Servitudes de l'ouvrier dépendant des machines.
ОглавлениеTable des matières
«Que la ville est brillante! que la campagne est triste et pauvre!» Voilà ce que vous entendez dire aux paysans qui viennent voir la ville aux jours de fête. Ils ne savent pas que si la campagne est pauvre, la ville, avec tout son éclat, est peut-être plus misérable.[26] Peu de gens au reste font cette distinction.
Regardez, le dimanche, aux barrières ces deux foules qui vont en sens inverse, l'ouvrier vers la campagne, le paysan vers la ville. Entre ces deux mouvements qui semblent analogues, la différence est grande. Celui du paysan n'est pas une simple promenade: il admire tout à la ville, il désire tout, il y restera, s'il le peut.
Qu'il y regarde. La campagne, une fois quittée, on n'y retourne guère. Ceux qui viennent comme domestiques et qui partagent la plupart des jouissances des maîtres, ne se soucient nullement de revenir à leur vie d'abstinence. Ceux qui se font ouvriers des manufactures voudraient retourner aux champs qu'ils ne le pourraient; ils sont en peu de temps énervés, incapables de supporter les rudes travaux, les variations rapides du chaud, du froid: le grand air les tuerait.
Si la ville est tellement absorbante, il ne faut pas trop l'en accuser, ce semble; elle repousse le paysan autant qu'il est en elle, par des octrois terribles, par l'énorme cherté du prix des vivres. Assiégée par ces foules, elle essaie ainsi de chasser l'assaillant. Mais rien ne le rebute; nulle condition n'est assez dure. Il entrera comme on voudra, domestique, ouvrier, simple aide des machines et machine lui-même. On se rappelle ces anciennes populations italiques qui, dans leur frénétique désir d'entrer dans Rome, se vendaient comme esclaves, pour y devenir plus tard affranchis, citoyens.
Le paysan ne se laisse pas effrayer par les plaintes de l'ouvrier, par les peintures terribles qu'on lui fait de sa situation. Il ne comprend pas, lui qui gagne un franc ou deux, qu'avec des salaires de trois, quatre ou cinq francs, on puisse être misérable. «Mais les variations du travail? les chômages?» Qu'importe? Il économisait sur ses faibles journées, combien plus aisément sur un si gros salaire il épargnera pour le mauvais temps!
Même en mettant le gain à part, la vie est plus douce à la ville. On y travaille généralement à couvert; cela seul, d'avoir un toit sur la tête, semble une grande amélioration. Sans parler de la chaleur, le froid dans nos climats est une souffrance, pour ceux même qui y semblent le plus habitués. J'ai passé pour ma part bien des hivers sans feu, sans être moins sensible au froid. Quand la gelée cessait, j'éprouvais un bonheur auquel peu de jouissances sont comparables. Au printemps, c'était un ravissement. Ces changements de saisons, si indifférents pour les riches, font le fonds de la vie du pauvre, ses vrais événements.
Le paysan gagne encore, en entrant à la ville, sous le rapport de la nourriture; elle est, sinon plus saine, au moins plus savoureuse. Il n'est pas rare, dans les premiers mois du séjour, de le voir engraisser. En récompense, son teint change, et ce n'est pas en bien. C'est qu'il a perdu, dans sa transplantation, une chose très vitale, et même nutritive, qui seule explique comment les travailleurs de la campagne restent forts avec des aliments très peu réparateurs; cette chose, c'est l'air libre, l'air pur, rafraîchi sans cesse, renouvelé des parfums végétaux. L'air des villes est-il aussi malsain qu'on le dit, je ne le crois pas; mais il l'est à coup sûr dans les misérables logis où s'entassent la nuit un si grand nombre de pauvres ouvriers, entre les filles et les voleurs.
Le paysan n'a pas compté cela. Il n'a pas compté davantage qu'en gagnant plus d'argent à la ville, il perdait son trésor,—la sobriété, l'épargne, l'avarice, s'il faut trancher le mot. Il est facile d'épargner, loin des tentations de dépense, lorsqu'un seul plaisir se présente, celui d'épargner. Mais combien est-ce difficile, quelle force faut-il, quelle domination de soi-même, pour tenir l'argent captif et la poche scellée, quand tout sollicite à l'ouvrir! Ajoutez que la Caisse d'Épargne, qui garde un argent invisible, ne donne nullement les émotions du trésor que le paysan enterre et déterre avec tant de plaisir, de mystère et de peur; encore moins, y a-t-il là le charme d'une jolie pièce de terre qu'on voit toujours, qu'on remue toujours, qu'on veut toujours étendre.
Certes, l'ouvrier a besoin d'une grande vertu pour épargner. S'il est facile, bon enfant et se laisse aller aux camarades, mille dépenses variables emportent tout, le cabaret, le café et le reste. S'il est sérieux, honnête, il se marie dans quelque bon moment, où l'ouvrage va bien; la femme gagne peu, puis rien, quand elle a des enfants; l'homme, à l'aise quand il était garçon, ne sait comment faire face à cette dépense, fixe, accablante, qui revient tous les jours.
Il y avait jadis, outre les droits d'entrée, une autre barrière qui repoussait le paysan des villes et l'empêchait de se faire ouvrier; cette barrière était la difficulté d'entrer dans un métier, la longueur de l'apprentissage, l'esprit d'exclusion des confréries et corporations. Les familles industrielles prenaient peu d'apprentis, le plus souvent leurs enfants qu'elles échangeaient entre elles. Aujourd'hui de nouveaux métiers se sont créés, qui ne demandent guère d'apprentissage et reçoivent un homme quelconque. Le véritable ouvrier, dans ces métiers, c'est la machine; l'homme n'a pas besoin de beaucoup de force, ni d'adresse; il est là seulement pour surveiller, aider cet ouvrier de fer.
Cette malheureuse population asservie aux machines comprend quatre cent mille âmes, ou un peu plus[27]. C'est environ la quinzième partie de nos ouvriers. Tout ce qui ne sait rien faire, vient s'offrir aux manufactures pour servir les machines. Plus il en vient, plus le salaire baisse, plus ils sont misérables. D'autre part, la marchandise, fabriquée ainsi à vil prix, descend à la portée des pauvres, en sorte que la misère de l'ouvrier-machine diminue quelque peu la misère des ouvriers et paysans, qui très probablement sont soixante-dix fois plus nombreux.
C'est ce que nous avons vu en 1842. La filature était aux abois. Elle étouffait; les magasins crevaient, nul écoulement. Le fabricant terrifié n'osait ni travailler, ni chômer avec ces dévorantes machines; l'usure ne chôme pas; il faisait des demi-journées, et il encombrait l'encombrement. Les prix baissaient, en vain; nouvelles baisses, jusqu'à ce que le coton fût tombé à six sols... Là, il y eut une chose inattendue. Ce mot, six sols, fut un réveil. Des millions d'acheteurs, de pauvres gens qui n'achetaient jamais, se mirent en mouvement. On vit alors quel immense et puissant consommateur est le peuple, quand il s'en mêle. Les magasins furent vidés d'un coup. Les machines se remirent à travailler avec furie; les cheminées fumèrent... Ce fut une révolution en France, peu remarquée, mais grande révolution: dans la propreté, embellissement subit dans le ménage pauvre; linge de corps, linge de lit, de table, de fenêtres; des classes entières en eurent, qui n'en avaient pas eu depuis l'origine du monde.
On le comprend assez, sans autre exemple: la machine, qui semble une force tout aristocratique par la centralisation de capitaux qu'elle suppose, n'en est pas moins, par le bon marché et la vulgarisation de ses produits, un très puissant agent du progrès démocratique; elle met à la portée des plus pauvres une foule d'objets d'utilité, de luxe même et d'art, dont ils ne pouvaient approcher. La laine, grâce à Dieu, a descendu partout au peuple, et le réchauffe. La soie commence à le parer. Mais la grande et capitale révolution a été l'indienne. Il a fallu l'effort combiné de la science et de l'art pour forcer un tissu rebelle, ingrat, le coton, à subir chaque jour tant de transformations brillantes, puis transformé ainsi, le répandre partout, le mettre à la portée des pauvres. Toute femme portait jadis une robe bleue ou noire qu'elle gardait dix ans sans la laver, de peur qu'elle ne s'en allât en lambeaux. Aujourd'hui, son mari, pauvre ouvrier, au prix d'une journée de travail, la couvre d'un vêtement de fleurs. Tout ce peuple de femmes qui présente sur nos promenades une éblouissante iris de mille couleurs, naguère était en deuil.
Ces changements qu'on croit futiles, ont une portée immense. Ce ne sont pas là de simples améliorations matérielles, c'est un progrès du peuple dans l'extérieur et l'apparence, sur lesquels les hommes se jugent entre eux; c'est, pour ainsi parler, l'égalité visible. Il s'élève par là à des idées nouvelles qu'autrement il n'atteignait pas; la mode et le goût sont pour lui une initiation dans l'art. Ajoutez, chose plus grave encore, que l'habit impose à celui même qui le porte; il veut en être digne, et s'efforce d'y répondre par sa tenue morale.
Il ne faut pas moins, en vérité, que ce progrès de tous, l'avantage évident des masses, pour nous faire accepter la dure condition dont il faut l'acheter, celle d'avoir, au milieu d'un peuple d'hommes, un misérable petit peuple d'hommes-machines qui vivent à moitié, qui produisent des choses merveilleuses, et qui ne se reproduisent pas eux-mêmes, qui n'engendrent que pour la mort, et ne se perpétuent qu'en absorbant sans cesse d'autres populations qui se perdent là pour toujours.
Avoir, dans les machines, créé des créateurs, de puissants ouvriers qui poursuivent invariablement l'œuvre qui leur fut imposée une fois, certes, c'est une grande tentation d'orgueil. Mais à côté, quelle humiliation de voir, en face de la machine, l'homme tombé si bas!... La tête tourne, et le cœur se serre, quand, pour la première fois, on parcourt ces maisons fées où le fer et le cuivre éblouissants, polis, semblent aller d'eux-mêmes, ont l'air de penser, de vouloir, tandis que l'homme faible et pâle est l'humble serviteur de ces géants d'acier. «Regardez, me disait un manufacturier, cette ingénieuse et puissante machine qui prend d'affreux chiffons et, les faisant passer, sans se tromper jamais, par les transformations les plus compliquées, les rend en tissus aussi beaux que les plus belles soies de Vérone!» J'admirais tristement; il m'était impossible de ne pas voir en même temps ces pitoyables visages d'hommes, ces jeunes filles fanées, ces enfants tortus ou bouffis.
Beaucoup de gens sensibles, pour ne pas trop souffrir de leur compassion, la font taire, en disant bien vite que cette population n'a une si triste apparence que parce qu'elle est mauvaise, gâtée, foncièrement corrompue. Ils la jugent ordinairement sur le moment où elle est le plus choquante à voir, sur l'aspect qu'elle présente à la sortie de la manufacture, lorsque la cloche la jette tout à coup dans la rue. Cette sortie est toujours bruyante. Les hommes parlent très-haut, vous diriez qu'ils disputent; les filles s'appellent d'une voix criarde ou enrouée; les enfants se battent et jettent des pierres, ils s'agitent avec violence. Ce spectacle n'est pas beau à voir; le passant se détourne; la dame a peur, elle croit qu'une émeute commence, et prend une autre rue.
Il ne faut pas se détourner. Il faut entrer dans la manufacture quand elle est au travail, et l'on comprend que ce silence, cette captivité pendant de longues heures, commandent, à la sortie, pour le rétablissement de l'équilibre vital, le bruit, les cris, le mouvement. Cela est vrai surtout pour les grands ateliers de filage et tissage, véritable enfer de l'ennui. Toujours, toujours, toujours, c'est le mot invariable que tonne à votre oreille le roulement automatique dont tremblent les planchers. Jamais l'on ne s'y habitue. Au bout de vingt ans, comme au premier jour, l'ennui, l'étourdissement sont les mêmes, et l'affadissement. Le cœur bat-il dans cette foule? Bien peu, son action est comme suspendue; il semble, pendant ces longues heures, qu'un autre cœur, commun à tous, ait pris la place, cœur métallique, indifférent, impitoyable, et que ce grand bruit assourdissant dans sa régularité n'en soit que le battement.
Le travail solitaire du tisserand était bien moins pénible. Pourquoi? C'est qu'il pouvait rêver. La machine ne comporte aucune rêverie, nulle distraction. Vous voudriez un moment ralentir le mouvement, sauf à le presser plus tard, vous ne le pourriez pas. L'infatigable chariot aux cent broches est à peine repoussé, qu'il revient à vous. Le tisserand à la main tisse vite ou lentement selon qu'il respire lentement ou vite; il agit comme il vit; le métier se conforme à l'homme. Là, au contraire, il faut bien que l'homme se conforme au métier, que l'être de sang et de chair où la vie varie selon les heures, subisse l'invariabilité de cet être d'acier.
Il arrive dans les travaux manuels qui suivent notre impulsion, que notre pensée intime s'identifie le travail, le met à son degré, et que l'instrument inerte à qui l'on donne le mouvement, loin d'être un obstacle au mouvement spirituel, en devient l'aide et le compagnon. Les tisserands mystiques du Moyen-âge furent célèbres sous le nom de lollards, parce qu'en effet, tout en travaillant, ils lollaient, chantaient à voix basse, ou du moins en esprit, quelque chant de nourrice. Le rythme de la navette, lancée et ramenée à temps égaux, s'associait au rythme du cœur; le soir, il se trouvait souvent qu'avec la toile s'était tissue, aux mêmes nombres, un hymne, une complainte.
Aussi quel changement pour celui qui est forcé de quitter le travail domestique pour entrer à la manufacture! Quitter son pauvre chez soi, les meubles vermoulus de la famille, tant de vieilles choses aimées, cela est dur, plus dur encore de renoncer à la libre possession de son âme. Ces vastes ateliers tout blancs, tout neufs, inondés de lumière, blessent l'œil accoutumé aux ombres d'un logis obscur. Là, nulle obscurité où la pensée se plonge, nul angle sombre où l'imagination puisse suspendre son rêve; point d'illusion possible, sous un tel jour, qui sans cesse avertit durement de la réalité. Ne nous étonnons pas si nos tisserands de Rouen[28], nos tisserands français de Londres, ont résisté à cette nécessité, de tout leur courage, de leur stoïque patience, aimant mieux jeûner et mourir, mais mourir au foyer. On les a vus longtemps lutter du faible bras de l'homme, d'un bras amaigri par la faim, contre la fécondité brillante, impitoyable, de ces terribles Briarées de l'industrie qui, jour et nuit, poussés par la vapeur, travaillent de mille bras à la fois; à chaque perfectionnement de la machine, son rival infortuné ajoutait à son travail, diminuait de sa nourriture. Notre colonie des tisserands de Londres s'est éteinte ainsi peu à peu. Pauvres gens, si honnêtes, d'une vie si résignée et si innocente, pour qui l'indigence et la faim ne furent jamais une tentation! Dans leur misérable Spitalfield, ils cultivaient les fleurs avec intelligence; Londres aimait à les visiter.
J'ai parlé tout à l'heure des tisserands de Flandre au Moyen-âge, des Lollards, Béghards, comme on les appelait. L'Église, qui souvent les persécuta comme hérétiques, ne reprocha jamais à ces rêveurs qu'une seule chose: l'amour; l'amour exalté et subtil pour l'invisible amant, pour Dieu; parfois aussi l'amour vulgaire, sous les formes qu'il prend dans les centres populeux de l'industrie, vulgaire et néanmoins mystique, enseignant pour doctrine une communauté plus que fraternelle qui devait mettre un paradis sensuel ici-bas.
Cette tendance à la sensualité est la même chez ceux d'aujourd'hui, qui d'ailleurs n'ont pas, pour s'élever au-dessus, la rêverie poétique. Un puritain anglais, qui de nos jours a fait un tableau délicieux du bonheur dont jouit l'ouvrier des manufactures, avoue que la chair s'y échauffe fort et s'y révolte. Cela ne vient pas seulement du rapprochement des sexes, de la température, etc. Il y a une cause morale. C'est justement parce que la manufacture est un monde de fer, où l'homme ne sent partout que la dureté et le froid du métal, qu'il se rapproche d'autant plus de la femme, dans ses moments de liberté. L'atelier mécanique, c'est le règne de la nécessité, de la fatalité. Tout ce qui y entre de vivant, c'est la sévérité du contre-maître; on y punit souvent, on n'y récompense jamais. L'homme se sent là si peu homme, que dès qu'il en sort, il doit chercher avidement la plus vive exaltation des facultés humaines, celle qui concentre le sentiment d'une immense liberté dans le court moment d'un beau rêve. Cette exaltation, c'est l'ivresse, surtout celle de l'amour.
Malheureusement, l'ennui, la monotonie à laquelle ces captifs éprouvent le besoin d'échapper, les rendent, dans ce que leur vie a de libre, incapables de fixité, amis du changement. L'amour changeant toujours d'objet, n'est plus l'amour, ce n'est plus que débauche. Le remède est pire que le mal; énervés par l'asservissement du travail, ils le sont encore plus par l'abus de la liberté.
Faiblesse physique, impuissance morale. Le sentiment de l'impuissance est une des grandes misères de cette condition. Cet homme, si faible devant la machine et qui la suit dans tous ses mouvements, il dépend du maître de la manufacture, et dépend plus encore de mille causes inconnues qui d'un moment à l'autre peuvent faire manquer l'ouvrage et lui ôter son pain. Les anciens tisserands, qui pourtant n'étaient pas, comme ceux-ci, les serfs de la machine, avouaient humblement cette impuissance, l'enseignaient, c'était leur théologie: «Dieu peut tout, l'homme rien.» Le vrai nom de cette classe, c'est le premier que l'Italie leur donne au Moyen-âge: Humiliati[29].
Les nôtres ne se résignent pas si aisément. Sortis de races militaires, ils font sans cesse effort pour se relever, ils voudraient rester hommes. Ils cherchent, autant qu'ils peuvent, une fausse énergie dans le vin. En faut-il beaucoup pour être ivre? Observez au cabaret même, si vous pouvez surmonter ce dégoût: vous verrez qu'un homme en état ordinaire, buvant du vin non frelaté, boirait bien davantage sans inconvénient. Mais pour celui qui ne boit pas de vin tous les jours, qui sort énervé, affadi par l'atmosphère de l'atelier, qui ne boit, sous le nom de vin, qu'un misérable mélange alcoolique, l'ivresse est infaillible.
Extrême dépendance physique, réclamations de la vie instinctive qui tournent encore en dépendance, impuissance morale et vide de l'esprit, voilà les causes de leurs vices. Ne la cherchez pas tant, comme on fait aujourd'hui, dans les causes extérieures, par exemple, dans l'inconvénient que présente la réunion d'une foule en un même lieu: comme si la nature humaine était si mauvaise que pour se gâter tout à fait, il suffit de se réunir. Voilà nos philanthropes, sur cette belle idée, qui travaillent à isoler les hommes, à les murer, s'ils peuvent; ils ne croient pouvoir préserver ou guérir l'homme moral qu'en lui bâtissant des sépulcres.
Cette foule n'est pas mauvaise en soi. Ses désordres dérivent en grande partie de sa condition, de son assujettissement à l'ordre mécanique qui, pour les corps vivants, est lui-même un désordre, une mort, et qui par cela provoque, dans les rares moments de liberté, de violents retours à la vie. Si quelque chose ressemble à la fatalité, c'est bien ceci. Comme elle pèse durement, presque invinciblement, cette fatalité, sur l'enfant et la femme! Celle-ci qu'on plaint moins, est peut-être encore plus à plaindre; elle a double servage; esclave du travail, elle gagne si peu de ses mains qu'il faut que la malheureuse gagne aussi de sa jeunesse, du plaisir qu'elle donne. Vieille, que devient-elle?... La nature a porté une loi sur la femme, que la vie lui fût impossible, à moins d'être appuyée sur l'homme.
Dans la violence du grand duel entre l'Angleterre et la France, lorsque les manufacturiers anglais vinrent dire à M. Pitt que les salaires élevés de l'ouvrier les mettaient hors d'état de payer l'impôt, il dit un mot terrible: «Prenez les enfants.» Ce mot-là pèse lourdement sur l'Angleterre, comme une malédiction. Depuis ce temps, la race y baisse; ce peuple, jadis athlétique, s'énerve et s'affaiblit; qu'est devenue cette fleur de teint et de fraîcheur qui faisait tant admirer la jeunesse anglaise?... fanée, flétrie... On a cru M. Pitt, on a pris les enfants.
Profitons de cette leçon. Il s'agit de l'avenir; la loi doit être ici plus prévoyante que le père; l'enfant doit trouver, au défaut de sa mère, une mère dans la patrie. Elle lui ouvrira l'école comme asile, comme repos, comme protection contre l'atelier.
Le vide de l'esprit, nous l'avons dit, l'absence de tout intérêt intellectuel est une des causes principales de l'abaissement de l'ouvrier des manufactures. Un travail qui ne demande ni force ni adresse, qui ne sollicite jamais la pensée! Rien, rien, et toujours rien!... Nulle force morale ne tiendrait à cela! L'école doit donner au jeune esprit qu'un tel travail ne relèvera pas, quelque idée haute et généreuse qui lui revienne dans ces grandes journées vides, le soutienne dans l'ennui des longues heures.
Dans le présent état des choses, les écoles, organisées pour l'ennui, ne font guère qu'ajouter la fatigue à la fatigue. Celles du soir sont, pour la plupart, une dérision. Imaginez ces pauvres petits qui, partis avant jour, reviennent las et mouillés, à une lieue, deux lieues de Mulhouse; qui, la lanterne à la main, glissent, trébuchent le soir par les sentiers boueux de Déville, appelez-les alors pour commencer l'étude et entrer à l'école!
Quelles que soient les misères du paysan, il y a, en les comparant à celles dont nous nous occupons ici, une terrible différence, qui n'influe pas accidentellement sur l'individu, mais profondément, généralement, sur la race même. On peut la dire d'un mot: à la campagne, l'enfant est heureux.
Presque nu, sans sabots, avec un morceau de pain noir, il garde une vache ou des oies, il vit à l'air, il joue. Les travaux agricoles auxquels on l'associe peu à peu, ne font que le fortifier. Les précieuses années pendant lesquelles l'homme fait son corps, sa force, pour toujours, se passent ainsi pour lui dans une grande liberté, dans la douceur de la famille. Va maintenant, te voilà fort, quoi que tu souffres ou fasses, tu peux tenir tête à la vie!
Le paysan sera plus tard misérable, dépendant peut-être; mais il a, tout d'abord, gagné douze ans, quinze ans de liberté. Cela seul met pour lui une différence immense dans la balance du bonheur.
L'ouvrier des manufactures porte toute la vie un poids très lourd, le poids d'une enfance qui l'a affaibli de bonne heure, bien souvent corrompu. Il est inférieur au paysan pour la force physique, inférieur pour la régularité des mœurs. Et avec tout cela, il a une chose qui réclame pour lui: il est plus sociable et plus doux. Les plus misérables d'entre eux, dans leurs plus extrêmes besoins, se sont abstenus de tout acte de violence; ils ont attendu, mourant de faim, et se sont résignés.
L'auteur de la meilleure enquête de ce temps[30], ferme et froid observateur qu'on ne soupçonnera de nul entraînement, porte en faveur de cette classe d'hommes, dont il ne dissimule aucunement les vices, ce grave témoignage: «Je n'ai trouvé chez nos ouvriers qu'une vertu qu'ils possédassent à un plus haut degré que les classes sociales plus heureuses: c'est une disposition naturelle à aider, à secourir les autres dans toute espèce de besoins.»
Je ne sais s'ils n'ont que cette supériorité, mais combien elle est grande!... Qu'ils soient les moins heureux et les plus charitables! qu'ils se préservent de l'endurcissement si naturel à la misère! que dans cette servitude extérieure ils gardent un cœur libre de haine, qu'ils aiment davantage!... Ah! c'est là une belle gloire, et qui sans doute met l'homme, qu'on croirait dégradé, bien haut, au jugement de Dieu!