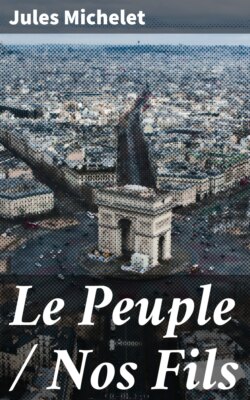Читать книгу Le Peuple / Nos Fils - Jules Michelet - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
L'instinct du peuple, altéré, mais puissant.
ОглавлениеTable des matières
La critique m'attend au premier mot, et elle m'impose silence: «Vous avez fait en cent et quelques pages un long bilan des misères sociales, des servitudes attachées à chaque condition. Nous avons patienté, dans l'espoir qu'après les maux nous saurions enfin les remèdes. À des maux si réels, si positifs, tellement spécifiés, nous attendons que vous opposerez autre chose que des paroles vagues, une banale sentimentalité, des remèdes moraux, métaphysiques. Proposez des réformes précises; dressez, pour chaque abus, une formule nette de ce qu'il faut changer; adressez-la aux Chambres... Ou, si vous en restez aux plaintes, aux rêveries, il vaut mieux retourner à votre Moyen-âge que vous n'auriez pas dû quitter.»
Les remèdes spéciaux n'ont pas manqué, ce semble. Nous en avons quelque cinquante mille au Bulletin des Lois; nous y ajoutons tous les jours, et je ne vois pas que nous en allions mieux. Nos médecins législatifs traitent chaque symptôme, qui apparaît ici et là, comme une maladie isolée et distincte, et croient y remédier par telle application locale. Ils sentent peu la solidarité profonde de toutes les parties du corps social, et celle de toutes les questions qui s'y rapportent[61].
Hérodote nous conte que les Égyptiens, dans l'enfance de la science, avaient des médecins différents pour chaque partie du corps; l'un soignait le nez, l'autre l'oreille, tel le ventre, etc. Il leur importait peu que leurs remèdes s'accordassent; chacun d'eux travaillait à part, sans déranger les autres; si, chaque membre guéri, l'homme mourait, c'était son affaire.
J'ai eu, je l'avoue, un autre idéal de la médecine. Il m'a paru, qu'avant tout remède extérieur et local, il ne serait pas inutile de s'informer du mal intérieur qui produit tous ces symptômes. Ce mal, c'est, selon moi, le refroidissement, la paralysie du cœur qui fait l'insociabilité; et celle-ci tient surtout à l'idée fausse que nous pouvons impunément nous isoler, que nous n'avons aucun besoin des autres. Les classes riches et cultivées spécialement s'imaginent qu'elles n'ont rien à voir avec l'instinct du peuple, que leur science de livres suffit à tout, que les hommes d'action ne leur apprendraient rien. Il m'a fallu, pour les éclairer, approfondir ce qu'il y a de fécond dans les facultés instinctives et actives. Cette route était longue, mais légitime, et nulle autre ne l'était.
J'apporte à cet examen trois choses avec moi. Quand je disais tout à l'heure que j'étais seul, j'avais tort.
1o J'apporte l'observation du présent, observation d'autant plus sérieuse qu'en moi elle n'est pas seulement du dehors, mais aussi du dedans. Fils du peuple, j'ai vécu avec lui, je le connais, c'est moi-même... Comment pourrais-je, étant ainsi au fond des choses, me fourvoyer, comme d'autres, et m'en aller prendre l'exception pour la règle, les monstruosités pour la nature.
2o Mon deuxième avantage, c'est que m'occupant moins de telle nouveauté dans les mœurs, de telle classe spéciale, née d'hier, mais me tenant dans la généralité légitime de la masse, je la relie sans peine à son passé. Les changements, dans les classes inférieures, sont bien plus lents qu'en haut. Je ne vois point naître cette masse brusquement, par hasard, comme un monstre éphémère qui jaillirait du sol; je la vois qui descend par une génération légitime du fond de l'histoire. La vie est moins mystérieuse quand on sait la naissance, les aïeux et les précédents, quand on a vu longtemps comment l'être vivant existait, pour ainsi parler, bien avant de naître.
3o Prenant ainsi ce peuple dans son présent et son passé, je vois ses rapports nécessaires se rétablir avec les autres peuples, à quelque degré de civilisation ou de barbarie qu'ils soient parvenus. Ils s'expliquent tous entre eux, et se commentent. À telle question que vous posez sur l'un, c'est l'autre qui répond. Tel détail, par exemple, dans les habitudes de nos montagnards des Pyrénées, d'Auvergne, vous le trouvez grossier; moi, je le vois barbare; comme tel, je le comprends, je le classe, j'en sais la place et la valeur dans la vie générale. Que de choses, effacées à demi dans nos mœurs populaires, semblaient inexplicables, dépourvues de raison et de sens, et qui, reparaissant pour moi dans leur accord avec l'inspiration primitive, se sont trouvées n'être autre chose que la sagesse d'un monde oublié... Pauvres débris sans forme que je rencontrais sans les reconnaître, mais, par je ne sais quel pressentiment, je ne voulais pas les laisser traîner sur le chemin; au hasard, je les ramassais, j'en remplissais les pans de mon manteau... Puis, en bien regardant, je découvrais avec une émotion religieuse que ce n'était ni pierre ni caillou que j'avais rapporté, mais les os de mes pères[62].
Cette critique du présent par le passé, par la comparaison variée des peuples, des âges différents, je ne pouvais la faire dans ce petit livre. Elle ne m'en a pas moins servi à contrôler, à éclairer les résultats que me donnaient sur nos mœurs actuelles l'observation, la lecture, l'information de toute espèce.
«Mais dira-t-on, ce contrôle lui-même n'a-t-il pas son danger? Cette critique n'est-elle pas hardie? Le peuple que nous voyons, conserve-t-il quelque rapport sérieux avec ses origines? Prosaïque à ce point, peut-il rappeler en rien les tribus qui, dans leur barbarie, gardent un souffle poétique?... Nous ne prétendons pas que la fécondité, la puissance créatrice ait manqué aux masses populaires. Elles produisent, à l'état sauvage ou barbare; les chants nationaux de tous les peuples primitifs le témoignent assez. Elles produisent aussi, lorsque, transformées par la culture, elles s'approchent des classes supérieures et s'y mêlent. Mais le peuple qui n'a ni l'inspiration primitive ni la culture, le peuple qui n'est ni civilisé ni sauvage, qui est, dans l'état intermédiaire, tout à la fois vulgaire et rude, ne reste-t-il pas impuissant?... Les sauvages eux-mêmes, qui ont naturellement beaucoup d'élévation et de poésie, voient avec dégoût nos émigrants, sortis de ces populations grossières.»
Je ne conteste pas l'état de dépression, de dégénération physique, parfois morale, où se trouve aujourd'hui le peuple, surtout celui des villes. Toute la masse des travaux pesants, toute la charge que, dans l'Antiquité, l'esclave portait seul, s'est trouvée aujourd'hui partagée entre les hommes libres des classes inférieures. Tous participent aux misères, aux vulgarités prosaïques, aux laideurs de l'esclavage. Les races les plus heureusement nées, nos jolies races du Midi, par exemple, si vives et si chanteuses, sont tristement courbées par le travail. Le pis, c'est qu'aujourd'hui l'âme est souvent aussi courbée que les épaules; la misère, le besoin, la peur de l'usurier, du garnisaire, quoi de moins poétique?
Le peuple a moins de poésie en lui-même, et il en trouve moins dans la société qui l'entoure. Cette société a du moins rarement le genre de poésie qu'il peut apprécier, le détail saisissant dans le pittoresque ou le pathétique. Si elle a une haute poésie, c'est dans les harmonies, souvent très compliquées, qu'un œil peu exercé ne saisit pas.
L'homme pauvre et seul, entouré de ces objets immenses, de ces énormes forces collectives qui l'entraînent, sans qu'il les comprenne, se sent faible, humilié. Il n'a nullement l'orgueil qui rendit jadis si puissant le génie individuel. Si l'interprétation lui manque, il reste découragé devant cette grande société qui lui semble si forte, si sage et si savante. Tout ce qui vient du centre lumineux, il l'accepte, le préfère sans difficulté à ses propres conceptions. Devant cette sagesse, la petite muse populaire se contient, elle n'ose souffler. La première impose à cette villageoise, la fait taire, ou même lui fait chanter ses chants. C'est ainsi que nous avons vu Béranger, dans sa forme exquise et noblement classique, devenir le chansonnier national, envahir tout le peuple, remplacer les vieux chants des villages, jusqu'aux mélodies antiques que chantaient nos matelots. Les poètes ouvriers des derniers temps ont imité les rythmes de Lamartine, s'abdiquant, autant qu'il était en eux, et sacrifiant trop souvent ce qu'ils pouvaient avoir d'originalité populaire.
Le tort du peuple, quand il écrit, c'est toujours de sortir de son cœur, où est sa force, pour aller emprunter aux classes supérieures des abstractions, des généralités. Il a un grand avantage, mais qu'il n'apprécie nullement, celui de ne pas savoir la langue convenue, de n'être pas, comme nous le sommes, obsédé, poursuivi de phrases toutes faites, de formules, qui viennent d'elles-mêmes, lorsque nous écrivons, se poser sur notre papier. Voilà justement ce que nous envient, ce que nous empruntent, autant qu'ils peuvent, les littérateurs ouvriers. Ils s'habillent, ils mettent des gants pour écrire, et perdent ainsi la supériorité que donnent au peuple, quand il sait s'en servir, sa main forte et son bras puissant.
Qu'importe? Pourquoi demander à des hommes d'action quels sont leurs écrits? Les vrais produits du génie populaire, ce ne sont pas des livres, ce sont des actes courageux, des mots spirituels, des paroles chaleureuses, inspirées, comme je les recueille tous les jours dans la rue, sortant d'une bouche vulgaire, de celle qui semblait le moins faite pour l'inspiration. Cet homme, au reste, qui vous repousse par la vulgarité, ôtez-lui son vieux vêtement, mettez-lui l'uniforme, le sabre, le fusil, un tambour, un drapeau en avant... On ne le reconnaît plus; c'est un autre homme. Le premier, où est-il? impossible de le retrouver.
La dépression, la dégénération, n'est qu'extérieure. Le fonds subsiste. Cette race a toujours du vin dans le sang; en ceux même qui semblent le plus éteints, vous retrouverez une étincelle. Toujours l'énergie militaire, toujours l'insouciance courageuse, grande parade d'esprit indépendant. Cette indépendance qu'ils ne savent où placer (entravés, comme ils sont, de toutes parts), ils la mettent trop souvent dans les vices, et se vantent d'être pires qu'ils ne sont. Exactement le contraire des Anglais.
Entraves extérieures, vie forte qui réclame au dedans, ce contraste produit beaucoup de faux mouvements, une discordance dans les actes, les paroles, qui choque au premier regard. Elle fait aussi que l'Europe aristocratique se plaît à confondre le peuple de France avec les peuples imaginatifs et gesticulateurs, comme les Italiens, les Irlandais, Gallois, etc. Ce qui l'en distingue d'une manière très forte et très tranchée, c'est que dans ses plus grands écarts, dans ses saillies d'imagination, dans ce qu'on aime à appeler ses accès de Don Quichottisme, il garde le bon sens. Aux moments les plus exaltés, une parole ferme et froide indique que l'homme n'a pas perdu terre, qu'il n'est pas dupe lui-même de son exaltation.
Ceci regarde le caractère français en général. Pour revenir au peuple spécialement, remarquons que l'instinct qui domine chez lui, lui donne pour l'action un avantage immense. La pensée réfléchie n'arrive à l'action que par tous les intermédiaires de délibération et de discussion; elle arrive à travers tant de choses que souvent elle n'arrive pas. Au contraire, la pensée instinctive touche à l'acte, est presque l'acte; elle est presque en même temps une idée et une action.