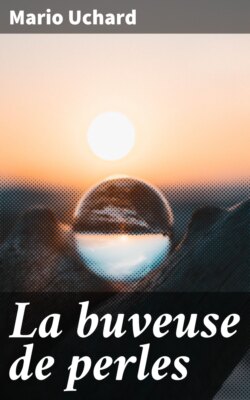Читать книгу La buveuse de perles - Mario Uchard - Страница 7
ОглавлениеV
A père avare, fils prodigue! disait autrefois la sagesse des bonnes gens. Mais le théâtre et le roman à sensations ont changé tout cela.
D’après les moralistes à la mode, ayant entendu parler de Darwin, dont ils ont pris à rebours la doctrine de progrès, l’hérédité du vice est redevenue pour nous la fatalité antique; agissant seule, prédominant dans tout, annulant jusqu’à cette domestication continue de la brute, qui constitue la base du système, et qui, chez la bête humaine, s’appelle l’éducation.
Où Darwin conclut à l’élimination forcée du mal, contraire à l’essor des races; la littérature scientifique démontre la pourriture finale de l’humanité, d’où il résulte très logiquement que, suivant cette admirable loi de certains psychologues qu’il ne faut pas confondre avec le savant anglais, l’ancêtre commun arrivé le premier à l’honneur d’être singe, eût dû retourner bien vite à reculons, pour ne produire qu’une descendance de singes et demie.
Confessons-le en toute humilité, la fille d’Ida Reynach n’avait rien d’une de ces héroïnes naturalistes, marquées dès leur procréation du sceau maudit d’un implacable destin. Pour être du sang de danseuse, le sang qui courait dans ses veines ne différait aucunement de celui d’une duchesse. Issue de deux êtres jeunes, sains et beaux, elle était saine, belle et bien venue, sans que l’irrégularité résultant de l’absence d’un maire, dans les liens trop fragiles de ses auteurs, eût influé sur sa naissance.
Fille d’un lord vingt fois millionnaire, elle avait fait son entrée dans le monde, toute nue, apte au bien autant qu’au mal, selon que les circonstances, le milieu, l’éducation la mettraient, comme toute autre créature humaine, en lutte avec les passions et avec les chances du sort.
Placée dans un grand pensionnat de Genève, cité paisible où Ida Reynach, d’origine suisse, avait quelques parents, son adolescence s’était écoulée au milieu d’enfants de familles honnêtes et aisées; ne voyant que deux fois par an sa mère, dont elle ignorait tout. Douée d’une imagination vive, d’un cœur aimant, aux sources d’une instruction supérieure à celle de nos filles, respirant l’atmosphère pure des faciles vertus familiales, Catherine Reynach était, à dix-sept ans, le naturel produit d’une solide éducation, ni plus ni moins que si elle eût été le fruit légitime et correct de deux descendants des croisades, ou d’une paire, de bourgeois de la rue Saint-Denis.
Précoce, bien formée, d’une santé de montagnarde, l’esprit et le cœur ouverts, c’était tout simplement une belle fille avec des grâces encore helvétiques et légèrement rougeaudes, prête à recevoir l’empreinte du bien ou du mal, selon ce que lui réserverait l’exercice de la vie. Ce fut en plein dans cet essor printanier, toute prête à ouvrir ses ailes d’ange, que, rappelée un beau jour, elle tomba chez sa mère; trouvant dès ses premiers pas la misère et un milieu flétri, dont elle ne comprit point d’abord les idées, singulièrement avancées pour une pensionnaire genevoise.
C’était une éducation nouvelle.
Trop ingénue pour suspecter en rien les principes maternels, apportant aux choses dévoilées cette curiosité de fille d’Ève toute fière de se découvrir femme, elle crut le monde ainsi fait.
Pour la mettre en passe de devenir princesse, Ida Bonnard résolut tout d’abord d’en faire une grande artiste. Catherine, déjà très bonne musicienne, entra au Conservatoire, ce qui ébaucha naturellement son émancipation.
Mais il se trouva que, si intelligente et si bien douée qu’elle fût, la fille du lord n’avait rien de l’aplomb ni de la volonté qu’il faut au théâtre. Sa voix trop peu robuste pour le chant, on s’était rabattu sur la comédie, lorsque, au bout de deux ans, il fallut bien s’avouer que toute espérance de gloire scénique était vaine.
Catherine avait alors atteint ses dix-neuf ans. Admirablement belle, avec ces airs de jeune déesse qui trahissaient sa lignée; sans qu’elle s’en doutât, sa mère tenait en mains pour elle un superbe avenir, déjà presque décidé avec M. Cambrelu; lorsque l’objet de tant d’espérances tourna mal tout à coup, en s’éprenant imprudemment d’un jeune chimiste du nom bourgeois de Victor Surville, qui demeurait dans leur maison.
Ida Bonnard n’avait jamais soupçonné que sa progéniture pût égarer son cœur au profit d’un garçon n’ayant pour toute richesse que l’espérance et son travail. Elle jeta les hauts cris à l’idée d’un mariage qui mettait à vau-l’eau tous ses rêves.
Mais les jeunes gens s’aimaient. Il y eut de terribles luttes.
Que peut la raison sur des amours de vingt ans? On sait comment l’esprit vient aux filles. Les plus sages préceptes ont leur envers, et qui sème le vent recueille la tempête. Catherine, trop bien préparée par sa mère à des principes tout particuliers, trancha d’elle-même la question au profit de son cœur, et disparut un beau matin avec celui qu’elle aimait.
Ce fut une catastrophe. A son retour, Ida la maudit. Après quoi, devant un de ces résultats mûrissants dont l’évidence saute aux yeux, il fallut bien consentir à couronner la flamme de deux amants naïfs si bien intentionnés.
On les maria.
Ce que fut le bonheur des jeunes époux, quiconque a jamais aimé se l’imagine. Victor Surville avait vingt-cinq ans. De bonne famille, charmant, distingué, en plein dans ce courant jeune et militant de la science et des arts, laborieux avec ardeur, et ambitieux de gloire et de fortune, il s’était même déjà fait un nom par quelques travaux heureux.
Catherine se trouva donc tout à coup transportée dans un petit cénacle d’intelligences d’élite qui revivifia son esprit déjà cultivé, et la rattacha à des notions plus hautes. Ce fut une sorte d’éducation esthétique qui fit d’elle une artiste. Mais, en élargissant ses idées, ce train de camaraderie avait ses écueils. Animée, originale, une imagination folle, libre comme un garçon, avec une étrange faiblesse de caractère, se grisant de louanges, et toujours la proie de l’heure, son mari l’appelait la linotte. Trop belle enfin pour traverser, sans exciter des convoitises, ce monde vibrant où sa nature étrange soulevait des admirations enthousiastes, elle était aussi trop femme pour ne point ressentir l’orgueil de ce joli prestige qu’elle exerçait sans défiance, avec cette coquetterie naïve de toute jeune épousée sûre d’elle-même, et qui se délecte à jouer avec le feu. Ce triomphe dura deux ans.
Par malheur, retenu par des travaux, au moyen desquels il réussissait à doubler le budget du ménage, Victor Surville laissait de longues journées oisives à cette inexpérience, avide de sensations neuves et mal équilibrée pour la vie.... Il est des heures troubles où la raison chancelle et dont le péril imprévu n’apparaît qu’alors qu’il est trop tard pour le fuir. Ce fut, une fois de plus, pour l’infortunée Catherine, l’histoire rebattue d’une imprudence de pitié, une passion à consoler, une de ces surprises étranges où tant de femmes succombent.
Approfondisse qui voudra ce chapitre des inconséquences humaines; en plein bonheur, adorant son mari, en un jour terrible et néfaste, elle se réveilla d’une abominable chute sans pouvoir même se l’expliquer. Elle était perdue, voilà tout. Sa première pensée fut tout à l’épouvante; puis, comme il arrive toujours, sous la crainte qu’un acte de folie de son complice, qui ne valait pas grand’chose, n’amenât un éclat, il lui fallut continuer, aggraver sa faute, se cacher et mentir et ruser. Ce à quoi elle réussit si mal, égarée par son manque de toute raison, qu’elle se livra pour ainsi dire elle-même, . crevant les yeux de l’infortuné qu’elle trompait, et qui découvrit tout.
Un duel dont les causes demeurèrent ignorées s’ensuivit.
Victor Surville tua l’amant, et sans même revoir sa femme, affolée de ce qu’elle avait fait, il partit pour l’Amérique.