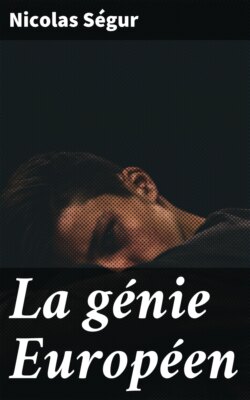Читать книгу La génie Européen - Nicolas Segur - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I LE CARACTÈRE
ОглавлениеLa fin du monde païen offre de grandes et héroïques figures d’ascètes. Affranchis presque de la religion, conscients de la laideur du monde et de ses petitesses, n’espérant rien de l’au-delà, ces sages se vengeaient de la fatalité en se recueillant en eux-mêmes et en tâchant de se faire meilleurs. La fin du dix-neuvième siècle vit dans le naufrage et le doute des croyances un pareil spectacle se reproduire, et les grandes âmes, tourmentées par cette disparition de tout espoir religieux, puisèrent dans la seule foi qui leur restait: la foi en la vérité et la science, une force morale, une grandeur de caractère, une vertu d’héroïsme qui les fait ressembler aux grandes physionomies de l’antiquité.
Nous vîmes encore de notre époque se former ces caractères tout pétris dans un noble stoïcisme, par lesquels la décadence romaine égala et surpassa le christianisme naissant. Car ce qui fait la supériorité d’un Marc-Aurèle, comme d’un Renan, d’un Taine, c’est que leur renoncement moral, leur discipline dans la vertu, leur durée dans le bien ne se fondent sur aucun espoir, sur aucune confiance aux récompenses futures. Par le seul culte de la dignité humaine, ces grands chrétiens sans foi persistèrent à demeurer purs, sereins et vertueux.
Et je crois que c’est à ce petit livre de Pensées tant lu, relu, commenté et adoré par l’auteur de la Philosophie de l’Art qu’il faut songer, en parlant du caractère d’Hippolyte Taine. Marc-Aurèle fut son maître et avec Homère la lecture de sa jeunesse. Il resta toujours son guide spirituel. Empoisonné prématurément par le scepticisme, «flétri, comme il le disait lui-même, dans toutes ses croyances», il se réfugia comme le roi stoïcien dans le calme de la contemplation et retrouva toutes les forces de l’ascétisme, les grâces et les supériorités de la pure foi chrétienne dans le respect de soi et dans le culte de la vérité.
Autant que Renan, il remplaça la sainte ferveur par une dévotion à la science, fondant des espoirs illimités sur le vrai. Il en parlait avec émotion et il y mettait presque de l’amour. En évoquant la science, il disait à Prévost-Paradol:
«Il faut une longue assiduité et un sincère, amour pour mériter ses faveurs et les obtenir. C’est pour cela que je ne cesserai de t’exhorter à te tourner vers elle et à te faire son fidèle serviteur. Je ne connais pas de joie humaine ni de bien au monde qui vaille ce qu’elle donne, c’est-à-dire l’absolue, l’indubitable, l’éternelle, l’universelle vérité.»
C’est presque l’accent mystique de Renan dans certaines pages de l’Avenir de la science et c’est la même foi, foi démesurée et sans espoir, seule foi demeurant debout au milieu d’un âcre pessimisme, d’une parfaite méfiance et d’une parfaite lassitude envers les hommes et l’humanité.
Le fond même du caractère d’Hippolyte Taine repose sur cette haute intégrité, cette passion fanatique pour la raison et la science. Ne croyant point à la bonté de la nature humaine, sûr au contraire de sa cruauté et de sa lubricité, de son double but de faim rapace et de brutal amour, il se retirera mentalement de la société, se fera ascète spirituel, vivant dans la communion de la nature.
«Je commence, écrivait-il en ses lettres de jeunesse, à renfermer mes désirs en un désir unique qui est celui d’éclairer mes idées et de résoudre mes problèmes... Je tâche de vivre en dehors du temps et de l’espace... Un travail acharné et une construction d’idées donnent un contentement profond et une paix absolue.»
Toutes ses joies sévères se résument dans la contemplation et il nous a laissé une page rappelant Epictète, où il parle de la seule vie digne du sage, qui est la vie solitaire et méditative, loin de la mêlée, dans la sereine et paisible immensité de l’univers. C’est la nature qui garde encore une influence sur lui et lui expliquant les hommes, le console de leurs imperfections. Dans ses pages sur la forêt de Fontainebleau, il en parle avec grandeur et, plus jeune encore dans ses lettres, il en parle avec tendresse véhémente. «...Je sentis mon cœur battre et toute mon âme trembler d’amour pour cet être si beau, si calme, si grand, si étrange qu’on appelle nature. Je l’aimais, je l’aime; je le sentais et je le voyais partout: dans le ciel lumineux, dans l’air pur, dans cette forêt de plantes vivantes et animées et surtout dans ce souffle vif et inégal du vent de printemps.» Et parlant de la compagne: «Pourquoi l’aimé-je tant? s’écrie-t-il. Pourquoi, lorsque je la vois, suis-je ému comme un amant, auprès de sa maîtresse? Pourquoi suis-je tout entier rempli d’une joie calme et parfaite?»
Ce caractère d’héroïsme pessimiste et de rectitude morale ne se tempère pas et ne s’éclaircit pas d’un sourire comme chez Ernest Renan. Au contraire, Taine montre une certaine raideur dans les opinions, une sûreté persistante et inébranlable, une confiance absolue en ce qu’il croit démontré juste.
C’est qu’au fond et malgré les préoccupations scientifiques, Taine était un moraliste et son esprit, respectueux de l’ordre et de la tradition, sans être le moins du monde un esprit chrétien, était quand même un esprit dénué de tout scepticisme, un esprit affirmatif et catégorique.
Déjà dans son pessimisme âpre, absolu, exagéré, dans sa sainte horreur de l’homme,—animal carnassier et chasseur,—il y a une irritabilité de prophète, quelque accent grave et biblique. C’est en moraliste qu’il parle quand il nous décrit notre férocité originelle, le triomphe omnipotent des instincts, la bête déchaînée qui dort ou s’éveille dans l’homme.
Il est vrai que dans ses commencements il affecte de ne pas se soucier des questions morales. Loin de les méconnaître ou de les mépriser, il les élimine, se contentant de faire, à propos des hommes, «de l’histoire naturelle».
Les préoccupations moralisatrices de Victor Cousin, l’abus d’abstraction utilitaire excitèrent même un jour sa verve et sa moquerie. Mais si on veut regarder attentivement dans sa pensée, on y verra que c’est par trop de probité et de rectitude qu’il s’efforce, à l’exemple des positivistes, de ne toucher à rien qui ne soit démontrable. Il veut que sa seule foi soit la foi scientifique. En morale comme en religion, il commence par vouloir ignorer «le dessous des cartes», comme disait Jouffroy; il ne s’intéresse qu’à en étudier le dessus, le seul que la nature consente à nous présenter.
Mais, peu à peu, les problèmes moraux se dresseront impérieux devant lui. Le philosophe qui voyait le bien et le mal, le vice et la vertu s’élaborer et se produire comme les substances chimiques, et n’étudiait dans l’homme que la sensation, sera bientôt attiré, par son honnêteté même, vers les questions sociales et sera amené à réfléchir sur le devoir et sur le bien.
Déjà devant une création d’art il commence à reconnaître le rôle prépondérant des sentiments moraux et quand, dans l’Idéal dans l’Art, il voudra se prononcer sur la valeur d’une œuvre, il ne trouvera plus haute et plus constante mesure que le degré de la «bienfaisance des caractères.»
Plus tard, quand les événements de sa patrie l’arracheront quelque peu à la contemplation, quand, portant un regard effrayé sur la foule, il verra pendant la Commune les convulsions d’un peuple libéré de freins et se jetant dans la violence ou le crime, il ressentira le besoin impérieux d’examiner l’histoire de la France contemporaine et de tâcher d’entrevoir un fondement moral des sociétés. La religion le hantera alors, et tandis qu’il dira, dans une phrase trop significative, qu’il estime heureux ceux qui ont trouvé la «sérénité du cœur», il reconnaîtra dans la foi la force essentielle et comme le pilier d’une nation.
Ce n’est pas qu’il adhère au christianisme, malgré les pages éloquentes des Origines. S’il croit que celle religion est encore pour 400 millions de créatures humaines «l’organe spirituel, la grande paire d’ailes indispensable pour soulever l’homme au-dessus de lui-même», s’il affirme que «le vieil Evangile, quelle que soit son enveloppe présente, est encore aujourd’hui le meilleur auxiliaire de l’instinct social», c’est qu’il se place au point de vue historique.
Amené à étudier l’histoire de l’Angleterre, il était détenu aristocrate dans ses opinions et s’était persuadé qu’il n’y a que le gouvernement oligarchique, la prépondérance d’une classe noble et éclairée, qui puisse aider à la prospérité d’une nation.
De même, quand il voulut se faire une opinion sur l’histoire contemporaine de la France, il crut y distinguer les suites funestes de la philosophie du XVIIIe siècle trop téméraire et qui prétendait abolir le passé, libérer les sociétés de toute contrainte et fonder une nouvelle Atlantide sur la raison instable de cette farouche et sanguinaire humanité. C’est alors qu’il se sentit pénétré de la force énorme de la tradition et de la foi. Les pages qu’il y consacra sont entre les plus profondes et les plus belles qu’il ait écrites et ne peuvent comporter, il faut le reconnaître, qu’une conclusion religieuse.
Aussi, se mettant à écrire Les Origines, il ne se soucie plus de la méthode de son cher Stendhal, il ne se résigne pas à nous montrer impassiblement les jeux des forces et le déchaînement des passions dans la Révolution. On le voit, au contraire, penché, inquiet, épouvanté, sur ses crimes et ses haines. Et il nous y apparaît enfin comme un moraliste farouche, maudissant, s’indignant, injuriant, éprouvant une aversion toute physique, la révolte de toute son honnêteté, de sa droiture, de sa pudeur morale devant «ce mardi-gras meurtrier et politique, cette formidable descente de la Courtille».
Dans son horreur de la force brutale, ce qu’il juge le plus capable de réprimer la bête, de la détourner du carnage, de la policer, c’est une religion, ce frein qui répond «à des besoins profonds, à des aspirations accumulées, à des facultés héréditaires, à toute une structure mentale et morale».
La prédominance fatale des questions morales pour l’historien, la nécessité d’un idéal religieux pour le peuple, voilà ce qui se déduit le plus clairement de ses Origines, cette œuvre contradictoire, mal conçue peut-être, inégalement exécutée, partiale, pamphlétaire par moments à force d’indignation, mais si riche, si éloquente, si puissante et qui grouille de la plus intense et de la plus profonde vie.