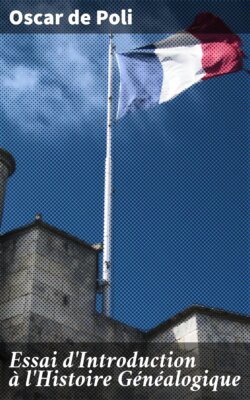Читать книгу Essai d'Introduction à l'Histoire Généalogique - Oscar de Poli - Страница 10
CHAPITRE VIII
ОглавлениеChrétiennes libéralités.—Grands repentirs.—Sobriquets vengeurs.—Surnoms élogieux.—Sous la bure des cloîtres.—Inhumés en habit religieux.—Chevalier moine.—Hugues Courtin.—Paupérisme.—Ubi Ecclesia, ibi miles.—Les Cartulaires monastiques.—Ce que le peuple doit aux Moines.—Ecoles vraiment gratuites.—Marmoutier et Cluny.
Le sentiment de la foi chrétienne dictait ces nobles libéralités, toujours faites pour le repos de l'âme du donateur, de ses parents, de ses amis[43]. C'est ainsi qu'en 1230 Dreux de Mello, seigneur de Loches et de Mayenne, affranchit à perpétuité de toute espèce d'impôts ses vassaux de Saint-Mars-sur-la-Futaie[44], et qu'en 1264 le seigneur de Bagneux exempta les siens de presque toutes charges[45]. Ce n'est pas à dire que tous les Nobles fûssent aussi larges, ni qu'ils fûssent tous parfaits; pour être seigneurs, ils n'en étaient pas moins hommes, avec toutes les faiblesses de l'humanité; mais, ce qu'oublient de relater les détracteurs systématiques du passé, les plus endurcis et les plus puissants, avant de paraître devant Celui qui juge les justices, avaient à cœur de réparer les torts ou le mal qu'ils avaient faits[46]. C'était sous l'influence vénérée de la Religion que germaient dans les âmes ces grands et admirables repentirs qui ne sont pas le moindre honneur des temps féodaux; et parfois, pour marquer sa contrition du sceau de l'humilité, le seigneur prenait non ses pairs, mais ses serfs à témoins de ses restitutions[47]. Pour un seigneur dur à ses vassaux et flétri d'un sobriquet vengeur, comme Guillaume Talvas[48], combien, comme les Lusignan, furent surnommés «le bon» par la reconnaissance de leurs sujets! «Les peuples, dit un ancien héraldiste, préfèrent un seigneur noble à un non-noble. Bienheureuse est la terre, dit l'Ecclésiaste, dont le Roi est noble[49]!»
Maints chevaliers, après avoir valeureusement servi leur Prince, allaient terminer leurs jours sous la bure des monastères, pour ne plus servir que leur Dieu[50]. C'était l'heure des expiations magnanimes. Des rois et des empereurs voulurent cette fin pieuse[51], et les cartulaires monastiques sont pleins de ces généreux renoncements. Les preux qui n'avaient pu accomplir dans le cloître cette suprême retraite préparatoire, voulaient au moins mourir sous l'habit religieux, «suivant un usage très suivi au moyen âge par la piété des latins comme des grecs[52].» Baudouin II, roi de Jérusalem, mourut sous l'habit des chanoines du Saint-Sépulcre[53]; l'empereur Jean de Brienne, sous celui des fils de saint François[54]. Dans les nécrologes du XIIIe siècle, des personnages sont qualifiés «chevaliers et moines.»[55] Dante voulut être inhumé en habit religieux[56].
Les nobles dames pratiquaient également cette dévotion; telles, Marguerite Escaface, en 1331, et Marguerite Mesnagier, en 1340[57]. Au même temps, Pierre de Bailleul et Mathilde d'Estouteville, sa femme, «furent inhumez estans revestus de l'habit de sainct Françoys; c'estoit une dévotion assez ordinaire en ce temps-là, de se faire inhumer avec l'habit de sainct Françoys, comme fist Marguerite d'Yvetot, dame de Goderville, qui gist sous une tombe auprès de la sacristie[58].» Comme fit aussi Hugues, dit Huet Courtin, seigneur de Soulgé, en 1330[59].
Le clergé par l'aumône, la féodalité par son fractionnement, prévinrent cette plaie sociale qui, grâce au désordre révolutionnaire, devient gangreneuse sous le nom barbare de paupérisme. L'Eglise, en façonnant à son esprit les maîtres des peuples, travaillait autant pour le bien des âmes que pour le bien-être des hommes. Ubi Ecclesia, ibi miles, disait un adage des temps chevaleresques. L'Eglise, en effet, était le chevalier des petits en face des grands, et les moines rivalisaient de dévouement avec le clergé séculier sur le terrain de la bienfaisance et du bien public. Il semble aux esprits superficiels que la Noblesse doive seule l'hommage de la gratitude à ces Religieux dont les cartulaires nous retracent clairement ses mœurs, ses chevaleresques ardeurs, ses vaillantises, ses actes de foi, ses œuvres de charité, ses grandes fautes chrétiennement rachetées par de grands repentirs, et constituent de précieux témoins généalogiques, en même temps que de lumineux jalons pour l'histoire de la civilisation française. C'est le peuple surtout qui doit aux moines un hommage filial de gratitude. Combien de «lieux incultes, sans chemins, repaires de bêtes fauves»[60], défrichés de leurs mains, fécondés de leurs sueurs, devenant des sources de richesse agricole! Et quels généreux emplois de leurs biens[61]! Les malades, les pauvres, les infirmes, les déshérités n'étaient pas leurs seuls favoris; à côté du cloître, il y avait toujours une école, vraiment gratuite, celle-là, riche des dons des générations et ne coûtant rien aux contribuables. Les moines de Marmoutier donnaient l'instruction partout où ils avaient des possessions[62]; tous les ordres religieux, et nombre de seigneurs à leur exemple, faisaient de même, «et le plus grand prince n'était pas élevé avec plus de soins dans le palais des Rois que ne l'était à Cluny le plus petit des enfants[63].»