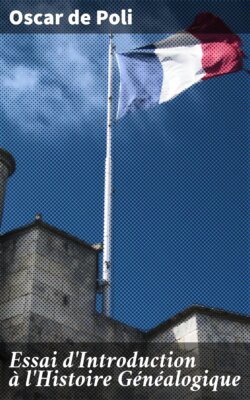Читать книгу Essai d'Introduction à l'Histoire Généalogique - Oscar de Poli - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE IX
ОглавлениеTable des matières
L'Eglise et la Nation.—Devise de Césène.—Sous la houlette.—Liberté céleste et liberté terrestre.—Serfs volontaires.—Niaiserie républicaine.—Les roturiers et le droit de propriété.—Pillages et gaspillages révolutionnaires.—Les abbayes et l'aumône journalière.—Spoliations ingrates.—Patriotisme du clergé de France.
Fidèle dans tous les temps à sa grande mission nationale et sociale, l'Eglise apparaissait aux peuples comme une auguste bienfaitrice, comme une mère; volontiers ils eussent pris, comme Césène, pour devise: Ecclesiastica libertas[64]! Ils disaient proverbialement qu'«il fait bon vivre sous la houlette», et quand l'autorité royale, punissant un mauvais seigneur, les dégageait de l'obéissance féodale, ces hommes libres couraient se placer avec leurs terres dans la vassalité du monastère voisin, comme sous une égide plus sûre et plus digne que la liberté même[65].
On ne feuillette pas un cartulaire sans rencontrer en abondance les marques de l'amour de l'Eglise pour les humbles, et de la reconnaissance de ceux-ci[66]. Il y a dans le cartulaire de Marmoutier une admirable charte dans laquelle les moines promettent «la liberté céleste» à ceux qui donneront à leurs serfs «la liberté terrestre»[67]; et, dans cette voie généreuse, l'Eglise prêchait aussi d'exemple[68]; mais, à la suite d'une charte d'affranchissement, il n'est pas rare d'en trouver une par laquelle un homme libre se déclare serf de telle abbaye et lui fait don de sa personne et de ses biens[69]. Les indigents étaient les véritables bénéficiaires de ces pieuses libéralités, dont les plus hauts seigneurs ne s'exemptèrent pas; en 1118, à Lamballe, en présence des barons et des bourgeois, le vicomte Geoffroy se fit serf de Marmoutier[70]. Toutes les classes manifestaient à l'envi leur filiale dévotion, et les chartes qui la constatent servent à montrer ce qu'il faut penser de cette niaiserie républicaine: que le droit de propriété, pour les roturiers, date de la révolution. En 1364, c'est Macé Jardin, mercier de Beaulieu, qui donne ses héritages à l'abbaye de Baugerais[71]; vers 1170, un paysan, Robert, qui donne à Saint-Georges de Hesdin deux champs qu'il avait hérités de son père[72]; en 1140, un cuisinier propriétaire de vignes, dont une jure paterno[73]; vers 1115, un homme du peuple, Gosbert, qui donne un champ à N.-D. de Josaphat[74]; vers 1100, un sellier de Chartres, qui donne sa maison aux moines de Saint-Père[75]; au XIe siècle, un paysan qui donne sa vigne à Saint-Etienne de Dijon[76]; vers 1040, «un pauvre homme» qui donne son moulin à Saint-Vincent-du-Mans[77]. Nous voilà loin de la révolution! Quand elle dépouilla les moines pour gaspiller misérablement leurs biens, les départements durent s'imposer pour fournir à l'aumône journalière fondée par les abbayes[78]. Quand elle dépouilla les églises, il n'y avait pas six ans que l'assemblée générale du Clergé de France, fidèle à ses séculaires traditions, avait voté la somme d'un million «pour être employée au soulagement des matelots blessés et des veuves et orphelins de ceux qui ont péri pendant la guerre.» De quel côté, je le demande, étaient la raison patriotique, l'amour de la France et du peuple?