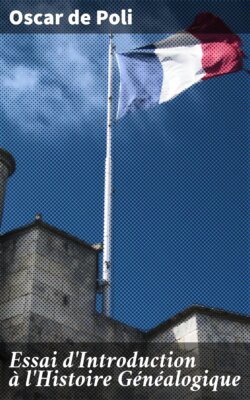Читать книгу Essai d'Introduction à l'Histoire Généalogique - Oscar de Poli - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE X
ОглавлениеTable des matières
Le servage, l'Église et la féodalité.—Louis X et les serfs. Feudophobes.—Sujétions infamantes.—Le fief, base de l'État.—Affranchissements.—Serfs maires, comtes et hauts justiciers.—Serf ayant des esclaves.—Riches laboureurs.—Vieilles familles patriarcales.—Le Sire de Coucy, otage pour un paysan.—Taillables à merci.
Les détracteurs du régime féodal inclinent à lui imputer la paternité du servage, triste rejeton de la barbarie payenne, quand, au contraire, c'est à partir de l'organisation de la féodalité que, sous l'impulsion de la civilisation chrétienne, le servage tend à disparaître. Assurément c'était un état contraire à la dignité de l'homme, mais était-il vraiment ce que nous le voyons, à travers les buées du sophisme, avec les yeux de notre temps? On a peine à le croire, lorsqu'on voit les serfs refuser la liberté que Louis X leur voulait octroyer[79]. On s'apitoie exclusivement, dans les sphères où sévit la feudophobie, sur ces infortunés ruraux rivés à la glèbe, ne possédant rien en propre, ne pouvant se marier sans l'aveu du seigneur, transmis à titre d'héritage «comme un vil bétail»; encore passè-je sous silence les sujétions infamantes, inventées par les feudophobes et dont, après Louis Veuillot, le savant comte Amédée de Foras, l'un des Présidents d'honneur du Conseil Héraldique de France, vient de faire magistralement justice[80]. Il n'est plus permis d'ignorer que l'organisation féodale comportait, à tous les degrés de l'échelle sociale, des servitudes convergeant toutes à la défense de la patrie. Le fief était la base de l'Etat: comment le seigneur eut-il acquitté les services qu'il devait au Roi, si ses vassaux avaient eu le droit de déserter son fief sans indemnité, sans compensation? Les plus nobles ne pouvaient se marier sans l'agrément de leur suzerain, et c'était encore la raison d'Etat, une raison d'ordre qui dictait cette précaution, toujours en vigueur dans les familles régnantes: il fallait que la sûreté du petit état féodal ne pût pas être compromise par quelque alliance intempestive ou dangereuse. En 999, nous voyons des hommes libres, des «Francs» transmis, comme des serfs, avec leurs héritages[81]: pour ceux-ci comme pour ceux-là, la transmission doit s'entendre seulement des services dûs par leurs héritages. Quant à la question de propriété, je l'ai déjà touchée; c'est une simple absurdité que de prétendre que le serf ne pouvait posséder en propre. Les chartes abondent par lesquelles des serfs achètent leur affranchissement; avec quoi, s'ils n'eussent rien possédé? En voici un qui, en 1097, est propriétaire et maire[82]; un autre qui a lui-même un esclave et lui octroie la liberté[83]; il y en eut qui devinrent comtes, c'est-à-dire gouverneurs militaires et civils, délégués de la puissance souveraine[84]. J'en vois un qui, vers 1099, ayant cessé d'être de condition servile, possède un fief dont il a la haute justice[85]. En 1273, Guillaume Poulain, tourneur, inféode une partie de son bien à un autre tourneur, moyennant un cens annuel et perpétuel, et revêt de son sceau la charte d'inféodation[86]. Il avait également son sceau, ce paysan normand qui, en 1256, contracte avec l'abbaye de Savigny[87]. L'inventaire de ce que possédait, en 1382, un «pauvre laboureur», relate «troys chevaulx, une vache, deux veaulx de let, une charrue et ses rouelles, deux colliers,» etc[88]. Mais ce «pauvre» serait presque riche aujourd'hui! Plus près de nous, en 1601, «Claude Saulnier, laboureur de la parroisse de Roanne», vend à Antoine Courtin «ses terres et domaines[89]», qui constitueraient de nos jours une fortune considérable. Le 24 mars 1626, «en la présence de leurs preudhommes», les enfants de «Jean Farges, laboureur de la parroisse de Riorges», partagent la succession paternelle, et il faut vingt-quatre pages in-quarto pour détailler les prés, terres, bois, etc., qui la composent[90]. Si l'on creuse jusqu'au fond de l'ancienne société française, on rencontre un peu partout de vieilles familles patriarcales de cultivateurs, se transmettant de génération en génération, à travers les siècles, des propriétés de concession féodale et, comme la part la plus belle de leur héritage, l'esprit de foi, de devoir, de probité, de respect de soi-même et d'autrui[91]. Tout cela dément radicalement le mensonge révolutionnaire. Et que penser de l'oppression féodale, lorsque nous voyons de hauts et puissants seigneurs comme le sire de Coucy se faire plèges et otages pour un paysan[92]? D'ailleurs, ce qui démontre irréfutablement que la classe non noble ne fut pas, comme aujourd'hui le contribuable, taillable à merci, dans le sens sophistiqué qu'entendent les feudophobes, autrement dit ruinable à merci, et qu'elle avait de sûrs et durables profits, c'est qu'à toutes les époques de notre histoire on voit des marchands, des artisans, des laboureurs acquérir des biens fonciers, tandis que s'émiettent les domaines de la classe noble, incessamment appauvrie, fatalement poussée à la ruine par les dispendieuses obligations de son état.