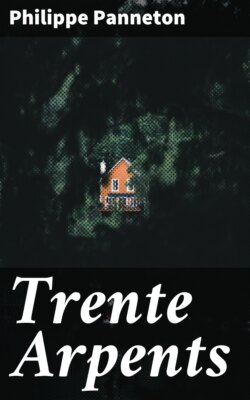Читать книгу Trente Arpents - Philippe Panneton - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
ОглавлениеTable des matières
Le poêle est allumé dans la cuisine des Moisan. C’est qu’avec la noirceur est survenue la pluie, une de ces lavasses d’octobre, violente, drue, froide, que le vent d’est ramasse en paquets pour la jeter aux carreaux avec des claquements de linge mouillé. Inutile pluie d’automne, vieille fée méchante arrivant sans invite sur le tard, rageuse qu’avant elle soient passées les pluies de juin, généreuses et fécondantes; jalouse aussi des pluies de fin août qui peuvent en une nuit pourrir le grain laissé sur le pré. Pluie d’automne est impuissante à bien ou mal faire. Elle ne peut que tambouriner sur le toit, brasser les flaques de boue de la route et télégraphier sur les vitres d’indéchiffrables dépêches.
Mécaniquement, l’horloge coupe les heures en minutes, débite les minutes en secondes. Sur le poêle chante la bouilloire, sous le poêle ronronne le chat. A côté du poêle, tout aussi frileuse, la vieille Mélie sommeille dans son voltaire. La lampe allumée au mur, près de la fenêtre pour éclairer le perron, n’accuse d’elle que la boule ronde de son béguin serré. Ephrem Moisan oscille doucement dans sa berceuse, au rythme de la pendule. La seule tache claire de la pièce, hormis la lampe, est un reflet sur son crâne, entre deux touffes d’ouate blanche au-dessus des oreilles. Il est vieux et cassé de porter sur ses épaules le poids de soixante labours, de soixante moissons.
Un grincement prolongé, puis dix fois de suite la pendule fait mine de sonner; mais le marteau tombe à vide, comme un cœur qui s’arrête. Les épaules de Mélie sursautent et sa figure soudain relevée fige ses rides dans la lumière. Ephrem Moisan se penche sur sa berceuse qui craque:
—T’as ben dormi? fait-il en frappant sèchement le fourneau de sa pipe sur son talon, au-dessus du crachoir plein de sciure.
—Si on peut dire! Seigneur Jésus! J’ai pas dormi! J’écoutais la pluie. Ça tumbe, ça tumbe!... Ephrem, y s’en va su les neuf heures, ça sera pas long que Charis va rentrer.
—T’as p’t’êt’ pas dormi, mais ça empêche pas qu’il est dix heures sonné, ma tante.
Pour Ephrem, c’est sa tante, quoiqu’il n’y ait entre eux qu’un bien lointain cousinage, «du trente et un au trente-deux», dit-il quand on le fait préciser. Mais Amélie était dans la famille depuis longtemps, depuis quasiment toujours, puisqu’elle avait bercé Ephrem, et Honoré, le père d’Euchariste, et Eva, morte en communauté chez les Sœurs Grises à Montréal, et les autres, les cinq enfants du grand-père Moisan dont pendait au mur le portrait au crayon. Cela représentait un brave vieux à la barbe en collier auquel l’artiste ambulant n’avait pu donner un air grave, tant souriaient bonnement mille petites rides au coin des yeux. C’est lui qui avait recueilli Amélie dans sa maison où elle avait vécu d’abord un peu comme une servante. Puis à mesure que les anciens mouraient et que les enfants quittaient ses genoux, elle entrait insensiblement dans la famille. Depuis longtemps elle n’a eu à qui chanter:
C’est la poulette grise,
Qu’a pondu dans la remise,
Elle a pond un beau petit coco...
Mais elle règne sans conteste depuis la mort de Ludivine, la femme d’Ephrem. Elle a gardé pour «ses pauv’s enfants» une tendresse déférente et grognonne, se contentant de grommeler des «C’est-y Dieu possible!...» et des «Comme de raison!...»; heureuse quand l’un ou l’autre, l’oncle ou le neveu, la bouscule un peu pour la taquiner.
On monte les degrés du perron. Des pieds lourds sont secoués sur le seuil et la porte s’ouvre.
—C’est-y toé, Charis? dit le vieux machinalement.
Qui pourrait-ce être d’autre, dans cette maison qu’eux trois seuls habitent?
—C’est moé, mon onc’.
Enlevant son veston mouillé, il reste un moment le bras en l’air, distrait. Tante Mélie trottine vers lui.
—Ça a-t-y du bon sens, te v’là trempé comme une lavette. D’ousque tu d’sors? Arrives-tu du fort?
—Ben, non, ma tante.
Elle dit encore le fort, en parlant du village, comme les vieux colons d’autrefois dont le refuge était une misérable palissade enfermant les maisons et sur les pieux de laquelle venaient à l’improviste se planter les flèches iroquoises. Elle demande cela comme si elle ignorait qu’il vient de chez Branchaud.
Pour lui aussi, comme pour son oncle, elle est «ma tante». Ce qu’elle fut pour son père et pour les frères de son père, elle l’a été pour lui. Sur ses genoux il a entendu raconter les mêmes éternelles histoires, les contes avec quoi s’endorment les enfants de tous les pays du monde: le Petit Poucet et les innombrables variantes du cycle aventureux de Ti-Jean.
Euchariste le disait au père Branchaud; ça a refait une famille. L’oncle Ephrem: veuf d’une femme stérilisée par une faiblesse constante, emportée finalement par une consomption tardive alors que lui était trop jeune encore pour abandonner la terre et surtout, pour la vendre, trop lié à cette même terre par une servitude millénaire. Amélie: une étrangère ou quasi; Amélie Carignan, arrière-petite-fille de quelque soudard venu de la Picardie ou du Maine avec le régiment dont elle avait gardé le nom. Euchariste enfin: du sang des Moisan, mais arrivé un jour en étranger aussi des terres neuves du Nord, vers cette paroisse de ses grands-pères qui pour lui n’était pas la patrie, la petite patrie restreinte que seule connaissent les paysans. Ces trois-là pourtant s’étaient fondus en une famille nouvelle; ces pièces différentes avaient été cousues les unes aux autres sur la trame solide de la terre ancestrale. La terre, impassible et exigeante, suzeraine impérieuse dont ils étaient les serfs, payant aux intempéries l’avenage des moissons gâtées, assujettis aux corvées de drainage et de défrichement, soumis toute l’année longue au cens de la sueur. Ils s’étaient regroupés sur et presque contre la dure glèbe dont on ne tire rien qui ne lui soit arraché à force de bras. Par sa volonté muette, ils avaient reconstitué la trinité humaine: homme, femme, enfant; père, mère, fils.
Et voilà qu’un cycle de plus s’étant clos avec l’automne venu, la terre engourdie déjà par les premières gelées allait endormir la ferme qui ne vivrait plus que de la vie restreinte de l’hiver. Les champs tireraient sur eux-mêmes une lourde couverture de neige. Ils reposeraient cinq longs mois, oubliés de ce soleil débile et fugace, impuissant à traverser de sa chaleur amoindrie la carapace de froid moulée sur la terre.
C’est cette hibernation qui allait commencer pour les choses, et pour les hommes qui partiellement dégagés des obligations de leur servage pourraient un peu penser à eux-mêmes et préparer les moissons futures de blé ou d’humanité. L’hiver est le temps de l’année où l’on coupe le bois, répare les bâtiments et les harnais, refait les clôtures; et l’hiver est aussi la saison où l’on se marie.
L’oncle Moisan savait tout cela. Sans les pouvoir formuler, il connaissait les lois de la terre. C’est pourquoi, d’un dimanche à l’autre, il s’attendait à ce qu’Euchariste lui annonçât son prochain mariage.
—Qu’est-ce qu’on chante de bon à soir, chez les Branchaud? demanda-t-il.
—Rien d’extraordinaire. Ils sont en train de lever les fossés du trécarré. Ils vont commencer demain à labourer, comme nous autres, si c’te maudite pluie-là peut s’arrêter.
Mais la pluie continuait à battre la retraite de l’été, accompagnant la mélopée du vent brutal qui arrache aux arbres les feuilles caduques et quand il ne le peut, casse net la branche.
Les minutes passaient martelées par la vieille horloge et tous se taisaient. Euchariste se leva, alla vers la pompe, but un coup d’eau, se rassit, alluma sa pipe, se releva, alla à la fenêtre, puis se retournant lâcha les grandes nouvelles:
—On s’est parlé, le père Branchaud pi moé, l’aut’jour.
L’oncle figea soudain le bercement de sa chaise et, le corps penché vers son neveu, le coude appuyé sur le genou, la pipe suspendue en l’air dans l’expectative, tout son vieux corps bandé de curiosité, il demanda d’une voix indifférente:
—Pi, y est consentant?
—J’cré bien qu’ça va se faire dret après les labours du printemps. Si vous voulez, c’t’hiver je vas arranger la vieille maison du père. Quand qu’a sera calfatée, avec quéques bardeaux qui y manquent, et pi un bon renchaussement tout le tour du solage, on sera pas mal, Alphonsine pi moé, en attendant la famille.
Depuis que son père était allé tenter fortune sur les terres neuves, la vieille maison des Moisan était restée inanimée et morte, la cheminée bayant comme une bouche sans vie, les carreaux ternis comme des yeux éteints. La vraie maison des Moisan désormais était la maison neuve bâtie par le père de l’oncle Ephrem. Un corps principal recouvert d’un toit à pans coupés et flanqué d’une aile toute semblable un peu en retrait, plus petite et qui était la cuisine. Tout cela en bois recouvert d’un badigeon jaunâtre. Derrière la véranda courant tout le long de la façade était d’une part le salon, aux volets hermétiques qu’on ne poussait qu’en deux occasions: l’annuelle visite paroissiale de M. le curé, et les rares fois où un Moisan de la ville venait passer quelques heures, au jour de l’An, par exemple, chez les Moisan de la campagne. A côté, éclairée par la seconde fenêtre de la maîtresse façade, une chambre vague, sans destination précise mais qui, du vivant de tante Ludivine, servait quelquefois la semaine aux veillées ordinaires. Derrière le salon, la chambre à coucher, avec, au milieu, le lit de bois recouvert d’une courtepointe à carreaux éclatants et, sur le sol, une descente de lit en catalogne. Aux murs des lithographies à bon marché: le Christ et, faisant pendant, la Vierge, vous regardant tous deux; le Fils, châtain; la Mère, blonde. Tous deux d’un geste identique offraient un cœur, l’un ouvert d’une blessure pleurante de sang et couronné de flamme, l’autre rayonnant des sept glaives de douleur. Au-dessus du lit, son cadre surmonté d’un rameau bénit de sapin, une Sainte-Face au visage anguleux et torturé.
Un escalier encombrait la pièce voisine, conduisant aux chambres mansardées du haut. Une porte, à l’opposé, donnait sur la cuisine où l’été on mangeait, où l’on vivait l’hiver et que l’on ne quittait que pour aller, le matin, reprendre le joug quotidien; le soir, après une veillée enfumée, étendre sur les lits durs des membres recrus.
—Comme de raison, reprit tout à coup l’oncle Ephrem, t’aimerais p’t’êt’ ben mieux être tout seul avec ton Alphonsine. Mais j’ai pour mon dire que vous seriez si tant mieux dans c’te bonne maison ’citte, qu’est plus confortable. Tu prendrais la grand-chambre. C’te chambre; elle serait pour sûr contente de voir enfin un p’tit enfant, puisque j’ai pas eu c’te chance-là avec ma Ludivine.
—Mais vous, mon onc’?
—J’vas t’dire, mon gars, j’commence à sentir l’âge. J’ai soixante-quatre fait! J’men va su’ soixante-cinq. Les rhumatismes m’ont poigné dur depuis trois ans et j’cré que la terre veut pu d’moé; elle est pu bonne pour moé. Ça fait que j’avais pensé à m’en aller rester au village avec Mélie. Tu prendras la terre comme si qu’elle était à toé, un peu plus tôt, un peu plus tard! Tu me paierais une petite rente, quelque chose comme dix du cent su’ ta récolte. J’ai quelque cent piastres chez le notaire, mais j’aimerais autant pas y toucher parce qu’on sait jamais c’qui peut nous timber d’sus su’ les vieux jours. Qu’est-ce que t’en dis?
—Faites à votre idée, mon onc’, malgré que ça me ferait d’la peine de vous voir partir.
—J’s’rais pas ben loin. Pas tout à fait trois lieues. Tu viendras nous voir le dimanche au village avec Phonsine. Tu seras reçu comme un monsieur et ça me fera quéque chose de voir tes p’tits Moisan. J’avais peur que la graine s’en perde.
—Avec Phonsine pi moé, y a pas d’danger de ce côté-là, mon onc’, dit Euchariste.
Elle se présentait à son esprit telle qu’il l’avait tenue près de lui tout à l’heure en la quittant sur la véranda des Branchaud, et surtout telle que la devinait goulûment son désir d’homme: la poitrine solide et généreuse, la bouche un peu lourde, les hanches larges oscillant avec un mouvement presque de berceau. Il se sentait le cœur réchauffé d’un contentement dont les vagues frappaient ses tempes à coups répétés. Il allait récolter plus que jamais n’avait semé son imagination contenue par les bornes étroites de l’habitude. Une chaleur lui était déjà montée au cœur quand entre lui et Branchaud étaient passées les paroles qui lui assuraient le corps désirable de cette belle fille et près de lui, pendant des années, sa vaillante et douce présence. Puis il avait gagné sur le père Branchaud de lui faire sortir ses écus.
Et voilà que, par surcroît, il allait devenir le maître de la vieille terre des Moisan. C’est lui qui désormais déciderait que tel champ serait emblavé, tel autre laissé en pacage pour les bestiaux; le foin serait coupé et vendu à son prix. Tout dépendrait de lui. Et toutes les choses de la terre et lui-même ne dépendraient plus de rien que de la terre même et du soleil et de la pluie. Trop économe pour louer un tâcheron, trop vieux pour quotidiennement peiner, l’oncle Ephrem, même avec son aide, ne pouvait tirer de ce sol toutes les richesses dont ses flancs étaient gros. Lui, Euchariste, pourrait désormais s’adonner sans réserve aux labeurs que demande la terre. Si pour un temps des bras mercenaires devraient l’assister, des fils bientôt naîtraient des chairs mêlées de sa femme—de sa femme!—et de lui.
—C’est une bonne terre, Charis, une ben bonne terre, dit le vieux, presque à voix basse.
Ainsi, son esprit avait suivi celui de son neveu en un vol parallèle. Il avait repassé l’un après l’autre les champs de son domaine, supputant le rendement de chacun et revivant leur histoire particulière. Car les prés ont leurs années de succès et de défaite. Le champ voisin de la terre des Mercure où, l’année d’après la mort de son père, il avait récolté vingt minots d’orge à l’arpent. Et cette bande étroite de terrain, au bord de la rivière, qui chaque année inondée lors des crues, reparaissait chaque fois après le retrait des eaux mais diminuée chaque fois, rongée par les glaces qui emportaient vers la mer des boisselées de bonne terre; cette étroite bande de terrain qui néanmoins, chaque année, donnait ses cent minots de patates, plus généreuse à mesure que plus circonscrite.
Il allait donc quitter tout cela pour vivre doucement au soleil, fumer sa pipe et jouer aux dames les longues journées, et causer des nouvelles de la terre, la terre des autres. Il avait dit ce qu’il fallait, bien sûr, et il ne pouvait songer à rester sur la ferme tout caduc et tordu de douleurs à la moindre menace de pluie. Mais il regrettait presque de déserter ainsi. Son neveu saurait-il tirer de la terre bonne mesure? Saurait-il surtout ne pas la fatiguer, la tarir?
Il s’était donné à son neveu, selon l’expression consacrée. Lui dont la subsistance avait jusque-là dépendu d’une saute de vent, d’une nuée chargée de grêle, répugnait à dépendre d’un autre humain aux caprices plus imprévus que les intempéries. Car on peut savoir que l’hiver sera tardif à ce que les écureuils n’ont pas encore commencé à amasser leurs provisions au creux des saules. Les premiers croassements des corneilles revenues avertissent de se préparer aux labours du printemps. Mais quel signe jamais peut faire prévoir le temps qu’il fera dans le cœur de ceux de qui l’on dépend?
Au dehors, la pluie avait cessé, avalée par les nuages ronds comme des outres que le vent roulait vers l’ouest. La vieille Mélie, réveillée par le silence revenu, se mit à réciter la prière du soir, dans un demi-sommeil. Les deux hommes, à genoux, la pipe à la main, répondaient sans que leur pensée à chacun fût détournée de son cours identique. Les pipes vidées dans le poêle, à petits coups précis, Mélie ayant bu comme tous les soirs une gorgée d’eau bénite, l’escalier craqua sous les pas de la vieille et d’Euchariste. Dans sa chambre du rez-de-chaussée le père Moisan toussa, cracha, se moucha longuement.
Puis plus rien que, au dehors, le vent qui plaquait aux carreaux des feuilles noyées; au dedans, le pouls lent de la pendule et, sur le parquet, le reflet clignotant des derniers tisons.