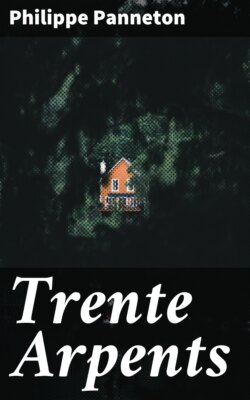Читать книгу Trente Arpents - Philippe Panneton - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VI
ОглавлениеTable des matières
—’Charis!... ’Charis!...
La voix lourde d’angoisse remplit le silence et les ténèbres.
—’Charis!
Euchariste dormait d’un sommeil massif avec, par intervalles, un ronflement.
—’Charis!... Aââh!... ’Charis!...
Il sursauta, se retourna brusquement et répondit d’une voix épaisse qui continuait son rêve:
—Laisse faire, j’y ai dit d’laisser la jument tranquille.
Mais Alphonsine insistait, le poussait du coude:
—’Charis!... Lève-toé!...
—Ouais!
Il s’était assis dans le désordre des couvertures, la tête subitement lucide, mais les membres gourds de sommeil.
—Qu’est-ce qu’il y a, ’Phonsine? C’est-y que t’es malade?
—J’ai mal dans le corps, c’est effrayant. Ah! que ça fait donc mal!
Mal éveillé, il hésitait à passer de la tiédeur du lit à la chambre glacée par l’hiver et que les ténèbres faisaient plus glaciale encore. Mais un gémissement de sa femme le mit debout dans un sursaut. Tante Mélie, tirée de son léger sommeil de vieille, entra portant une lampe allumée. Elle se pencha sur Alphonsine qui geignait doucement, dents serrées, à chaque nouvelle douleur qui lui déchirait les entrailles et contractait ses membres.
—Ous’que c’est que ça fait mal, comme ça? dit la vieille.
—Ça me poigne dans les reins pi ça... âââh! pi ça me tord en dedans. Je sais pas c’que j’ai mangé à soir au souper; mais c’est comme si j’avais pris d’la poison.
—Ça fait-y longtemps que t’es de même, dit Mélie.
—Ça fait depuis hier que j’ai les rognons sensibles; mais c’est d’à soir seulement que ça me tire de même.
—Mais pourquoi est-ce que tu l’disais pas, étou? reprit la vieille. Va atteler, ’Charis, pi vas qu’ri l’docteur tu’ suite. Pi toé, ’Phonsine, inquiète-toé pas. C’est un mal de ventre mais un mal de ventre de mariage. Dépêche-toé, ’Charis.
—Ma tante, ma tante, j’cré que j’vas mourir!
C’était là le cri instinctif qui lui venait; non pas de terreur mais presque de désir de la mort comme une évasion devant le martyre qui la guettait: ce chemin de croix dont elle avait deviné chaque station souffrante à travers les réticences et les encouragements de celles qui y avaient passé. Dans les derniers temps de sa grossesse, elle allait de l’une à l’autre, sous couleur d’emprunter ici du pain, là du fil. Et à chacune elle posait timidement la même question, avec une espèce de pudeur craintive qui cherchait à se rassurer. On lui répondait: «C’est d’la misère, mais ça dure pas longtemps», et l’on parlait d’autre chose, tandis qu’elle restait là, les tempes moites, à se ronger les sangs.
Et voilà que maintenant son heure était arrivée, annoncée par ces vagues lentes de douleur qui pourtant n’étaient—elle le sentait—qu’un prélude.
—Reste pas couchée, ’Phonsine, lui conseilla la vieille qui s’affairait. Quiens-toé debout! les mains su’l’dossier d’une chaise. Quand ça fait mal, serre fort. Pendant c’temps-là, j’vas aller chauffer le poêle. Après ça, j’te frotterai le ventre avec du beurre. I’y a rien de mieux!
Cela durait encore quand la voiture revint avec le docteur qu’il avait fallu aller chercher au village. Euchariste vit la porte se fermer devant lui; il resta seul dans la cuisine, bouleversé plus par son inutilité que par l’inquiétude, tandis que de temps à autre un cri plus strident le raidissait sur sa chaise.
Cela dura jusqu’à l’heure du midi, jusqu’au moment où la porte ouverte lui montra Mélie penchée sur le lit ravagé où gisait Alphonsine les yeux clos et les membres inanimés, pâle comme une morte avec ses longs cheveux tressés. La vieille tante tenait dans ses mains une petite chose vagissante enveloppée de langes blancs:
—C’est un garçon. ’Phonsine! pi un beau!
Alphonsine tourna faiblement les yeux vers son fils, toute surprise que cet être, si menu qu’il semblait noyé dans ses vêtements de nouveau-né, ait pu lui coûter tant et de si longues douleurs. Mais en même temps envahie par une joie triomphante et profonde: l’indicible joie d’avoir créé.
Elle n’eut jamais cru qu’après sa maladie les forces lui reviendraient si vite. Le cinquième jour elle avait repris sa place dans la cuisine, un peu faible encore certes, en dépit de sa vaillance, mais retrouvant une vigueur nouvelle au contact maternel de son petit, chaque fois qu’elle tendait à cette bouche avide le sein gonflé.
Sous quel nom serait-il baptisé? Grand sujet de discussion. D’abord Joseph, bien entendu, puisque tous les garçons doivent s’appeler Joseph et toutes les filles, Marie. Mais ensuite? Mélie voulait Ephrem en souvenir de l’oncle. Euchariste avait suggéré Barthélémi, qui lui semblait un vrai nom d’homme. Sans doute parce qu’il avait autrefois connu à Sainte-Adèle un fort-à-bras qui s’appelait ainsi, il lui semblait que ce nom, par quelque magie, donnerait à son fils une vigueur extraordinaire. Mais Alphonsine avait son idée qui était de donner à son premier enfant, à cet être prestigieux qu’était pour elle le fruit de ses souffrances, un nom singulier, bien à lui. Il ne pouvait s’appeler Jean-Baptiste, ou Etienne, ou Louis-Georges, comme tout le monde. Il s’appellerait d’un nom mystérieux et doux: Oguinase, qu’elle se rappelait vaguement avoir entendu prononcer à l’église dans quelque sermon de retraite, il y avait bien longtemps. Depuis lors, elle s’était dit que son premier-né, si jamais elle enfantait, s’appellerait ainsi. Et l’enfant fut baptisé Joseph, Ephrem, Oguinase.
Cette naissance métamorphosa la maison chez les Moisan. Alphonsine surtout qui, pour vaillante qu’elle fût, s’était sentie comme amortie dans cette atmosphère où régnaient conjointement le souvenir du vieil oncle Ephrem et la présence caduque de la vieille tante. La vie entre ces vieux avait déjà singulièrement éteint chez Euchariste la vivacité qu’on eût attendu de ses vingt-cinq ans. Or c’est tout cela qui disparut d’Alphonsine avec la naissance du petit. Elle redevint une enfant pour jouer avec cette vivante poupée, pour lui parler cette inintelligible langue que les mères et toutes celles qui ont l’instinct de la maternité parlent aux petiots. Ainsi pour Mélie, habituée à faire siennes les maternités des autres. Toutes deux se disputaient l’enfant, leur vie désormais centrée sur la tête d’Oguinase. C’est à son sujet que s’élevaient les discussions; sur la façon dont il le fallait vêtir, la vieille craignant toujours pour lui les refroidissements, l’enveloppant de langes épais, de robes de flanelle et de couvertures que sa mère lui ôtait ensuite avec patience, malgré les protestations de Mélie. Celle-ci, despotique, dès qu’Alphonsine avait le dos tourné, allait enlever l’enfant de la fenêtre où sa mère l’avait placé pour le distraire, en disant: «Si tu le mets à la lumière comme ça, les yeux vont lui crochir.»
Mais c’est surtout la vie d’Euchariste qui s’en trouva singulièrement modifiée. Son autorité sur les choses et sur les bêtes restait égale; vis-à-vis de la terre rien n’était changé. Mais il avait perdu de son importance dans cette maisonnée accrue. Il y avait désormais des questions auxquelles il ne connaissait rien, des débats où, s’il donnait timidement son avis, on lui disait nettement que les hommes ne s’y entendaient point.
Le marmot se contentait de faire risette quand on lui chatouillait le menton, ou de pousser parfois des cris inarticulés auxquels on donnait des interprétations divergentes, nouveaux sujets de discussion. Il ne pouvait réagir vraiment que par des indispositions mystérieuses qui écrasaient Euchariste du sentiment de son impuissance, terrifiaient Alphonsine, mais faisaient triompher Mélie. Car la vieille en profitait pour tirer chaque fois de son expérience quelque nouveau remède traditionnel; c’est elle qui le guérit de la coqueluche en lui suspendant au cou, par une ficelle rouge, une coquille de noix où était enfermée une chenille. Dès que la chenille fut desséchée, le mal disparut.
Alphonsine et Euchariste étaient revenus à la norme humaine hors de laquelle, les premiers mois de leur mariage, ils avaient vécu. Ils étaient désormais la famille avec, répartie sur chacun, sa part bien tranchée des soucis communs et des besognes quotidiennes. Et cela suivant l’ordre établi depuis les millénaires, depuis que l’homme abdiquant la liberté que lui permettait une vie de chasse et de pêche, a accepté le joug des saisons et soumis sa vie au rythme annuel de la terre à laquelle il est désormais accouplé. Euchariste: les champs; Alphonsine: la maison et l’enfant. La vie passait de la terre à l’homme, de l’homme à la femme, et de la femme à l’enfant qui était le terme temporaire.
Maintenant que ses absences se faisaient moins sentir, Euchariste prit l’habitude d’aller, hors les époques de grand travail où il devait même engager parfois de l’aide, passer ses soirées près de la fromagerie; là, petit à petit, se formait un hameau.
De la terre des Moisan, il y avait deux lieues et plus pour se rendre au village de Saint-Jacques dont ils dépendaient, et plus de trois pour Labernadie, en descendant. Cela faisait six bonnes lieues entre les deux églises.
La fromagerie avait été établie vingt ans auparavant par le père des propriétaires actuels, un cousin germain du grand-père maternel d’Euchariste. Afin de desservir le plus possible de territoire, il l’avait bâtie à la croisée des chemins: d’une part la grand’route, le chemin du Roi, qui longeait irrégulièrement la rivière, d’autre part la route de raccordement entre le grand rang et les terres de l’intérieur. Celles-ci formaient ce qu’on appelait communément le rang des Pommes, peut-être parce que certains cultivateurs y avaient planté nombre de pommiers, plus probablement parce qu’un des premiers concessionnaires avait été un certain Bernard Peaume. La famille y existait encore, mais selon un accident fréquent, un surnom avait supplanté le nom originel. Elle s’appelait désormais Lebeau.
La population des paroisses suit une constante assez marquée dans le Québec: le nombre de familles terriennes varie peu, car la division des terres répugne au paysan. Le père préfère en général voir ses fils puînés partir pour les terres neuves, laissant à l’aîné la possession indivise du bien familial, plutôt que le déchirer entre ses enfants. Aussi bien, le cadastre en longues bandes étroites rend-il impossible le parcellement. Mais à mesure que le défrichement élargit l’étroite bande de terrain arable étranglée entre le fleuve et l’âpre flanc de la chaîne laurentienne, de nouveaux rangs se forment. C’est pourquoi un Labarre, connu de tout le monde sous le surnom de «La Patte», à cause d’une boiterie, jugea à propos d’installer en face de la fromagerie un atelier de forge et maréchalerie et «Pitro» Marcotte, une échoppe de sellier. Puis, lors du décès de Maxime Auger, la veuve ouvrit boutique dans sa maison. On y voyait, posés sur des tablettes dans la fenêtre, des verres de lampe, des lacets, des bobines de fil, des sacs de sel, des couteaux de poche, et, dans une boîte, de ces petits cochons en guimauve recouverts de chocolat sur lesquels les enfants s’exercent à «faire boucherie». Graduellement, son commerce augmentait. Petit à petit, les paysannes cessaient de tisser et de filer, les paysans de confectionner leurs lourdes bottes, et remplaçaient tout cela par l’article de la ville presque aussi solide, plus élégant et surtout moins coûteux. Sa boutique devint le rendez-vous des flâneurs, du jour où le député avec qui elle avait une lointaine parenté—certains le disaient en clignant de l’œil—lui obtint une station postale. Sous prétexte de venir chercher de rares lettres, toutes les voitures s’y arrêtaient le dimanche, au retour de la messe. Les hommes s’y rencontraient aussi le soir pour jouer d’interminables parties de dames. La veuve Auger augmentait ses profits par la vente clandestine de whisky blanc. Mais comme elle était femme de tête, prudente et raisonnable, et que jamais on ne sortait de chez elle trop ivre, personne ne se mêlait de protester.
C’est elle qui avait fait venir du bas du fleuve, son pays d’origine, un sien neveu pour l’installer comme boulanger. Il avait acquis, avec l’argent de la veuve, une petite pièce de terre, derrière la fromagerie, sur la route qui montait au rang des Pommes; après quoi il s’était construit un four et une espèce de hangar et avait transformé en voiture de livraison un vieux tapecu acheté d’occasion. Mais de quelle clientèle vivrait-il puisque chaque ferme boulangeait et cuisait son pain, une fois la semaine? Or l’une après l’autre, les ménagères étaient devenues ses chalandes, sans que les hommes se fussent trop plaints, le pain livré trois fois la semaine étant plus frais et dans bien des cas meilleur. Si bien qu’Antoine Cloutier avait payé son lopin de terre, s’était bâti maison, avait pris femme dans la paroisse, et élevait ses sept enfants sur un bien agrandi de deux pièces achetées à même ses bénéfices.
Tout cela, avec les maisons des fermiers, faisait à la croisée des routes un groupe de constructions basses, sans étage, faites de planches clouées verticalement sur la charpente et noircies par les intempéries, et que le voisinage de la fromagerie remplissait continuellement d’une odeur de petit-lait. Le magasin de la veuve Auger se reconnaissait à ce que seul il était précédé d’une plate-forme haute de quelques marches, sur laquelle on la voyait, l’été, tricoter à l’après-midi longue, en surveillant ceux qui passaient sur la route et ce qui se passait autour des maisons. Il y avait au-dessus de la porte une affiche jaune battant au vent sur laquelle on lisait: MAGASIN GÉNÉRAL.
De la ferme des Moisan au hameau, la distance n’était pas grande. Il y avait les Raymond, puis les Gélinas, puis Maxime Moisan, qui n’avait avec Euchariste que de très lâches liens de cousinage. Pour les distinguer de ce dernier on les appelait du prénom du père joint à celui du grand-père: les Maxime à Clavis, tout comme on disait souvent «’Charis à Noré» (Honoré).
Venaient ensuite les Zéphir Authier avec, comme voisin, toujours en descendant vers le hameau, une famille au nom bizarre: les «Six». Ce n’était pourtant pas là un surnom, mais bien leur propre nom transmis de père en fils et qui n’était que la corruption de leur véritable patronyme. Ils descendaient d’un de ces soudards allemands qui traversèrent la mer avec le général Riedesel et dont quelques-uns se fixèrent au pays de Québec, retenus par leur mariage avec des filles du cru. De Schiltz, trop difficile à prononcer, on avait «Six». Dans quelques générations qui se souviendrait qu’un peu de sang différent coulait dans leurs veines? Ils étaient aussi canadiens que quiconque, puisque comme les autres ils peinaient sur la terre laurentienne et vivaient d’elle. La patrie c’est la terre, et non le sang.
Trois terres de plus et l’on arrivait à la croisée des chemins; après quoi reprenait le chapelet des fermes identiques avec la maison au toit brisé surveillant le groupe des bâtiments en retrait, et cela sur trois bonnes lieues, jusqu’à Labernadie dont on voyait le clocher de métal briller au-dessus d’une ondulation du terrain comme le mât d’un navire enlisé dans les sables.
C’est au hameau qu’Euchariste prit l’habitude d’aller assez souvent. Il partait après le souper en disant invariablement: «J’vas voir si y a pas une lettre.» C’était la formule, une façon de dire plus facile que d’avouer: «J’m’vas faire une partie de dames au magasin.» De lettres, il n’y en avait jamais. On ne s’écrit pas souvent dans les campagnes et seulement en cas de nécessité absolue, en cas de maladie ou de mort. Les affaires? On ne les confie pas au papier; il vaut mieux régler cela de vive voix, de préférence le gobelet en main. C’est pourquoi l’arrivée d’une lettre est toujours un sujet de crainte. La dernière qu’on eut reçue chez les Moisan avait causé presque de l’affolement. Euchariste l’avait apportée à la maison sans oser l’ouvrir. Mais elle ne contenait rien que la requête d’un cousin des Etats demandant qu’on lui expédiât son baptistaire dont il avait besoin pour se marier.
Les longues soirées d’hiver se passaient ainsi au magasin, agréablement. Quand Euchariste entrait dans la salle basse et enfumée, le bruit de ses pieds enneigés qu’il secouait sur le seuil faisait lever la tête à l’un de ceux que la contemplation de la partie absorbait; cinq ou six paysans, presque tous entre deux âges, penchés au-dessus des joueurs qui tenaient le damier sur les genoux et de temps à autre poussaient d’un doigt raide une pièce menaçante en un mouvement qui faisait s’exclamer d’admiration les spectateurs. Une voix disait: «Quiens, v’là ’Charis!», pendant que le joueur attaqué, l’esprit tendu, proférait simplement: «Ah! mon maudit, tu me poigneras pas comme ça!» et tous se repenchaient sur le damier, plus Euchariste.
Quand une partie avait été chaudement contestée et la victoire brillante, le vainqueur se tournait vers Moisan qui était l’un des forts joueurs du rang: «’Charis, viens te faire donner ta ronde. J’m’en vas t’prendre pour un whisky blanc.» Le vaincu, qui était rarement Euchariste, payait un verre et la revanche lui était offerte. Les gosiers avaient beau être rudes et les estomacs solides, après sept ou huit parties il fallait que la mère Auger intervînt à cause des disputes menaçantes. Elle mettait tout le monde dehors; et chacun s’en retournait chez soi dans la nuit piquetée d’étoiles drues, parmi le silence immense de l’hiver qui éteignait les voix et sobrait les esprits.
Il n’y avait point là de jeunes gens. Lorsque l’automne vient clore les travaux de la terre, presque tous montent dans les chantiers. Ils partent fin de septembre, dès après le battage des grains, se rassemblant par petits groupes dans les villages d’où ils s’enfoncent dans les forêts du haut Saint-Maurice ou de la Gatineau, pour la coupe du bois. A seize ans, à quinze même ils quittent la ferme, le baluchon sur le dos, par pelotons qui chantent le long de la route et, sans arrêt, font circuler de bouche en bouche la cruche d’alcool.
Aucun ne part enfant qui ne revienne homme fait. Non pas tant par le dur travail des camps d’hiver, aux froids de quarante sous zéro, que par la rudesse des travailleurs entre eux; depuis le départ où chaque équipe, à mesure qu’elle rejoint les autres, aligne son champion contre celui des nouveaux arrivés; jusqu’au retour après six mois, quand les voyageurs des pays d’en haut, les poches lourdes d’argent, font sonner leurs écus sur le comptoir des bars. Tel part les yeux candides qui revient capable comme un homme de boire, de blasphémer et de se battre.
Euchariste n’était jamais tombé sous le coup de cette conscription qui, chaque année, vide les maisons de tous les jeunes disponibles. Peut-être parce que celle des Moisan eût semblé trop déserte sans lui, l’oncle Ephrem ne l’avait pas une seule fois laissé partir avec les autres. Il l’eût désiré pourtant. Cette dure vie de six mois à être logés en des cabanes enlisées dans la neige, à manier sans arrêt la grand’hache ou le «godendard», ne l’effrayait point. Au contraire, les récits du retour irritaient en lui le désir de cette existence étrange des pays d’en haut, pleine de mâles combats comme une épopée; de cette routine distraite par le passage occasionnel de la «chasse-galerie» que Pit’ Gélinas avait vue ou par les lamentations du «gueulard du Saint-Maurice», cet être invisible dont le cri faisait trembler ceux qui n’avaient pas dit leur chapelet le dimanche à l’heure où dans les paroisses se chante la grand’messe. Il eût voulu, lui aussi assister à ces nuits splendides et diaboliques où le ciel boréal s’allume de lueurs mobiles qu’un violoneux peut faire danser à son gré, mais au risque de son salut éternel.
Il avait été sensible aux plaisanteries de ceux qui partaient. Cela lui faisait une espèce de honte comme s’il eût été infirme et qu’on eût moqué son infirmité. Il était maintenant un peu gêné de ne jamais pouvoir, comme eux, sortir des blasphèmes extraordinaires et de ce qu’il était le seul dont la tête commençât à chavirer après quelques verres, pendant que les autres racontaient des aventures merveilleuses sur lesquelles lui seul ne pouvait renchérir. C’était même devenu une façon d’habitude chez eux que de s’adresser à lui, pour annoncer une histoire de chantiers: «Toé, ’Charis, qu’a jamais fait les chantiers, j’m’en vas t’en conter une tannante, pi c’est la vérité vraie.» Même maintenant, il serait parti, n’eût été Alphonsine et le petit.
C’est pour cela que parfois, chez la mère Auger, il tenait tête aux autres; afin de montrer qu’il était un homme lui aussi, encore qu’il ne fût jamais monté dans le bois.
Alphonsine ne trouvait pas à redire quand il rentrait un peu gris. Il n’avait point l’ivresse violente et, surtout, elle avait l’habitude de ces choses-là qui sont normales chez un homme et qui se passent toujours avec l’âge, quand on a affaire à un bon garçon comme Euchariste. Son mari n’était pas pour cela un mauvais mari; il ne se dérangeait point et savait s’arrêter à temps. D’ailleurs il lui rapportait toujours, du magasin, quelque nouvelle sur les gens de la paroisse et parfois, quand il avait gagné aux dames et qu’il avait quelque argent en poche, une fanfreluche pour sa toilette du dimanche.