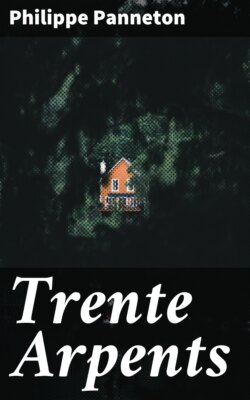Читать книгу Trente Arpents - Philippe Panneton - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE V
ОглавлениеTable des matières
D’avoir ouvert la maison à une étrangère revêtit Euchariste d’une plus complète autorité et lui donna en même temps que le sentiment de son importance celui de la possession entière du bien des Moisan. La maison hier si terne vivait maintenant d’une vie nouvelle rythmée au pas alerte d’Alphonsine.
Et Mélie pouvait enfin s’arrêter. Elle n’y manquait point, passant toutes ses journées collée au poêle, béatement, son esprit étroit libéré des soucis de la vie quotidienne, les doigts seuls courant machinalement sur le rosaire.
Les jeunes époux avaient ouvert «la chambre» et l’habitaient le soir, tandis que tout le long du jour la jeune femme allait et venait dans la grande cuisine où l’on vivait. Au début, il avait fallu que Mélie lui indiquât la place de chaque chose; elle eut vite appris, tant se ressemblent toutes les maisons de paysans. Elle aussi appelait désormais la vieille: «ma tante», adoptant tout ce qui était la famille de son mari, comme elle avait fait de la chambre: «ma chambre»; du four à pain: «mon four» du poêle: «mon poêle». Cela était de son domaine où tout dépendait d’elle. Elle régnait sur la cuisine où l’homme ne mangeait qu’à son plaisir à elle et ce qu’elle, de son propre vouloir, décidait de lui servir.
Quant aux bâtiments, ils étaient pour elle comme pour son mari «nos» bâtiments et les champs «nos» champs. Car advenant l’heure de la traite, elle aussi se rendait à l’étable chaude où, dans l’odeur forte des litières, la clarté falote de la lanterne illuminait les museaux lourds des vaches qui la regardaient d’un air las en secouant leur chaînette et en soufflant dans l’eau courant sous leurs naseaux dans la longue auge de bois.
Euchariste goûtait paresseusement son contentement. Avec mars terminant, un soleil chaque matin plus chaud fouillait de ses rayons la robe de neige moins blanche sous laquelle se révélaient chaque jour un peu plus les formes de la terre. Sur la rivière, lentement, les pluies tièdes pourrissaient l’écorce des glaces; et des flaques noires commençaient à apparaître où l’eau bouillonnait sourdement grossie par l’invisible ruissellement des neiges fondantes. Mais il s’en fallait de beaucoup encore que le sol mis à nu fût prêt pour les travaux printaniers. Si bien qu’Euchariste pouvait rester des après-midi entières assis dans la chaise du vieux, à fumer sa pipe à courtes bouffées, et à regarder sans en avoir l’air Alphonsine qui passait et repassait devant lui, la figure calme, les cheveux châtains bien en place, avec dans ses attitudes quelque chose d’alourdi, de plus abandonné, de plus savoureux, qui n’était pas d’Alphonsine Branchaud, mais bien d’Alphonsine «la femme à ’Charis Moisan».
Il était content de savoir que tous les hivers se passeraient ainsi, quiètement. Il acceptait sans déplaisir cette immobilité à laquelle l’hiver nordique condamne les êtres et les choses. Parfois Alphonsine s’arrêtait et le regardait d’un air amusé:
—Fatigue-toé pas, ’Charis! Si tu travailles de même, tu vas te donner un tour de rein.
Elle parlait d’une voix un peu couverte, comme ces ciels de prime automne d’où tombe une lumière attiédie. En elle aussi l’amour était une chose voilée, inconsciente.
’Charis ne répondait rien à cette taquinerie qui était la seule forme de tendresse qu’ils connussent. Toutes les caresses qui sont permises entre mari et femme et qui sont douces à goûter, ils les réservaient pour le soir quand, la porte de la chambre fermée, Mélie endormie au-dessus d’eux, Euchariste entourait brusquement Alphonsine d’un geste hardi et maladroit contre lequel elle se défendait en riant d’un rire avide. Tandis qu’en plein jour ils n’osaient pas même s’embrasser, par une espèce de pudeur qui leur faisait détourner leurs regards lorsque l’idée leur en venait. Parfois, cependant, le désir les surprenait dans la boutique sombre où Euchariste réparait un harnais ou dans le fenil, parmi l’odeur entêtante du foin, d’où elle sortait en arrangeant son chignon sous l’œil oblique et souriant de Mélie. Les mois passèrent et petit à petit, sa démarche s’alourdit. Elle eut en marchant le bercement de hanches de celles qui portent un fardeau. Et il la surprit un beau jour qui taillait des pièces de cotonnade blanche pour les coudre ensuite prestement en une espèce de robe longue mais si étroite.
Certes il se doutait bien un peu. Mais il n’osait préciser ni sa pensée, ni encore moins ses paroles. Il se pencha vers elle:
—C’est-y que tu veux me faire une chemise des dimanches pour aller voir les filles? Montre donc voir?
Et il voulut lui prendre des mains la pièce qu’elle cousait. Mais elle, d’un geste instinctif, la serra sur sa poitrine déjà forte et lui répondit sans sourire:
—C’est un autre qui ira voir les filles, ’Charis, quand qu’i’ sera grand.
—C’est... c’est... pour quand, ’Phonsine?
—Ça sera p’t’êt’ ben ton cadeau du Jour de l’An, si t’es pas trop chéti!
—Ouais... Ouais! On va tâcher, sa mère.
Pour la première fois il l’appelait ainsi, il l’appelait la mère de ses fils encore à naître, de son fils désormais promis; «sa mère», comme les paysans de nos campagnes dénomment leur épouse féconde sans jamais lui donner d’autre titre que celui-là qui rappelle leur rôle suprême.
Une étrange sensation de bien-être avait envahi Euchariste. Il se sentait raffermi, confirmé, en même temps que subitement mûri. Lui qui, à peine quelques mois auparavant, n’était que le neveu recueilli sur la terre d’un autre, il se savait devenu, de par la magie de cette procréation, le maître de cette terre où il était hier étranger; le tuteur en quelque sorte de ces trente arpents de terre dont par un mystère bizarre, il était à la fois serf et suzerain. Les semailles du printemps, il les avait faites d’une main allégée par la pensée qu’il semait pour deux, pour Alphonsine et lui. Les labours avaient été restreints cette année, ne voulant pas engager d’aide pour la moisson actuelle puisque, pour le moment, il leur suffirait de vivre sans penser à d’autre avenir que l’avenir immédiat et prochain, celui du travail qui doit être fait demain et celui de la récolte promise.
Tout était changé, désormais. Son avenir n’était plus cet avenir étroit qu’il avait envisagé jusque-là, ce futur à courte échéance, maintenant passé. Il voyait subitement sa tâche grandir sous ses yeux comme la lumière naissante du jour déroule les prés et révèle un monde au matin renouvelé.
L’un après l’autre étaient tombés les grands-pères, le père, la mère, la tante Ludivine, l’oncle Ephrem, tous les êtres tutélaires et protecteurs; tous ceux qui s’interposaient entre lui, enfant, et la rudesse des saisons, la froidure des nuits, la fatigue du travail chaque jour terminé et chaque lendemain recommencé; ceux dont il sentait, dans la pénombre de son enfance, les mains toucher les siennes pour le rassurer comme les vieux arbres entrelacent leurs branches sur la tête des arbres jeunes. Il restait bien maintenant l’arbre unique respecté dans la destruction de la futaie familiale, seul debout au milieu de la plaine, au printemps parmi les sillons, en été parmi les vagues blondes des épis, à l’automne offrant son tronc rugueux aux caresses des bêtes paissant et l’hiver, résistant de tous ses membres sombres, tendus à la bise et aux poudreries. Et comme cet arbre, il servirait d’abri et de refuge aux moissonneurs et ces moissonneurs seraient ses fils, jusqu’à ce que la foudre vienne frapper sa tête et tarir en lui la sève de la vie, comme pour l’oncle Ephrem.
Pauvre oncle Ephrem. Cette joie lui aura donc été refusée, qu’il avait escomptée, de voir les petits-neveux dont il se serait fait le grand-père. Mélie serait là pour leur chanter La poulette grise, pour les faire rire aux éclats en récitant les vieilles formules: «tit-œil, gros-t’œil, soucillon, soucillette...» ou «’tit galop, gros galop...» Mais le vieux qui dormait là-bas, au cimetière du village, ne raconterait pas aux enfants émerveillés les aventures étonnantes que lui et ceux de son époque avaient vécues; et les prouesses de «Tirible» Moisan, qui pliait un écu à force de doigts, ainsi que sa bataille nocturne avec un loup-garou auquel il avait échappé en lui tirant du sang d’un coup de canif pour reconnaître le lendemain matin que c’était son propre cousin, à l’estafilade qu’il avait sur la joue. Et l’histoire du grand-oncle Gustin Lafrenière qui avait fait le coup de feu en ’37 à Saint-Charles contre les «habits-rouges»: à la suite de quoi il avait été arrêté et gardé dix mois durant dans les prisons du vieux brûlot Colborne.
—Te v’là ben jongleux, à c’t’heure, ’Charis, dit Alphonsine.
—J’pensais à la couverture de la grange, qui coule. J’l’ai pas arrangée l’hiver dernier parce qu’avec la mort de mon oncle, j’avais pas l’cœur à l’ouvrage ben ben. Pi l’année d’avant, j’m’étais quasiment coupé le bras droit, en battant au moulin, tu t’en rappelles? Et pi y a la cabane à sucre qu’à besoin, aussi. Faudra que j’fasse ça à l’automne, après le grain rentré.
—Tu vas donc faire du sucre, le printemps prochain? demanda Alphonsine.
—J’cré ben que oui, si l’hiver est bonne. Mais pas beaucoup d’neige, pas beaucoup de sucre. D’la neige y en a pu autant ces années icitte. Plus ça va, moins qu’y en a.
—C’est rien ça, intervint Mélie, si t’avais connu ça dans mon jeune temps. J’ai vu une fois, quand j’étais petite, à Lavaltrie, chez mon père, qu’on s’est réveillé un beau matin avec d’la neige qui bouchait jusqu’au châssis d’la chambre d’en haut. On était quasiment tout enterré. Y a fallu que mon père i’ sorte par la ch’minée pour aller nous désenterrer. C’est la pure vérité. Vous savez pas c’que c’est qu’l’hiver, vous autres, pour le certain.
—Ben sûr que c’est pas des menteries, renchérit Euchariste. J’ai vu ça quand j’étais à Sainte-Adèle, dans les hauts. Pas chez nous, parce qu’on restait dans la côte. Mais dans les baisseurs. J’ai vu des dimanches qu’on pouvait pas aller à la messe parce que les chevaux calaient jusqu’aux avaloires dans les bancs de neige. Y fallait aller déterrer les balises après chaque bordée, les sortir, pi les replanter par-dessus.
—Quiens, c’t’affaire, rétorqua Mélie, dans les temps, c’était pas une fois, c’était tout le temps de même. Mais tant plus que ça va, tant plus que les hivers sont douces.
—C’est vrai ma tante, y a moins d’hiver, acquiesça Alphonsine, la tête penchée sur sa couture.
Elle se redressait de temps à autre, les épaules rejetées en arrière, la tête droite et portait machinalement la main à sa ceinture.