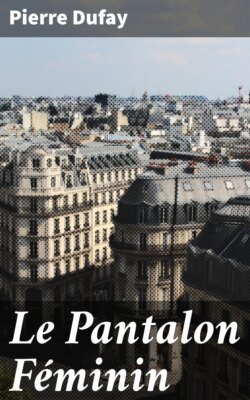Читать книгу Le Pantalon Féminin - Pierre Dufay - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES HÉROINES DE BRANTOME
ОглавлениеTable des matières
LES COURTISANES DE VENISE ET DE ROME
Toutes les héroïnes de Brantôme, ou presque, portent, en effet, des pantalons. Parfois même, ils sont de toile d'or ou d'argent; volontiers, elles les laissent voir, soit pour montrer leur jambe qu'elles savent belles, soit sous l'effort de quelque main malhonnête, friande de rondeurs et d'intimités plus haut placées.
Ces caleçons, un satirique anonyme cité par Pierre de l'Estoile, les chansonnera:
Pour les dames et damoiselles
Sont cent mille modes nouvelles;
Pignouers, tabliers et calessons,
Coiffures de cinq cents façons[31]...
Brantôme n'a garde, en attendant, d'omettre de détailler les dessous de ses amoureuses. Il célèbre le luxe de leurs culottes ou dit si elles n'en ont pas.
Deux grandes dames—sans doute élevées dans un pensionnat de Lesbos—apparaissent ainsi, «toutes retroussées et leurs caleçons bas», à un écolier, qui, l'œil collé à un trou de la cloison, suit avidement cette leçon de choses...
Ce bon monsieur de Bourdeilles décrit même assez gentiment la scène; mais les mœurs sévères qui nous régissent m'empêchent de suivre son exemple. Baudelaire fut poursuivi pour moins et je serais inconsolable de faire condamner à mon tour la grande Sapho et de faire une peine même légère à ces enfants fidèles au «rite inventé».
Je préfère renvoyer l'«hypocrite lecteur» que «ces choses» peuvent amuser au premier discours des dames galantes où elles sont décrites par le menu[32].
Telle autre, une Espagnole, qu'un compagnon du conteur connut à Rome dans un sens à satisfaire pleinement l'Écriture, avait vis-à-vis de son serviteur des exigences un peu déconcertantes:
«Quand il l'accostoit elle ne vouloit permettre qu'il la vist, ny qu'il la touchast par ses cuisses nues, sinon avec ses calsons»[33]...
Singulière pudeur, dira-t-on, et des âmes naïves pourront se demander si c'était la conséquence d'un vœu?
Non pas: la dame avait simplement une cuisse plus maigre que l'autre.
Mais on peut conclure de cette anecdote que les pantalons de ces «cinq à sept» étaient forcément ouverts, tandis que ceux du petit ménage, qui, de nos jours, eût si volontiers fréquenté le Hanneton, étaient fermés comme ceux de Claudine ou de la Môme Picrate.
Le caleçon ne se contente pas de voiler: il supplée, corrige et rembourre au besoin. Rien n'est nouveau sous le soleil, ni même sous la lune, et le coton n'avait pas attendu la création de notre Académie nationale de musique et la divine aventure de Cléo de Mérode, pour jouer dans les ballets et la figuration le rôle que l'on sait.
«A quoy pour suppleer, telles dames sont coustumières de s'ayder de petits coissins bien mollets et delicats à soustenir le coup et engarder de la mascheure; ainsy que j'ai ouy parler d'aucunes, qui s'en sont aydees souvent, voire des callesons gentiment rembourrez et faits de satin, de sorte que les ignorants, les venans à toucher, n'y trouvent rien que tout bon, et croyent fermement que c'est leur embonpoint naturel: car, par-dessus ce satin, il y avoit des petits callesons de toille volante et blanche; si bien que l'amant donnant le coup en robbe, s'en alloit de sa dame si content et satisfait, qu'il la tenoit pour très bonne robe[34]».
Cela faisait, si je ne m'abuse, deux caleçons au lieu d'un et ce «coup en robbe» induit non moins à supposer qu'ils étaient ouverts l'un et l'autre.
Quelques-unes, pourtant, avaient déjà la fâcheuse habitude de les porter fermés, et, non plus une petite amie, mais le Balafré, suivant M. Lalanne, de déchirer de sa main brutale, dans une embrasure de fenêtre, cette malencontreuse lingerie:
«L'autre frère, sans cérémonie d'honneur ny de parole, prit la dame à un coing de fenestre, et, luy ayant tout d'un coup escerté ses calleçons qui estoyent bridez, car il estoit bien fort, luy fit sentir qu'il n'aimoyt point à l'espagnole, par les yeux, ny par les gestes du visage, mais par le vrai et propre point et effet qu'un vray amant doit souhaitter; et ayant achevé son prix fait s'en part de la chambre[35]».
Ouverts ou fermés? grave question dont la solution était déjà soumise, comme on voit, au gré et à la fantaisie de chacune. Il est de petits plaisirs passagers auxquels il n'est pas bon d'opposer, si illusoire soit-il, l'obstacle d'une toile d'or ou d'argent. Celles que ne tentent pas l'imprévu furent toujours l'exception: elles seules les portaient «bridez» et le conteur prenait soin de le noter.
Comme Béroalde, comme Taboureau, comme Estienne, Brantôme signale la nouveauté de cette mode. Vingt-cinq ou trente ans plus tôt, on n'en portait pas encore. C'était le cas des filles de Catherine de Médicis, qui, au début du règne, ignoraient ce travesti sous la jupe et la reine de prendre à leur endroit, ou mieux à leur envers, des privautés auxquelles l'éducation anglaise et quelques vieux messieurs sont seuls restés fidèles:
«Aucunes fois sans les despouiller, les faisoit trousser en robe, car pour lors elles ne portoyent point de calsons, et les claquetoit et fouettoit sur les fesses, selon le sujet qu'elles lui donnoyent ou pour les faire rire, ou pour plorer[36]».
Ces dames n'avaient point attendu que Colombine eût prêché, dans le Gil Blas, l'Évangile des dessous, pour les simplifier quand il leur plaisait, et pour supprimer, l'été, le pantalon, pour éviter le surcroît de chaleur qu'il leur apportait. Brantôme exulte à cette vision de nymphes demi-nues et en véritable amant de la femme, semble, attacher, cette fois, plus de prix aux somptuosités de leur corps qu'à celles de leur lingerie.
«Mais le meilleur fut que la dame, parce que c'estoit en esté et faisoit grand chaud, s'estoit mise en appareil un peu plus lubrique que les autres fois, car elle n'avoit que sa chemise bien blanche et un manteau de satin blanc dessus et les calleçons à part[37]».
Ou encore,—l'été était très chaud, paraît-il:
«Ce n'est pas par contraire, par son contraire se guarir, ains semblable par son semblable, bien que tous les jours elle se baignast et plongeast dans la plus claire et fraische fontaine de tout un païs, cela ny sert, ny quelques légers habillemens qu'elle puisse porter, pour s'en donner fraîcheur, et qu'elle les retrousse tant qu'elle voudra, jusques à laisser les callessons, ou mettre le vertugadin dessus eux, sans les mettre sur le cottillon, comme plusieurs le font[38]».
Passage peu clair, comme le faisait judicieusement remarquer M. Bouchot, qui ne fait remonter qu'à 1577 ou environ la mode des caleçons.
D'une part, les unes supprimaient le pantalon, «comme plusieurs le font», ajoute Brantôme et d'autres sembleraient, en mettant le vertugadin sur le caleçon, sans le mettre sur le cotillon, conserver le pantalon, mais supprimer le jupon, ou son équivalent, comme il a été longtemps de mode. Mais alors, il faudrait lire le et non les; au reste, le bon Brantôme était-il à un lapsus de langue près?
Dames et demoiselles avaient, au surplus, une singulière façon de se vêtir pendant la canicule, et l'on comprend si elles devaient faire bon marché de ces inutilités.
Bois d'amour ou bois sacré, le déshabillé de Mlle de Sainte-Beuve[39], entre autres, eût pu paraître charmant. Dans une église, il avait lieu d'étonner:
«Les Mémoires sur l'Histoire de France, t. I, p. 272, disent qu'elle se laissa mener par le bras à travers l'église de Saint-Jean-en-Grêve, seulement couverte d'une fine toile et d'un point coupé à la gorge pour être muguettée et attouchée, au grand scandale de plusieurs qui assistaient de bonne foi aux processions; les Notes sur la Satire Ményppée disent la même chose[40]».
Sans doute... les «Enfants de Marie» nous ont habitué à une autre tenue... pourtant sur les sculptures des chapiteaux, on en voyait bien d'autres. Il eut été de mauvais goût de se scandaliser par trop.
Était-ce bien là, pourra-t-on se demander, le véritable pantalon féminin ou de ces hauts-de-chausses bâtards, sortes de culottes de bicyclette avant la bicyclette, dont parle Racinet?
Parfaitement, c'était bien là le pantalon féminin et il avait déjà son charme ambigu et un peu pervers. C'étaient, par-dessus les coussins rembourrés corrigeant les cuisses défectueuses, de véritables pantalons «de toile volante et blanche».
Pantalons de femmes également, encore que d'un luxe un peu douteux, quoique royal, que n'eût point, en son beau temps désavoué Mlle Otéro, ceux qu'avait accoutumé de porter Catherine de Médicis.
«Et par ainsi, sur cette curiosité qu'elle avoit d'entretenir sa jambe belle, faut penser que ce n'estoit pour la cacher sous sa juppe, ny son cotillon ou sa robbe, mais pour en faire parade quelques fois avec de beaux callesons de toile d'or et d'argent, ou d'autre estoffe très proprement et mignonnement faits, qu'elle portoit d'ordinaire: car on ne se plaist point tant en soy que l'on en vueille faire part à d'autres de la veue et du reste[41].
Pantalons de femmes encore, ceux de l'infortunée Marie Stuart qu'ils fussent en toile de Hollande: «sept aulnes de Ollande pour faire six paires de callesons à la royne» (Inventaire d'Edimbourg, 1563) ou plus prosaïquement en futaine, comme le jour de son supplice.
Ah, nous sommes loin des toiles d'or et d'argent de la Florentine. Quelle femme de chambre consentirait à porter aujourd'hui, au dessus des «bas de soye bleue», retenus par des «jarretières de soye», ces «caleçons de futaine blanche» de la reine martyre?[42]
De la futaine, fi! ma chère.
En Italie, au contraire, d'où le caleçon, comme la vertugade était originaire, il semblait plus se rapprocher du haut-de-chausses que du pantalon.
Les «onze pantalons de coton» que relève M. E. Rodocanachi[43] dans l'inventaire de la célèbre courtisane romaine Tullia d'Aragona (23 avril 1556) paraissent avoir été l'exception.
Ces demoiselles se plaisaient, le plus souvent, à revêtir de véritables chausses masculines, bouffantes et tailladées, qu'elles étaient à peu près seules à porter.
Pietro Aretino, ce divin Aretin[44], si peu connu et si mal jugé en France, sur la foi des mauvaises reproductions des planches de Marc-Antoine, sera, si vous le voulez bien, notre introducteur auprès de ces rouées personnes qui venaient faire antichambre dans son palais.
On ne saurait choisir meilleur guide, encore qu'une bourse bien garnie eût pu paraître suffisante. Après les Dames galantes, les Ragionamenti:
Tout d'abord dans l'Education de la Pippa, ces conseils de la Nanna à sa fille:
«Renonce d'abord à ta fierté, renonces-y te dis-je, parce que si tu ne changes pas de façons, Pippa, si tu n'en changes point, tu n'auras pas de braye au derrière (non havrai brache al culo) »[45].
On voit, par cette menace maternelle, si le caleçon devait tenir au cœur des jeunes personnes qui se destinaient à la Carrière et dans la Ruffiannerie, une matrulle expérimentée de savoir l'importance que peut prendre, auprès d'un gentillâtre imbécille, un coin de pantalon entrevu à propos sous le retroussis d'une jupe.
Les Vieux Messieurs datent de Suzanne et les petits vieux les avaient peut-être précédés:
«En ramassant le gant elle releva le bord de sa robe et laissa voir assez de ses jambes pour que le faucon désencapuchonné aperçut ses caleçons bleus (la calza turchina) et ses mules de velours noir, élégances qui le firent haleter de luxure»[46].
Philosophe moqueur, Montaigne fait allusion à la magnificence de ces chausses, quand il raille ces voyageurs qui savent:
«Rapporter seulement à la mode de nostre noblesse française combien de pas à la Santa Rotonda ou la richesse des callessons de la signora Livia»[47].
Corona, dont le recueil existe manuscrit dans plusieurs bibliothèques d'Italie, en fait, dans une de ses nouvelles, porter de moins magnifiques aux religieuses qu'il met en scène. Ils se rapprochent des pantalons de Tullia d'Aragona et plus encore de l'horrible flanelle germanique, bien plus que des hauts-de-chausses plus haut décrits.
On les portait en laine au monastère de l'Archange, et les saintes filles semblaient plutôt y prendre gaiement l'existence.
Le conteur ajoute, pour excuser leurs débordements «que les caleçons de laine qu'elles portaient excitaient outre mesure leurs esprits vitaux et leurs muqueuses»[48].
Cette explication un peu spécieuse n'est pas sans rappeler une histoire qu'aimait à raconter le bon père Ricord, et dans laquelle il mettait un brave curé de campagne et Madame sa Soutane.
Le digne homme, contrairement aux nonnes de Corona, ne portait pas de caleçon et expliquait ainsi bien des choses, encore que la réalité fût plus simple encore.
Cette excitation spéciale est sans doute étrangère à la règle qui, dans la plupart des ordres, a fait interdire aux religieuses l'usage des pantalons. Il faut plutôt voir dans cette prohibition un effet du vieux cas de conscience que se posèrent et discutèrent les casuistes: une femme pêche-t-elle mortellement ou véniellement en empruntant à l'autre sexe son costume en tout ou en partie?[49]
Et dire que cette niaiserie fut un des principaux motifs qui entraînèrent la condamnation de Jeanne d'Arc!
Un monastère conduit à un autre. Du monastère de l'Archange, passons à ceux de l'amour. Vecellio après avoir décrit le costume des pensionnaires de certains couvents dont l'hospitalité est généralement assez écossaise pour que cet accessoire semble inutile, leur fait cependant porter de véritables culottes:
«Elles portent des bracelets d'or, des globules d'argent au cou, et même des espèces de culotte comme les hommes, avec des bas de soie ou de drap brodé»[50].
Après tout, si ce travesti versait les illusions nécessaires aux habitués triés sur le volet, le volet clos, de ces derniers salons?
C'était comme un uniforme; et, passant du rang à l'état-major, les détails en variaient peu. Racinet décrit ainsi, avec de plus amples détails, les chausses des courtisanes, non le macaroni napolitain, mais le gratin vénitien:
«Notre exemple no 7 montre, ainsi que le dit Vecellio, que les courtisanes vénitiennes étaient vêtues en dessous à la masculine. Les culottes marinesques, provençales, guéguesques, braguesques, comme les appelle Blaise de Vigenère, les chausses prolongées jusqu'aux genoux étaient à leur usage. Il n'est pas probable, quoique leur corsage fût taillé en pourpoint, que pour se montrer à l'intérieur, elles se contentassent d'enlever leur jupe. Le buste démesurément allongé eût été trop disgracieux lorsque l'on quittait les patins, et comme le panseron avait deux épaisseurs de bourre, l'une fixée au pourpoint même, l'autre dans le gilet de dessous (M. Quicherat, Histoire du Costume de France), il est bien plus vraisemblable de supposer que ces femmes affublées de la culotte ne conservaient que le gilet qui se trouvait sous ce pourpoint masculin. On voit ici que la culotte large avait des poches intérieures latérales; c'était un vêtement coquet, brodé, tailladé. La mode d'appareiller la couleur des bas à celle des chausses était alors remplacée par l'usage contraire, les chausses étaient d'une couleur, les bas d'une autre. Ces bas aux coins brodés étaient de soie, faits à l'aiguille, ou de drap...»[51]
Ces aimables enfants poussaient si loin l'élégance de leurs chausses que plus d'une fois les provéditeurs (provveditori alle pompe) durent intervenir et essayèrent de réduire, par des amendes, ces extravagances[52].
Ne se contentant pas de porter des culottes, elles aimaient à se montrer ainsi vêtues: ce fut l'objet de pénalités nouvelles qu'il fallut appliquer en partie double.
Si les femmes affectaient de sortir habillées en hommes, quelques-uns de ceux-ci, affichaient au contraire pour le costume féminin, un faible désordonné.
Dès le milieu du XVe siècle, on crut devoir sévir contre ces travestis. Le recueil de M. Brunet les Courtisanes et la Police des mœurs à Venise cite et reproduit trois textes caractéristiques sur ce point.
Le plus ancien, 1443, vise les..., mettons le troisième sexe, ce sera plus convenable:
«Et a simel condicion sotozaxa ogni homo trovado in habito femineo, over altro habito desconveniente perdando el vestimento e livre cento per cadaun e star mexi 6 in prexon, etc.»[53]
Les deux autres, c'est vraiment plus propre, ont trait aux courtisanes. L'un, daté de 1480, légitime cette prohibition par des raisons historiques; la cendre de Sodome et de Gomorrhe en a séché l'encre:
«Habitus capitis quem mulieres Venetiarum gerere a modico tempore citra ceperunt non posset esse inhonestior, et homnibus qui illas videant, et deo omnipotenti quem per talem habitum sexum dissimulant suum et sub specie virorum viris placere contendunt quo est species quedam sodomie, etc»[54].
Nouvelles menaces en 1578, celles-là rédigées en italien:
«E cresciuta a questi nostri tempi talmente la gran dishonesta et sfazatezza delle cortegiane et meretrice de Venetia che per prender et illaguear e gioveni conducensosi a sui apetiti, oltra diversi altri modi hanno trovato questo novo et non più usato di vertisi con habiti de homo... che sia proibito alle meretrici et cortigiane sopradette l'andar per la citta vagando in barca vestite da homo, etc.»[55].
Il en était de même à Rome. Les courtisanes y avaient également la manie de sortir vêtues à la masculine et M. E. Rodocanachi de fournir ces amusants détails:
«Cependant, chose bizarre, le costume qu'elles affectionnaient le plus était le costume masculin. Non seulement elles sortaient dans la rue, mais elles allaient à la messe en habits d'homme! L'ambassadeur mantouan tout en admirant leur air réservé, s'en étonne un peu, ce qui prouve que cette mode était particulière à Rome[56]. Quel pouvait être le but des courtisanes en se travestissant de la sorte? Était-ce pour jouir plus complètement d'une liberté qu'on leur marchandait alors si peu pourtant? Etait-ce par pur caprice? Je n'oserais émettre l'avis que c'était afin de se soustraire dans la rue aux obsessions et de dépister les galants. Le mot de l'énigme se trouve peut-être dans la déposition d'une servante qui décrit ainsi le costume que portait sa maîtresse lors d'une équipée. Elle avait, dit-elle, des pantalons et une casaque bleu turquin, relevés d'or et d'argent; des bas de soie verte, un manteau de drap madré et une toque ornée de plumes. Le costume ne devait pas laisser que d'être seyant et des plus avantageux, et l'on conçoit que les courtisanes y tinssent fort.
«Le conseil communal rendit bien une ordonnance contra mulieres inhonestas ne se vestiant habitu virili, destinée à mettre un terme à cet abus, mais l'amende était alors minime, quelques écus, et à ce prix les courtisanes pouvaient se payer de nombreuses infractions, ce qu'elles ne manquèrent de faire, comme bien on pense. Aussi augmenta-t-on plus tard la pénalité, qui fut successivement portée à quinze, puis à vingt et même à cent écus! Preuve que la prédilection de ces dames pour le costume masculin était donc difficile à déraciner[57].»
En souvenir de quoi, sans doute, par un de ces retours de race chers aux généalogistes, on put voir, aux beaux temps de la bicyclette, les agents de M. Lépine faire la chasse aux petites femmes qui, soit à la musique du Luxembourg, soit par les terrasses de Montmartre, déambulaient et se déhanchaient en culotte, sans avoir même l'excuse de la plus humble Clément où asseoir leur séant rebondi.