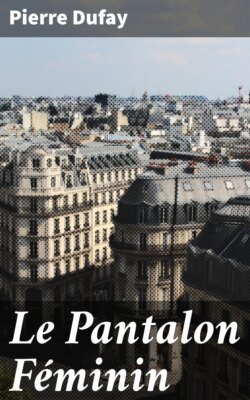Читать книгу Le Pantalon Féminin - Pierre Dufay - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE CALEÇON DES COQUETTES DU JOUR
ОглавлениеTable des matières
Quelques tentatives faites pour réacclimater sous les jupes le caleçon aboli de l'escadron volant de Catherine, donnèrent naissance à ce poème.
Il avait la prétention d'être comique et Bachaumont qui, sans doute ne l'avait pas lu, le juge, sur son titre, ordurier:
«Le Caleçon des Coquettes du jour. La Haye, 1763, in-8. Cet ouvrage ordurier se distingue assez par son titre et ne mérite pas une plus grande attention[92]».
N'exagérons rien, il n'est pas ordurier, il n'est qu'ennuyeux.
Encore que la librairie belge ait cru devoir rééditer cette pauvreté, elle est peu connue. Malgré sa fadeur, il n'est donc peut-être pas inutile d'en donner une brève analyse et d'en citer quelques extraits.
Place Saint-Sulpice, le vent qui balaie le bureau du tramway d'Auteuil ne datant pas d'aujourd'hui, une femme, Dorimène, vient à tomber. La rafale soulève ses jupes et sa chemise, offrant aux regards le double globe de ses rotondités naturelles.
«Une grande sœur grise», sœur Véronique, l'aide à se relever et à réparer le désordre de sa toilette; un peu placière, elle lui offre le bras et la reconduit chez elle, pour lui vanter sa marchandise.
Nous ne sommes pas encore à l'époque où la supérieure d'un couvent d'Orléans refusera de laisser confectionner par ses pensionnaires les pantalons d'un trousseau de mariage, «vu l'inconvenance de ce vêtement». Sœur Véronique ne se contente pas, contrairement à la plupart des religieuses, de porter des culottes, elle-même les fabrique et elle voudrait bien en vendre à Dorimène. Cet accessoire lui permettrait, une autre fois, d'éviter les suites d'un semblable accident:
J'en rougis aussi.
On doit rougir, être en souci,
A moins de n'être pas pudique,
D'une avanie aussi publique,
Dont vous pouviez vous garantir,
Pour éviter tout repentir.
Et comment, ma sœur, je vous prie,
Lui dis-je, et de quelle façon
Vous en seriez-vous garantie?
Si vous portiez un caleçon,
Par pudeur, me répondit-elle,
D'une toile bien blanche et belle
Quand le plus impétueux vent
Ou par derrière, ou par devant,
Vous trousserait dans une rue,
Sur une place, ou bien ailleurs,
Le caleçon frappant la vue
Ferait taire tous les railleurs.
Je tiens ce conseil d'une tante,
Qui, tandis qu'elle était vivante,
Craignant que des vents furieux,
Ou de ces galants curieux,
Coureurs des filles d'Amathonte,
Pressés par d'amoureux transports
Ne me fissent l'horrible honte,
D'exhiber celle de mon corps,
Me tint, à ma dixième année,
Exactement caleçonnée,
Depuis les reins jusqu'au dessous,
Deux bons pouces de mes genoux.
Un peu étonnée, Dorimène retient la sœur Véronique à souper. Le vin achève de lui délier la langue et nous apprenons ainsi pour quelle raison sa tante, qui à vrai dire était sa mère, mais ne compliquons pas le récit, la condamna à compliquer ses dessous de cet entonnoir d'un nouveau genre:
Mais comme au-dessus de l'anus,
Vous avez un horrible signe,
Je veux que vous portiez toujours,
Pour en changer tous les cinq jours,
Un blanc caleçon de cretonne,
Mesure prise à votre cu,
Par moi-même, afin que personne
Du défaut dont il est pourvu
N'ait connaissance.
Un horrible signe? Allons donc! il y a des grains de beauté qui sont parfois du meilleur effet! et, confiante, la chaste brebis raconte sa vie; pour une femme, c'est un peu raconter ses amours.
Tout d'abord des souvenirs de pension, non, de couvent. Claudine fut de tous les temps à l'école. Véronique portait déjà son fameux caleçon, et au moment de l'introduction du duo saphique, sa partenaire ne laissa pas d'être étonnée en présence de cet obstacle alors imprévu:
Brûlant pour moi d'un vif amour,
Avec ardeur, cette tribade
S'y prit de si bonne façon,
Que défaisant mon caleçon,
Dont elle parut très surprise,
Elle me fit une sottise
Qui me cause encor du regret.
Dans une rencontre plus sérieuse et en face d'un adversaire mieux armé, la place ne devait pas tarder à capituler sans conditions et à démanteler ses faibles remparts.
Cela se passa comme à l'ordinaire, dirait Longus: le déshonneur de la guerre tout au plus.
Dorimène sait ce qu'il en est et se montre bien plus curieuse de savoir comment peut bien être fait un pantalon de femme? Envie d'autant plus facile à contenter que la Sœur voit là une occasion unique de vanter et d'écouler sa marchandise:
De vos malheurs consolez-vous,
Ma chère Sœur, unissons-nous
D'amitié pour toute la vie,
Et pour remplir mon autre envie
Faites-moi voir le caleçon
Que vous portez. Sœur Véronique,
Se troussant alors sans façon,
Me dit: Madame, j'en fabrique
Depuis longtemps parfaitement,
Dans ma cellule, sourdement,
A douze francs pour la main-d'œuvre
Pour les dames dont la manœuvre
Est de cacher leur pays bas;
Parce qu'un galant homme attache
Moins d'attraits aux frappants appas,
Qu'à ceux que le caleçon cache».
C'est peut-être un peu cher pour la façon; mais toute nouveauté se paie. Puis, la confection d'un semblable caleçon n'est pas aussi simple que peut penser le vulgaire. Celui de la religieuse comporte deux brayettes, comme certains modèles allemands et Véronique d'en vanter les avantages et la commodité:
Le mien, quoique déjà sali,
Depuis six jours que je le porte,
Sur moi ne fait pas un seul pli;
Regardez: il est fait de sorte,
Que par derrière et par devant,
Déboutonnant ces deux brayettes,
Que je crois artistement faites,
On se sert du moulin à vent,
Et du moulin à l'eau sans gêne,
Pour leurs diverses fonctions[93];
C'est une des inventions
Qui cache ce qu'on a d'obscène
Dont bien des femmes font grand cas.
Pas tant que cela, semble-t-il. Bien peu en faisaient cas. A la scène, les comédiennes et même les danseuses n'en portaient pas. Si, en dehors de celle de la pièce, une chute venait à se produire, elle ne manquait pas d'être plaisante.
Bachaumont, non encore atteint de sa pruderie de décembre, raconte tout au long l'accident qui marqua les débuts de Mlle de Maisonneuve:
C'est là une chose qu'une femme n'oublie pas. «1763—mai 3—Mlle de Maisonneuve, petite-fille de la femme de chambre de Mlle Gaussin, celle dont on a déjà parlé et dont l'abbé de Voisenon a décélé les talens, vient de débuter: elle a de la naïveté, de l'intelligence et promet beaucoup; elle a été très bien accueillie aujourd'hui; elle a joué dans la Gouvernande et dans Zénéide. Dans la première pièce, comme elle est en tête-à-tête avec son amant, on vient l'avertir de se retirer; en fuyant elle est tombée dans la coulisse et a laissée voir son derrière. Mlle Bellecour, dite Gogo, soubrette, est venue très modestement lui remettre ses jupes. Le tout s'est passé au contentement du public, qui a fort fêté le cul de l'actrice et la modeste Gogo. La jeune personne n'a point été déconcertée, elle est rentrée peu après sur le théâtre[94]...»
Le Mercure de France donne bien un compte rendu élogieux de cette «première» et trace un joli portrait de la débutante, mais, de même que Collé, il tait son accident.[95] Victor Fournel, par contre, en parle dans ses Curiosités théâtrales[96] et, par une double confusion, l'attribue à la modeste Gogo elle-même, qui serait, à son dire, Mlle Beauminard.
L'héroïne de cette aventure, Louise-Adélaïde Berton de Maisonneuve, dont le père était orfèvre, comme M. Josse, joua peu sous son nom et fut surtout connue au théâtre sous celui de Mlle d'Oligny[97].
Dans son étude sur la Raucourt et ses amies, M. Jean de Reuilly croit trouver dans cette chute l'origine de l'ordonnance qui rendit le caleçon obligatoire à la scène:
«Le jour de ses débuts, D'Oligny en sortant de scène tomba dans la coulisse et fit voir son derrière au public...
«La plaisante chute de D'Oligny eut pour résultat l'obligation pour les dames de théâtre d'avoir une culotte ou un caleçon sous leurs jupes. On peut donc dire que cette actrice est l'inspiratrice du pantalon féminin qui, de la scène a gagné la ville au commencement du XIXe siècle»[98].
L'accident ne me semble pas avoir eu d'aussi graves conséquences. Le public se contenta de rire et le lieutenant de police ferma les yeux.
Mlle de Maisonneuve resta étrangère à cette réforme, qui suivant les contemporains aurait eu pour berceau non la Comédie-Française, mais l'Opéra.
On suppose, en effet, quelles piquantes révélations le ballet devait réserver à ses fervents, du jour où Mlle de Camargo y eut importé l'usage gracieux des robes courtes.
Mlle Sallé tenta, de son côté, à Londres, une révolution analogue, quand elle y créa, en 1784, le ballet de Pygmalion. Mais sa haute vertu qui lui valait une estime particulière des Anglais et lui avait fait refuser un don de 2.000 guinées, dont on devine le motif, ne s'était cependant point embarrassée d'un caleçon pour paraître sur la scène. La novatrice était pour la simplification du costume et non pour sa complication. Son costume, dont le Mercure de France fournit la description ne laisse aucune place à un pantalon:
«Elle a osé paraître dans cette entrée sans panier, sans jupe, sans corps, et échevelée, et sans aucun ornement sur sa tête; elle n'était vêtue, avec son corset et un jupon, que d'une simple robbe de mousseline tournée en draperie et ajustée sur le modèle d'une statue grecque»[99].
Pour qu'il y eût caleçon, il fallut la Camargo et ses jupes courtes; puis, il fallut un nouvel accident, car l'accident qui le rendit obligatoire ne vint que plus tard.
«Elle importa au théâtre, dit M. Nérée Desarbres, l'usage des caleçons, qui bientôt furent obligés par une ordonnance de police et plus tard remplacés par le maillot.»[100]
Toutefois, malgré sa verve «capriolante», elle dansait, paraît-il, avec une décence telle que jamais, à l'époque de ses débuts tout au moins, elle ne laissait apercevoir sa jambe au-dessus du genou.
Une question se serait même posée, à ce sujet, parmi les habitués de l'Opéra:
—«Camargo porte-t-elle un caleçon?... Des paris furent engagés sur cette énigme, jusqu'au jour où l'héroïne interrogée sur ce point délicat, répondit:—Vous imaginez-vous qu'une fille de qualité ose se produire sur la scène sans cette précaution?»[101]
Casanova, toujours si véridique, qui vit danser Camargo vieillie, se montre, cependant, moins affirmatif ou plutôt affirme, par ouï-dire, qu'elle négligeait, comme ses camarades, cette précaution:
«Immédiatement après, je vois une danseuse qui, comme une furie, parcourt l'espace en faisant des entre-chats, à droite, à gauche, dans tous les sens, mais s'élevant peu et cependant applaudie avec une sorte de fureur.
—C'est, me dit Patru, la fameuse Camargo. Je te félicite mon ami, d'être arrivé à Paris assez à temps pour la voir, car elle a accompli son douzième lustre.
«J'avouai que sa danse était merveilleuse.
—C'est, ajouta mon ami, la première danseuse qui ait osé sauter sur notre théâtre; car avant elle les danseuses ne sautaient pas; et ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'elle ne porte point de caleçon.
—Pardon; j'ai vu...
—Qu'as-tu vu? C'est sa peau, qui à la vérité, n'est ni de lis, ni de rose.
—La Camargo, lui dis-je, d'un air pénitent, ne me plaît pas; j'aime mieux Duprès.
«Un vieil admirateur, qui se trouvait à ma gauche, me dit que dans sa jeunesse elle faisait le saut de basque et même la gargouillade, et qu'on avait jamais vu ses cuisses quoiqu'elle dansât à nu.
—Mais si vous n'avez jamais vu ses cuisses, comment pouvez-vous savoir qu'elle ne portait point de tricot?
—Oh! ce sont des choses qu'on peut savoir. Je vois que Monsieur est étranger.
—Oh! pour ça, très étranger.»[102]
Que cette «fille de qualité» ait ou n'ait point porté de caleçon, Mlle Mariette, dite «La Princesse», en raison de sa liaison avec M. de Carignan, n'en portait à coup sûr point et le prouva jusqu'à l'évidence, le soir où ses jupes furent accrochées par les aspérités d'un portant.
L'accident aurait pu arriver à toute autre. Ces demoiselles de la danse avaient, en effet, adopté sans se faire prier, l'usage des robes courtes de la Camargo: elles permettaient d'apprécier leurs jambes et apprécier n'est-ce pas un peu désirer?
Par contre, elles se souciaient peu d'embarrasser leurs cuisses de ce «pantalon qui, serré au genou, produisait sous la jupe, un effet disgracieux.»[103]
L'accident prévu devait donc se produire, et l'on fait communément remonter à «cette vision d'art» l'origine de l'ordonnance de police qui imposa le port du «caleçon» à toutes les comédiennes, chanteuses, danseuses et simples figurantes des divers théâtres de Paris»
«Mlle Mariette n'est pas étrangère à l'ordonnance qui prescrivit les caleçons. Un soir, cette danseuse eut sa robe, ses jupons et ses paniers enlevés par les aspérités d'un décor sortant du dessous et posa pour l'antique pendant quelques secondes devant une salle fort garnie applaudissant à ce spectacle inattendu.»[105]
Le lieutenant de police avait-il attendu l'accident pour intervenir, ou, en contravention, Mlle Mariette méritait-elle une amende, comme une vulgaire théâtreuse?
La première des deux hypothèses est la plus plausible. L'Administration s'émeut toujours après, elle prévoit rarement.
Une telle ordonnance ne pouvait pourtant passer inaperçue. Les plus graves problèmes de la politique ou de la diplomatie sont peu de choses, auprès des amours d'une comédienne ou des débauches d'une fille d'Opéra. Le Journal des inspecteurs de M. de Sartines et les rapports de Marais sont, à ce point de vue, singulièrement édifiants. Paris a pu vieillir, mais n'a guère changé.
Aussi, devons-nous à l'ordonnance, rendant le caleçon obligatoire, deux des pages les plus gaies peut-être de la correspondance de Grimm:
«C'est Camargo qui osa la première faire raccourcir ses jupons, et cette invention utile qui met les amateurs en état de juger avec connaissance les jambes des danseuses, a été depuis généralement adoptée; mais alors elle pensa occasionner un schisme dangereux. Les jansénistes du parterre criaient à l'hérésie et au scandale, et ne voulaient pas souffrir ces jupes raccourcies; les molinistes, au contraire, soutenaient que cette innovation nous rapprochait de l'esprit de la primitive Église, qui répugnait à voir des pirouettes et des gargouillades embarrassées par la longueur des cotillons. La Sorbonne de l'Opéra fut longtemps en peine d'établir la saine doctrine sur ce point de discipline qui partageait les fidèles. Enfin, le Saint-Esprit lui suggéra, dans cette occasion difficile, un tempérament qui mit tout le monde d'accord; elle se décida pour les jupes raccourcies, mais elle déclara en même temps, article de foi, qu'aucune danseuse ne pourrait paraître au théâtre sans caleçon. Cette décision est devenue depuis un point de discipline fondamental dans l'église orthodoxe, par l'acceptation générale de toutes les puissances de l'Opéra et de tous les fidèles qui fréquentent ces lieux saints[106]».
Mercier commente également cette ordonnance. Il ne la fait intervenir qu'après l'accident de Mlle Mariette et témoigne de l'ignorance dans laquelle les Parisiennes vivaient généralement de ce voile protecteur:
«C'est toujours après l'accident que vient la loi réparatrice. Le jeu subit d'une décoration ayant accroché les jupons d'une comédienne et coupé son rôle, il s'ensuivit une ordonnance de police, qui enjoint à toute actrice ou danseuse de ne paraître sur les planches d'aucun théâtre sans caleçons.
«L'actrice qui joue le rôle grave de Mérope ou d'Athalie n'en est pas plus dispensée que celle qui bondit et fait des cabrioles au-dessus des têtes pressées du parterre. Cette loi s'étend depuis la salle de l'Opéra[107] jusqu'à la loge du grimacier.
«La tragédienne superbe, sous ses majestueux habillemens, et déjà respectable par elle-même, doit encore se munir de ce voile caché contre les accidents ignorés et imprévus, ainsi que la saltimbanque de chez Nicolet, pour qui ce vêtement n'est pas une précaution superflue.
«Excepté les actrices, les Parisiennes ne portent point de caleçons; ils sont d'usage dans des pays plus froids. S'ils étaient adoptés à Paris, nos femmes délicates, qui aiment à courir partout, se préserveraient d'une infinité de maux que le froid et l'humidité leur occasionnent[108]».
Garsault, en son Art de la Toilette, ne souffle mot du caleçon et la Du Barry, qui possédait de si jolis bidets, semble en avoir ignoré l'usage. Ainsi, laissait-elle apercevoir à Léonard, ce héros ridicule, «un petit pied et beaucoup plus de la moitié d'une jambe modèle exposés avec cette recherche de coquetterie qui s'inquiète peu du qu'en-dira-t-on».
Le drôle n'ayant su cacher son ravissement la comtesse ne put s'empêcher de sourire:
«Et tout en se récriant sur mon défaut de perspicacité la maîtresse de Louis XV fit sur son canapé le plus indiscret des mouvements, et put se convaincre que mes yeux savaient mieux pénétrer que mon esprit[109]».
La jambe modèle devait être de beaucoup dépassée car, comme la plupart des Parisiennes, Jeanne Bécu ne portait point de pantalon.
Quelques-unes, pourtant, commençaient à s'en munir pour monter à cheval, d'autre pour des raisons d'hygiène infiniment respectables, mais peu écoutées.
Les premières suivant l'Encyclopédie étaient assez nombreuses, les secondes: l'exception:
«En France, plusieurs femmes portent actuellement des caleçons pendant l'hiver pour éviter des maladies; et pendant l'été, par propreté, presque toutes les bourgeoises qui vont souvent à la campagne, à cheval, portent aussi des caleçons[110]».
Non moins que sœur Véronique, un subtil industriel s'était fait une spécialité de leur confection. Il y dut sa vogue et son surnom. La Liste des Seigneurs et Dames venus aux Eaux de Spa, l'an 1773, fournit l'adresse du personnage et donne l'origine de son surnom:
«N. Pantalon, connu sous ce nom par la quantité qu'il en a faits, tant pour hommes que pour femmes, très commodes pour monter à cheval, demeure rue de la Sauvenière, à Spa[111].
En Hollande, non pour monter à cheval, mais pour patiner, les femmes et les jeunes filles en portaient également:
«Le prétendu de Mlle Casanova m'attacha des patins, et voilà les demoiselles en train, en courtes jupes, bien culottées en velours noir pour se garantir de certains accidents[112]».
Bien plus, cet aventurier de Casanova nous révèle également ce détail: les servantes elles-mêmes prenaient soin de passer une culotte sous leurs paniers, lorsque certaines besognes les forçaient à dominer par trop la tête des passants.
«Cette maison paraissait être un bloc de marbre, car l'extérieur en était recouvert comme l'intérieur; elle devait avoir coûté des sommes immenses. Le samedi, une demi-douzaine de servantes, perchées sur des échelles, lavaient ces magnifiques murs. Ces servantes, portant de larges paniers, étaient obligées de se mettre en culotte, car sans cela, elles auraient trop intéressé les passants curieux[113]».
En vérité, je n'aurais jamais cru la Hollande aussi vertueuse, et tels personnages de Teniers nous avaient habitués à moins de retenue.
Quant au caleçon des danseuses, il n'avait point tardé à rallier les suffrages des «amateurs». Il avait du bon et faisait mieux désirer ce qu'il cachait.
L'«abonné» était déjà en puissance:
«Vous voyez souvent en Angleterre, écrit l'Espion anglais, Mlle Heinel; mais il n'est pas possible qu'elle y ait montré son talent pour la pantomime comme elle l'a fait ici dans le ballet de Médée et Jason, où elle a rendu le rôle de la célèbre magicienne avec une vérité qu'on ne peut surpasser. Les demoiselles Allard et Peslin sont depuis trop longtemps au théâtre pour que vous ignoriez leur nom et leur mérite. Les gavottes, les rigaudons, les tambourins, les loures, tout ce qu'on appelle les grands airs leur fournissent sans cesse une occasion d'imaginer une variété de pas étonnante: leur chef-d'œuvre est surtout la gargouillade, c'est-à-dire les écarts, les tournoymens, les pirouettemens sur un seul pied, les développemens des charmes secrets, qu'un perfide caleçon dérobe sans cesse aux yeux, mais qui ne fait qu'irriter davantage les désirs des amateurs[114]».
Certains n'étaient cependant pas sans protester, entre autres Robbé de Beauveset, cet enfant perdu de la Muse, qui vivait et soupait à Paris de son esprit et des deux pensions qu'il touchait, l'une de Mgr de Beaumont, archevêque de Paris et l'autre de Louis XV, que ses contes en vers amusaient. Robbé, qui, en ce moment ne tombait pas dans les convulsions du cloître Saint-Médard après avoir prêté aux caleçons une origine singulière dans son adaptation un peu libre du bref Si femoralia, fulmina dans ces termes contre ce qui n'était pas encore le «tutu» des danseuses:
O caleçons! Voile modeste
Qu'au détriment des yeux la pudeur déterra;
A nos regards lascifs, obstacle trop funeste,
Masque d'appas secrets, toujours on te verra
Éclipser à nos yeux la cuisse blanche et leste
De nos danseuses d'Opéra!
Avant que la triste réforme
Dont à jamais Dieu damne les auteurs,
Eut fait sur tous les culs sauteurs
Endosser l'habit uniforme,
L'avide spectateur dressé sur ses ergots,
Suivant dans l'air une jambe élancée,
A l'aide d'une jupe à l'instant rehaussée,
Des cuisses de nos camargos
Découvrait du moins la naissance,
L'orgueil d'un fémur portant à l'œil frappé,
Par un hasard de luxure échappé,
Aiguisait l'appétit de la concupiscence.
On jouissait d'un beau cul dans les airs,
Comme on jouit du brillant des éclairs.
Mais qu'à présent une sauteuse alerte,
Quittant la terre aux yeux du public enchanté,
Communique au panier son élasticité
Qu'aperçoit-on dessous? Qu'une cuisse couverte
De son harnais plissé tout je ne sais comment,
Et fait un vrai haut-de-chausse ottoman.
Que le foudre sacré dont le pape Alexandre
Pulvérisa jadis le caleçon romain
Ne puisse-t-il réduire en cendre
L'audacieux, l'impitoyable humain,
Qui, sous ce béguin ridicule,
De Terpsichore emboîta les genoux,
Au mépris d'une sainte bulle,
Comme au détriment de nous tous[115].
En dépit de ces protestations, le caleçon passa à l'étranger et y devint obligatoire. A Rome, les danseuses durent en porter dès 1765, et, en attendant que leurs maillots verts transformassent en grenouilles les marcheuses des théâtres napolitains, en 1780, une ordonnance pontificale contraignit, à Rome, les ballerines à porter des culottes de velours noir.
Les marionnettes elles-mêmes n'échappèrent pas à cet empantalonnement, tant on avait du «nu» une crainte que n'eût point désavouée le plus vertueux des sénateurs:
«Quant à la perfection des entrechats et des ronds de jambe de mesdames les marionnettes de Rome, je ne citerai qu'un fait qui me dispensera de toute autre louange. Les pudiques scrupules de l'autorité romaine ont astreint ces sages et irréprochables sylphides à porter des caleçons bleu de ciel, tant on craint les dangers de l'illusion[116]».
O Guignol! une interpellation au Luxembourg, parce que, en se laissant choir, Mme Guignol aura laissé constater aux gosses assemblés qu'elle n'avait pas de pantalon.
Mais il est vrai qu'elle n'a ni cuisses, ni jambes.
Il y eut mieux, d'ailleurs. Si le caleçon était obligatoire, il était, en Espagne du moins, interdit aux danseuses de laisser apercevoir sous leurs jupes le leurre du caleçon et une amende d'un écu était réservée à celles qui avaient failli à cette prescription.
Casanova raconte, non sans esprit, comment, à Barcelone, la Nina encourut l'amende et évita le lendemain son retour. Ce fut même là, suivant le Vénitien, l'origine de sa fortune. Mlle Churchill se fit aimer en laissant voir son derrière. Il en fut de même de l'artiste:
—Comment le comte Ricla en est-il devenu amoureux?
—Écoutez. L'histoire n'est pas longue et elle est singulière.
«A peine arrivée à Barcelone, il y a deux ans, venant du Portugal, on la prit pour figurante dans les ballets, à cause de sa belle figure, car pour son talent elle n'en a pas: tout ce qu'elle fait fort bien est la rebaltade, sorte de saut en reculant et en pirouettant. Le premier soir qu'elle dansa, elle fut vivement applaudie du parterre, parce que en faisant la rebaltade, elle montra ses caleçons jusqu'à la ceinture. Or, il faut savoir qu'en Espagne, il y a une loi qui condamne à un écu d'amende toute danseuse qui, en dansant sur la scène, a le malheur de montrer ses culottes au public. Nina, qui n'en savait rien, se voyant applaudie, recommença de plus belles; mais à la fin du ballet, l'inspecteur lui dit qu'il lui retiendrait deux écus de son mois pour payer ses impudentes gambades. Nina jura, pesta, mais ne put s'opposer à la loi. Savez-vous ce qu'elle fit le lendemain pour éluder la loi et se venger?
—Elle dansa mal peut-être?
—Elle dansa sans caleçons et fit sa rebaltade avec la même force, ce qui causa au parterre un tumulte de gaieté tel qu'on n'en avait jamais vu à Barcelone. Le comte Ricla qui, de sa loge, avait tout vu et qui se sentit à la fois saisi d'horreur et d'admiration, fit appeler l'inspecteur pour lui dire qu'il fallait exemplairement punir cette audacieuse autrement que par les amendes ordinaires.—En attendant, amenez-la moi.—Voilà Nina dans la loge du vice-roi, et qui, avec son air effronté, lui demande ce qu'il lui voulait.—«Vous êtes une impudente et vous avez manqué au public.—Qu'ai-je fait?—Le même saut qu'hier.—C'est vrai, mais je n'ai pas violé votre loi, puisque personne ne peut dire qu'il a vu mes culottes; car, pour être sûre qu'on ne les verrait pas, je n'en ai point mis. Pouvais-je faire plus pour votre maudite loi qui par surprise, me coûte déjà deux écus? Répondez-moi.» Le vice-roi et tous les grands personnages présents eurent besoin de se mordre les lèvres pour s'empêcher de rire, car dans le fond Nina avait raison, et une discussion approfondie sur cette loi violée ou non eût produit un grand ridicule. Le vice-roi, qui sentit la fausse position où il se trouvait, se contenta de dire à la danseuse que si à l'avenir il lui arrivait de danser sans culotte, elle irait passer un mois en prison au pain et à l'eau. Nina fut obéissante»[117].
Le caleçon, c'était un peu pour le public le fruit défendu et sans qu'à Londres une loi aussi draconnienne interdit aux danseuses de laisser voir le leur, le parterre se montrait friand de ce voile intime. Mlle Coulon, qui, dans ses pirouettes, laissait voir jusqu'au dernier bouton de sa culotte, savait le prix que les spectateurs attachaient à cette exhibition:
«La danseuse Coulon a dansé la première; il m'a paru ainsi qu'à tous les spectateurs qu'elle a fait beaucoup de progrès, surtout dans les sauts, car elle a fait voir au moins dix fois, dans de très longues pirouettes, le plus haut bouton de son caleçon; elle a été fort applaudie»[118].
Au surplus, La Nina n'était pas seule à supprimer, quand il lui chantait, le caleçon réglementaire: les comédiennes, à qui il était, à vrai dire, moins nécessaire, ne se gênaient pas davantage. D'où ce dialogue emprunté à Casanova, car il faut toujours revenir à ce diable d'homme quand il s'agit de la fin du XVIIIe siècle:
—Quand même nous saurions nos rôles comme le Pater, nous sommes certaines de rester court si le souffleur n'est pas dans son trou.
—Fort bien, madame, dis-je à celle qui était chargée du rôle de Lindane, je remplirai moi-même votre trou, mais je verrai vos caleçons.
—Il serait difficile, dit le premier acteur, elle n'en porte pas.
—Tant mieux.
—Vous n'en savez rien, monsieur, lui dit-elle[119].
Cette manie aussi qu'ont certaines gens de ne pouvoir garder pour eux les petits secrets qu'une défaillance ou un moment d'abandon ont pu leur révéler!
Quant au souffleur, ne le plaignez pas trop. Lorsque, dans un trou, il manque la réplique, ne croyez pas qu'il dorme, point du tout: il voit.
LES COSTUMES A LA GRECQUE
Notre-Dame de Thermidor, Thérèse Cabarrus, devenue la citoyenne Tallien, est la reine de la mode, elle se montre à Frascati, ainsi vêtue ou plutôt dévêtue, sa robe à l'athénienne fendue latéralement, laissant voir ses jambes dans un maillot couleur chair, avec des cercles d'or à la place des jarretières et des cothurnes à l'antique et des bagues à chaque doigt de ses pieds de statue.
Robida.