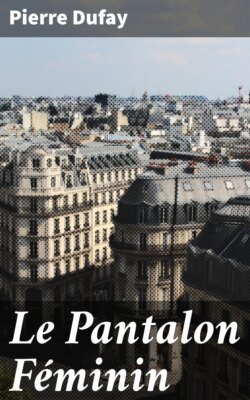Читать книгу Le Pantalon Féminin - Pierre Dufay - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES ORIGINES
ОглавлениеTable des matières
Le Pantalon féminin! Pourquoi pas? Des érudits et des chercheurs ont écrit l’histoire et retracé les origines de la chemise, du corset, de l’éventail, de l’ombrelle. Le pantalon, seul, semble avoir été négligé. C’est là, en vérité, une lacune qu’il conviendrait de combler.
Des dessous de la femme, nul n’est plus moderne; il semble en constituer la quintessence. Il a le charme d’une inutilité d’autant plus soignée que quelques-uns seulement doivent jouir de sa vue. «Un trou avec de la dentelle autour», disait une jolie femme que son radieux sourire n’empêchait point de se souvenir de la définition du canon; quelque chose comme «l’écrin qui enferme le rubis», ajoutait une autre.
Comme l’écrin, le pantalon s’entr’ouvre pour laisser contempler à nos yeux émerveillés les joyaux qu’il recèle. Il les rend plus désirables en les voilant, mais il ne les cache pas.
Grave sujet de réflexions pour les jeunes gens du temps présent, hommage respectueux rendu par le vice à la vertu: puissent les disciples de M. Bérenger reconnaître la salutaire influence de leur maître, au cours de ces pages dont la femme nous a fourni le fond et la forme, encore que, il le faut confesser, le pantalon féminin soit rarement fermé.
Son «usage ne se perd pas dans la nuit des temps», écrivait judicieusement, il y a quarante ans, le dessinateur Bertall[1]; toutefois, si Eve la blonde qui, après la pomme, se contenta d’une feuille de vigne, en ignora l’usage et si beaucoup d’autres l’ignorent encore, la femme n’attendit point la crinoline pour arborer cet accoutrement d’un genre nouveau. Bien avant que fussent révolus les temps des cages et des cerceaux, certaines se plurent à porter la culotte, aussi bien au propre qu’au figuré.
Soucieux de la vérité historique, le grand Flaubert, dans son Hérodias,faisait porter à Salomé des «caleçons noirs semés de mandragores», et, dans son adorable Aphrodite,Pierre Louys se garde bien de taire les «caleçons fendus»—déjà—de la reine Bérénice.
Ce n’est pas là seulement littérature. A Rome, comme les danseuses du Tabarin ou du Moulin Rouge, acrobates et actrices de mimodrames étaient tenues d’en être munies. Au mot subligatus,le Dictionnaire des Antiquités romaines d’Antony Rich et celui de Saglio fournissent, à ce sujet un dessin caractéristique.
De même, les chutes au tennis ne datant pas d’aujourd’hui, Philœnis, l’une des héroïnes de Martial (Epigr. VII, 67) a soin de passer un pantalon avant de jouer à la balle.
C’étaient évidemment là des cas où il pouvait paraître indispensable. Mais, en dehors de ces jeux, à certaines époques tout au moins, les Romaines: matrones, affranchies et femmes du peuple firent mieux et en portèrent d’une façon courante.
Les fouilles et les moulages opérés à Pompéi, par M. Fiorelli, ne laissent sur ce point aucun doute.
Dans la grave Revue des Deux Mondes,M. Beulé commentait ainsi la découverte de ces corps de femmes moulés dans la cendre:
«Les cuisses sont recouvertes d’une étoffe fine qui constitue un véritable caleçon. Ce qu’on avait cru remarquer sur les empreintes du souterrain de Diomède devient ici un fait certain. En y réfléchissant, le costume antique était si transparent chez la femme, si court chez les hommes, si sujet aux accidents de la vie en plein air, que le caleçon ou un équivalent étaient nécessaires pour que la pudeur ne fût pas à chaque instant blessée. La sculpture n’avait pas à tenir compte du caleçon, qui disparaissait sous le costume; toutefois, sur la colonne Trajane, on était déjà averti que les soldats romains en portaient; à Pompéi on constate que même les esclaves et les femmes du peuple avaient ce vêtement qui, surtout alors était indispensable»[2].
Puis, au sujet d’une jeune fille:
«Deux anneaux de fer passés à ses doigts attestent sa pauvreté; son oreille écartée et large, son origine prolétaire. Sur les cuisses, on reconnaît un caleçon assez fin; au contraire, l’étoffe du reste des vêtements est grossière, déchirée par places, mais elle laisse voir des chairs fermes et polies, des contours d’un réalisme presque embarrassant qui rappelle le modèle dans l’atelier.»[3]
Toutes étaient loin d’en porter, cependant. Calphurnie, outrée d’avoir perdu la cause qu’elle venait de plaider, aurait même donné aux juges que n’avait pu toucher la grâce de son talent, une preuve, empruntée à Phryné, de l’ignorance où elle vivait de ce vêtement.
Ce geste dont devait se souvenir la Mouquette aurait même été la cause, suivant Furetière, de la loi qui fit interdire aux femmes l’exercice du barreau:
«Calphurnie fut cause qu’on a interdit le barreau aux femmes, parce qu’ayant plaidé une cause qu’elle perdit, elle en fut si irritée contre les Juges, qu’elle se découvrit impudemment le derrière et le leur montra par mépris. On ordonna en même temps que jamais femme ne plaideroit»[4].
Sans doute, craignait-on que la justice, malgré sa cécité légendaire, se laissât trop facilement influencer si de tels éléments d’appréciation continuaient à être soumis au tribunal.
L’Ordre des Avocats compte aujourd’hui d’adorables «consœurs»: est-ce en raison du pantalon dont on les croit munies sous leur robe que la sévérité de la loi s’est, dirai-je à leur endroit, si singulièrement adoucie?
Pour Vignola, comme pour Beulé, la Romaine aurait porté sous la stola un caleçon d’un tissu délicat et... «des chaussettes»[5].
Oh, oh!... voilà qui est un peu osé; mais Vignola joint tant d’esprit à son talent.
Le caleçon se retrouve également dans la Gaule et la Gallo-Romaine ne portant pas de bas, ce serait à retenir autour du genou leurs culottes qu’auraient servi les jarretières luxueusement ornées: camées, pierres gravées, émeraudes ou améthystes, dont les fouilles nous révèlent parfois la richesse[6].
La sculpture n’a point toujours négligé ce détail. Au Louvre, parmi les délicieuses statuettes en terre cuite provenant de Myrina, figure un Atys hermaphrodite, en costume phrygien, dont, dans le mouvement de la danse, la tunique courte laisse voir, tombant jusqu’à la cheville, les jambes d’un pantalon étroit et uni[7].
Le pantalon, combien qu’on ait longtemps semblé l’ignorer, appartenait si bien au costume de la femme antique, qu’en 1807, se faisant auprès de leurs contemporaines les apôtres peu écoutés de ce vêtement oublié, les docteurs Desessartz et de Saint-Ursin ne craignaient point de se reporter à l’antiquité et de la donner comme exemple:
«Parmi les vêtements de l’antiquité grecque, que le goût et la santé devraient faire prendre au sexe en Europe, il en est un dont j’ai toujours regretté qu’on ne soupçonnât pas le besoin: c’est le double caleçon, l’intérieur de toile et l’extérieur d’une soie légère, qui, en interceptant le passage de l’air, soit dans la marche ordinaire des femmes, soit dans leurs danses animées, préviendrait les rhumatismes et d’autres incommodités... Cette antique et nouvelle parure, si elle était adoptée, aurait encore l’avantage de les délivrer des entraves de leurs triples jupons[8].
Ce conseil fut, il est vrai, un peu suivi. Parmi les grandes dames de la cour impériale, Hortense fut seule, à peu près, à consentir, et par un simple caleçon, à ce retour à l’antiquité. A peine si sa mère, l’impératrice Joséphine, en portait parfois pour monter à cheval et combien en ignorèrent toujours l’usage. Quant à ceux d’Hortense, le grand livre de Leroy, à défaut des indiscrétions de la chronique, nous en révèle l’élégance.
De Rome, le subligat des acrobates et des actrices de mimodrames était passé à Byzance, où au VIe siècle, il était interdit aux femmes de se dévêtir sur la scène sans en être munies.
Notre temps n’a rien inventé, à part la Volupté nouvelle... et elle s’en va en fumée! c’était déjà le cache-sexe cher à M. Bérenger, dont les échos du Palais de Justice ont popularisé le nom, ces dernières années.
Procope, que son nom semblait vouer à ces potins politiques, nous a révélé ce détail de mœurs ignoré. Théodora elle-même, dans une nudité dont elle se montrait peu avare, se voyait forcée de conserver ce mince vêtement destiné à mettre un frein à la licence des rûts.
«Souvent, au théâtre, devant le peuple entier, elle ôtait ses vêtements et s’avançait nue au milieu de la scène ne gardant qu’un petit caleçon qui cachait le sexe et le bas-ventre. Ceci même, elle l’aurait volontiers montré au peuple, mais il n’est permis à aucune femme de s’exposer tout à fait (nue) si elle ne porte pas au moins un petit caleçon sur le bas-ventre...[9].
Avec l’invasion barbare, le pantalon semble avoir disparu de la toilette des femmes, pour passer, sous le nom de braies,dans celle des hommes. Le Moyen-Age est, au point de vue qui nous occupe, d’une pauvreté de renseignements navrante.
A peine si deux vers du Roman du Renard nous font connaître que quelques femmes en portaient... et fermés encore! Sans doute, estimaient-elles, comme Willy, que c’était plus distingué[10].
Cela a ses braies avalées
Qu’elle avait... fermées.
Patience, malgré le silence des auteurs, le pantalon ne devait par tarder à faire une nouvelle apparition sous les jupes des dames. Le Dictionnaire du Mobilier de Viollet-le-Duc en fait foi aux articles Jarretière et Braies:
«Pour danser, les dames portaient des hauts-de-chausses (caleçons) et des bas-de-chausses, par conséquent des jarretières. Les caleçons portés dans les bals sous les jupes étaient commandés par une observation d’hygiène très exacte. Pendant le XIVe siècle, les dames portaient des jarretières de soie brodée, qui, serrées sur le bas-de-chausses, au-dessus du genou, étaient croisées sous le jarret et venaient s’attacher au-dessus du genou. Les caleçons descendaient sur les jarretières plus ou moins haut et ne serraient point la jambe»[11].
Ce fut même, suivant l’éminent architecte, l’origine du nom de bas:
«Les femmes qui ne portaient jamais de braies à pieds, mais des caleçons descendant aux genoux, avaient des hauts-de-chausses, d’où le nom de bas est resté»[12].
Tandis que Viollet-le-Duc se borne à signaler l’existence du pantalon dans la toilette féminine pour danser seulement, M. Alfred Franklin, dans son intéressante série la Vie privée d’autrefois, généralise cet usage, sans, malheureusement, indiquer davantage ses sources:
«Toutes les femmes portaient des hauts-de-chausses ou caleçons, et l’objet des jarretières était précisément de les attacher aux bas-de-chausses ou bas, que l’on ne cherchait point à dissimuler. L’habitude du cheval, l’ensemble un peu brusque des manières découvraient souvent la jambe. La jarretière n’est donc pas encore une pièce secrète du costume; on la couvre d’ornements, on y peint des devises, des armes, des pensées, parce qu’elle est destinée à être montrée»[13].
De son côté, Vignola confirme:
«Les châtelaines» portaient aussi une culotte d’étoffe à crevés, qui leur permettait de chevaucher à califourchon ou en croupe»[14].
Comment les dames avaient-elles été amenées à s’attribuer cet accoutrement viril? On est, sur ce point, réduit aux conjectures.
En dehors de l’observation d’hygiène signalée par Viollet-le-Duc, ne faut-il pas, comme M. le professeur Nardi, de Bari, trouver l’origine du caleçon à cette époque dans le mode de chevaucher qu’avaient alors les femmes?
«Le pantalon des dames fut-il inventé au Moyen-Age par des maris jaloux? Fut-il à certaine époque une ceinture cadenassée?[15] C’est possible, quoique l’histoire reste muette sur ce point. Au Moyen Age, les pauvres dames trottèrent à cheval par les mauvais sentiers de l’Italie, de l’Espagne ou de la France; les selles pour femmes et pour hommes étaient semblables. Dans ces conditions, une jeune fille devait éviter certain froissement immédiat des arçons; et une dame tombant de cheval, préférait ne montrer qu’un fond d’étoffe. Les chutes de cheval ont dû donner naissance au caleçon»[16].
C’est fort vraisemblable. Mais, hypothèse pour hypothèse,—il est bon de rire quelquefois—pourquoi, analysant ce plaisant conte du chevalier de la Tour-Landry, que cite Gudin[17], ne pas chercher l’origine du caleçon, ou, à plus proprement parler, du pantalon, dans l’irrésistible besoin qu’éprouvent parfois les femmes de tromper leur mari ou leur amant?
Celui de la dame était vieux et cordier, et la chère âme le cocufiait avec la furie bien française dont était digne le prieur d’un couvent de cordeliers. Les Carmes ne sont pas seuls à jouir de certaines prérogatives.
A deux reprises, le pauvre homme faillit être convaincu de son infortune et pincer, sans avoir recours au commissaire de police, cet ange tutélaire des maris trompés, l’épouse coupable en flagrant délit.
Grâce au ciel, sa voisine veillait, et l’on sait si les voisines ont toujours été indulgentes à l’adultère de la femme. Voici comment, pour la seconde fois, elle sut la sauver:
«Après une aultre foiz lui avint que il cuida prendre une poche aux piez de son lit pour aler au marché a iij leues d’illec, et il prist les brayes du prieur, et les troussa a son eisselle. Et quant il fut au marchié et il cuida prendre sa poche, il prist les brayes, dont il fut trop dolent et couroucié. Le prieur, qui estoit cachié en la ruelle du lit, quand il cuida trouver ses brayes, il n’en trouva nulles, fors la poche qui estoit de costé. Et lors, il sceut bien que le mary les avoit prinses et emportées. Si fut la femme a grand meschief, et ala à sa commère de rechief et luy compta son fait, et pour Dieu elle y meist remède. Si lui dist:
«Vous prendrés mes brayes et je en prendray unes autres, et je lui diray que nous avons toutes brayes, et ainsi se firent. Et quant le preudhomme fut revenu moult dolent et moult courouciez, sy vint la faulse commère le veoir, et lui demanda quelle chière il faisoit: car mon compère, dist-elle, je me doubte que vous n’ayez trouvé aucun mauvais encontre ou que vous n’aiez perdu du vostre.
«—Vrayment, dist le bonhomme, je n’ay rien perdu; mais je ay bien autre pensée. Et au fort elle fist tant qu’il luy dist comment il avoit trouvé une brayes, et quant elle l’ouy commença à rire et à lui dire:—Ha, mon chier compère, or voi-je bien que vous estes deceu et en voye d’estre tempté; car, par ma foy, il n’y a femme plus preude en ceste ville que est la vostre, ne qui se garde plus nettement envers vous qu’elle fait. Vrayment, elle et moy et aultres de ceste ville avons prises brayes pour nous garder de ces faulx ribaulx qui parfoiz prennent ces bonnes damoiselles à cop, et afin que vous sachiez que c’est vérité, regardez se je les ay. Et lors elle haulsa sa robe et luy monstra comment elle avoit brayes, et il regarda et vit qu’elle avoit brayes et qu’elle disoit voir; si la crut et ainsi la faulce commère la sauva par ij foi»[18].
Il est à noter que les contes du chevalier de la Tour-Landry étaient destinés à «l’enseignement de ses filles». Que n’a-t-il écrit pour ses fils—quand ils auraient vingt ans?—c’eût été plutôt joyeux.
Sans que son usage fût général, le pantalon féminin était donc connu et porté par certaines au Moyen-Age.
Après être devenu la parure favorite des courtisanes de Rome et de Venise, passant les Alpes et la Manche, il devait, au seizième siècle, jouir d’une vogue inconnue jusque-là à la cour de France, aussi bien qu’à celle d’Angleterre.
Vogue passagère: il ne tardera pas à disparaître des mœurs et des dessous. Celles même qui sembleraient avoir le plus besoin de ce vêtement protecteur le plus souvent inutile, les ballerines et les amazones, ne voudront pour rien au monde s’en embarrasser.
Deux siècles passeront ainsi. Pour qu’à notre époque il retrouve sa vogue et sa grâce anciennes, il faudra que chutes et scandales se soient multipliés; que la police, cette pure gardienne des mauvaises mœurs, soit intervenue; que par cinquante années de luttes enfin, il soit parvenu, la crinoline aidant, à s’imposer à la femme moderne,...à la ville et l’hiver tout au moins.