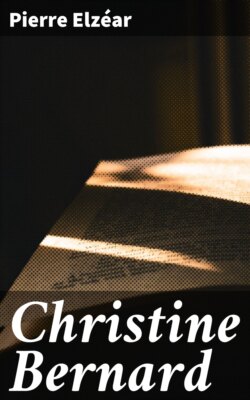Читать книгу Christine Bernard - Pierre Elzéar - Страница 10
ОглавлениеVIII
Après l’armistice Pierre d’Arnaud eut une rechute fort grave. Gaston le fit transporter chez lui.
La Commune survint. Un soir, un capitaine fédéré se présenta chez Gaston. Il le trouva, inquiet et attentif comme une mère, soignant le jeune blessé. Il se retira en s’excusant, et le malade et son gardien ne furent nullement inquiétés.
Ce n’est qu’en avril que le médecin put déclarer à Pierre qu’il était parfaitement rétabli.
Le soir même, Pierre d’Arnaud quittait Paris.
Il éprouvait, au milieu de sa mélancolie, une sorte de bien-être, un soulagement inexprimable. Il rendait la grande ville responsable de ses faiblesses, de ses déceptions, de l’inassouvissement de ses rêves. Il lui en voulait de l’avoir poursuivi, jusque sur son lit d’ambulance, de ses sottises et de ses vanités mondaines, et Sabine, cette jeune fille provocante et hardie, avec ses allures de femme, cette intrépide chercheuse de maris, symbolisait dans son esprit tout ce qu’il voulait fuir à jamais.
Quand Paris se fut effacé dans le brouillard, il sembla à Pierre que sa jeunesse stérile et sans amour s’effaçait avec lui, et que le convoi, dans la nuit à chaque instant plus épaisse, l’emportait vers un avenir encore inconnu, mais grave et souriant.
Il avait pris son billet pour Blois. Il allait retrouver dans la vieille ville de province ses souvenirs d’enfance déjà lointains.
Arrivé au milieu de la nuit, il dormit dans le premier hôtel venu.
Le lendemain matin, il traversa le grand pont sur la Loire, montant à travers le faubourg de Vienne jusqu’à–Saint-Gervais. Il cherchait la maison bien connue où longtemps il avait vécu près de sa mère.
Des étrangers devaient l’habiter maintenant. Depuis une dizaine d’années madame d’Arnaud l’avait vendue, voulant venir s’installer à Paris pour l’éducation de son fils, et d’ailleurs abandonnant volontiers une demeure où elle avait vu son mari s’éteindre lentement, et dont l’aspect ravivait sa douleur de veuve toujours saignante.
Pierre a dépassé la forge. Il aperçoit le grand verger avec ses pommiers dépouillés encore, mais où pointent les premiers boutons. Puis le mur de terré rousse qui enclôt le jardin. C’est bien là.
La clématite, autour du perron, a grandi. Elle monte maintenant jusqu’au toit couvert de mousse. Mais rien n’a été changé.. Voici le vieil orme, qui bourgeonne déjà aux souffles tièdes du-printemps. Voici la ferrure du puits, dépassant la petite muraille, et la tourelle du pigeonnier.
Pierre monta en face, sur le talus de la route, et regarda longtemps.
C’est un ménage qui habitait là. Le mari et sa jeune femme étaient assis sur ce même banc de pierre, sous la petite charmille, où son père et sa mère aimaient à s’asseoir autrefois.
Tout à coup, sur le perron, un enfant parut, un enfant de cinq ans à peine, en robe blanche, tout rose, tout blond.
Pierre eut, en le voyant, un étrange serrement de cœur. Il lui sembla que c’était lui qui entrait dans le vieux jardin.
La mère se leva, courut à l’enfant, le prit sur ses genoux, lui baisant doucement les cheveux. Le petit riait, d’un bon rire innocent, et Pierre, à demi caché derrière un arbre, sentait des larmes chaudes descendre lentement sur ses joues.
Que n’aurait-il pas donné pour redevenir ce petit enfant qui, jadis, trébuchait parmi les fraisiers; pour retrouver les chères caresses de sa mère morte, le sourire tondre et indulgent de son père sitôt disparu?
Il pleurait, regardant la joie sereine de ces braves gens. Il songeait combien on est fou de jeter à tous les vents les trésors de sa jeunesse: et, devant ce petit enclos où il avait fait ses premiers pas, qui semblait conserver encore la sainte tradition de la famille et de la paix du cœur, des désirs ardents et chastes lui venaient, plus que jamais intenses, des désirs d’amour profond et pur et de paisible bonheur.
L’émotion de ces naïfs ressouvenirs d’enfance est notre meilleure conseillère.
Pierre redescendait vers la Loire, quand il vit venir à lui, sous une allée de tilleuls un peu basse, verdissante à peine, deux femmes vêtues de noir qui, comme lui, marchaient lentes et mélancoliques.
C’était une jeune fille avec sa mère. Il y avait dans leur démarche, dans leurs vêtements somhres, dans leur silence je ne sais quelle sympathique tristesse qui s’accordait avec l’état de son esprit.
Quand elles passèrent auprès de lui, son regard rencontra celui de la jeune fille. Un instant seulement, une seconde à peine. Ce fut assez pour qu’il vît dans ces grands yeux châtains un singulier mélange de candeur enfantine et de précoce douleur.
Et longtemps, debout à la même place, le jeune homme suivit du regard cette inconnue, se demandant quelle mystérieuse influence avait mis ainsi sur sa route la vivante image de son rêve.
Laisserait-il s’éloigner ces deux femmes, qu’il ne reverrait peut-être jamais?
Habitaient-elles Blois?
Sans doute, car il les vit, au bout de l’allée, revenir sur leurs pas et se diriger du côté du pont.
Pierre les suivit de loin.
Le pont traversé, elles prirent à droite, sur le mail, le long du fleuve, qu’ombragent de grands arbres, et, au bout de cinq cents pa environ, traversant une petite place déserte, à leur gauche, elles entrèrent dans une modeste maison ancienne, à façade briquée, à un seul étage.
La plus âgée des deux femmes avait tiré une clef de sa poche et ouvert une petite porte, surélevée de trois marches.
C’est évidemment là qu’elles habitaient.
Pierre avait fait quelques pas sur la promenade, quand il s’entendit tout à coup interpeller par une voix jeune et fraîche:
–Monsieur d’Arnaud!
–C’est toi, Caliste?
Entre la promenade et la Loire, il avait devant lui une auberge propre et avenante, avec cette enseigne à demi-effacée par les pluies:
«Hôtel de la Providence.»
Sur le seuil, une jeune fille, vêtue comme une servante, le regardait, un peu honteuse de l’exclamation qui lui était échappée.
Caliste. Encore tout un coin du passé... Un coin innocent et enfantin… C’était sa sœur de lait. Madame d’Arnaud, six mois après la naissance de Pierre, atteinte d’une cruelle maladie, n’avait pu continuer à le nourrir et avait du se faire remplacer par une brave femme, sa voisine, dont l’enfant venait de mourir.
Caliste était la fille de cette nourrice, née quatre ans plus tard. Que de fois, là-haut, dans le vieux jardin, sous le grand orme, Pierre avait passé des après-dîners entiers, jouant avec la petite Caliste, dont il s’amusait comme d’une mignonne poupée.
Ce souvenir fraternel lui revenait tout à coup.
Quelques années avant, étant venu passer un mois à Blois avec sa mère, il avait revu l’enfant déjà grandelette. Maintenant c’était une belle jeune fille, brave et avenante sous sa blanche cornette.
Pierre s’approcha et se prit à causer avec Caliste.
La mère nourrice était morte. Le père, réunissant toutes ses économies, avait acheté cette auberge. Mais les affaires allaient bien doucement. Enfin, on. faisait comme on pouvait. Le père s’occupait de la cuisine. Il y avait une petite servante pour le gros de l’ouvrage. Caliste veillait au reste. Puis, quand elle avait le temps, elle faisait pour les dames de la ville do fins ouvrages de couture, que madame d’Arnaud lui avait enseignés.
–Ma bonne Caliste, il ne sera pas dit que je logerai à Blois ailleurs que chez toi, dit Pierre d’Arnaud.
Et il envoya aussitôt chercher sa valise à l’hôtel où il était descendu.
Le papa apparut, très rouge et très empressé. Le pauvre hôtelier, dans son auberge souvent vide, avait cette heureuse faculté de paraître toujours prodigieusement affairé. Il possédait une autre qualité, celle de ne pouvoir jamais achever une phrase commencée:
–Monsieur Pierre, dit-il, je ne saurais vous dire combienje suis honoré de…
Et, renonçant à exprimer toute sa pensée, il passa la main dans ses cheveux gris crépus et disparut brusquement, criant à la petite servante invisible de préparer la chambre bleue, qui donne sur la Loire.
–Non, dit Pierre, donnez-moi une chambre ayant vue sur la promenade.
Quelques instants après, accoudé à sa fenêtre, il pouvait regarder tout à loisir, de l’autre côté de la petite place déserte, la maison à façade briquée où étaient entrées les deux femmes vêtues de noir.