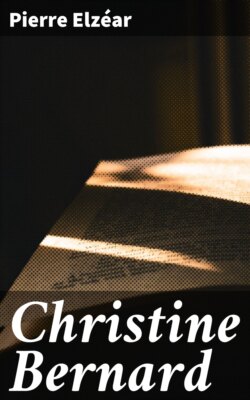Читать книгу Christine Bernard - Pierre Elzéar - Страница 6
ОглавлениеIV
Il Y avait des salles destinées aux officiers, d’autres aux simples soldats. Mais, comme l’armée comptait dans ses rangs quelques jeunes gens du meilleur monde, la règle souffrait des exceptions. Pierre d’Arnaud fut immédiatement installé dans un petit salon blanc et or, où il n’y avait que quatre lits.
L’arrivée de ce beau garçon, gravement blessé, qu’il avait fallu monter sur une civière dans le grand escalier de marbre, avait fait une sensation profonde parmi ces dames. Quand on l’eut couché avec des précautions infinies et que le docteur Désorbiers, en attendant Jousselot, eut déclaré, avec une autorité sereine, que le nouveau venu avait avant tout besoin de repos, accentuant cette phrase d’un geste de lorgnon, comme si elle eût été infiniment profonde et spirituelle, il fallut bien que l’aimable groupe des infirmières se retirât dans un froufrou sympathique de soies et de satins. Mais, de temps à autre, la lourde portière de tapisserie s’écartait un peu: c’était une jolie curieuse qui, sur la pointe des pieds, venait regarder le visage fier et doux du jeune zouave, dont une pâleur cadavérique faisait ressortir la délicatesse, et que virilisaient un peu les cheveux coupés ras, suivant l’ordonnance.
Bref, comme blessé, Pierre d’Arnaud eut un grand succès, et ces dames remercièrent vivement Gaston d’avoir eu cette heureuse idée de faire transporter son ami à l’ambulance modèle.
Ce succès, pour le moment, Pierre ne pouvait en jouir. En proie à une fièvre intense et au délire, il ne se rendait aucun compte de l’endroit où il se trouvait.
Quand Jousselot, aidé de l’interne Jolibois, eut défait les linges ensanglantés pour examiner l’épaule fracassée, l’éminent chirurgien fit un léger hochement de tête et leva un instant vers le ciel, ou plutôt vers le plafond, ses yeux d’homme de génie, comme s’il sollicitait discrètement le concours actif de la providence.
Cette attitude fut vivement commentée et, pendant toute l’après-midi, les élégantes garde-ma lades se communiquaient la nouvelle avec un petit frémissement.
«Vous ne savez pas, ma chère?. Pierre d’Arnaud… Eh bien, Jousselot ne répond pas de lui.»
Gaston, qui avait vite compris que le service de la garde nationale, fût-elle de marche, était une assez mauvaise plaisanterie, ne se gêna pas pour en prendre à son aise; il venait tous les jours faubourg Saint-Honoré et souvent même passait la nuit au chevet de son ami. Il serait venu plus souvent si sa présence n’avait paru parfois contrarier l’ambulancière à qui appartenait Pierre d’Arnaud, mademoiselle Sabine de la Grangère.
Madame de la Grangère, la mère de Sabine, était d’origine brésilienne. Elle avait épousé un gentilhomme français, assez pauvre d’esprit, qui se ruina presque complètement à Rio-Janeiro. La veuve revint en France avec ses deux filles et, grâce au nom de son mari et à l’incontestable beauté des demoiselles de la Grangère, elle fut assez bien reçue dans les salons parisiens.
Césarine, la fille cadette, n’avait encore que quatorze ans, et malgré le développement visible de son corsage, mûri par le soleil du Brésil, sa mère s’obstinait à la traiter en enfant et à la laisser en robes courtes.
Mais Sabine, l’aînée, avait de grands succès près des hommes. Elevée à l’américaine, avec certaines libertés de langage et d’allures, elle traînait derrière elle un cortège d’adorateurs plus ou moins titrés, plus ou moins millionnaires. Mais jusqu’à présent pas un de ces adorateurs n’avait paru ambitionner le titre de prétendant.
Un jour, vers le milieu d’octobre, alors que l’ambulance fonctionnait depuis longtemps à la satisfaction générale, Massard attendait dans le vestibule un arrivage de blessés. Une sortie devait avoir lieu du côté de la Malmaison.
Il aperçut, gravissant l’escalier en soufflant, suivie de ses deux filles, la grosse madame de la Grangère. Bien qu’elle n’eût eu qu’un étage à monter, elle avait complètement perdu la respiration, et son opulente poitrine se soulevait avec une impétuosité inquiétante pour son corset.
Massard lui adressa un sourire affectueux et compatissant, et, par-dessus ses larges épaules, décocha un regard plus galant à mademoiselle Sabine et à mademoiselle Césarine.
Madame de la Grangère ne menait pas encore Césarine dans le monde. Mais Massard avait souvent rencontré la sœur aînée dans les salons et ne manquait jamais de lui adresser les plus tendres propos, qu’autorisait d’ailleurs sa chevelure grisonnante.
Oh! une mère ou un mari n’avait rien à craindre de lui. Massard, en réalité, sinon en apparence, avait depuis longtemps abdiqué. Pourvu qu’il conservât sa réputation de viveur émérite,– et il la conservait, grâce à un sourire insinuant, gros de sous-entendus légers, dont il était l’inventeur–Massard ne demandait pas davantage. Il eût même été fort embarrassé si on lui eût accordé davantage. Il avait grand soin de se montrer assez souvent aux premières représentations, dans une baignoire d’avant-scène, dont il relevait les stores à demi, en compagnie d’une femme jeune et élégante, jamais la même, tantôt une dame du monde, tantôt une cantatrice ou une comédienne célèbre, au besoin même une débutante qu’il voulait lancer. Et ses yeux, où brillait encore une jeunesse trompeuse, s’allumaient d’orgueil dans l’ombre de la loge lorsqu’il voyait les jeunes beaux de l’orchestre lancer vers la baignoire mystérieuse des regards malicieux, et lorsqu’il devinait, au mouvement de leurs lèvres, des commentaires flatteurs.
Mais, bien entendu, le rideau baissé, Massard ramenait à son domicile la dame, quelle qu’elle fut, avec une tendresse respectueuse, et s’empressait de rentrer chez lui, où l’attendait un excellent lit, avec une boule d’eau chaude et un foulard, qu’il roulait deux fois autour de sa tête, sans aucune prétention.
Bientôt la veilleuse dessinait sur le fond du lit l’ombre paisible et grotesque du pacha platonique.
–Comment va madame Massard? demanda madame de la Grangère.
A cette question imprévue, Massard resta uri instant stupéfait, la bouche ouverte. Non qu’il y eût le moindre nuage entre lui et cette excellente dame, mais madame Massard ne se plaisait qu’en villégiature, ou si, par hasard, elle restait quelques mois à Paris, elle y demeurait tellement invisible que plusieurs personnes doutaient même de son existence. Elle existait pourtant, mais d’une façon si impersonnelle, si discrète, si ffacée, que ceux qui, par le plus grand hasard, venaient à la rencontrer étaient tentés de la prendre pour le pâle reflet d’une véritable madame Massard, depuis longtemps disparue.
En tout cas, personne n’avait jamais songé à demander des nouvelles de madame Massard.
Quand Massard fut remis de sa surprise, il répondit: «Elle va très bien, je vous remercie. Je crois qu’elle est à la campagne.»
Et il introduisit ces dames dans son cabinet.
Ce cabinet n’était autre chose que le boudoir de la princesse Lœtizia. Il était tendu de soie rose mourante, nuance un peu tendre peut-être pour le cabinet d’un directeur d’ambulance; mais Massard avait soin de corriger, par l’expression solennelle de ses traits, les gaîtés intempestives de la tapisserie.
Madame de la Grangère exposa le but de sa visite. Elle désirait vivement que ses filles fissent partie de l’ambulance.
–Hum! fit Massard, c’est que… des demoiselles. vous comprenez, chère madame… il y a mille détails. Nous n’avons ici que des dames mariées… ou veuves… des personnes expérimentées. Et vraiment, mademoiselle Césarine, notamment, est bien jeune.
–Césarine est une enfant, dit madame de la Grangère. Vous avez raison. Aussi vous l’emploierez à surveiller le linge, à faire de la charpie. Mais Sabine est brave. Et puis, ajouta-t-elle en baissant la voix, je compte sur vous, cher monsieur, sur votre tact parfait, pour ne lui donner à soigner que des blessés. convenables.
Sabine regardait Massard avec un petit air suppliant tout à fait irrésistible. Il céda et, immédiatement, procéda à l’installation des deux nouvelles infirmières.
Quant à madame de la Grangère, elle disparut après avoir remercié, et, comme c’était une femme d’intérieur, on ne la revit plus jamais à. l’ambulance du faubourg Saint-Honoré.
Pendant quinze jours, Pierre d’Arnaud fut entre la vie et la mort. Sa jeunesse enfin prit le dessus, et Jousselot déclara qu’il le sauverait.
Plusieurs fois, à travers son délire, Pierre avait senti une haleine fraîche comme un souffle printanier effleurer son front brûlant; il avait entrevu, aux clartés discrètes de la lampe de nuit, un visage de femme penché sur lui, tandis que des doigts fins et délicats tâtaient doucement le pouls du jeune blessé.
Le jour où la fièvre s’apaisa et où il reprit toute sa connaissance, à la suite d’une longue crise, Sabine de la Grangère était debout au pied de son lit, le couvant des yeux avec une touchante anxiété.
Pierre, un peu étourdi encore, se souleva sur un bras et regarda fixement cette apparition charmante. Le soleil couchant, à travers les grands arbres du parc chargés de neige, éclairait vaguement la jeune fille d’un reflet rosé, qui s’éteignait peu à peu.
Il était difficile de rêver un type plus séduisant que Sabine. Un peu élancée, fièrement cambrée dans une robe de velours marron, elle appuyait sur sa main sa joue nacrée et sa tempe délicatement veinée, que couronnaient les ondes de ses beaux cheveux châtains, tirant sur le blond.
Comme elle était forcée, pour payer ses toilettes, de peindre des éventails, qu’elle vendait fort cher, ses yeux, d’un bleu sombre, étaient souvent dissimulés derrière un mignon pince-nez d’écaille qui donnait un charme piquant à son visage un peu mélancolique. Les larges manches de la robe laissaient entrevoir la naissance du bras. Le corsage était même un peu échancré par devant–il faisait si chaud dans les salles d’ambulance.
La principale beauté de Sabine était cette carnation éblouissante, cette exquise transparence de peau des créoles blondes, pour qui toutes les comparaisons classiques de la neige ou des lis demeurent insuffisantes.
Pierre la regardait, sans rien dire.
–Je vois que cela va mieux, dit-elle d’une voix savamment caressante. Il faut vous reposer encore.
Et, s’avançant, elle se pencha sur lui, sa poitrine touchant celle du jeune zouave, et le recoucha doucement sur l’oreiller, lui frôlant le visage de ses douces mains parfumées.
Pierre sentit sur son cou le froid du bracelet d’or de Sabine.
–Allons, fermez les yeux, mon bel ami.
Et, cavalièrement, du bout du doigt, elle effleura la paupière du jeune blessé.
Le soir, quand Gaston vint prendre des nouvelles de Pierre:
–Quelle est donc la jeune femme qui me soigne? lui dit-il aussitôt.
–Une jeune femme? Mais c’est une jeune fille, Sabine de la Grangère.
–Une jeune fille? fit Pierre d’Arnaud très étonné.