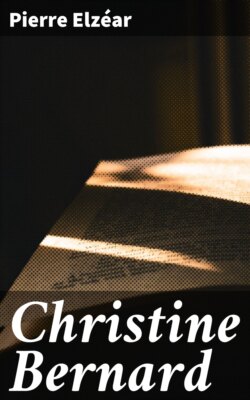Читать книгу Christine Bernard - Pierre Elzéar - Страница 4
ОглавлениеII
Le bataillon passa sous la voûte du chemin de fer, et se dirigea–vers la Marne, par le rondpoint de Plaisance. Partout, dans la campagne, on distinguait confusément des régiments et de l’artillerie en marche.
A un croisement de chemins, on s’arrêta pour laisser passer une batterie. Le major, grelottant dans son manteau, causait avec Pierre et Gaston.
«C’est étrange, dit-il tout bas. Le matin de Reichshoffen, le régiment s’est arrêté ainsi, à un carrefour tout semblable, pour laisser le passage à l’artillerie. Il y avait des oseraies et une ligne de peupliers, comme vous en voyez là, à droite. C’est comme un mauvais rêve.»
Et, quittant les deux amis, il s’avança vers la tête de la colonne, sautillant pour éviter les flaques d’eau des ornières. On eût dit de loin un corbeau gigantesque.
La batterie passa au grand trot, avec les servants de pièces rudement secoués sur les lourds caissons, leur foulard autour de la tête à cause du froid, et l’on se remit en marche.
En face, derrière les lignes de l’ennemi, une raie. blanchâtre annonçait l’aube. Une tache de sang pâle apparut ensuite; des nuages, qui couraient au bord de l’horizon, la balayaient par instants; mais elle s’étalait peu à peu, sans parvenir pourtant à être lumineuse.
Tout à coup les nuages se dissipèrent. Le soleil parut, soleil d’hiver, rouge et sans rayons.
Les zouaves s’arrêtèrent près de la Marne.
Presque aussitôt la bataille commençait. Le fort de Nogent, les diverses batteries placées sur le plateau d’Avron, sur les hauteurs de Villemomble et, plus bas, au-dessus du village de Neuilly-sur-Marne, évacué par les Prussiens, couvraient de feu Bry et Villiers. A droite et au centre, vers Joinville et Champigny, s’engageait une vive fusillade, que coupait le déchirement âpre et strident des mitrailleuses. Sur le coteau qui s’étendait en face, de l’autre côté de la rivière, on aperçut bientôt les feux des tirailleurs. Les rubans de fumée se déroulaient comme des serpents le long des chemins et des haies.
Le deuxième zouaves attendait toujours, l’arme au pied. Cela dura toute la matinée.
On avait jeté deux ponts sur la Marne, mais on hésitait à faire passer les troupes de l’aile gauche; la lutte était rude vers le viaduc et la ferme de Cœuilly. Par instants on voyait faiblir les tirailleurs français. Au cas de déroute les ponts n’auraient pu suffire à la retraite.
Un capitaine expliquait cela à Pierre, impatient de combattre:
–Tiens! dit Gaston, nos généraux songent déjà à la retraite?
Enfin, vers deux heures de l’après-midi, on se décida à faire franchir la Marne à quatre, ou cinq régiments: les zouaves, le136e de ligne, les mobiles de la Côte-d’Or, d’autres encore. De ce côté vinrent aussi les amis de la France; en tête, à côté du commandant, marchait crânement la cantinière, madame de Bcaulieu.
Cinq ou six prisonniers défilèrent, qui répétaient: «Nous pas Prussiens! Nous Saxons!» et les zouaves marchèrent au pas accéléré vers Bry-sur-Marne.
Les masses allemandes, qui s’étaient montrées sur la crète du coteau vers Noisy-le-Grand, avaient disparu. Depuis quelque temps, l’artillerie française se taisait.
Le village de Bry-sur-Marne, horriblement dévasté, avait été évacué précipitamment par l’ennemi, qui n’avait pas eu le temps d’emporter ses blessés. Sous un hangar, un officier râlait, étendu sur un tas de paille sanglante.
Le bataillon traversa le village et s’engagea dans un chemin creux, derrière l’église, qui monte au plateau de Villiers. Tout à coup, sur la droite, éclata le crépitement sinistre des mitrailleuses. En face, une fusillade terrible accueillait les nouveaux arrivants.
–Nous ne sommes pas encore à Berlin, dit Gaston en tordant sa fine moustache.
Et, par un mouvement inconscient et machinal, il se plaça devant Pierre, qui l’écarta doucement.
Le sommet de la côte cachait encore le plateau.
«En avant!» cria le colonel en faisant sauter son cheval sur le talus. Un clairon s’élança à dix pas en tête de la colonne et sonna la charge. Au second coup de langue, une balle le frappait en pleine poitrine et le couchait à la renverse. Les autres clairons se précipitèrent et sonnèrent tous ensemble. Les zouaves s’élancèrent au pas gymnastique sous une grêle de balles. Gaston, impassible, examinait en courant la batterie de son chassepot, et chantonnait entre ses dents les paroles de la sonnerie:
Y a d’la goutte à boire là-haut,
Y a de la goutte à boire!
Les plus timides s’exaltaient. La charge sonnait toujours, haletante, furieuse, précipitée. C’était comme un vertige.
Aussitôt en haut, ordre aux hommes de jeter les sacs et de se déployer en tirailleurs. L’ennemi paraissait résolu à défendre vaillamment la position. Au centre, à quatre cents mètres, le mur crénelé du parc de Villiers-sur-Marne, dont les feux balayaient tout le plateau.
À droite et à gauche, des lignes de tirailleurs allemands, appuyés par de fortes réserves. Peu d’artillerie. De notre côté, il n’y en avait pas du tout. Les batteries avaient été retardées par le mauvais état des ponts.
Sur la gauche combattaient les mobiles de la Côte-d’Or. Un régiment de ligne, qui avait subi des pertes considérables, se repliait pour laisser la place aux zouaves.
Pierre entrevoyait tout cela confusément, à travers la fumée. Déjà sa compagnie se jetait en avant, la baïonnette au canon. Il s’élança en tête, suivi par Gaston, s’arrêtant tous les vingt pas pour envoyer un coup de feu.
Le clairon de la compagnie était hors d’haleine. Le fourrier, un brave garçon qui avait été de la fanfare, le remplaça et sonna la charge à son tour. Mais presque aussitôt il roulait à terre, avec deux balles dans le ventre et une dans la cuisse. Deux pas plus loin, à la gauche–de Pierre, son caporal recevait une balle en plein front et, raide mort, frappait lourdement le sol de sa tête, inondant d’un flot de sang les guêtres du jeune volontaire.
En même temps le voisin de Gaston tombait atteint en pleine poitrine. Gaston s’arrêta, mit un genou en terre et détacha son bidon pour donner un peu d’eau-de-vie au mourant qui criait: «A boire!» Une balle, lui effleurant les doigts, brisa le goulot de fer-blanc.
Quand il se releva, il ne vit plus Pierre. Le jour baissait déjà, et la fumée devenait à chaque instant plus épaisse.
Des zouaves passèrent près de lui, traînant deux pièces de canon que l’ennemi avait abandonnées. Les Allemands avaient évacué le plateau, mais le feu des murs du parc continuait sans interruption. Nos soldats tombaient, comme fauchés par une main invisible.
Gaston avait pour son ami la tendresse d’un grand frère:
«Pierre!» cria-t-il. Mais sa voix se perdait dans le tapage assourdissant de la fusillade. Il sifflota entre ses dents, suivant sa coutume dans les grandes émotions, et continua sa marche.
Bientôt le feu cessait. L’ennemi se repliait sur toute la ligne. Nous étions maîtres de la position. Les clairons sonnaient le ralliement.
Étonné de vivre, Gaston revint lentement sur ses pas. Dans les vignes, sous de grands pommiers, au pied desquels des blessés s’étaient traînés, on faisait l’appel. Bien peu répondaient.
«Pierre d’Arnaud!» fit la voix rude du sergent-major de la troisième.
Un silence. Il appela un autre nom.
Gaston s’élança vers le champ de bataille.
La nuit était presque close. Le fin croissant de la lune éclairait les monticules sombres épars dans la plaine. Le silence n’était troublé que par des gémissements plaintifs.
Il était seul sur le plateau de Villiers-sur-Marne. Les ambulances n’étaient pas encore arrivées. Que de faces pâles collées à terre il retourna, craignant toujours de rencontrer celle qu’il cherchait! Çà et là des blessés l’appelaient. Il leur parlait doucement, leur promettait qu’on allait venir les prendre, et ils se recouchaient patiemment sur la terre froide.
Au pied d’un arbre dépouillé étaient assis, frappés mortellement, mais respirant encore, deux jeunes Saxons. Gaston leur adressa la parole en allemand. Ils sourirent avec reconnaissance dans leur barbe blonde, mais ni l’un ni l’autre n’avait la force de répondre. Ils expiraient côte à côte, les dents serrées, sans un cri, sans une plainte, les ongles crispés dans le gazon.
Plus loin; au bord d’un talus, Gaston aperçut un zouave qui paraissait dormir, appuyé sur son sac, la tête dans ses deux bras croisés, les genoux ramassés et ployés sous lui. Il le reconnut à cette posture. Pierre le lui avait montré, le matin, à la halte de Plaisance. C’était un garçon de la campagne, un Breton, un faible d’esprit. Dans sa compagnie on ne l’appelait que la pauvre bête. Quand il n’était pas de service, il se couchait toujours ainsi. Parfois il restait de même tout le jour, essayant de dormir pour oublier qu’il était soldat.
Le voyant étendu dans sa pose habituelle, Gaston le prit par le bras. Mais cette fois la pauvre bête était couchée pour longtemps.
Gaston errait toujours, continuant son inspection funèbre, rencontrant à chaque pas les yeux grands ouverts des morts.
Il appelait Pierre, mais à mi-voix, n’osant pas troubler l’agonie des camarades.
Enfin, au premier rang des cadavres, près de la muraille crénelée, il trouva tout à coup celui qu’il cherchait.
Il était étendu sur le dos, évanoui ou mort, baignant dans une mare de sang. A côté de lui, son chassepot brisé.
Gaston se sentit remué jusqu’au fond des entrailles. Il aimait beaucoup Pierre d’Arnaud, mais, dans le tumulte joyeux de l’existence parisienne, il n’avait jamais soupçonné en lui-même une tendresse aussi poignante pour son grand enfant, comme il l’appelait en riant.
La lune éclairait nettement le profil pâle de Pierre. Gaston s’agenouilla à terre, plus pâle encore peut-être, sifflant tout bas la cavatine de Don Juan.
Une balle avait fracassé l’épaule du jeune homme.
Avec sa ceinture, Gaston attacha soigneusement le long du corps le bras inerte. Puis il chargea Pierre sur son dos et revint vers Bry-sur-Marne.