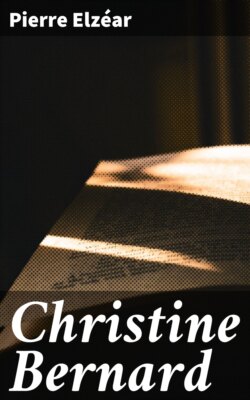Читать книгу Christine Bernard - Pierre Elzéar - Страница 3
I
ОглавлениеLe29novembre1870, les troupes massées sous Paris se préparaient à tenter un effort suprême. Cette grande sortie, tant de fois sollicitée par la population, les soldats seuls, dans leur naïf enthousiasme, la prenaient au sérieux. Les chefs en avaient désespéré d’avance.
On sait que par une inexcusable étourderie, que quelques-uns même ont prétendue volontaire, les ponts qui devaient être jetés sur la Marne se trouvèrent trop courts et l’opération fut retardée d’une journée. Elle perdait dès lors toute chance de succès, et la diversion exécutée vers le Sud par le général Vinoy, qui ne reçut pas de contre-ordre, devenait inutile.
Le deuxième zouaves faisait partie de la division d’Exéa, qui occupait l’aile gauche de notre corps d’armée. La nuit précédente, il avait quitté son campement des usines de la Folie, à Nanterre, pour se rendre à Fontenay-sous-Bois.
Le deuxième zouaves. Ce n’était plus le beau régiment qui, quatre mois auparavant, débarquant d’Algérie, remontait la Canebière au milieu du délire d’une ovation provençale et des hurlements féroces: «A Berlin! A Berlin!» Le deuxième zouaves avait été écrasé à Reichshoffen. Cent cinquante hommes à peine, conduits par quelques officiers, blessés pour la plupart, avaient pu regagner la capitale.
A ces survivants du désastre s’étaient joints un certain nombre de volontaires, recrutés dans toutes les classes de la population parisienne. Le tout formant à peine l’effectif d’un bataillon.
Pierre d’Arnaud s’était engagé le quatre septembre. Il venait d’avoir vingt-trois ans. Incorporé depuis un mois dans la mobile, il se consumait dans l’énervement d’une inaction forcée. Il pensa que, dès qu’il faut se battre, il vaut mieux se battre au premier rang.
Il ne s’était guère occupé de politique, mais il éprouvait pour l’empire le dégoût de tout honnête homme. Le jour où il s’écroula dans la honte, Pierre d’Arnaud n’y tint plus. Laissant ses camarades jouer au soldat, il endossa la veste du zouave. Son père était mort peu d’années après sa naissance. Il venait de perdre sa mère, qu’il aimait follement. Il était donc libre de lui-même, tranquillement résigné à toutes les chances de mort, et n’ayant pas à craindre ces lâchetés respectables qui mordent le cœur des plus braves lorsqu’ils songent aux êtres qui les adorent et les attendent au foyer.
Comme tant d’autres, après les premiers combats du siège, il désirait avec impatience une bataille décisive. Son esprit simple et droit, qu’il avait toujours gardé de l’ironie, avait accueilli avec enthousiasme l’ardente proclamation du général Ducrot, et ce fut avec une déception véritable qu’il entendit lire l’ordre du jour aux troupes qui différait l’action au lendemain.
Le deuxième zouaves reçut l’ordre de descendre derrière le remblai du chemin de fer de Mulhouse, entre les forts de Rosny et de Nogent, et de dresser les tentes.
Le jeune soldat ne put dormir une seule minute. Il passa toute cette nuit, toute cette longue nuit, étendu sur le dos, les yeux grands ouverts, les membres glacés, l’esprit inquiet et en travail. L’intérieur de la tente était complètement obscur. Il n’entendait que la respiration paisible du sergent couché à côté de lui, une barbe grise, un vieux chacal d’Afrique, qui dormait pelotonné comme un chat frileux. Puis, par instants, au-dessus de sa tête, le sifflement sur la toile d’une bise chargée de givre.
Il songeait, ainsi qu’il arrive à la veille des grands événements: il revoyait toute sa vie, depuis son enfance rieuse, à Blois, dans le vieux jardin de province.
Ainsi que presque tous les jeunes gens qui ont été élevés par une femme, Pierre était une nature tendre et nerveuse. Son visage fin, un peu pâle, toute sa personne avaient je ne sais quoi de délicat et de féminin. Ce qui donnait à ses traits un charme irrésistible, c’était la sincérité et la bonté. Sa mère avait songé, avant tout, à lui inspirer l’horreur du mensonge. «Sois dupe dans la vie, mon fils, lui répétait-elle; ne sois jamais fripon. Sois trompé, souffre, pleure; ne trompe jamais et ne fais jamais souffrir.»
Et l’âme de l’adolescent s’était modelée sur cette âme haute et délicate.
Pour satisfaire un désir de son père expirant, Pierre d’Arnaud, après avoir fait son droit, non sans répugnance, avait tenté le barreau. Le peu que nous avons dit de son caractère suffit à indiquer clairement qu’il n’y pouvait rester. C’est, sauf exceptions, un triste monde, mesquin, faux et jaloux, que celui du Palais. Les allures franches et cordiales de Pierre lui valurent bien vite la réputation d’un innocent, d’un naïf, qui ne ferait jamais son chemin. Ajoutez à cela que son esprit cultivé avait horreur de l’odieux patois dans lequel s’exprimaient ses chers confrères. Il plaidait en langue française, ce qui fut considéré comme le comble de la bizarrerie et de l’insolence.
Il eut bien quelques succès en cour d’assises. Mais un jour, devant une chambre civile, comme il plaidait pour une vieille brave femme dans la misère, à qui une riche compagnie devait, depuis plus de six années, une centaine de mille francs, son adversaire, un membre du conseil, qui avait l’oreille du tribunal, nia l’évidence avec une impudence digne et une effronterie sereine qui soulevèrent l’indignation du jeune avocat. Cette indignation, il l’exprima hautement, en pleine audience. Le président lui adressa une réprimande sévère, et la demande de sa cliente fut rejetée.
Le lendemain, Pierre d’Arnaud forçait la brave femme à accepter cent mille francs. C’était le tiers de ce que lui avait laissé son père.
Me Clari, un homme d’esprit,–il y en a deux ou trois au Palais,–prit à part son jeune confrère, dans la salle des Pas-Perdus, et s’efforça de lui enseigner, avec un aimable scepticisme. les premiers éléments de la profession. Pierre ne comprit que trop bien la leçon. Il alla droit au vestiaire, se débarrassa de son rabat, de sa robe et de sa toque, et se fit le serment de ne plus jamais revêtir cet accoutrement ridicule.
Il rentra chez sa mère, qui l’embrassa au front, et lui dit: «Tu as raison.»
Pierre d’Arnaud s’en tint à cette expérience. Il n’essaya pas une autre carrière. Possesseur de quinze ou vingt mille livres de rente, peu soucieux d’une fortune plus considérable, il résolut de vivre en indépendant. Il écrivait, pour sa joie personnelle, de la prose ou des vers, mais ne s’occupait nullement de publier ses œuvres. Ses camarades les plus intimes les ignoraient.
Cette nuit-là, Pierre revit dans son esprit tout cela, et bien d’autres choses encore.
Puis, brusquement, tout s’effaçait. Sa mère lui apparaissait, couchée sur son lit funéraire, avec ses chères mains fluettes, couleur de cire, tranchant sur la blancheur du drap, et gardant à ses lèvres demi-entr’ouvertes le sourire résigné de ses dernières heures d’agonie.
Voici que cette vision s’efface aussi, comme les autres. Une idée obstinée la remplace, une idée née elle-même du souvenir maternel. Au rebours de la plupart des mères, madame d’Arnaud, incapable de jalousie, avait bien des fois répété à son fils que le véritable amour est le seul but sérieux de ce monde, et, le soir, quand ils se trouvaient ensemble, elle lui exprimait quelle joie ce serait pour elle lorsqu’il lui amènerait, dans sa triste maison de veuve, la fille qu’il lui aurait choisie.
Pierre–et c’était là le seul remords de sa vie–s’était laissé entraîner à des passions inutiles. Faible parfois et un peu irrésolu, faute d’une éducation virile, il avait fait, sans être réellement épris, l’aumône de lui-même à des femmes qui l’avaient trouvé charmant. A quoi bon? Pourquoi n’avait-il pas eu le courage, pour lui facile, d’attendre celle tant de fois évoquée par les tendresses maternelles, à qui il se donnerait tout entier?
Cette véritable compagne, il ne l’avait pas rencontrée. L’avait-il cherchée seulement?
Non. Affamé d’amour pur, il avait promené en étourdi dans tous les mondes son cœur sincère et ses illusions sans cesse meurtries. Il n’avait trouvé chez ses maîtresses qu’une sotte coquetterie ou une basse sensualité. De mordantes railleries, des pitiés ironiques l’avaient froissé cruellement; de subits abandons de courtisane l’avaient écœuré. Et sa fière et loyale nature, se sentant incomprise, avait pris les parisiennes en dégoût.
Il allait même jusqu’à se reprocher comme un crime ce gaspillage de son cœur.
Quelques jours avant de s’engager, il s’était aperçu que sa dernière maîtresse, Hortense, une femme du meilleur monde, réputée honnête et pure, avec un profil d’archange blond, avait l’âme d’une fille de théâtre: et il ne s’était même pas donné la peine de lui adresser un mot de souvenir.
Déjà bien des fois, dans les longues veillées solitaires des campements, Pierre avait médité le regret amer de sa jeunesse inutile, et senti lui monter aux lèvres la rancune des baisers méchants.
Cette nuit, plus que toutes les autres, il conçut l’implacable résolution de se garder pour celle qui serait digne de lui.
Vers le matin, les rêves du jeune soldat devinrent vagues et troublés. Le cerveau fatigué et fiévreux, il oubliait peu à peu où il se trouvait. Le vent, qui fraîchissait, faisait clapoter la toile de la tente au-dessus de sa tête; il se figurait voguer en pleine mer, couché sur le pont d’une frégate, vers des pays inconnus.
Tout à coup, le lieutenant, soulevant la couverture qui fermait l’entrée de la tente, cria:
«Cinq heures! Debout!»
Pierre se dressa en sursaut et sortit. Une légère buée flottait dans l’air et amortissait les feux des étoiles. Au loin, on entendait le clairon du fort de Rosny sonner la diane.
Il repassa en une minute dans son esprit, ses réflexions nocturnes. Il se sentait comme transformé. La veille au soir, il n’était encore qu’un enfant. Cette nuit d’insomnie avait fait de lui un homme.
Les soldats quittaient les tentes, un à un, piétinant pour se réchauffer. On défaisait les faisceaux. On bouclait les sacs. Silhouettes confuses, estompées dans le brouillard. Allées et venues de spectres muets. On avait défendu d’allumer les feux.
«Qui vive!» cria la sentinelle du côté de Rosny.
Une forme à peine distincte s’approcha et donna le mot d’ordre à voix basse. L’homme pénétra dans le campement, s’arrêtant autour des soldats qui déjà se groupaient par compagnies. Il paraissait chercher quelqu’un.
Comme il venait du côté de Pierre, celui-ci s’aperçut que le nouvel arrivé portait un autre uniforme que celui des zouaves. Un instant après, il crut reconnaître sa démarche. Il fit quelques pas et, brusquement, s’écria à mi-voix:
«Gaston»
–Ah! te voilà enfin! Je te cherche depuis deux heures du matin, dit le nouveau venu, qui portait avec désinvolture la lourde capote du garde national de marche. Vous vous battez tout à l’heuxe, heureux gaillards. On s’ennuie rudement à Paris. On va faire la popotte sur les remparts. On hurle le Chant du départ et la Marseillaise. Mais on ne peut pas obtenir des avocats qui nous gouvernent la faveur de se faire casser la tête.
–Qu’est-ce que tu viens faire ici?
–Je suis chargé, pour toi, d’une commission importante. Une lettre d’Hortense.
Et il tendait à Pierre d’Arnaud un billet sur papier satiné, plié en triangle.
–A quoi bon? dit Pierre; et, prenant la lettre, il la déchira en petits morceaux. Le vent emporta les chiffons de papier dans une haie de broussailles nues, le long de la voie.
–La pauvre femme! soupira Gaston avec un attendrissement railleur.
–Tu la consoleras.
–Qu’est-ce que tu as?
–J’ai que je suis décidé à prendre désormais la vie au sérieux. Je n’en ai pas pour longtemps peut-être, ajouta-t-il avec une amertume tranquille.
–Tu as tort. J’espérais t’avoir converti. Moi, comme Figaro, je ris de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer.
Ils furent interrompus. Le bataillon se mettait en marche, sans bruit.
–Adieu, Gaston.
–Tu sais, dit tout à coup le garde national avec un subit élan d’affection, je reste avec toi.
Il alla dire quelques mots au commandant, qui haussa les épaules avec indifférence, et, au moment où la dernière compagnie défilait, Gaston prit place dans le rang à côté de Pierre.