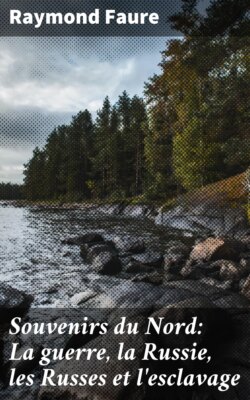Читать книгу Souvenirs du Nord: La guerre, la Russie, les Russes et l'esclavage - Raymond Faure - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bataille de la Moskowa.
ОглавлениеLE 5 septembre, au soir, une canonnade qui se prolongea jusqu’à l’entrée de la nuit sur une hauteur, nous parut une affaire d’avant-postes, seulement plus sérieuse que celles qui avaient lieu presque tous les jours; c’était l’attaque d’une grande redoute d’où nous voyions partir le feu; elle fut prise avec quelques canons; après l’avoir examinée, nous fûmes étonnés qu’on s’en fût sitôt rendu maître.
Le 6, les troupes continuèrent à arriver et à se rapprocher de part et d’autre pour décider, à coups de canon, du sort des armées et des empires.
Le 7, à deux heures du matin, Napoléon réunit son état-major sur la redoute prise l’avant-veille, et la proclamation suivante fut mise à l’ordre du jour:
«SOLDATS!
«Voici la bataille que vous avez tant désirée;
«désormais la victoire dépend de vous, elle
«vous est nécessaire, elle vous donnera l’abondance,
«de bons quartiers d’hiver, et un prompt
«retour dans la patrie. Conduisez-vous comme
«à Austerlitz, à Friedland, à Witepsk, à Smolensk,
«et que la postérité la plus reculée cite
«avec orgueil votre conduite dans cette journée;
«que l’on dise de vous: Ils étaient à celte
«grande bataille sous les murs de Moscou.»
Au point du jour, des coups de canon donnèrent le signal de l’attaque, ils se répondirent, le feu se développa et ne cessa plus; la direction du bruit et l’avantage du lieu amenaient un grand nombre de personnes sur la redoute prise le 5, et d’où, regardant vers l’orient, on découvrait le champ de bataille.
Le sol, qui s’inclinait légèrement à partir de ce point et des environs, se relevait à un demi-quart de lieue, offrant un espace considérable coupé de trois ou quatre ravins desséchés, et terminé par les redoutes ennemies.
A dix heures du matin, le soleil perça le brouillait et découvrit un ciel serein; à une demi-lieue partaient de l’horizon couvert d’une épaisse fumée, des lignes de feu avec un fracas. tel qu’on ne peut guère se l’imaginer. Le bruit des canons dirigés contre nous, et la plupart d’un gros calibre, couvrait tellement celui de nos pièces, que nous les entendions à peine, quoiqu’elles fussent plus près. Cependant des caissons sautant au milieu des rangs ennemis prouvaient que notre artillerie faisait aussi des ravages. La partie la plus avancée de notre armée couverte de la fumée des ennemis et de la nôtre, était en grande partie invisible. On établissait des batteries dans un bois taillis, et un groupe de quelques personnes, parmi lesquelles était l’empereur, s’y portait pour en diriger le feu. A gauche, l’armée d’Italie, placée sur le flanc d’un coteau, tenait en échec l’aile droite de l’ennemi. A notre droite et très en avant, une masse de cavalerie ou la plus grande partie de la cavalerie sous lés ordres du roi de Naples, quittait parfois la place où elle était en repos et comme à l’abri, s’avançait brusquement vers des redoutes d’où partait un horizon de feu, et se retirait bientôt après, abandonnant un terrain nu où les boulets et la mitraille faisaient voler la poussière. Ces charges, quoique habilement dirigées, et produisant l’effet désiré, pouvaient paraître à un œil peu exercé des tentatives inutiles et par conséquent pernicieuses. A chaque instant éclataient dans divers points de ce champ couvert de tant de corps, des obus qui y portaient le ravage. Des généraux blessés étaient portés sur les derrières, par cinq ou six soldats. Des gendarmes de la garde conduisaient quelques groupes de prisonniers noircis de fumée: des boulets tombaient souvent jusqu’auprès de la grande redoute où nous étions, et enlevaient du monde dans les rangs de réserve, tant était fort le calibre des pièces ennemies! La garde impériale, parée comme pour un jour de fête, formait en grande partie cette réserve; les grenadiers avaient ôté les fourreaux de leurs bonnets à poil et de leurs longs plumets rouges. Le moment était venu de ne plus rien épargner, il fallait que ceux qui succomberaient mourussent dans tout l’éclat de leurs armes, et les vainqueurs devaient compter ce jour au nombre des plus beaux de leur vie. Des officiers brillans d’or ou d’acier étaient attentifs du haut de ces retranchemens aux efforts des autres troupes; ils durent plus d’une fois concevoir des craintes sur l’issue de cette bataille, en voyant qu’on avait déjà fait divers mouvemens inutiles; dans ce moment l’artillerie de la garde reçut ordre d’avancer; quelques officiers quittèrent leurs groupes et allèrent, avec le calme de la valeur, sacrifier leur vie à leur devoir.
A deux heures, la situation respective des deux armées offrit une différence aussi avantageuse pour nous qu’elle était inattendue. Ces redoutes, en apparence inaccessibles, étaient presque toutes tombées en notre pouvoir; on en voyait encore partir la foudre; mais dirigées par nos canonniers, contre une redoute encore très forte, qui dominait presque toutes les autres, et qui fut prise long temps avant le coucher du soleil. Cette occupation hâtait alors l’heureuse issue de cette sanglante bataille. Des soldats de réserve accumulés le matin autour du point d’où nous regardions, s’étaient avancés vers les lignes, laissant derrière eux un grand espace dans lequel l’œil aimait à ne rencontrer personne.
Avant la nuit le feu cessa; notre armée resta sur le champ de bataille. Les tentes de Napoléon furent dressées sur la redoute prise le 5; et le calme du soir vint permettre aux troupes accablées de goûter ce repos si doux après d’éclatans succès.
Les blessés, dont il y avait un grand nombre dans le village, furent réunis sous un hangar isolé, d’où leurs cris ne se faisaient pas entendre.
Le général Nansouty avait été blessé dès le matin. Sous le toit où on l’avait déposé menait de mourir le général Montbrun, qui avait reçu le matin un biscayen dans le ventre. Guidant naguère nos colonnes aux rives du Tage, il expirait sur celles de la Moskowa. Auprès de sa porte, gisait étendue sans connaissance, la femme d’un de ses serviteurs, mort comme lui dans cette journée.
Le soir on racontait les exploits les plus marquans; on parlait de la valeur avec laquelle s’étaient conduits les chefs; tout le monde s’accordait à donner les plus grands éloges au roi de Naples.
Des cuirassiers du cinquième régiment étaient entrés à cheval dans une redoute, avaient sabré les canonniers et l’infanterie qui s’y trouvaient, et frayèrent ainsi la voie à nos fantassins, pour s’en rendre maîtres. On convenait que l’ennemi s’était retiré en bon ordre; qu’on avait vu le soir ses lignes défiler sans aucune précipitation, quoiqu’il eût beaucoup perdu.
Le lendemain matin on visitait le champ de bataille. Dans un enfoncement, auprès dune église entourée de quelques chaumières, qui étaient sans doute le village de Borodino, des soldats autour de leurs bivouacs semblaient déjà ne plus penser à leurs succès, comme si ce jour ne dût être marqué dans l’histoire qu’au rang des actions ordinaires. Dans les quartiers de l’artillerie, l’enclume résonnait sous les coups redoublés du marteau, pour réparer les pertes de la veille. Des blessés venaient, de la main qui leur restait libre, prendre avec leurs camarades des alimens que l’amitié la plus pure leur offrait. Des caissons d’ambulance établis dans des ravins, étaient entourés de blessés mourans. Ceux qui avaient pu marcher étaient allés joindre leurs amis.
On trouvait des morts bien avant d’arriver aux redoutes, et surtout au-delà des premières. Devenus maîtres de celles-là, nos canonniers avaient tiré avec avantage sur les autres et sur les troupes qui s’y réfugiaient. C’était là qu’on voyait des cuirasses brunes enfoncées dans les poitrines-des Russes, des uniformes blancs percés d’une grande ouverture noirâtre; là étaient entassés des morts d’un aspect effrayant, par la manière dont ils avaient été frappés. Des chevaux énormes faisaient des efforts pour se relever, et retombaient aussitôt, quelquefois sur des mourans qui les entouraient. Des malheureux laissés dans les ravins, traînaient une cuisse qui tenait à peine, et s’approchaient, peut-être depuis la veille, d’un peu d’eau qu’ils avaient aperçue, pour calmer la soif allumée par la douleur. D’autres cherchaient seulement à s’éloigner, et croyaient échapper à la mort en fuyant des lieux où elle régnait avec toutes ses horreurs. Ce n’était que débris de chariots, de caissons, qu’armes brisées et éparses, sur un sol ensanglanté !
A un spectacle si propre à présenter les rois sous un jour peu avantageux, on serait tenté de se demander si c’est pour en user ainsi qu’ils ont reçu des empires; si c’est pour faire de leurs semblables les victimes d’une ambition qui n’est au fond qu’un froid égoïsme, et devant laquelle tout se tait, jusqu’à la susceptibilité des remords.
En m’avançant dans des broussailles, je trouvai un fantassin qui venait à moi, et qui me dit de ne pas aller plus loin, que nos avant-postes étaient à peu de distance. La cavalerie avait passé la nuit dans l’intervalle des redoutes; les chevaux souffraient la faim sur ce terrain nu. Quelquefois, non loin des feux des bivouacs, on roulait sous ses pieds, sans y réfléchir, des obus qui n’avaient pas éclaté. Les officiers, satisfaits de la nouvelle gloire qu’ils venaient d’acquérir, renouaient dans de vifs entretiens des liens d’amitié qui avaient été si près d’être rompus par le sort des combats. Le temps était redevenu sombre; la tristesse semblait répandue jusque dans l’air. Il ne fallait rien moins que la gaîté française pour tenir contre de pareilles épreuves. Que ce jour devait être triste pour les vaincus!
On avait pris dans cette journée quarante ou cinquante canons. ( Il y en avait vingt-cinq dans une seule redoute, et on avait pris quatre ou cinq redoutes). Il était resté sur le champ de bataille, de douze à quinze mille morts, d’après l’estimation de militaires qui avaient l’œil exercé. Au bruit de tant d’artillerie, on aurait pu croire que la moitié des combattans avait péri. Il faut beaucoup d’habitude dans une action pour ne pas s’en laisser imposer par le bruit; c’est nécessaire. Cependant, pour juger sainement ce qu’on aura de la peine à croire, et que je n’aurais. pas cru moi-même si je ne l’avais pas vu, c’est qu’il y avait au moins quatre Russes pour un Français. On compte ordinairement trois fois plus de blessés que de morts; ainsi le calcul est facile. On fit peu de prisonniers de part et d’autre, 2
Les cuirassiers russes ressemblent assez aux cuirassiers westphaliens ou saxons. Il y eut un moment de méprise. Les cuirassiers français chargèrent les cuirassiers saxons ou westphaliens; mais cette erreur ne dura pas.
On disait que si le soir Napoléon eût mis la cavalerie de sa garde à la poursuite de l’ennemi; que s’il ne lui avait pas donné le temps de se refaire après cette journée, il aurait détruit la moitié de ce qui restait de l’armée russe, avant qu’elle arrivât à Moscou 3: c’était plus proposable alors qu’après l’affaire de Smolensk. 4
Le 8 et le 9 on manœuvra sur la gauche de l’ennemi; il hâta sa retraite, et le quartier-général de notre armée entra le 10 au matin à Mojaïsk, distant de deux ou trois lieues du champ de bataille. Cette ville avait été traitée par les Russes comme celles que nous avions déjà traversées; c’est-à-dire qu’elle était en partie brûlée et dépourvue de tout. N’ayant pu tenir contre notre avant-garde, qui les avait attaqués avec vigueur, ils s’étaient éloignés en laissant quelques blessés à Mojaïsk, où les nôtres furent ensuite transportés. Nous trouvions sur la route plusieurs soldats russes morts pendant ce court trajet, et dès les jours suivans on se tira le soir quelques coups de canon aux avant-postes.
Quel plaisir de voir sur les poteaux de la route, qui marquaient les distances; sur ces poteaux dont les chiffres nous effrayaient au commencement, que nous n’avions plus que cinquante, quarante, trente werstes à faire pour arriver à Moscou! L’abondance allait revenir, nous allions être dans une capitale, nous allions reprendre des habitudes agréables dont nous commencions presque à perdre le souvenir; car les idées qu’on a dans le repos s’étaient effacées de notre esprit; nous ne savions plus à quel jour du mois ni de la semaine nous étions; nous ne pensions plus qu’il y eût ni fêtes ni dimanches; nous aurions pu presque oublier que la terre fût encore habitée, tant nous avions parcouru de pays déserts ou abandonnés. La paix allait donc se faire: envisageant la patrie, dont l’idée ne peut jamais se séparer de celle du bonheur, nous avancions aussi satisfaits qu’étonnés d’avoir pu arriver au port à travers tant d’écueils.
Des livres français, trouvés dans une maison où nous passâmes la nuit, me firent une impression que ne m’avaient jamais causée nos chefs-d’œuvre littéraires. Il faut se trouver dans une position pareille pour comprendre quelles idées ils réveillèrent en moi!