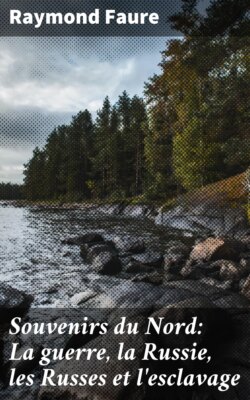Читать книгу Souvenirs du Nord: La guerre, la Russie, les Russes et l'esclavage - Raymond Faure - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Moscou.
ОглавлениеNous étions auprès de Moscou; notre corps d’armée allait y arriver le premier; les cuirassiers s’avançaient, précédés de quelques escadrons, restes de notre division de cavalerie légère, forte de près de trois mille hommes au commencement de la campagne. 5
D’une hauteur nous découvrîmes, à deux lieues dans la plaine, l’antique capitale des Czars, et le nom de Moscou circula dans ces rangs affaiblis par tant de travaux, mais fortifiés de tant de gloire, comme celui de Jérusalem était autrefois répété avec un religieux enthousiasme par les Croisés. Tout paraissait tranquille à Moscou. On n’entendait tirer aucun coup de fusil, rien n’annonçait d’incendie, et l’idée de cette paisible occupation nous eût transportés de joie, si on eût pu s’y livrer sans inquiétude.
Mais en considérant cette immense cité comme le terme de nos maux, on ne pouvait se défendre d’un sentiment pénible. Le salut de notre armée tenait à sa conservation: il ne fallait que la détruire pour que nous eussions fait inutilement cette horrible campagne; pour que nous trouvassions tous, au lieu de la paix dans cette capitale conquise, la plus affreuse mort au milieu d’un désert. Placé entre les mains de quelques fanatiques religieux ou politiques, combien notre sort devenait incertain!
Près d’entrer, l’empereur s’arrêta comme pour attendre quelque députation. Cinq ou six personnes du peuple que des officiers polonais lui amenaient, étaient loin de pouvoir soutenir la dignité de ce rôle qu’on pouvait cependant entreprendre de leur faire jouer aux yeux de l’Europe. Il n’y avait guère là de quoi flatter l’amour-propre du vainqueur. Nous entrâmes dans Moscou le 14 septembre après midi.
D’abord peu satisfaits de voir encore de pauvres maisons en bois, nous dûmes revenir de cette première impression à mesure que nous avancions. On ne rencontrait que quelques hommes de la basse classe, dont plusieurs avaient cru de leur devoir de mettre une cocarde tricolore, et de se tenir au coin d’une rue avec une vieille arme au bras. Peu de personnes se montraient aux fenêtres.
Toutes les issues furent occupées par des postes d’infanterie. La cavalerie qui était entrée dans la ville, la traversa, et fut prendre position au-delà, marchant pour ainsi dire à côté des cosaques qui l’évacuaient sans qu’il vînt dans l’idée de se battre, tant on croyait que la guerre était finie. Une autre partie de la cavalerie passa la rivière au gué, et alla se poster vers le nord de Moscou.
Le lendemain, la garde impériale et les divers corps d’armée y entrèrent. Napoléon vint occuper le Kremlin. On vit ce jour-là une épaisse fumée s’élever d’un seul point. On ne dut d’abord concevoir aucune inquiétude. Le lendemain le feu n’était pas éteint, il paraissait au contraire plus violent. On pillait les magasins et les maisons que le feu menaçait. Bientôt il éclata dans divers, quartiers, et l’on fut obligé de s’avouer que la ville allait être dévorée par les flammes.
Le 18, notre corps d’armée qui était hors des faubourgs du côté du nord, reçut ordre de se porter au sud-est sur le chemin de Saint-Wladimir. Nous traversâmes Moscou. L’incendie était alors considérable, beaucoup de maisons avaient été brûlées. Dans une grande rue bâtie en bois, par où nous entrâmes, on ne rencontrait que des militaires qui faisaient apporter dans leurs bivouacs, par des hommes du peuple, des provisions de toute espèce. Nous passâmes dans des quartiers mieux bâtis où d’énormes boules dorées qui surmontaient les dômes des églises, si elles n’offraient les formes de la belle architecture, avaient au moins un air d’opulence. Dans des rues isolées on voyait des flammes sortir des fenêtres, et dévorer en silence l’ouvrage de tant de siècles qu’on leur abandonnait. Personne ne cherchait à arrêter les progrès du feu; la plupart des maisons étaient fermées. Le roi de Naples avait changé trois fois de logement. Nous étions alors devant celui qu’il occupait, et il était déjà entouré de flammes. Qu’opposer à un semblable fléau qui avait fini par éclater sur tous les points à la fois? On fusillait tous ceux qu’on trouvait la torche à la main; et cette mesure, qui pouvait être efficace, ne produisit cependant aucun effet. Ce feu destructeur était favorisé par un vent de sud-ouest que nous pouvions regarder comme celui de la colère céleste; il continua ses ravages. Éloignés de Moscou, nous reconnûmes pendant huit jours l’emplacement de cette ville, à un épais nuage de fumée qui s’élevait de l’incendie, et obscurcissait le jour; la nuit, on voyait luire une clarté non moins sinistre que la lueur de ces comètes où les peuples ont souvent voulu voir d’affreux présages.
Telle d’un rouge ardent, lugubre, ensanglanté,
La nuit, dans l’air brûlant, la comète étincelle.
DELILE, Énéide.
Cependant des provisions que nous apportions de Moscou réparaient nos forces dans les bivouacs. L’abondance, si long-temps désirée, pouvait seule nous distraire d’un événement aussi grave, et aussi fatal. Toujours accessibles à l’espérance, nous nous livrions au sommeil comme si nous avions dû nous réveiller pour un meilleur avenir.
Centre d’un immense commerce, offrant réunis le luxe asiatique et les mœurs de l’Europe, Moscou était une ville florissante. Des maisons spacieuses avec de vastes cours et des jardins y offraient un genre de liberté qu’on trouve si rarement dans les cités populeuses. Quelques belles maisons blanches, avec des façades à colonnes, contrastaient agréablement avec des édifices sombres qui avaient vu passer les siècles et les nations. Ce monument de la puissance tartare, dont le front superbe dominait cette capitale long-temps malheureuse , était devenu, depuis la destruction de l’ennemi qui l’avait érigé, un trophée des Russes, et ne semblait plus destiné qu’à la protection de leurs arts et de leur culte réunis autour de lui. Mais ces peuples se sont vainement confiés dans ce palladium des peuples. Poussés d’un point éloigné de la terre, des soldats sont venus fondre sur ce berceau de leur société, et Moscou a disparu pour ne pas devenir encore une fois un instrument d’oppression. Vous qui naquîtes dans ses beaux jours, et qui vécûtes dans sa paisible enceinte, venez le reconnaître sous cet amas de cendres et de ruines!.... Ah! si jamais l’Athènes des temps modernes, si cette capitale que nous pouvons à juste titre regarder comme celle du monde entier, si Paris devait éprouver le même-sort!... Cette réflexion devait naturellement se présenter à l’esprit, après le spectacle qui venait de frapper nos regards!
Des lieux témoins d’un si grand désastre, qui pouvait sans amertume jeter un coup-d’œil sur l’Europe? que dis-je! sur le monde, vaste théâtre de nos exploits, et pour en suivre le cours, se transporter en Afrique, au pied des pyramides et au milieu des sables brûlans du désert; en Asie, autour des vieux murs de Gaza, de Jaffa, de Césarée et de Saint-Jean-d’Acre; en Amérique, dans les fatales plaines de Saint-Domingue! Dans tous ces lieux l’ambition avait laissé des traces déplorables de son passage. Cadix, Valence, Saragosse, fumaient encore. Les rives du Danube, de l’Elbe, de l’Oder et de la Vistule, avaient été les malheureux champs d’une riche moisson de gloire. Une traînée de feu et de sang marquait la route récente de Kowno à Moscou: ces campagnes désertes étaient jonchées de cadavres; les villes étaient réduites en cendres. Le génie de la guerre avait porté partout la destruction et la mort!
Nous nous éloignions lentement de Moscou. Au bout de huit jours (le 24 septembre), nous n’en étions pas à plus de douze lieues. Le roi de Naples venait dans les premiers jours visiter les avant-postes, et s’en retournait le soir. Il était convenu, disait-on, avec le général qui commandait les cosaques de l’arrière-garde, de ne pas s’inquiéter réciproquement, que les affaires d’avant-postes ne pouvaient plus avoir aucun résultat, qu’ils avaient besoin de repos aussi-bien que nous. On parlait de paix, et dans cette idée, nous restions en pleine sécurité à la portée des cosaques. Nous rêvions à des cantonnemens; l’ordre de les prendre ne pouvait tarder à arriver; on nous assignerait un village. Nous désirions que ce fût celui où nous étions: une grande partie des paysans y étaient restés. On établirait une espèce de police pour gagner leur confiance, afin qu’ils engageassent les autres à revenir. On passerait l’hiver dans ces petites chaumières, et l’on s’y voyait heureux par avance, puisqu’on y trouvait des subsistances et du repos. Quant à la patrie, on tâcherait de l’oublier!
Au printemps, mettant les choses au pis, la guerre recommencerait, et nous serions vainqueurs; mais ici commençait le vague et l’incertitude, et nous ne pouvions qu’à peine former des conjectures.
Un officier vint apporter l’ordre de partir pour se mettre à la poursuite de l’ennemi. ( Ce n’était pas se battre. ) Le général en avait perdu la trace. On parlait d’une dame qui avait donné quelques renseignemens sur la route qu’il avait tenue. Nous partîmes le 24.
Pendant une marche de flanc, des cosaques postés dans des bois prirent quelques uns de nos équipages. Nous parcourions un pays inégal, coupé de bois, où la cavalerie ne pouvait que rarement se déployer. Aussi, peu de monde nous arrêtait. Le prince Poniatowski, à la tète de l’infanterie polonaise, avait chaque jour des engagemens avec les Russes. Mais, quoique le canon ne cessât presque de tirer de toute la journée, ces affaires n’étaient nullement sérieuses.
Nous traversâmes le village de Woronovo, où tout était dévasté. Dans le château, le roi de Naples trouva sur une cheminée, ou contre un mûr, un écriteau où il était dit que cette maison appartenait au comte Rostopchin, gouverneur de Moscou, qui y avait mis le feu lui-même, afin qu’aucun Français ne vînt la souiller par sa présence: elle était en effet presque toute brûlée. Nous n’étions pas irrités contre les Russes; nous pensions que les militaires de cette nation n’en voulaient pas non plus aux Français; ils ne devaient voir dans leurs ennemis que des soldats qui, dans ce moment, étaient les plus forts, comme de leur côté les Français rendaient justice aux Russes, dont ils étaient les vainqueurs.
J’ai vu plus tard, lorsque j’ai mieux connu la noblesse de Russie, que l’orgueil blessé et une habitude de sentimens exagérés, qui font la force de leur pays à défaut de lois, pouvaient les porter aux actes les plus violens, sans aucun calcul des suites. Que le village de Woronovo fût brûlé ou non, les événemens devaient être les mêmes; mais j’ai compris par la suite que le comte de Rostopchin aurait regretté toute sa vie de l’avoir laissé intact. C’est ainsi qu’ils ont brûlé Moscou; ils auraient pu l’évacuer; et s’ils voulaient en faire le sacrifice, ils auraient pu le défendre, et nous le faire acheter bien cher. Ils ont trouvé plus beau de la détruire, sans faire la réflexion que dès que nous y étions entrés, il était de leur intérêt que nous y restassions; car si nous y fussions demeurés deux mois de plus, il ne se serait certainement pas sauvé un seul homme de toute l’armée française; la retraite étant alors impossible, le manque de vivres, de fourrages, de bois, dont Moscou doit s’être approvisionné au commencement de l’hiver, aurait tout forcé à capituler; et cependant quelle perte pour l’état, que la destruction de cette ville! que de fortunes! que d’objets d’arts! que de matériaux pour l’histoire de la nation ont été anéantis! quel retard pour la civilisation!
Le 6 octobre au soir nous arrivâmes à Tarontin, à quinze lieues de Moscou, du côté de Kalouga. On se battit comme de coutume avant de prendre position. On était déjà installé dans les bivouacs, lorsqu’on entendit tout à coup sonner à cheval. Ce fut presque une alerte; notre corps partit à la hâte, et s’avança vers le coteau dont nous n’étions séparés que par un ravin, pour repousser les cosaques qui venaient en nombre. On fournissait souvent des courses inutiles contre eux; ils se retiraient devant notre cavalerie qui ne pouvait plus faire de charges, tant les chevaux étaient ruinés, et ils couraient après dès qu’elle revenait sur ses pas.
Le lendemain, et pendant deux ou trois jours, la cavalerie était à cheval à cinq heures du matin, c’est-à-dire avant le jour; les équipages se retiraient à une demi-lieue sur les derrières,, parce qu’on s’attendait à être attaqué ; mais l’ennemi ne vint pas, et on ne prit plus cette précaution, si ce n’est une fois encore vers le 12 ou le 15, et ce fut encore inutilement.
Nous étions dans un pays couvert; mais la place que nous occupions était assez libre. Sur des collines couronnées de quelques bouquets de bois, nous pouvions voir à une assez grande distance des détachemens de nos troupes qui tenaient la même ligne. Placés auprès du bivouac du roi de Naples, un coteau nous bornait la vue à un quart de lieue vers le sud-est, et terminait là notre horizon. Nous y voyions tous les jours placer les vedettes. Sur le revers de ce coteau était dans un village le quartier-général de la cavalerie légère, d’où nous voyions partir les pelotons qui allaient faire des reconnaissances et relever les postes. Nous en étions séparés par un ruisseau peu profond, et presque desséché , le long duquel bivouaquaient notre corps d’armée, celui du général Grouchy, de l’infanterie polonaise, et le deuxième corps de cavalerie, formé en grande partie par les carabiniers. Nous entendions toute la journée des coups de fusil tirés dans les camps des Russes, où sans doute on exerçait des recrues.
Le surlendemain, ou le quatrième jour de notre arrivée dans ce bivouac, le bruit se répandit qu’on venait de signer une suspension d’armes; cette nouvelle dont on aurait craint de découvrir la fausseté en remontant à sa source, était reçue par tout le monde avec un transport aveugle. Mais ces espérances ne purent se soutenir: il y avait bien eu quelques négociations, mais ce n’avait été de la part des Russes qu’un moyen de nous amuser.
Nous n’avions trouvé en arrivant à cette place que les cendres d’un village encore fumantes; quelques fourrages découverts à une lieue, sur les derrières, suffirent pendant les premiers jours à la nourriture des chevaux. Mais ensuite il fallut aller plus loin; on y était entouré par les cosaques; on fut obligé de se former en troupe, et bientôt de prendre des canons. Vers neuf heures du matin, les deux tiers de la cavalerie, force principale de cette avant-garde de l’armée, partaient en corps pour aller au fourrage, armés comme pour aller au combat. Ces troupes n’étaient de retour que vers trois ou quatre heures de l’après-midi. Ainsi, le camp restait toute la journée exposé à un coup de main de la part des Russes. Les chevaux, doublement chargés du cavalier et de quelques gerbes de blé, rentraient harassés de fatigue, et étaient obligés le lendemain, sinon de recommencer la même course, du moins de faire le service. Aussi en mourait-il beaucoup. Quelques jours d’un vent froid avec du givre et du verglas, les éprouvèrent jusqu’à leur donner une espèce de tremblement habituel. En se promenant autour des bivouacs, on ne voyait que des chevaux morts.
Les vivres manquaient; il n’y avait que les personnes qui avaient des équipages qui pouvaient avoir conservé des provisions, qu’elles avaient prises en passant à Moscou; encore avaient-elles eu le temps d’en consommer la plus grande partie. Les soldats n’avaient rien, pas même de viande dont on n’avait jamais manqué jusque là. Ils mangeaient du seigle bouilli dans de l’eau, sans pain, sans sel, sans aucun assaisonnement. Quelques Polonais voulaient essayer de moudre du blé avec un moulin à bras, qu’ils avaient trouvé ; ils épuisaient leurs forces, et le vent emportait, en grande partie le résultat de ce pénible travail.
Moscou était trop loin. Les communications avec cette ville étaient à peu près interceptées par les cosaques. On ne pouvait y aller qu’en force. C’était un voyage au moins de cinq ou six jours pour aller et venir; et puis, était-on sûr d’y trouver des vivres? on entendait dire que des domestiques et des soldats qui étaient allés depuis deux ou trois jours dans les environs, pour chercher quelque subsistance, n’étaient pas revenus. Quelquefois il en arrivait un ou deux qui racontaient comment ils avaient eu à se battre contre des cosaques ou des paysans réunis dans des bois; comment ils avaient été séparés de leurs camarades qui avaient été pris ou tués; souvent eux-mêmes ne rapportaient Tien. Chaque régiment se mit sur le pied de fournir un détachement qui se réunissait à d’autres, et tous ensemble allaient aux vivres sous la conduite d’un capitaine ou d’un chef d’escadron. Avant le jour, lorsque la fatale trompette sonnait, des hommes affamés allaient avec ce qui restait de leurs chevaux, se répandre dans des campagnes dévastées, et jusque dans les lignes ennemies, pour trouver de quoi calmer le tourment qui les dévorait. On espérait de ces expéditions et de quelques convois qu’on avait envoyés à Moscou; mais toutes ces tentatives échouaient successivement, et chaque jour, au lieu de combler nos espérances, venait les détruire.
L’inspecteur aux revues, avec lequel nous vivions, avait un sac de farine qui était bien ce qui lui tenait le plus à cœur. Une nuit on vint le lui voler dans ses équipages, quoique deux cuirassiers qu’il avait avec lui fussent pour ainsi dire couchés dessus.
Plus heureux que beaucoup d’autres, nous mangions du riz; nous maudissions la nécessité où nous étions de consommer sans bouger de place ce qui aurait pu nous servir pendant une longue route. Mais quand cette ressource serait épuisée, qu’allions-nous devenir? Heureusement, les rigueurs de la saison n’ajoutaient pas encore à ce que nous souffrions: excepté les deux ou trois jours de froid dont j’ai parlé, il avait toujours fait beau; le soleil paraissait toute la journée; et la nuit, de grosses pièces de bois que nous faisions amener de loin avec nos chevaux, entretenaient un feu devant lequel, avec le moindre abri, nous ne ressentions pas le froid.
Il arrivait quelquefois, pendant ces longues courses, à plusieurs d’entre nous, de se trouver couchés à la renverse comme un de nos célèbres voyageurs, et contemplant par une belle nuit ces points lumineux, dont la voûte du ciel est semée, et qui éclairent l’infini. Que la terre se rapetissait quand l’esprit s’arrêtait aux réflexions que devait inspirer un pareil spectacle! Comment s’arrêter alors aux êtres éphémères qui la peuplent, à ces folles entreprises, calculées comme s’ils devaient durer autant que les soleils! Qu’on prenait en pitié leurs agitations! qu’on avait honte de se trouver parmi des fous qui allaient si gravement tourmenter les autres, et qui se donnaient tant de peine pour disparaître plus tôt de la scène du monde!.....
Nous nous réveillions couverts de rosée, de gelée, en attendant la neige et de plus cruels frimas; en attendant le sommeil définitif...
On parlait de Moscou: que disait-on à Moscou? pourquoi l’empereur nous laissait-il dans ce lieu? savait-il comment nous y étions?.... On rapportait que le maréchal Bessière lui ayant un jour fait observer que les Russes s’étaient refaits pendant ce repos, sa majesté avait gaîment dédaigné cet avis. Le général Domon fut envoyé vers lui, par le roi de Naples, pour quelque mission. L’empereur lui demanda comment allait la cavalerie légère. Le général voulut être sincère, et répondit qu’elle allait mal. L’empereur lui tourna le dos et ne le regarda plus. Quelqu’un encourut sa disgrâce pour avoir osé dire qu’on mangeait du cheval aux avant - postes. Le roi de Naples s’emportait chaque jour contre lui, de ce qu’il s’obstinait à nous laisser dans ce repos destructeur, malgré ses représentations.
Napoléon avait reçu la nouvelle que les Anglais étaient à Madrid; bien sûr qu’elle se répandrait, il l’annonça à la parade, en disant qu’il ferait lui-même la campagne prochaine. Un autre jour qu’il distribuait des croix d’honneur, un colonel témoigna quelque surprise sur le petit nombre de celles destinées à son régiment. «C’est bien assez, répondit-il, pour
«le résultat de la campagne.» Ce mot décelait qu’il n’était pas aussi satisfait qu’il voulait le paraître quelquefois. Il est vrai que s’il eût dit qu’il ne comptait plus d’armée russe, il n’eût pas été le seul de cette opinion; nous étions nous-mêmes dans la plus grande sécurité fondée sur l’habitude plutôt que sur la raison. Mais qu’allions nous devenir? voilà l’idée dont on ne pouvait se débarrasser. Est-il rien de plus affreux qu’une pareille situation lorsqu’on a le temps d’y réfléchir! Nous voyions que nous n’aurions pas la paix; nous sentions que rien ne pouvait forcer les Russes à la faire; nous allions être obligés de nous retirer sans traité. Et quelle perspective que celle de recommencer des marches d’une aussi pénible longueur avec une armée dont nous connaissions tous le mauvais état! Cette réflexion était si effrayante que nous ne pouvions nous y arrêter, surtout en voyant que l’hiver approchait: nous ne croyions presque plus dès lors à la possibilité d’une retraite.