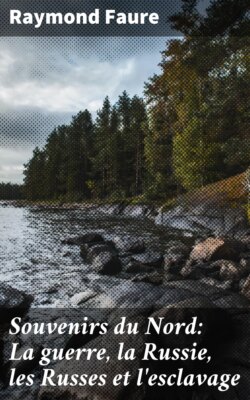Читать книгу Souvenirs du Nord: La guerre, la Russie, les Russes et l'esclavage - Raymond Faure - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Affaire d’Ostrowno.
ОглавлениеNOTRE corps faisait l’avant-garde de l’armée, nous étions depuis deux ou trois jours en vue de l’ennemi; on avait échangé quelques coups de canon. Le 26 juillet au matin, nous partimes de bonne heure; le soleil brillait, la campagne était riante, nous suivions une belle route; des lanciers polonais arrivaient sur leurs vigoureux chevaux, en répétant leur chant national. En descendant vers un village, nous entendîmes quelques coups de canon très près de nous; nous crûmes que c’était un léger engagement, mais les coups de canon reprirent un moment après. Nous approchions; un capitaine d’état-major vint au galop chercher les cuirassiers qui arrivaient derrière nous; plus loin nous vîmes un de nos hussards du huitième étendu sur la route, la face contre terre: il avait eu le crâne emporté par un boulet.
Des batteries russes avaient fait feu sur la cavalerie légère, on s’était de suite mis en bataille, le général qui la commandait était venu dire avec fureur, que si l’ennemi tirait encore, il fallait charger les pièces; les coups de canon ayant recommencé comme nous l’avions entendu, ses soldats étaient partis comme l’éclair, et étaient revenus bientôt après avec quatre ou huit pièces de canon et des prisonniers. Quand on nous faisait ce récit, les deux côtés du chemin étaient déjà couverts de blessés prisonniers ou français. On voyait des hussards amener des prisonniers qu’ils faisaient courir devant eux à pied, ou montés sur des chevaux dont ils tenaient la bride d’une main; dans l’autre main était un pistolet. Je pansai les plus pressés.
L’action se passait dans un endroit bas où la route changeait de direction: le feu et la fumée se croisaient presque, tant l’artillerie ennemie était près de la nôtre. Les cuirassiers, rangés en bataille des deux côtés, soutenaient les pièces et les troupes engagées sans faire un mouvement. Le roi de Naples, voyant que l’ennemi voulait tenir, ordonna qu’on fît reculer les équipages; les équipages se retirèrent; ceux qui étaient derrière, voyant les plus avancés reculer, s’éloignèrent avec précipitation: ce fut presque une alerte.
Bientôt arriva de l’infanterie formée en pelotons: conduite avec lenteur, elle n’en paraissait que plus sûre de vaincre. Près de les imiter, elle admirait les exploits de la cavalerie légère; ces hommes étaient en effet devenus furieux dans le combat: combien n’en vis-je pas qui, venant de se faire panser, et ayant la tête, un bras ou une jambe bandés, retournaient dans la mêlée au grand galop, et échappaient, en se débattant, à ceux de leurs camarades qui voulaient les retenir!
La canonnade avait cessé plusieurs fois; le feu se soutint encore après l’arrivée de l’infanterie; mais il finit vers trois heures après midi. Nos troupes restèrent en position; des lignes qu’on avait étendues jusque sur le revers d’un coteau, y passèrent la journée à observer l’ennemi; tout était calme le soir; on n’entendait aucun cri; et après tant de bruit, de fatigue et d’exaltation, on se trouvait dans un état voisin de l’étonnement. Nous descendîmes dans le village d’Ostrowno, dont une partie avait été brûlée. Les soldats y circulaient; on était surpris d’y voir quelques habitans qu’on employait à secourir les blessés. Quel air effrayé avaient ces pauvres gens, au milieu de tant d’hommes armés et en proie au délire de la gloire! quelles expressions pourraient rendre la contenance avec laquelle ils recevaient nos ordres?
Les hussards avaient beaucoup perdu. L’artillerie à cheval, la seule que nous eussions, avait aussi beaucoup souffert. Grand nombre de boulets tirés trop haut avaient passé pardessus nos canonniers; d’autres avaient atteint les cuirassiers qui semblaient ne devoir pas être touchés. La plupart des blessures étaient graves, puisque la plupart étaient des blessures d’artillerie. Qu’allaient devenir les blessés? on les envoyait à la petite ville par où nous avions passé la veille ou l’avant-veille; mais que feraient-ils là ? qui les nourrirait? les hommes bien portans avaient de la peine à trouver quelques ressources; cette idée faisait frémir.
Cette victoire, si l’on peut appeler ainsi le succès dans un combat aussi opiniâtre, était éclatante; mais ces lieux n’offraient aucun moyen d’en recueillir le fruit. Ostrowno était un village formé de quelques maisons enfumées et pauvres. Il n’y avait personne pour payer au courage de ces soldats le tribut d’admiration qu’ils avaient si bien mérité. On ne pouvait dresser la moindre table où l’on pût raconter les exploits de la journée. Après de telles acti ons on voudrait être tout entier à ce qu’on éprouve; on a de la peine à détacher son attention de sujets aussi graves.
On coucha en toute confiance dans le village que des troupes entouraient; le roi de Naples y passa la nuit. Le lendemain matin au départ, nous passâmes sur le champ de bataille; il y avait encore quelques morts sur la route; mais le plus grand nombre de ceux qui s’y étaient trouvés avaient été jetés dans les fossés. Quelques arbres avaient été entamés ou coupés par les boulets. Hors de la route, sur un terrain peu large, borné par une espèce de marais qui avait empêché de prendre les Russes en flanc ou de les tourner, s’étaient faites plusieurs charges de cavalerie. Le gazon y était labouré, et là gisaient des hommes couchés dans tous les sens et mutilés de diverses manières. Les uns, tout noirs, avaient été brûlés par l’explosion d’un caisson; d’autres, qui paraissaient morts, respiraient encore; en s’approchant d’eux on les entendait se plaindre; ils étaient couchés ayant la tête appuyée quelque fois sur un de leurs camarades mort depuis quelques heures; ils étaient dans un apathie, dans une espèce de sommeil de douleurs, d’où ils ne sortaient qu’à regret, ne faisant aucune attention aux personnes qui passaient autour d’eux; ils ne leur demandaient rien, sans doute parce qu’ils savaient qu’il n’y avait rien à en espérer. D’ailleurs nous trouvions ce spectacle nouveau, nous qui arrivions; mais eux qui étaient là depuis la veille, peut-être depuis le commencement de l’action, qui l’avaient vue continuer, qui avaient peut-être vu faire de nouvelles charges de cavalerie, qui avaient peut-être été foulés aux pieds des chevaux, ils trouvaient qu’il y avait long-temps; et croyant qu’on ne pouvait plus les rappeler à la vie, ils n’imploraient pas des secours déjà tant de fois refusés, ils attendaient la mort. Des lanciers prussiens parcourant les lieux où ils étaient venus fournir des charges, contemplaient d’un œil morne les restes de quelques amis qu’ils avaient de la peine à reconnaître. Dans une semblable situation on accuse la fatalité ; le soldat est généreux, il n’en veut ni à celui qui le fait battre, ni à ceux contre lesquels il se bat. Çà et là étaient des chevaux renversés, des harnois rompus, des caissons en éclats, des sabres tordus, des pistolets, des fusils brisés, la terre était couverte de débris. Ces braves hussards du huitième, couchés en grand nombre parmi les morts, avaient mêlé leur sang à celui de l’ennemi.
La perte des Russes était considérable; ils avaient quatre fois plus de morts, et par conséquent quatre fois plus de blessés que nous. Nos canonniers, en passant sur la route, jugeaient avoir visé plus juste que leurs adversaires, et en devenaient plus confians dans leurs manœuvres. On quittait ce lieu avec un sentiment bien difficile à exprimer; mais qu’eût été ce sentiment, si de pareils événemens se fussent passés sur le sol de la patrie! si cette terre natale eût été saccagée de la sorte, et arrosée du sang des Français vaincus!
Un peu plus loin on reconnaissait la place où les Russes avaient pansé leurs blessés. Pendant la marche de ce jour, nous trouvâmes la route couverte de la crinière de casques ennemis.
On se tira quelques coups de fusil le soir.
Le 26 au matin, peu après le départ, le canon se fit entendre, une nouvelle action s’engagea; elle ne devait pas devenir importante, le lieu ne permettant pas de se développer; on disputait un passage. L’armée d’Italie nous rejoignit (car nous l’avions déjà en vue), les coups de fusil se succédaient sans interruption, et cependant les équipages se présentaient pour passer; on donna ordre comme la veille de les faire reculer, il en résulta plus de confusion encore: les administrations italiennes, qui ne s’étaient pas trouvées à Ostrowno, avaient pris l’alarme et l’avaient répandue jusque parmi les soldats qu’elles trouvaient sur la route.
Vers trois heures, l’empereur vint donner le coup-d’œil du maître; aucune émotion ne paraissait sur son visage: sa sensibilité avait résisté à d’autres épreuves!
Le 27 on se battit encore; on avança peu: le gros de l’armée arriva. Les divers corps et la garde furent placés sur les côtés de la route, dans les endroits qu’on trouvait les plus commodes; le pays était encore coupé de gorges et couvert de bois. Le passage fut libre le surlendemain de l’arrivée de l’empereur. A l’endroit où l’ennemi avait le plus long-temps tenu, gisaient quelques fantassins russes et un nombre à peu près égal des nôtres; le canon, d’ailleurs, n’avait pas fait grand mal: cette affaire n’avait été rien moins que meurtrière; l’ennemi avait seulement voulu retarder notre marche.
Au sortir de ces défilés nous vîmes Witepsk à plus d’une lieue. Une colonne de fumée s’élevait de quelques magasins auxquels les Russes avaient mis le feu. Le canon tira toute la journée; il périt beaucoup de monde devant la ville, dans une grande plaine où la cavalerie donna. Le soir, le canon cessa.de tirer, la cavalerie légère passa la ville et suivit l’ennemi; le reste de l’armée demeura en position sur des hauteurs où les deux tentes du chef furent dressées.
Le 28, la garde impériale en grande tenue partit de bonne heure pour faire son entrée dans Witepsk; les divers corps d’armée défilèrent; on allait lentement; les environs et l’intérieur même de la ville étaient coupés de ravins. Witepsk a quelques maisons qui ont de l’apparence; c’était la plus belle ville que nous eussions vue depuis Wilna, à laquelle elle n’est pourtant pas comparable; on y trouva quelques vivres qui étaient loin de pouvoir suffire: le soir on alla bivouaquer au-delà.
Le 29 ou le 30, vers midi, notre corps d’armée qui s’était séparé du reste arriva dans une petite ville abandonnée; nous y étions à peu près installés lorsque des officiers d’état-major vinrent dire que l’ennemi inquiétait nos avant-postes; nous prêtâmes l’oreille un instant avec eux, et nous entendîmes, quoique peu distinctement à cause de la distance, des coups de fusil qui paraissaient être tirés dans une plaine de sable; nous ne pûmes rien apercevoir à l’horizon. On jugeait convenable de se tenir prêts à partir, parce que nous pouvions être obligés de reculer. Un moment après, les coups devinrent plus fréquens; on sonna à cheval; la division de cuirassiers alla reconnaître ces forces qui ne parurent pas considérables; elle revint aussitôt.
Le lendemain nous nous dirigeâmes vers le lieu où nous avions entendu cette escarmouche; des hussards y étaient en vedette. Des piquets de cavalerie, qui pouvaient être des patrouilles russes, rôdaient dans les environs pendant que des villages brûlaient.
Nous restâmes dix jours à ce poste; les chevaux se refirent pendant cette halte; un tiers étaient ou blessés ou tellement affaiblis qu’ils n’auraient pu soutenir plus long-tèmps la fatigue; lorsqu’on leur laissait manger l’épi du seigle, ils tombaient fourbus, c’était pour eux un poison; leurs jambes devenaient faibles, leur marche chancelante, ils étaient après peu de jours d’une maigreur extrême; tous n’en mouraient pas, mais ils restaient maigres et faibles pendant long-temps, et peu redevenaient tels qu’ils avaient été auparavant.
Un jour, le 8 août, nous entendîmes de notre village des coups de canon pendant une grande partie de la journée; ce bruit venait de trois à quatre lieues vers notre droite. Nous sûmes les jours suivans que le corps du général Montbruny avait eu une affaire très vive; l’ennemi était tombé en force sur sa cavalerie légère, et l’avait fait reculer dé trois ou quatre lieues. Le 9, à six heures du soir, nous reçùmes ordre de partir.
Il fallut d’abord rétrograder d’une lieue. Nous passâmes dans un endroit où des déserteurs dirent que les Russes bivouaqués avaient eu quelques jours auparavant une grande alerte en apprenant que les Français s’approchaient. Ce mouvement rétrograde inquiétai t déjà ; nous n’en avions pas fait encore; les têtes travaillaient. Les Français ont peut-être à la guerre une imagination trop vive: lorsqu’ils ont des succès ils les exagèrent, et personne n’avance aussi vite qu’eux; mais lorsqu’ils ont des revers ils les exagèrent encore davantage, et alors on voit parmi eux une funeste inquiétude mise à la place de l’impassible et froide obéissance nécessaire dans une armée.
Nous changions de direction. De Wilna à Drissa nous étions allés vers le nord. De Disna à Polotsk et à Witepsk, vers l’est à peu près: maintenant nous marchions vers le sud-est pour prendre la route de Smolensk.
Dans ce trajet, un parlementaire traversa un jour le camp les yeux bandés, ainsi que son trompette. Au commencement les Russes saisissaient toutes les occasions d’en envoyer, et jamais pour des raisons sérieuses: ce trompette en avait déjà conduit plusieurs. Nous passâmes une petite rivière qui était sans doute la Caspla. Arrivés au bord du Dniépe, on nous dit confidentiellement que le lendemain de grand matin on devait attaquer sur toute la ligne, que l’ennemi était de l’autre côté du fleuve, et qu’il voulait livrer bataille sur ses bords. C’était d’ailleurs pour nous quelque anniversaire de victoire. Le général Nansouty, regardant sa montre, nous dit: «qu’il était
«neuf heures, qu’il fallait se coucher à dix,
«et se lever à deux; que quatre heures de
«sommeil suffisaient.» Il n’y avait donc pas de doute que ce qu’on nous avait dit ne fût vrai.
On était mal instruit. On passa sans difficultés. Nous entendîmes quelques coups de canon qui n’eurent pas de suite. Le soir l’armée était réunie, et ce fut sans doute alors, autant qu’il m’en souvient, que nous vîmes passer sept ou huit pièces de canon prises le matin.
En Pologne nous avions souvent trouvé des endroits où la terre mobile ondulait en quelque sorte sous les roues de l’artillerie et des équipages; avant Smolensk nous passâmes dans des contrées de sable où l’eau, qui avait toujours été si mauvaise, et qui nous avait aussi souvent manqué jusque là, était encore plus rare. Dans un bois où l’on nous fit rester une nuit, des milliers de fantassins, la plupart venus de deux lieues, se pressaient autour d’une citerne, d’où l’on ne retirait plus que de la boue. Au milieu du village on se portait en foule vers un puits, quoique l’incendie qui dévorait tout, et dont on sentait vivement l’ardeur, menaçât de fermer toutes les issues. Sur quelques routes la poussière étouffait, et, sans exagérer, lorsque le mouvement était précipité, on ne pouvait se voir en plein jour. Quelquefois un épais tourbillon qu’on apercevait au loin dans de vastes plaines, indiquait la marche de l’ennemi. Sur les côtés il faisait soupçonner la direction de nos divers corps d’armée: c’était la colonne de feu ou de fumée qui s’élevait au-dessus des Israélites et qui guidait leur marche dans le désert.
Cependant nous approchions de Smolensk, ville enceinte de murailles; et le prince Bagration venait d’opérer sa jonction avec le reste de l’armée russe; le succès de sa retraite tenait du prodige.