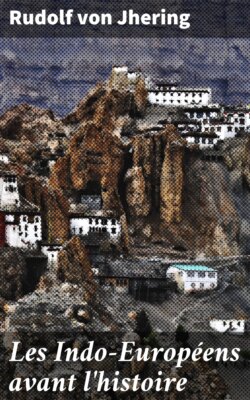Читать книгу Les Indo-Européens avant l'histoire - Rudolf von Jhering - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
C Le droit de la famille — la femme.
ОглавлениеTable des matières
XI. D’après l’opinion de plusieurs auteurs, c’était le côté brillant du droit aryen. On cite à cet effet d’abord le principe de la monogamie et ensuite les sacrifices funéraires. La première prouverait chez les Aryas une conception morale de l’essence du mariage qui les élèverait bien au-dessus de tous les autres Asiatiques, les seconds prouveraient que la piété était le trait fondamental des liens de la famille.
La première proposition est inexacte ; la polygamie était juridiquement permise. Peu fréquente, il est vrai, elle ne se rencontrait en fait que chez les princes et les riches, ainsi que cela se présente partout où elle est permise. Avoir plusieurs femmes est un luxe trop cher pour celui qui n’a que des ressources restreintes. Néanmoins, l’assertion même que l’on veut prouver à l’aide du prétendu principe de la monogamie est parfaitement exacte. La vie conjugale chez les Aryas était bien au-dessus de ce qui formait la règle chez les autres peuples de l’Asie. La femme n’occupait point, comme chez ces derniers, la situation décourageante, peu différente de celle de l’esclave, d’un être servant seulement aux plaisirs de l’homme, mais celle d’une compagne du mari, de même condition que lui. Sans doute, elle était, tout comme chez les Romains, juridiquement soumise à la puissance (manus) du mari, mais, tout comme à Rome, cela ne portait aucune atteinte à sa position dans la vie. Elle était la maîtresse de la maison et même les parents et les frères et sœurs plus jeunes du mari devaient la respecter comme telle, lorsque la direction de la maison était dévolue à ce dernier (v. plus loin).
La célébration religieuse du mariage ne s’imposait, il est vrai, que pour certaines formes; entièrement abandonnée pour d’autres à la libre volonté des contractants, elle restait cependant la règle. Cette intervention du culte atteste éloquemment la haute idée morale que l’on avait du mariage, et c’est à bon droit que l’on a pu faire remonter à cette source la confarreatio des Romains, dont, au surplus, le cérémonial, par sa relation avec l’agriculture, trahit clairement une origine plus récente, au sujet de laquelle je m’expliquerai plus loin. Pour le reste, les formes aryennes du mariage ne présentent rien de particulier. L’achat de la femme — l’une de ces formes — se retrouve chez tous les peuples; la corrélation de la coemtio romaine avec cette forme du peuple père est certes historiquement certaine, mais elle ne présente aucun intérêt. Il en va de même de la conduite de la femme dans la maison du mari, cérémonie trop naturellement impliquée dans les formes du mariage pour que l’on doive, pour expliquer la deductio in domum mariti des Romains, appeler à l’aide l’usage semblable existant chez les Aryas.
Par contre, le droit matrimonial aryen présente deux particularités dont on ne peut en dire autant et qui méritent d’être relevées, non seulement parce qu’elles se retrouvent en droit romain, mais aussi parce qu’elles sont significatives pour la conception morale qui s’y manifeste.
C’est d’abord l’interdiction du mariage entre proches parents. Comme on le sait, il y avait dans l’antiquité bien des peuples, et parmi eux un peuple civilisé de premier ordre, le peuple Egyptien, qui ne s’offensaient point de pareils mariages et même d’unions entre frères et sœurs. Pas n’est besoin d’expliquer l’influence qu’avait l’autorisation de ces unions pour la physionomie de la vie à l’intérieur de la maison, ni le but que poursuivait l’Aryas en les prohibant. Ce fut un grand mérite pour lui d’avoir exactement reconnu les dangers dont la différence des sexes à l’intérieur de la maison menaçait la vie morale; il voulait les écarter en prohibant le mariage entre proches parents; la pureté morale de la vie de famille était le but final qu’il avait en vue dans sa prohibition.
La deuxième circonstance est l’apport dotal que la fille recevait de son père en se mariant . Nous y trouvons l’origine historique de la dot romaine. Chez les Germains, c’est le mari qui apporte la dot à sa fiancée (brautgabe), les dons qu’elle lui fait sont sans valeur . Chez les Romains, c’est la fiancée qui apporte la dot à son mari. Les Romains ont conservé l’institution aryenne, les Germains point; ils l’ont remplacée par une autre, qu’ils ont probablement empruntée au peuple de leur seconde patrie. Chez les Russes, nous la trouvons encore très tard. Wladimir le Grand se mariant avec une princesse byzantine (988) n’obtint aucun apport de celle-ci, bien qu’il eût obtenu le mariage par la force des armes, bien plus, il paya même à ses parents , tellement était étrangère aux Slaves la conception que la future doit apporter quelque chose au futur. Cette conception ne s’accorde point avec l’idée de l’achat de la femme. Les Germains qui de tous les Indo-européens sont demeurés le plus longtemps dans la seconde patrie, ont adopté l’organisation du peuple soumis; les populations italiotes ont conservé celle du peuple père, tandis que les Celtes et les Grecs ont combiné les deux organisations dans la contre-dot (ἀντίφερα) à fournir par le mari à la femme, ce que firent également les Romains à l’époque impériale. Sous le rapport moral, l’organisation romano-aryenne se trouve bien au-dessus de l’organisation germano-slave, bien entendu si l’on remonte aux idées qui en forment la base. L’une reposait sur l’achat de la femme, l’apport dotal (brautgabe) formait le prix de vente, sauf que ce n’était pas comme dans les temps primitifs le père ou les parents vendeurs qui recevaient le prix, mais la femme elle-même. L’autre au contraire exprime la belle idée que la femme entre dans la maison du mari comme compagne libre, de même condition; elle apporte avec elle ce qu’elle a: comment pourrait-elle conserver ce qui est le moins, son avoir, alors qu’elle se livre elle-même toute entière? Si elle n’a rien elle-même, son père a quelque chose et c’est à lui qu’il incombe, lorsque sa fille quitte la maison, de la laisser partir dignement. Par là elle obtient d’avance, vis-à-vis du mari, d’après les idées de l’époque, seules en question ici, une position plus digne, plus respectable que si elle était entrée dans sa maison les mains vides; une uxor sine dote était si bien, pour les Romains, un objet déplaisant que c’était un point d’honneur pour les proches parents de constituer une dos à la jeune fille pauvre. L’idée de la communauté parfaite entre les époux, qu’un juriste postérieur (Modestin, L. I, de R. N., 23-2), exprime en ces mots: consortium omnis vitae, divini et humani juris communication ne pouvait être mieux réalisée que si la femme apportait sa part pour édifier la maison; et si nous rencontrons déjà cette organisation chez les anciens Aryas, c’est une nouvelle preuve de cette reconnaissance morale de l’essence du mariage que nous avons déjà pu déduire de la forme religieuse de sa célébration et qui les place si incomparablement au-dessus de tous les peuples contemporains de l’antiquité. Sous ce rapport le peuple aryen a prouvé qu’il était un peuple civilisé de premier rang.
Tout cela est confirmé par ce qu’on nous rapporte de la vie conjugale, de la fidélité de la femme, de l’amour ardent des époux entre eux . Les renseignements ne datent, il est vrai, que de la période védique, mais ils autorisent à conclure pour l’époque antérieure. La littérature retentit des louanges de l’amour conjugal et elle a produit sur ce thème des œuvres qui pour la profondeur, la douceur, la force du sentiment, peuvent être mises à côté de ce qu’il y a de plus parfait dans la poésie de n’importe quel autre peuple. L’Aryas exigeait la chasteté des filles non mariées aussi bien que celle de la femme mariée, et la séduction de la fille sans frère, était une faute grave qui trouvait sa peine dans «un lieu profond.»
A l’époque postérieure, la femme dont le mari est venu à mourir doit attester sa fidélité en montant sur le bûcher; c’est l’usage connu des sutties, ou bûchers des veuves, qui s’est conservé dans les Indes jusqu’à nos jours, et n’a été aboli que par les Anglais. Faut-il y voir une invention du brahmanisme ou un usage aryen d’une haute antiquité ? La question est controversée. Le Rigveda n’en témoigne point, la veuve est même autorisée à se remarier. ZIMMER pense que c’est un usage antique des Aryas, aboli par la civilisation chez maintes tribus, conservé chez d’autres et ensuite élevé par les brahmanes au rang de prescription légale. Ce qui semble militer en ce sens, c’est que l’usage se retrouve chez les Slaves et les Germains, tandis que les Grecs, les Romains, les Celtes ne le connaissent point . Si cette opinion est exacte, le tableau que nous a offert jusqu’ici la vie conjugale s’augmente d’un trait, qui, selon le motif qui faisait brûler les veuves, l’illuminerait d’un éclat nouveau ou le noircirait d’une ombre épaisse. Ce motif peut avoir été l’héroïsme de la femme aimante, voyant tout son bonheur et toute sa raison d’être sur terre finis à ce point par la mort de l’époux qu’à la vie sans lui elle préfère la mort par les flammes. Cette conception est si élevée qu’il ne peut être étonnant qu’elle se soit emparée des imaginations; elle répond à l’idéalisme qui forme le trait caractéristique de notre conception de la moralité et il se peut aussi qu’elle ait flotté devant les yeux des brahmanes lorsqu’ils ont restauré l’institution du passé et l’ont élevée en devoir de piété. Mais elle ne cadre point avec l’époque primitive; on pourrait tout aussi bien espérer rencontrer le lys sur la glace; la température historique était encore trop hivernale; il fallait l’été pour que pareille idée pût naître. Il est bien plus vrai de dire que la physionomie des choses était toute autre à cette époque. La femme partageait le sort de toutes les autres choses que l’on enterrait avec le défunt, soit que l’on crût qu’il en pourrait jouir dans le monde au delà, soit qu’il ne pût supporter l’idée qu’elles tomberaient en d’autres mains. Comme on lui donnait ses armes, son cheval de bataille, même ses serviteurs non libres ou demi-libres, on lui donnait aussi sa femme. Ce n’était pas l’amour dévoué de la femme, choisissant spontanément la mort par les flammes; c’était l’égoïsme du mari, vide de toute étincelle d’amour vrai, et poussé jusqu’au dernier degré de l’insensibilité et de l’inhumanité qui la vouait contre son gré à ce sort. Tel était le passé, non point celui arbitrairement forgé à l’aide d’appréciations qui ont exigé des milliers d’années pour se former, mais le passé réel, qui ne peut se dérober à quiconque a les yeux ouverts. Qu’une époque postérieure, en conservant des institutions formées sans nulle coopération d’idées morales, les envisage à la lumière de ses propres vues et leur infuse ainsi un nouveau sang, cela est un phénomène qui se range parmi les faits les plus incontestables, mais aussi les plus souvent négligés de l’évolution historique de la morale. C’est l’outre ancienne remplie d’un liquide nouveau, d’un vin généreux remplaçant l’eau trouble. Les notions de moralité n’ont pas existé de tout temps; ce ne sont pas elles qui ont fait le monde; elles ne se sont établies que quand le monde existait déjà ; le rapport entre elles et la réalité est précisément l’inverse de ce que l’on admet régulièrement; ce ne sont pas elles qui ont engendré la réalité, c’est celle-ci qui les a engendrées; leur vrai créateur, c’est la nécessité et l’intérêt. A ce compte, il ne pourra paraître étonnant qu’un acte ayant comme la crémation des veuves sa source dans l’égoïsme et l’insensibilité complète du mari, ait pu apparaître à une époque postérieure comme un devoir imposé à la femme par l’amour vrai et l’abnégation. On y trouve en présence la conception la plus basse et la plus haute de la vie conjugale, toutes deux inhumaines, l’une par excès d’égoïsme, l’autre par excès d’amour.