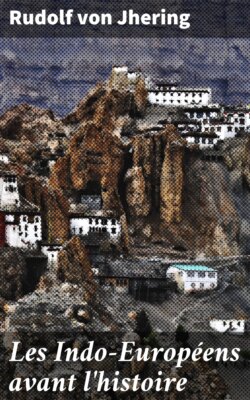Читать книгу Les Indo-Européens avant l'histoire - Rudolf von Jhering - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E. Sacrifices funéraires et droit maternel.
ОглавлениеTable des matières
XIII. D’après l’opinion dominante, le sacrifice funéraire serait la preuve d’un profond amour. Si nous ne connaissions la conduite du fils à l’égard de ses vieux parents de leur vivant, nous n’en dirions rien. Mais en présence du sort autorisé par le droit, qui leur était fait sur terre, que signifie le sacrifice funéraire, le léger don d’aliments et de boissons déposé de temps en temps sur une tombe? Singulier amour, qui attend la mort pour se manifester, qui ne donne aux parents que dans l’autre monde le pain refusé ou mesuré parcimonieusement dans celui-ci. Non! ce n’est pas l’amour qui célèbre le sacrifice funéraire, c’est la peur. D’après la croyance aryenne, qui s’est conservée chez tous les peuples indo-européens, les morts vivent encore, après leur décès, à l’état d’esprits ou d’ombres; c’est pour cela qu’on leur procure dans leur tombeau ou sur le bûcher les objets préférés, les aliments, la boisson dont ils ont toujours besoin . Dans le sacrifice d’Ulysse aux enfers les ombres se pressent avidement pour boire du sang; dans le Walhalla le héros germanique se désaltère avec de l’hydromel. Il incombe au descendant d’apporter aux défunts des aliments et des boissons sur leur tombe; s’il néglige ce devoir, les morts se vengent et apparaissent comme des fantômes menaçants pour lui causer toute espèce de maux et de peines.
Tel est à mes yeux le motif originaire du sacrifice funéraire; il n’émane point de la piété ni de l’amour filial, mais de l’égoïsme, de la crainte et de la peur. Le culte des ancêtres a la même origine que celui des Dieux d’après une opinion de la philosophie des religions, que nous trouvons déjà chez les anciens: timor fecit deos. Dans ces deux cultes le sacrifice repose sur la même idée: l’offre de la nourriture nécessaire; celui qui la refuse devient l’objet de la colère et de la vengeance de ceux qu’il néglige. Le fils n’a rien à craindre des vieux parents en vie; que peuvent-ils, eux, les faibles, contre lui, le fort? — mais contre des ombres et des fantômes c’est en vain que lutte le plus fort.
Cette opinion qui dénie toute part dans la genèse du sacrifice funéraire à l’amour et à la piété filiale n’empêche nullement que ces vertus ne se soient emparées d’une institution toute créée, lorsque leur temps fut venu. C’est encore l’outre ancienne dans laquelle on verse un liquide nouveau (p. 48), c’est un phénomène qui se reproduit si constamment dans l’histoire de la morale sur terre, que celui qui n’y a point égard court toujours le risque de transporter un concept qui n’appartient qu’à une phase avancée de la moralité dans un temps qui ne l’avait point et ne pouvait l’avoir. Le raisin, doux en automne, était aigre au printemps, il a fallu la chaleur pour le mûrir; il en est de même de la morale; son premier germe et son état définitif diffèrent immensément, mais de même que la nature a su rendre doux ce qui était aigre, de même l’histoire a su tirer de l’égoïsme, par lequel elle a commencé partout sans exception, à mon avis, ce qui lui était diamétralement contraire: la moralité.
L’époque postérieure peut donc fort bien avoir vu dans le sacrifice funéraire un témoignage de pieux amour filial; cela n’empêche nullement que la cause orginaire, ici comme ailleurs p. ex. dans la crémation de la veuve (p. 47), a pu être autre; et elle a dû être autre, cela résulte d’une manière irréfragable de ce que nous avons rapporté ci-dessus de la nature des relations filiales du vivant des parents. La vie est la pierre de touche de l’amour; celui qui ne résiste pas à cette épreuve et qui ne se montre qu’après la mort ne mérite pas le nom d’amour; le sacrifice funéraire des Aryas ne peut être rattaché à l’amour filial, il ne reste pour l’expliquer d’autre motif que celui que j’ai admis: la peur.
Je crois avoir ainsi réfuté la conclusion que l’opinion dominante puise dans cette institution des Aryas. Mais elle en rend possible une autre, bien plus précieuse, l’ignorance où se trouvait ce peuple du droit de la mère. Ce droit est en faveur aujourd’hui, partout on cherche à en trouver des traces; une des dernières découvertes dans cet ordre d’idées est que les Germains comme d’autres peuples, avant d’en arriver au droit du père, ont vécu quelque temps sous le régime du droit de la mère; récemment on est même allé jusqu’à admettre pour les Germains une période distincte du droit de la mère. Sous ce régime toute la famille se groupe autour de la mère, à elle appartiennent les enfants, le père n’a sur eux aucun droit ni aucune puissance, la parenté n’est produite que par la descendance de la même mère, la descendance du même ou d’un autre père est absolument indifférente, bref la même situation juridique que crée l’union sexuelle extra conjugale du droit romain, dans laquelle il n’y avait point de père dans le sens légal. Le droit de la mère implique l’absence du mariage; — à l’apparition de celui-ci surgit le droit du père qui dans sa forme originaire historique s’appuie aussi exclusivement sur la position du père, que le droit de la mère sur la position de la mère. Il est le maître de la maison, à lui appartiennent les enfants, et la mère elle-même est soumise à sa domination de la même manière qu’eux, toute parenté provient de lui, les enfants d’un autre lit de la femme, ne sont nullement apparentés aux siens, et leurs parents non plus. Tel est l’aspect que présente le droit du père dans la législation romaine antique; plus tard seulement elle s’est élevée jusqu’à l’idée du droit des parents, la réconciliation du droit du père et de la mère. Mère, père, parents, telles sont les phases du développement historique de la famille, tant en ce qui concerne la position des enfants vis-à-vis des parents qu’en ce qui concerne les liens de parenté.
S’il est vrai, et la chose est fort probable, que le droit de la mère ait été en vigueur chez les Aryas, il est indubitable que sa disparition devant le droit du père remonte bien au delà de l’époque de l’exode des Indo-européens. Le théâtre du droit de la mère est la maison de la femme, où les hommes entrent et sortent et où les enfants nés de relations passagères restent. Le théâtre du droit du père est la maison du mari dans laquelle la femme fait son entrée en se mariant. Telle est la forme aryenne de la conclusion du mariage. La femme n’entre pas seulement dans la maison, mais passe sous la domination du mari, et cela exclut absolument son pouvoir sur les enfants, car elle-même est soumise au mari au même titre que les enfants. A ces raisons vient encore s’ajouter le sacrifice funéraire. Le droit de la mère aurait exigé son accomplissement en l’honneur de la mère et de ses ascendants maternels; en réalité il était accompli en l’honneur du père et des ascendants paternels. D’après l’assertion de FUSTEL DE COULANGES, que je suis obligé de laisser de côté mais qui n’était nullement nécessaire pour les déductions à tirer du sacrifice funéraire, les Aryas n’admettaient même pas, en général, une parenté avec la mère et les membres de sa famille.
En somme: le droit de la mère était absolument étranger au peuple aryen à l’époque de la séparation des Indo-européens; le degré de civilisation déjà atteint par ceux-ci et qui avait à son sommet l’exacte appréciation morale de l’essence du mariage, était trop élevé pour son maintien. Ce droit aurait donc pris naissance chez les Germains, l’un des descendants des Aryas? Il y aurait là une rechute dans un état de grossièreté et de barbarie depuis longtemps abandonné par le peuple père, et dont il ne restait plus la moindre trace. Si l’on s’était rendu compte du fait, on n’aurait guère admis cette idée. On n’a pas réfléchi que l’histoire des Germains a sa préhistoire chez les Aryas, et que ceux-ci avaient déjà passé du droit maternel au droit paternel. Ce phénomène de transformation régressive n’aurait pu se produire que dans l’hypothèse d’un retour vers la barbarie antérieure, d’un recul de la civilisation — supposition qui n’est pas exacte pour les Germains pas plus que pour aucun des peuples indo-européens. Tous ont conservé la constitution aryenne de la famille, basée sur le mariage c.-à-d. le droit du père. Chez les Germains, ainsi que chez les autres peuples, les enfants n’appartenaient point à la mère, comme dans le droit maternel, mais bien au père; la femme elle-même, comme les enfants, se trouve sous la puissance (mundium) du mari. Or c’est dans cette distinction, de celui des deux auquel appartiennent les enfants, que gît l’antithèse du droit paternel et du droit maternel; l’influence qu’elle exerce sur la parenté n’est que secondaire.
D’après l’opinion de l’auteur français que nous avons cité, les Grecs et les Romains, ne s’en seraient pas tenus à l’institution telle que la tradition la leur avait donnée, mais pour eux l’idée fondamentale du culte religieux des ancêtres aurait servi de point de départ et de direction pour tout leur ordre social. Rien qui ne fût en rapport avec ce culte. Etat, religion, droit, même le droit patrimonial, tout est enfermé en lui. Le culte des ancêtres nous donne l’intelligence du monde grec et romain, sans lui ce monde reste un indéchiffrable secret. La cité antique est pour FUSTEL DE COULANGES la communauté primitive, pénétrée dans toutes ses parties de l’idée de Dieu, déclarée religieuse et sacrée en opposition avec la communauté sans Dieu de l’époque moderne. Le culte des aïeux est la source d’où cet esprit religieux s’est répandu sur le monde. Je ne m’occupe que de cette dernière assertion et en tant seulement qu’elle concerne les Romains; je ne puis omettre de l’examiner ici puisque je me suis proposé de préciser ce que les Romains doivent aux Aryas.
Qu’il faille ranger dans cette catégorie le sacrifice funéraire et le culte des aïeux, on le savait depuis longtemps. Simple obligation de conscience, à ce qu’il paraît, chez les Aryas, le sacrifice funéraire prit à Rome, dans les sacra, la forme d’une institution sociale, confiée à la garde des pontifes; l’autorité supérieure ecclésiastique peut en imposer l’obligation par la contrainte, et par la mort du débiteur elle passe à ses héritiers comme une charge grevant son patrimoine; nulla hereditas sine sacris disait une règle connue du jus pontificium. C’est uniquement par cette règle successorale que l’institution touche au droit privé, et de ce côté aussi son importance a toujours été exactement appréciée depuis que nous est ouverte la connaissance du droit hindou. Un seul point a été perdu de vue: la dissemblance existant entre le droit de succession des enfants sous puissance (sui heredes) et celui des autres parents. Les premiers deviennent héritiers qu’ils le veuillent ou non, ipso jure (heredes necessarii), les autres ne le deviennent que par leur volonté, par l’adition de l’hérédité (heredes extranei). La règle s’explique par l’obligation du sacrifice funéraire imposé d’après le droit aryen aux seuls enfants; ils ne pouvaient la décliner; en ce sens ils étaient heredes necessarii, et ce seul trait accuse toute la physionomie particulière de leur droit héréditaire. Chez les Aryas, l’obligation du sacrifice funéraire ne passait point avec la succession aux collatéraux, c’est ce que prouve l’effroi ressenti par l’Aryas à l’idée de mourir sans enfants tenus de lui faire des sacrifices funéraires et l’usage de l’adoption pour remédier à leur absence. Dans le transfert admis par le droit romain de l’obligation du sacrifice funéraire aux héritiers sans distinction, légaux et testamentaires, nous ne pouvons donc voir qu’une disposition du jus pontificium. L’autorisation concédée plus tard aux enfants de répudier la succession paternelle est une rupture complète avec le passé ; le droit dispensa les enfants de l’obligation de faire les sacrifices funéraires. Cette évolution appartient au même courant d’idées que la coemtio fiduciae causa sacrorum interimendorum causa .
Au sacrifice funéraire se rattache également la différence d’aspect du droit de succession des enfants selon qu’il s’agit de leur père ou de leur mère; vis-à-vis de la mère ils étaient heredes extranei, vis-à-vis du père, necessarii. L’opinion dominante en trouve la raison dans la puissance sur les enfants appartenant au père seul à l’exclusion de la mère. Mais on ne peut apercevoir pourquoi une différence modifiant pendant la vie la position juridique des parents vis-à-vis des enfants devait influer encore, après la mort, sur leur succession. C’est parler inconsidérement que de répondre: puisque les enfants se trouvent du vivant du père sous sa puissance, ils doivent aussi après sa mort devenir nécessairement ses héritiers. Ici encore le sacrifice funéraire fournit l’explication; les enfants le devaient au père et non à la mère; en d’autres termes, en droit héréditaire ils étaient pour elle des heredes extranei, au même titre que les collatéraux, et ainsi s’explique le fait étrange que la succession au patrimoine de la mère était dans l’ancien droit civil rangée sur la même ligne que la succession des collatéraux.
Je ne puis accorder à l’institution aucune autre importance pour le droit privé (Comp. p. 77); tout ce que l’on nous en rapporte encore, p. ex. l’énigmatique detestatio sacrorum, concerne l’activité professionnelle des pontifes, ou sa forme extérieure qui est du domaine de l’archéologue . La configuration du droit de famille romain elle-même n’en a pas été influencée, et moins encore celle du droit patrimonial. Si l’obligation aux sacra s’éteint avec la sortie de la famille, cela a sa raison dans la constitution romaine de celle-ci, reposant sur l’idée de la puissance du père de famille; ce ne sont pas les sacra qui sont déterminants pour la constitution de la famille, c’est elle au contraire qui est déterminante pour les sacra. De là résulte également que la théorie romaine de la parenté ne peut être déduite de l’obligation aux sacra; ici encore la relation de causalité est exactement la même, ce rapport est déterminant pour les sacra, et non ceux-ci pour celui-là, sans compter que cette obligation n’existait absolument pas par rapport aux collatéraux et ne pouvait passer, par succession, à des personnes non parentes.
Quant au droit patrimonial je me réserve d’y revenir, je veux dire d’abord quelques mots de la connexion prétendue entre le sacrifice funéraire et l’organisation politique des Romains ainsi que le culte public des Dieux.
Il est exact de dire que dans l’organisation politique des Romains ainsi que dans le droit de l’époque la plus reculée la religion avait une importance dont rien dans le temps présent ne peut donner une idée . Mais l’assertion que pour la comprendre, nous ayons besoin de remonter au culte religieux des ancêtres est réfutée par l’exemple d’autres peuples où ce culte était entièrement inconnu, et chez lesquels la constitution théocratique donnait à la religion, sur l’organisme politique, une influence bien plus grande encore que chez les Romains. Du reste, l’on cherche en vain une preuve positive que précisément chez les Romains cette influence ait eu sa cause dans le culte des ancêtres. Même pour le culte religieux public où la corrélation avec le culte des ancêtres serait surtout facile à comprendre, on ne peut en trouver la trace, les divinités nationales des Romains n’ont rien de commun avec les lares et les pénates. C’est encore dans le culte de Vesta qu’il y a le plus de chance de pouvoir ramener le culte public des Dieux à l’origine indiquée. Le foyer, centre local et symbole de la communauté domestique, est en même temps l’autel sur lequel on sacrifie aux dieux lares; ce qu’il est pour la famille isolée, le foyer de Vesta l’est pour le peuple. Mais le sacrifice sur le foyer n’est pas un sacrifice funéraire; celui-ci — désigné par l’expression romaine parentalia — s’accomplit sur les tombes et seulement à des jours déterminés; celui-là s’accomplit à la maison, sans être attaché à des jours déterminés, et l’antithèse se reproduit également pour le peuple; au culte domestique correspond le culte public de Vesta, aux parentalia (sacra privata) correspondent les feralia (sacra popularia). La circonstance seule que les hommes étaient exclus du culte de Vesta et ne pouvaient pas même pénétrer dans le temple, que le sacrifice était offert à une divinité féminine par des personnes du sexe féminin, aurait déjà dû exclure l’idée d’un sacrifice funéraire incombant en première ligne aux descendants masculins envers les ascendants du même sexe, sans compter que celui qui en est l’objet doit être mort.
Nulle part l’imagination de FUSTEL DE COULANGES ne l’a entraîné aussi loin qu’en matière de droit patrimonial. Il a découvert que le caractère religieux du foyer implique nécessairement la propriété privée du sol à Rome. Le foyer est l’autel des dieux domestiques, le dieu domestique prend possession du sol et le donne aux siens (p. 70), d’où résulte directement que la communauté du sol est inadmissible (p. 72). Une fois établi, et abstraction faite de nécessités extrêmes, le foyer ne peut plus être déplacé, les Dieux exigent un siège particulier, et un foyer permanent (p. 69), or cela n’est possible que dans la maison de pierre (p. 72). Ce n’est pas à l’individu qu’appartenait la maison et le foyer, mais au Dieu domestique; l’individu n’en a que la garde, ils sont pour toujours inséparablement unis avec la famille (p. 81). Si la propriété privée se fondait sur le droit résultant du travail, l’homme pourrait s’en dessaisir; mais elle est fondée sur la religion, et c’est pourquoi il ne le peut (p. 81). Sans doute les Romains ont autorisé l’aliénation de la propriété foncière, mais il fallait pour cela un acte religieux (mancipatio], avec la coopération d’un prêtre (libripens). Laissons l’auteur célébrer lui-même l’importance de cette découverte: «Sans discussion, sans travail,
«sans l’ombre d’une hésitation, l’homme arriva d’un seul
«coup et par la vertu de ses seules croyances à la conception
«du droit de propriété (p. 77); supprimez la propriété, le
«foyer sera errant, les familles se mêleront, les morts seront
«abandonnés et sans culte (p. 76).»
Voilà, en effet, la genèse la plus simple de la propriété du sol; le droit que s’arrogeait la divinité domestique l’établissait irrésistiblement. Par malheur l’histoire la réfute d’un bout à l’autre. La notion de la propriété privée du sol était entièrement inconnue de l’Aryas; il ne connaissait que la propriété commune (p. 27), et quant à la maison de pierre exigée par le Dieu domestique, il l’ignorait; les Germains mêmes, si longtemps après, ne la connaissaient pas davantage, pas plus que la propriété foncière. La maison était chose mobile, on la démontait et la plaçait là où le pâtre le jugeait nécessaire pour mieux surveiller et nourrir ses troupeaux. Cela créait précisément ce qui d’après FUSTEL DE COULANGES devait contenir la dissolution de tous les liens de famille: le foyer errant. Lorsqu’il en conclut que «les morts seront abandonnés et sans culte», le peu de fondement de cette conclusion saute aux yeux. Qu’y avait-il donc de commun entre le déplacement du foyer et le sacrifice funéraire? Les offrandes mortuaires étaient apportées au tombeau et celui-ci restait toujours à la même place, l’homme pouvait élever son foyer où il le voulait. Cette conclusion ne serait juste que si les Aryas avaient inhumé leurs morts sous leur foyer et je pense qu’ils ont très bien su pourquoi cela ne pouvait se faire, bien vite ils auraient été mis en fuite par leurs dieux domestiques! Ici revient de nouveau cette confusion du culte du foyer ou des mânes domestiques avec le sacrifice funéraire qui est le culte des mânes au tombeau, dont j’ai déjà parlé en passant.
L’auteur cité n’a pas porté ses regards sur la migration des Aryas. Que devenaient le foyer et le sacrifice funéraire lorsque le peuple se mettait en route? Que chaque famille ait traîné après elle son foyer de pierres, l’autel de son dieu domestique, chacun peut en penser ce qu’il veut, moi je ne le crois point; mais il est évident qu’ils devaient délaisser les tombeaux des défunts et le spectre des morts abandonnés sans culte devient ainsi une pure réalité. La même nécessité de laisser à l’abandon les tombes des morts se renouvelait à chaque départ pendant la période de migration. Le peuple aurait dû renoncer à émigrer et à migrer, s’il n’avait point voulu se séparer des tombes des défunts. Les émigrants partaient en faisant un dernier sacrifice sur les tombes des leurs, avant de se mettre en route; le départ avait lieu au commencement de mars, le dernier sacrifice dans les derniers jours de février (§ 38). Pendant la migration, lorsqu’il fallait passer un fleuve on se dispensait même d’inhumer les morts: les vieillards, dans l’occurrence, étaient précipités du haut du pont comme tribut à la divinité fluviale (§ 49).
Ce que notre auteur a trouvé de plus édifiant pour le romaniste, dans son inflexible poursuite des conséquences quand même, est peut-être l’élévation de la prosaïque mancipatio au rang d’acte religieux et de l’honnête libripens au rang de prêtre. La propriété du sol appartient au Dieu domestique; l’aliénation, lorsqu’elle est possible, ne donc peut se faire que dans des formes religieuses. Il oublie absolument que les mêmes rites sont observés pour la mancipation de toutes les autres res mancipi, et même dans le nexum. Les bœufs et les ânes recevant la bénédiction du prêtre lorsqu’ils passent d’une main dans une autre, le prêtre intervenant pour donner une consécration religieuse au contrat usuraire de l’Aryas — en faut-il davantage pour exclure toute idée de rattacher le rituel de la mancipation à la religion? Quel n’aurait pas dû être le nombre des prêtres — et l’on sait qu’ils étaient très peu nombreux — s’ils avaient dû exercer les fonctions du libripens dans toute mancipation et dans tout nexum.
En somme, de tout ce qu’avance l’auteur cité, rien n’est vrai. La signification du sacrifice funéraire aryen pour les Romains gît toute entière dans les sacra popularia et privata exactement estimés à leur juste valeur par la science moderne.
Je termine ici mes explications sur le droit de famille aryen, pour m’occuper du droit patrimonial.