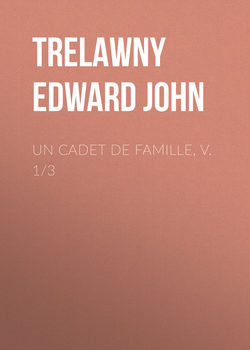Читать книгу Un Cadet de Famille, v. 1/3 - Trelawny Edward John - Страница 2
I
ОглавлениеMa naissance est mon premier malheur. Je suis venu au monde dénoncé comme un vagabond, quoique je fusse le cadet d'une famille fière de son antiquité. Dans une telle maison, mon inopportune arrivée fut à peu près accueillie comme celle des jeunes loups, sur la tête desquels le bon roi Edgard avait mis un prix, à l'époque de l'invasion de ces animaux, qui infestèrent de leur désolante présence les années de son règne.
Mon grand-père était général. À sa mort, il ne laissa à l'auteur de mes jours, son fils unique, qu'un nom sans tache et des protections dans la carrière qu'il avait parcourue. La nature avait été plus généreuse à l'égard de mon père, en lui prodiguant toutes les qualités extérieures qui mènent à la fortune plus promptement encore que le travail, le courage et la vertu. Il était jeune, beau, spirituel, et avait des manières gracieuses, simples et distinguées. La jeunesse de mon père ne se signala par aucun fait remarquable; il menait la vie aventureuse et galante des jeunes gens de l'époque. Le vin, les femmes, la cour et le camp formaient le théâtre de ses exploits, mais il jouait parfaitement son rôle.
À l'âge de vingt-quatre ans, il devint amoureux d'une douce et charmante jeune fille. Ses pensées prirent alors une nouvelle direction, et en apportant un peu de régularité dans le désordre de sa vie, elles calmèrent l'effervescence de son goût effréné pour les plaisirs.
Mon père découvrit bientôt que la jeune fille partageait son amour (car il était savant dans l'étude des sentiments du cœur), que le seul obstacle qui s'opposait à leur union était la fortune. Leurs familles, non leurs espérances d'avenir, se trouvaient égales: car la jeune fille était pauvre, et l'ambition de mon père aurait pu, en dirigeant sa conduite, le faire arriver à une brillante fortune. Mais la jeunesse et l'amour ne calculent pas, et l'argent, les contrats, les douaires, sont des mots dont ils n'apprécient nullement la valeur; puis, lorsque ce sentiment se révèle pour la première fois, il est trop sincère, trop vif, trop passionné pour être retenu par l'intérêt personnel. Intérêt sordide, qui, à une certaine époque de la vie, se trouve si bien mélangé à tous les sentiments, qui les fait naître et mourir à l'aide d'un chiffre. Des passions nobles et généreuses, animées par le premier amour, impriment souvent sur le caractère incertain et irrésolu de la jeunesse une stabilité que le temps ne peut pas tout à fait détruire. Plût au ciel que mon père eût uni sa destinée à celle de cette charmante femme, car son mérite et sa constance ont résisté aux épreuves du temps et de ses vicissitudes!
Pendant que mon père essayait de vaincre les difficultés matérielles qui s'opposaient à son mariage, il lui fut soudainement ordonné de partir pour l'Ouest avec son régiment.
Pensant que leur séparation ne serait que momentanée, les deux jeunes gens se dirent adieu, comme tous ceux qui se trouvent dans la même situation, avec des larmes et des serments de fidélité éternelle; et quoique mon père fût un soldat joyeux et galant, il s'éloigna avec l'accablement du regret, et fit honneur à ses promesses pendant trois mois entiers.
Pour célébrer sa nouvelle dignité, le shérif du comté où mon père était en garnison donna un bal à ses administrés.
Mon père y fut invité, ainsi que les premiers officiers de son grade, car il était capitaine.
Les honneurs de la soirée étaient faits par la fille du riche gentleman. Celle-ci était le bonheur, l'idole et l'unique héritière de son père. À l'ouverture du bal, le shérif engagea sa fille à choisir pour cavalier l'homme le plus haut placé dans le monde par ses distinctions sociales: la jeune personne répondit qu'elle n'accorderait cette faveur qu'au plus charmant, et tendit la main à mon père. Cette flatteuse préférence enivra l'orgueilleux capitaine, car elle attira sur lui l'attention générale, et le brillant officier fut dès ce moment le sujet de toutes les causeries. Dès lors une modification complète s'opéra dans les idées de mon père, et lui fit concevoir des désirs que, sans cet événement, il n'eût jamais soupçonnés.
La fille du shérif avait vingt-huit ans, les traits prononcés, la tournure sans grâce. Ses gestes, ses allures et le son de sa voix avaient quelque chose de masculin et de peu agréable; mais elle était riche, et en parant ses imperfections des splendeurs de la fortune, elle les rendait intéressantes.
Naturellement, ou par l'exemple du monde, mon père était très-égoïste. Son ambition, prenant un nouveau point de départ, lui fit abandonner le chemin de l'amour et considérer la richesse et la beauté comme des dons semblables. Les constantes attentions de l'héritière, en élevant mon père au-dessus de ses rivaux, lui donnèrent encore le désir de les vaincre complétement par l'éclat d'une triomphante victoire, et ceux dont il avait autrefois envié le sort devinrent alors jaloux de lui.
Ce dernier succès fut le voile sous lequel disparurent les vivants souvenirs de sa première affection; car son premier amour passa bientôt dans son esprit à l'état de folie de jeunesse. L'or devint son unique idole, car il avait cruellement ressenti les humiliantes souffrances de la pauvreté. Il prit donc la résolution de sacrifier son cœur au dieu de la fortune, et n'attendit plus qu'un instant favorable pour dévoiler son apostasie envers l'amour. Il appelait sa conduite prudence, sagesse, nécessité, essayant ainsi d'en dissimuler le cruel et froid égoïsme. Ses lettres à l'aimante jeune fille si lâchement trahie devinrent moins longues, moins expansives, moins tendres; l'intervalle entre chaque jour de cette correspondance fut d'une interminable longueur; puis enfin elle cessa tout à fait, et la pauvre enfant fut entièrement convaincue de son abandon. Elle pleura ses illusions, son bonheur et sa jeunesse à jamais flétrie par d'inconsolables regrets; car la malheureuse fille resta fidèle aux serments violés par le trompeur oublieux.
Mon père consacra donc tous ses loisirs à sa nouvelle conquête, et finit par lui donner son nom. Mais pourquoi nous arrêter ainsi sur un événement si commun dans le monde? N'arrive-t-il pas journellement que nous jetons loin de nous la vertu et la beauté, pour prendre la laideur et la richesse, quoique ce soit le diable qui nous les donne?
Une fois initié aux affaires embrouillées du shérif, mon père découvrit que la fortune de sa femme était des plus médiocres. Désespéré de s'être si aveuglément laissé éblouir par les luxueuses apparences d'une fausse splendeur, il rentra au régiment avec la conscience peu satisfaisante d'avoir mérité sa punition. Non-seulement par l'excès des exigences de la dame, mais encore pour continuer la parade de son élévation, il dépensa en bals et en festins une bonne partie de la dot, et six mois après mon père quittait l'armée sous le faux prétexte d'une maladie de poitrine, mais véritablement pour se retirer à la campagne et y végéter, en attendant mieux, dans les privations d'une tardive et sévère économie.
Le savant Malthus n'avait pas encore éclairé le monde, et chaque année mon père enregistrait à contre cœur dans la Bible de la famille la naissance d'un fardeau vivant. Des dépenses inévitables le fatiguèrent tellement, qu'il s'attrista et perdit le courage de tâcher d'y pourvoir. Sur ces malheureuses entrefaites, un legs lui fut laissé, et, en relevant son affaiblissement moral, cette bonne fortune augmenta, s'il était possible, son système d'économie et ses désirs d'amasser de l'argent.
Cette avare occupation devint alors l'unique emploi de son temps; il y concentra toutes ses facultés, et fut enfin ce que l'on appelle un homme prudent. Si un pauvre parent se hasardait à venir demander à mon père l'appui d'un secours, il lui était refusé au milieu de phrases sonores qui élevaient au-dessus de toute considération les devoirs qu'il avait à remplir envers sa femme, et les nécessités sans cesse renaissantes d'un essaim d'enfants dont le chiffre n'était pas encore arrêté.
Plus la fortune de mon père prenait d'accroissement, et plus il s'entourait des apparences de la misère, plus il criait contre le prix déraisonnable de toutes les denrées. Son avarice, en ne se relâchant jamais que pour lui-même, mettait dans sa tête des idées absurdes. D'abord il se persuadait et essayait de persuader aux autres qu'il était au-dessus de ses moyens de nous envoyer en pension, parce que l'éducation coûtait bien au delà de sa valeur; il partait de là pour prouver encore que ses études à Westminster ne lui avaient été ni utiles ni agréables, et n'avaient apporté aucun changement à la direction de sa vie, puisqu'il n'avait point relu les livres grecs et latins qu'il avait été forcé d'y apprendre.
Cependant, disait-il, je ne suis ni plus sot ni plus ignorant qu'un autre: tout ce que l'on doit savoir, c'est la valeur de l'argent, les avantages qu'il procure et la nécessité d'en amasser beaucoup; la science vient quand on en a besoin. Car il croyait peut-être à la doctrine du talent inné, en trouvant qu'il n'était nécessaire de s'instruire qu'au moment de faire le choix d'une profession. Comme il me destinait, ainsi que mon frère, à celle des armes, nos études devaient se borner à la plus légère superficie de toutes les sciences. Mon père détestait les superflus onéreux; d'ailleurs il avait observé dans son régiment que ceux qui étaient instruits étaient les plus niais et les plus pédants, et que la profondeur de leur érudition ne les avançait pas d'une ligne dans la carrière militaire.