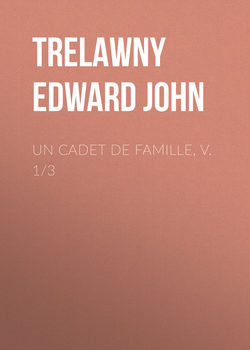Читать книгу Un Cadet de Famille, v. 1/3 - Trelawny Edward John - Страница 4
III
ОглавлениеD'après le règlement établi dans notre famille par les convictions de mon père sur l'inutilité de l'enseignement précoce, on nous laissa jusqu'à l'âge de dix ans sans nous apprendre à lire.
J'étais à cette époque d'une taille élancée, grand, maigre, gauche dans tous mes mouvements, surtout en présence de mon terrible père.
En me voyant si rapidement atteindre la stature d'un adolescent, ma famille commença à entrevoir la nécessité de me mettre au collége, et on s'occupa journellement à discuter l'instant précis de ce départ et du choix à faire de la maison d'enseignement.
Comme mes parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la solution de ces importantes affaires, elles traînèrent en longueur, et ne se seraient peut-être jamais résolues si un événement puéril, et même trivial, n'était venu couper court à toutes leurs discussions.
La fatigante oisiveté qui absorbait lentement les longues heures du jour, en laissant mon esprit occupé à la recherche des distractions, me conduisait naturellement à mal faire, et cela parce que je ne savais que faire.
Un jour donc, excédé d'ennui et de désœuvrement, j'entrai au jardin, malgré la défense que nous avions reçue de ne jamais y reparaître, éternelle expiation de la mort du corbeau. Mon frère m'avait suivi. Je grimpai lestement sur un pommier, et nous nous amusâmes, moi à lui jeter des pommes, lui à riposter à mes agaceries par la dégringolade de celles qu'il atteignait avec des projectiles. Au milieu de l'animation d'un plaisir qui provoquait nos éclats de rire, nous fûmes violemment interrompus par cette foudroyante exclamation:
– Ah! les voleurs!
C'était la voix de mon père.
James voulut s'enfuir, mais, pris par l'oreille, il fut contraint d'attendre que mon père m'eût jeté en bas de l'arbre. Lorsque nous nous trouvâmes tous deux en sa possession, il nous dit d'un ton furieux:
– Suivez-moi, brigands!
Je m'attendais aux inévitables coups de canne dont mon père gratifiait si généreusement nos épaules pour la moindre faute; mais il passa devant la maison sans s'y arrêter, traversa la route et se dirigea vers la ville.
Nous marchâmes ainsi pendant une heure et sans échanger la moindre parole. Moi, je suivis mon père d'un air bourru, tandis que le pauvre James, ivre de peur, trébuchait à chaque pas, et, sans ma main qui saisit la sienne, il serait infailliblement tombé de faiblesse et d'épouvante.
Arrivés à l'extrémité de la ville, mon père questionna un marchand assis devant sa porte, et d'après la réponse qui lui fut faite, il se dirigea d'un air superbe vers un sombre édifice entouré de hautes murailles. Nous suivîmes automatiquement notre majestueux conducteur dans un long passage, au bout duquel se trouvait une porte massive, lourde et chargée de serrures comme celle d'une prison. Mon père frappa, le domestique qui ouvrit nous fit traverser d'abord une immense salle remplie d'ombre et d'une atmosphère glaciale, puis enfin il nous laissa dans un petit parloir sévèrement et tristement meublé de quelques chaises.
Après dix minutes d'une silencieuse attente, minutes dont l'anxieuse longueur me parut éternelle, un petit homme parut. La tête de cet homme, renversée en arrière, soit dans le dessein de relever par la fierté de cette pose la médiocre apparence de sa frêle personne, soit par l'habitude de regarder du haut en bas son interlocuteur en le toisant comme une bête de somme, donnait à sa physionomie, à demi cachée sous de grandes lunettes bleues, quelque chose de faux, de lâche et de servilement bas. Les grandes boucles d'argent qui reluisaient sur ses souliers, le col étroit qui emprisonnait son cou comme un carcan de fer, ajoutaient à la première impression produite par son aspect un air précis, froid et terriblement méthodique pour l'imagination d'un enfant.
Le regard rapide de ses yeux de faucon, sous ses lunettes relevées, tomba d'abord sur mon père, et, quand il nous eut également examinés, il comprit sans doute le but de notre visite, car il avança une chaise à mon père, et d'un signe brusque et impératif il nous engagea tous deux à nous asseoir.
– Monsieur, dit mon père après avoir répondu à la profonde salutation du petit homme, vous êtes, je crois, monsieur Sayers?
– Oui, monsieur.
– Pouvez-vous disposer de deux places dans votre pension?
– Certainement, monsieur.
– Eh bien! répliqua mon père, maintenant, monsieur, voulez-vous vous charger de ces indomptables vagabonds qui me rendent fort malheureux, car il m'est impossible d'en obtenir respect et obéissance? Celui-ci, continua mon père en me désignant, fait plus de mal, cause plus de tourments et de discorde dans ma maison que ne le font ici, bien certainement, vos soixante pensionnaires.
En entendant ces paroles, le pédagogue remit ses lunettes sur le bout pointu de son nez, et me regarda en dessous. Ses deux mains se joignirent comme rapprochées par l'étreinte d'un bouleau correcteur, et il jeta à mon père un coup d'œil oblique.
– Ce mauvais garçon, ajouta mon père, qui comprit l'éloquente réponse de son interlocuteur, a un naturel féroce, sauvage; je le crois incorrigible.
Un petit ricanement déplissa les lèvres froncées du maître.
– Incorrigible! s'écria-t-il en faisant un pas vers moi.
– Oui, et tout à fait. Il montera un jour sur l'échafaud si vous ne fouettez énergiquement le diable qu'il a dans le corps. Je l'ai vu commettre ce matin un acte de déloyauté, d'insubordination, de félonie, pour lequel il mérite la corde. Mais je me contente de satisfaire ma juste fureur par son exil, et c'est, je vous assure, trop d'indulgence. Mon fils aîné, que voici, est déjà gâté par les insinuations de ce vaurien, dont il a eu la faiblesse de se faire le complice. Cependant il y a plus à espérer de sa nature, qui est douce, tranquille, et que le travail polira complétement.
Quand mon père eut enfin achevé la longue énumération de nos crimes, dont je supprime les trois quarts, il prit avec M. Sayers les arrangements indispensables, nous recommanda encore chaleureusement à toutes les rigueurs de sa domination et sortit du parloir sans même nous regarder.
Je souffris mortellement de cet insensible abandon, et je restai bouche béante, immobile, terrifié, ne comprenant que trop la cruauté de la conduite de mon père, qui nous arrachait sans commisération du lieu de notre enfance, des bras de notre mère, dont il ne nous avait même pas été permis de rencontrer le regard. Cet exil, ce pouvoir étranger, cette maison à l'extérieur horrible, me causaient une si vive impression, que je ne m'aperçus pas que j'étais poussé par M. Sayers dans une vaste et triste cour, au milieu d'une quarantaine d'enfants. En les voyant tous, grands et petits, se grouper autour de moi, en entendant leurs questions déplacées, leurs rires moqueurs, je repris mes sens, et je souhaitai de toutes les puissances de mon âme que la terre s'entr'ouvrît pour me dérober à leur insolente inspection et à la misérable existence qui m'était promise.
Le cœur gonflé par les larmes que je n'osais répandre, je demandai intérieurement au ciel, avec une énergie bien au-dessus de mon âge, la fin de ma vie, et je venais d'atteindre à peine ma neuvième année!
Eh bien! si à cette époque il m'eût été permis d'apercevoir l'avenir qui m'attendait, je me serais brisé la cervelle contre le mur auquel je m'appuyai, morne, stupide de chagrin, sans voix et sans regard.
Le caractère tranquille et doux de mon frère le rendait capable de supporter patiemment sa destinée; mais sa figure pâle et triste, mais l'imperceptible tremblement de ses mains, la lourdeur de ses paupières, la faiblesse de sa voix, montraient que, si nos souffrances étaient dissemblables dans l'expression, elles avaient la même force et nous oppressaient également le cœur. Quoique je me sois constamment trouvé malheureux pendant mes deux années de collége, les douleurs qui marquèrent le premier jour de mon installation se sont plus fortement encore que les autres gravées dans mon souvenir. Je me rappelle que le soir, au souper, il me fut impossible de porter jusqu'à mes lèvres, tremblantes de fièvre, l'immonde nourriture qui nous fut servie en portions d'une cruelle mesquinerie.
Je ne trouvai un peu de soulagement que dans le misérable grabat qui me fut assigné loin de mon frère, car déjà on nous séparait.
Lorsque les lumières furent éteintes, et que les ronflements de mes nouveaux camarades m'eurent laissé en pleine liberté, je me pris à pleurer amèrement, et mon oreiller se mouilla de mes larmes. Si le frôlement d'une couverture ou la respiration d'un dormeur éveillé troublait le silence, j'étouffais vivement le bruit de mes sanglots; et la nuit s'écoula dans l'épanchement de cette surabondante douleur.
Je m'endormis vers le matin; mais cette heure de repos fut courte, car au point du jour on m'éveilla brusquement, et sitôt habillé il fallut descendre dans les salles d'étude.
Les enfants élevés sous l'oppression brutale, cruelle et absolue d'un maître sans cœur, perdent complétement les bons instincts qui gisent au fond des natures en apparence les plus mauvaises. La brutalité leur révèle leurs forces, les décuple pour le mal, en comprimant les efforts généreux qu'elles pourraient leur faire entreprendre si elles étaient doucement dirigées vers le bien. Mais la parole sans réplique d'une volonté supérieure par ordre, et non par mérite, mais la froide cruauté des punitions, souvent injustes, en aigrissant le caractère à peine formé d'un enfant, étouffe ses bonnes dispositions, en donnant naissance à la ruse, à l'égoïsme et au mensonge, car ce sont alors les seuls moyens de défense qu'il puisse opposer à d'indignes traitements.
Après le sonore appel de la cloche qui nous réunissait dans la salle, le professeur parut, sa férule à la main. C'était encore, comme le maître de la maison, un pédagogue du vieux temps, à l'air dur, à la physionomie froide, revêche, ennuyée. Il avait aussi une croyance absolue dans l'efficacité des coups, et la prouvait continuellement en les employant dans toutes les circonstances où la sagesse de l'élève paraissait douteuse. Cette pension, dans laquelle on n'entendait depuis le matin jusqu'au soir que des cris, des pleurs, des murmures de rébellion et des sanglots d'épouvante, ressemblait bien plus à une maison de correction qu'à une académie de sciences; et quand je songeais aux recommandations qu'avait faites mon père de ne point m'épargner la verge, je sentais dans tout mon corps un vif tressaillement, et mon cœur palpitait d'effroi.
Comme mon temps de pension a été, depuis le premier jusqu'au dernier jour, une horrible souffrance, je suis obligé d'en raconter les détails, non-seulement parce qu'elle a cruellement influé sur mon caractère, mais encore parce que ces rigueurs des maisons d'enseignement, quoique bien modérées aujourd'hui, sont cependant encore commises à la sourdine sur les enfants pauvres, ou qu'un motif de haine particulière livre à la tenace rancune d'un professeur.
Pour suivre à la lettre les ordres de mon père, on me fouettait tous les jours, et à toutes les heures une volée de coups de canne m'était administrée. Je m'étais habitué si bien à ces horribles traitements que j'y étais devenu insensible, et que les heureuses améliorations qu'ils apportèrent dans mon caractère furent de le rendre entêté, violent et fourbe.
Mon professeur proclama enfin que j'étais l'être le plus sot, le plus ignare et le plus incorrigible de la classe. Sa conduite à mon égard prouvait et motivait la vérité de ses paroles. Car ses plus terribles punitions ne faisaient naître en moi qu'un âcre ressentiment, sans même m'inspirer le désir de m'y soustraire par un peu d'obéissance. J'étais devenu non-seulement insensible aux coups, mais à la honte, mais à toutes les privations. Si mes maîtres se fussent adressés à mon cœur, si le sentiment de ma dégradation intellectuelle m'eût été représenté avec les images du désespoir que je pouvais répandre dans la vie de ma mère, mon esprit se fût plié à des ordres amicalement grondeurs; mais la bonté, la tendresse étaient bien inconnues à des êtres qui martyrisaient sans pitié un misérable enfant. Et, sous le joug du despotisme sauvage qui me courbait comme un esclave exécré, j'ajoutai à tous les mauvais instincts de ma nature, si indignement asservie, une obstination contre laquelle se brisaient toutes les volontés.
Je devins encore vindicatif, et, par d'injustes représailles, brutal et méchant envers mes camarades, sur lesquels je déchargeais ma colère… La peur me gagna non leur amitié, mais leur respect, et si je n'étais pas supérieur à tous par mon application ou mes progrès dans l'étude, je l'étais du moins par la force corporelle et par l'énergie de ma volonté. J'appris ainsi ma première leçon, de la nécessité de savoir se défendre et ne compter que sur soi-même. À cette rigide école mon esprit gagna une force d'indépendance que rien ne put ni comprimer ni affaiblir. Je grandissais en courage, en vigueur d'âme et de corps, dans mon étroite prison, comme grandit, malgré le vent destructeur des tempêtes, un pin sauvage dans la fente d'un rocher de granit.