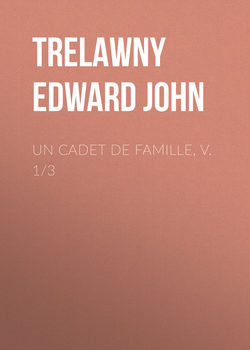Читать книгу Un Cadet de Famille, v. 1/3 - Trelawny Edward John - Страница 5
IV
ОглавлениеEn augmentant de vigueur, mes forces corporelles me rendirent adroit et leste dans tous les jeux et dans tous les exercices de la gymnastique. J'acquis en même temps la malice, la finesse et la rouerie d'un singe. Résolu à ne jamais rien apprendre, je réservais pour le plaisir toute la vivacité, toute la fougue de mon esprit; je dominais si entièrement mes camarades, qu'ils me choisirent pour chef dans tous leurs complots de rébellion. Lorsque je fus certain de l'ascendant que j'avais sur eux, je songeai à la possibilité de me venger de M. Sayers; mais, avant d'arriver à lui, je voulus essayer ma puissance sur le sous-maître. Après avoir fait un choix parmi les élèves les plus forts et les plus intrépides, je leur communiquai mon intention, à laquelle ils applaudirent avec des transports de joie et de reconnaissance.
Tout bien projeté, discuté, arrangé, nous attendîmes la première sortie.
Une fois par semaine, on nous faisait faire dans la campagne une longue promenade, et le pédagogue désigné pour être le support de notre colère était d'ordinaire le surveillant qui nous accompagnait.
Le jour de sortie arriva le surlendemain, à la grande satisfaction de notre impatience. Nous partîmes joyeusement pour la campagne, et le maître arrêta notre course sous l'ombre d'un grand bois de chênes et de noisetiers. Les élèves qui ignoraient le complot se dispersèrent dans le taillis, tandis que ceux qui étaient initiés à la préparation de la bastonnade attendirent le signal en armant leurs mains du bouleau vengeur. Le sous-maître s'était solitairement assis, un livre à la main, sous l'ombre d'un arbre. Nous approchâmes de lui en silence, et lorsque la position de la bande en révolte m'eut assuré la victoire, je sautai sur notre ennemi, que je maintins immobile en le saisissant par les bouts de sa cravate nouée en corde. Au cri d'effroi et au geste violent qu'il fit pour se dégager de ma furieuse étreinte, mes compagnons tombèrent les uns sur ses jambes, les autres sur ses bras, et nous réussîmes, après de prodigieux efforts, à le jeter sans défense sur le gazon. Nous eûmes alors l'indicible plaisir de lui rendre largement les coups que nous en avions reçus, entre autres un échantillon du fouet dont il garda longtemps le visible souvenir.
Je fus aussi insensible à ses cris, à ses prières et à ses plaintes, qu'il l'avait été aux sanglots de mes souffrances et je laissai à demi mort de rage, de honte, d'indignation et de douleur.
À notre retour au collége, notre maître et pasteur (car M. Sayers était ecclésiastique) resta stupéfait en entendant la narration de notre conduite: il commença à comprendre jusqu'à quel point nous étions irrités contre les règlements de sa maison, et de quels emportements la colère nous rendait capables. L'idée terrible que le sous-maître lui donna de ma violence éveilla la crainte que la sainteté de sa vocation et de sa robe sacerdotale ne fût pas plus respectée que ne l'avait été le grade de premier maître d'étude. M. Sayers comprit qu'ayant une fois goûté les douceurs de la victoire, nous serions assez présomptueux pour refuser nettement d'obéir à ses ordres, que le mauvais exemple de ma rébellion et mon influence pernicieuse, en encourageant les élèves dans l'indiscipline, nuiraient à son autorité, qui deviendrait alors de jour en jour plus faible et plus chimérique.
Ce châtiment si durement infligé au professeur confondit son esprit en lui ouvrant les yeux sur la nécessité de prendre, pour préserver l'avenir, des mesures fermes et décisives: il lui conseilla de faire un exemple en me punissant sévèrement avant que je devinsse assez audacieux pour comploter quelque méchanceté contre lui. Sa prévoyance et ses précautions étaient trop tardives.
À la classe du soir, le lendemain, M. Sayers entra, et s'assit sur l'estrade à la place du maître. Quand il eut promené sur nous son œil de faucon, redressé ses lunettes, il m'appela d'une voix dure. Comme de jeunes chevaux qui viennent d'apprendre tout nouvellement leur force et leur pouvoir, les élèves bondissaient sur leurs siéges, et les énergiques soufflets appliqués par les professeurs n'arrêtaient pas leur turbulente agitation. J'escaladai mon banc, et je parus devant M. Sayers, non pas comme autrefois, pâle, tremblant, mais le regard hautain, le pied ferme, le front calme, et, par moquerie de la tenue de mon juge, audacieusement renversé en arrière. L'air sévère du prêtre ne me fit pas rougir. Mon œil se fixa hardiment sur le sien, et j'attendis son accusation avec arrogance.
Après avoir froidement écouté le récit de ma faute, je répondis en énumérant les griefs que j'avais à venger, et je plaidai, non pas ma cause, mais celle de mes camarades. Sans attendre la fin de ma défense, M. Sayers me frappa à la figure, et cela si violemment, que mes dents s'entrechoquèrent. Je devins furieux, et par un effort soudain, plutôt irréfléchi que calculé, je saisis le féroce directeur par les jambes, je le renversai en arrière, et il tomba lourdement sur la tête. Les professeurs accoururent à son secours, mais les élèves ne firent pas un geste; ils ricanaient entre eux, attendant avec anxiété le résultat de ma brusque revanche. Peu désireux d'être saisi par le sous-maître déjà bâtonné, qui, entre la peur que je lui inspirais et ses devoirs envers son chef, demeurait irrésolu, je m'élançai hors de la classe.
J'avais pris depuis longtemps la détermination de quitter le collége; l'invincible effroi que m'inspirait mon père avait toujours mis un sérieux obstacle à ce projet. Mais en me promenant dans la cour du pensionnat, je résolus de ne jamais y remettre les pieds, et de m'évader le soir même. Depuis deux ans que duraient mes souffrances, elles avaient tellement accablé ma patience, qu'il était impossible de songer à la mettre plus longtemps à l'épreuve. J'étais désespéré, et par conséquent sans espoir de résignation et sans peur de personne.
Vers la nuit tombante, je reçus l'ordre par un domestique de rentrer dans la maison; l'impossibilité d'un départ subit me contraignait forcément à l'obéissance, et, après quelques minutes d'hésitation, je le suivis sans réplique.
Un des professeurs m'enferma sans mot dire dans une chambre élevée de la maison, et, à l'heure du souper, on me donna un morceau de pain. C'était un pauvre repas, mais celui que nous faisions ordinairement n'était pas meilleur.
Le lendemain, je ne vis que la servante; elle m'apporta encore la maigre pitance du régime des prisonniers.
Le soir de ce même jour, on me laissa, sans doute par inadvertance, un bout de chandelle pour me coucher.
Une idée affreuse me vint à l'esprit; mais elle ne fut point dictée par un désir de vengeance: ce fut plutôt l'espoir de conquérir ma liberté.
Je pris cette chandelle, et j'enflammai les rideaux de mon lit: le feu se propagea rapidement, et sans même avoir la pensée de m'enfuir, je regardais les progrès avec un plaisir joyeux et enfantin.
Après avoir consumé les rideaux, le feu gagna le lit, la boiserie, les meubles, et la chambre devint le centre d'un violent incendie.
Je commençais à suffoquer de chaleur et d'étourdissement, car une épaisse fumée obscurcissait par intervalles la brillante clarté des flammes. Le domestique vint reprendre sa chandelle; à son entrée, le vent s'engouffra par la porte et augmenta rapidement l'intensité du feu.
– Georges, criai-je au domestique, dont la peur avait paralysé les mouvements, vous m'avez dit que, malgré le froid, je me passerais de feu; eh bien, j'en ai allumé un moi-même.
Le valet me prit sans doute pour un démon, car il s'enfuit en jetant des rugissements d'épouvante et d'alarme. On accourut; l'incendie fut rapidement éteint, mais il avait entièrement dévoré les meubles. Je fus transporté dans un autre appartement, et un homme resta toute la nuit pour me surveiller. Cette précaution me rendit extrêmement fier, et doubla, à mes yeux, la terrible crainte que j'inspirais. Cependant, lorsque j'entendais appeler mon action sacrilége, blasphème, frénésie, j'en restais un peu surpris, car je n'en comprenais pas le sens. On me laissa entièrement seul pendant toute la journée, et, à mon grand étonnement, je ne vis point mon révérend professeur; sans doute, il se ressentait encore de sa chute sur la tête. Mes maîtres défendirent expressément aux élèves de pénétrer jusqu'à moi, et cette recommandation se montra encore plus sévère à l'égard de mon frère, auquel on assura que j'étais un être maudit, et que mon contact serait sa perdition.
Le lendemain de cette mémorable journée, je fus reconduit sous bonne garde au domicile paternel. Fort heureusement pour mes épaules, mon père était absent, car une fortune imprévue et considérable venait de lui être léguée.
À son retour au logis, il feignit d'ignorer la cause de mon renvoi du collége; soit parce que son humeur morose s'était adoucie dans son enchantement d'hériter, soit par mesure politique; toujours est-il qu'il ne me parla nullement de mon aventure.
Un jour, en sortant de table, il dit à ma mère:
– Je crois, madame, que vous avez un peu d'influence sur l'indomptable caractère de votre fils. Donnez-lui vos soins, je vous prie, car je suis fermement résolu à ne jamais m'occuper de lui. S'il veut se conduire raisonnablement, gardez-le ici, sinon il faut songer à lui trouver un autre domicile. J'avais à cette époque à peu près onze ans.
Après une assez vive discussion sur le prix fabuleux qu'avaient coûté mes deux années de collége, mon père finit par conclure qu'il avait eu bien tort de sacrifier tant d'argent, parce qu'il eût été tout aussi bien de m'envoyer à l'école de la paroisse, à laquelle il était obligé de contribuer. Et pour connaître le bénéfice que cet onéreux déboursé de pension avait pu rapporter en savoir, il se tourna vers moi et me dit brusquement:
– Eh bien! monsieur, qu'avez-vous appris?
– Appris? répondis-je en hésitant, car je craignais les suites de sa question.
– Est-ce la manière de répondre à votre père, lourdaud? Parlez plus fort, et dites monsieur. Me prenez-vous pour un laquais? continua-t-il en élevant sa voix jusqu'à un rugissement.
Cette expression furibonde chassa de ma tête le peu de science que le maître m'avait enseignée avec des coups et des punitions abominables.
– Qu'avez-vous appris, canaille? redit mon père, que savez-vous, imbécile?
– Pas grand'chose, monsieur.
– Parlez-vous latin?
– Latin? monsieur, je ne sais pas le latin.
– Vous ne savez pas le latin, idiot? comment, vous ne le savez pas? mais je croyais que vos professeurs ne vous enseignaient que cela.
– Autre chose encore, monsieur, le calcul.
– Eh bien! quels progrès avez-vous faits en arithmétique?
– Je n'ai pas appris l'arithmétique, monsieur, mais le calcul et l'écriture.
Mon père avait l'air encore plus stupéfait que grave. Cependant, malgré l'étrangeté de ma réponse, il continua son interrogatoire.
– Pouvez-vous faire la règle de trois, sot que vous êtes?
– La règle de trois, monsieur?
– Connaissez-vous la soustraction, nigaud? répondez-moi: ôtez cinq de quinze, combien reste-t-il?
– Cinq et quinze, monsieur; et, comptant sur mes doigts, en oubliant le pouce, je dis: cela fait… dix-neuf.
– Comment, sot incorrigible, s'écria furieusement mon père, comment! Voyons, reprit-il avec un calme contraint, savez-vous votre table de multiplication?
– Quelle table, monsieur?
Mon père se tourna vers sa femme et lui dit:
– Votre fils est complétement idiot, madame; il est fort possible qu'il ne sache seulement pas son nom; écrivez votre nom, imbécile.
– Écrire, monsieur; je ne puis pas écrire avec cette plume, car ce n'est pas la mienne.
– Alors, épelez votre nom, ignorant, sauvage!
– Épeler, monsieur?
J'étais si étourdi, si confondu, que je déplaçai les voyelles.
Mon père se leva, exaspéré de colère; il renversa la table, et se meurtrit les jambes en essayant de me donner un coup de pied.
Mais j'évitai cette récompense de mon savoir en me précipitant hors de l'appartement.