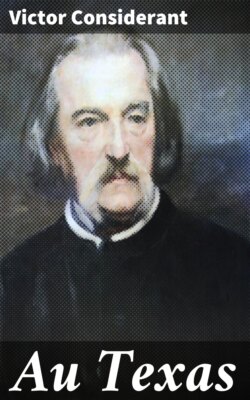Читать книгу Au Texas - Victor Considerant - Страница 13
IX
ОглавлениеNous primes congé, à Patriot, des derniers amis que nous dussions rencontrer sur notre route, n’emportant plus que nos selles et le strict équipage d’un voyage à cheval à travers les forêts et les prairies du Territoire indien et du Texas. gions des derniers rameaux de la chaine des Alléghanys; les rives s’abaissaient et nous atteignîmes enfin les plaines sans limite du bassin du Mississipi. Quels espaces! Nous avions laissé dernière nous, en quittant Patriot, le grand État de l’Ohio, longé à notre droite les États de l’Indiana, de l’Illinois, du Missouri, de l’Arkansas, et sur notre gauche ceux du Kentuki, du Tenessé et du Mississipi. Quels espaces, grand Dieu! et quel avenir n’est pas réservé, acquis, à celte grande Fédération qui les retourne, ces espaces, et les ensemence de villes, comme le laboureur retourne son champ et sème son grain, et où cette semence de cités florissantes lève et grandit d’un soleil à l’autre... Croissez et multipliez, États de l’Union! vous êtes déjà la grande patrie de la Démocratie, du travail, des éléments intégrants du monde moderne; vous serez bientôt, quoiqu’il arrive, le champ d’asile de ses idées les plus progressives et de leurs réalisations.
Nous allions jour et nuit, descendant à pleine vapeur le Mississipi, le père des eaux, ce fleuve de plus de mille lieues, dont l’aspect, à force de grandeur, reproduit l’impression d’infini que donne l’Océan. Nous étions enfermés entre le ciel bleu, les eaux gris de cendre du fleuve qui charrie sans cesse à la mer des flottes de grands arbres arrachés des berges de ses tributaires, et les deux remparts de verdure serrée, régulièrement étagée et massive, qui en flanquent, à perte de vue, sans interruption, les rives.–Nous atteignîmes enfin l’embouchure de l’Arkansas qu’il fallait maintenant remonter jusqu’à Little-Rock, au centre de l’État auquel cette rivière de900lieues a donné son nom. Nous y arrivâmes, saturés d’espace horizontal et heureux de revoir enfin un brin de rocher, premier signe d une région qui commence à sortir des eaux et à s’accidenter.
Nous devions, d’après les renseignements du capitaine Marcy, qui dataient d’un an à peine, acheter des chevaux à Little-Rock et, de là, gagner, à travers des terres à peu près vierges, Preston, dernier point habité du Texas sur la rivière Rouge. Nous apprîmes qu’une diligence faisait régulièrement déjà ce trajet trois fois par semaine! D’autre part, un bateau à vapeur chauffait pour remonter la rivière jusqu’au Fort Smith, extrême frontière des États civilisés, où l’Arkansas entre sur le Territoire indien. Jusqu’aux pieds des Rocheuses, le fleuve ne voit plus sur ses bords que des peuplades sauvages. Nous n’eûmes que le temps de délibérer un instant et de nous embarquer de nouveau.
La contrée s’élevait peu à peu sur nos rives. Des montagnes boisées surgissaient a1horizon. A Van Buren, où nous nous arrêtâmes quelques heures, nous rencontrions déjà des peaux rouges et examinions avec intérêt un groupe d’Osages, un des plus beaux échantillons des races indigènes, que nous dussions rencontrer. La civilisation finissait; l’Amérique indienne se rapprochait rapidement a chaque tour de roue; nous touchions à la phase où le voyage allait devenir une soi te d expédition. Enfin, ayant pris nos derniers renseignements et acheté des montures au Fort Smith, le19mai dans l’après-midi nous entrions, en traversant la rivière du Poteau, sur un bac en troncs d’arbres, dans le territoire des Choctaws. Le nom de cette rivière rappelle que des aventuriers français, amenés par la chasse, furent les premiers blancs qui parurent sur ses bords.
Il est impossible de franchir plus brusquement trois pé~ riodes sociales. A deux heures nous étions encore dans la riante cité qui s’élève au pied du Fort Smith: c’étaient des maisons blanches ou en briques roses, entourées de warandes toutes verdoyantes, séparées par des jardins en fleurs; des rues larges et parfaitement alignées; des magasins de toutes sortes; des dames en robe de mousseline; des enfants coquettement parés jouant avec leurs ombrelles; des avocats, des médecins, des orfèvres, des horlogers, etc., et trois ou quatre grands bateaux à vapeur à quai sur l’Arkansas: toute une civilisation jeune, alerte et prospère.–Moins de deux heures après, nos chevaux ne se dégageaient qu’avec de grandes difficultés des fanges, des branches mortes, des troncs d’arbres à demi pourris, à travers lesquels nous suivions péniblement une espèce de chemin dans la forêt primitive dont les voûtes épaisses nous faisaient une nuit anticipée sur le bottom (le fond) marécageux du Poteau. C’était la nature sauvage dans sa pureté; la solitude sombre, silencieuse, vierge, et ses âpres parfums; la végétation luxuriante et compacte des masses arborescentes et des lianes gigantesques qui étreignent les grands arbres et les entrelacent en réseaux inextricables; des générations végétales s’élevant, sans interruption de temps ni d’espace, sur les débris séculaires des générations mourantes, mortes, entassées. Nous étions seuls, et pour la première fois au sein de ces énergies indomptées de la nature naturante. C’était superbe!
Il était nuit close quand nous arrivâmes à Choctaws-Agency, village indien où nous soupâmes, servis par une négresse esclave, avec de la pâte de maïs fumante, des oignons crus et un plat noir que je pris d’abord, avec quelque surprise, pour des côtelettes ultra-grillées, et que nous reconnûmes bientôt être composé de morceaux de poisson parfaitement carbonisés au dehors, mais, en compensation, parfaitement crus au dedans. Azaïs n’eût rien eu à y objecter.
Nous n’avions rencontré, d’ailleurs, dans la forêt que quelques cochons demi-sauvages et trois cavaliers indiens, ivres de brandy. Jusqu’au voisinage de l’autre frontière de l’Indian-Territory, du côté du Texas, ce village était le seul que nous dussions trouver sur notre route. Il nous offrait une page de la grande histoire sociale, la difficile transition de Sauvagerie en Civilisation. L’esclavage en fait ici les frais. Le nègre esclave est l’éducateur des peaux rouges, qu’il initie à l’agriculture, aux industries élémentaires, et auxquels il enseigne le violon. Nous en entendîmes, çà et là, toute la soirée dans les log-houses (maisons en troncs d’arbres) du voisinage, des sons si étranges que, si on ne nous l’eût dit, je conviens que nous n’eussions jamais pu savoir de quel instrument cela pouvait sortir. Nous vîmes donc là l’esclavage à sa place historique dans le mouvement de la Subversion ascendante, et nous en reconnûmes la fonction. Ici encore je regrette de ne point vous entretenir de sujets très-intéressants pour nous tous au point de vue delà science; mais, pas plus que précédemment, je ne dois oublier mon but et ne veux m’arrêter en route. Un mot seulement sur un incident qui faillit nous faire rétrograder.
Partis le lendemain matin de Choctoews-Agency, nous atteignîmes de bonne heure l’habitation d’un Indien de sang mêlé, qui nous était indiquée comme une bonne station. Quoique la journée ne fut pas finie, nous dûmes nous y arrêter. Je me sentais non-seulement très-fatigué, mais vraiment indisposé. Je reconnus bientôt que j’avais une assez forte fièvre. La nuit fut mauvaise; la fièvre ne me quitta pas. Le lendemain, j’avais à peine la force de me lever et éprouvais une grande prostration. Trois cavaliers américains qui survinrent, nous apprirent qu’ils avaient rencontré des rivières gonflées par les orages, et dû les passer à la nage eux et leurs chevaux. J’avais entendu, au Nord, des histoires assez peu gaies sur les fièvres et les maladies des contrées du Sud-Ouest. Ces histoires me revinrent, et je voyais, assez naturellement, dans mon état, l’effet d’une action de ces influences, si puissante et si prompte, que je craignais d’être livré, sans résistance possible de ma constitution européenne, à une atmosphère ennemie. Je n’avais pas encore senti poindre en moi la moindre lueur d’une foi sérieuse au but social de notre voyage; rien ne me soutenait et j’éprouvai quelques heures de découragement moral aussi bien que d’abattement physique. Je me demandai s’il n’était pas absurde, par simple curiosité et par un puéril amour-propre, de poursuivre une entreprise qui débutait si mal. Je me voyais bientôt sérieusement entrepris parla maladie, ne pouvant plus avancer ni reculer, et privé de tout secours, dans quelque coin du désert: nous n’avions pas même un guide avec nous.
Heureusement Br. était bien portant; sa foi américaine réagit: il soupçonna que le changement brusque de régime et la fatigue du cheval, dont j’avais depuis vingt ans perdu toute habitude, pouvaient bien être les seules causes de mon état, et il me proposa l’essai d’une nouvelle étape en avant. Br. avait deviné juste. Le cheval agit, paraît-il, homéopathiquement; car, après ce repos de vingt-quatre heures, nous n’eûmes pas plutôt fait quelques milles que je me sentis remis. Le soir, nous soupâmes chez un Indien qui venait de tuer un dindon sauvage, dont trois ou quatre morceaux mangés avec appétit me rendirent toutes mes forces. Dès lors, je me trouvai parfaitement.–J’ai mentionné cet incident d’abord pour montrer que si l’on peut avoir à subir, au début d’un semblable changement de régime et de pays, une petite épreuve, il ne faut pas s’en exagérer l’importance; ensuite, parce qu’il me rappelle nettement à moi-même, qu’entré déjà sur le Territoire indien je n’avais encore aucune foi à l’utilité de cette expédition au point de vue de notre cause; et enfin parce qu’il marque l’époque où une transformation en quelque sorte subite était à la veille de se faire à ce sujet dans mon esprit.