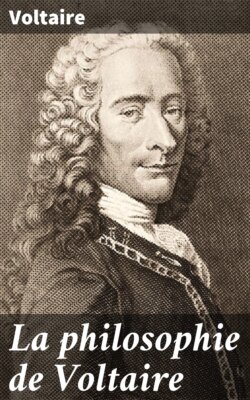Читать книгу La philosophie de Voltaire - Voltaire - Страница 5
II.
ОглавлениеIl est temps de pénétrer dans l’intérieur de la philosophie de Voltaire, et de l’interroger sur les grandes questions que pose obstinément l’esprit humain. Avant tout, que pensait-il de la perfection du monde? Croyait-il que tout est mal, par une injure envers la Providence, ou avait-il de plus consolantes convictions?
Il n’est pas ennemi de l’optimisme; mais de l’optimisme de Leibniz. Lorsque Leibniz prétend que ce monde est le meilleur des mondes possibles, Voltaire est d’accord avec lui, et avec tous ceux qui croient que Dieu existe. Évidemment, si Dieu a conçu un monde plus parfait, s’il pouvait le créer et ne l’a point créé, il a choisi le mauvais parti, il est imparfait, il n’est plus Dieu. C’est un raisonnement tout simple et tout géométrique, que Voltaire, en maint endroit, reconnaît excellent. Mais quand on a dit cela, tout n’est pas dit encore; on est optimiste comme le premier venu et non comme Leibniz. Dans cette grande religion du genre humain, il y a des sectes, et voici les questions d’où elles naissent. Ce monde, le meilleur par comparaison avec ceux qui pouvaient être, qu’est-il en lui-même? A-t-il ou non des défauts? S’il en a, sont-ils légers ou graves? Est-il bon pour l’ensemble des créatures, ou spécialement pour l’humanité, ou, plus spécialement encore, pour chaque homme? Est-il bon par l’heureux arrangement des événements particuliers, ou par la beauté des lois générales, ou par le dessein que ces lois exécutent? Parle-t-on enfin de la vie présente uniquement, ou de la vie future avec elle? L’optimisme est aussi divers que les réponses à ces problèmes. Voici celui de Leibniz: le monde, collection de toutes les existences passées, présentes et futures, enfermant la vie présente et la vie à venir, est, dans l’ensemble, le meilleur que Dieu pût créer. Les mondes possibles étaient en nombre infini, car les événements possibles et leurs combinaisons sont innombrables; parmi ces combinaisons Dieu a choisi celle qui recevait le plus de bien. Elle admet le mal, sans doute, mais comme condition inévitable d’un bien qui le surpasse; tout compté, tout rabattu, c’est encore là qu’il s’en rencontre le moins. De là, en toute circonstance, la nécessité pour Leibniz d’atténuer le mal, d’exagérer le bien, parfois des efforts désespérés pour faire rendre au mal le bien qu’il doit contenir; et aussi, lorsqu’il rencontrera quelque dogme où la bonté de Dieu semble compromise, il ne s’effraiera pas et se montrera facile à l’admettre, sauf à se rejeter sur les conséquences heureuses. Ne les voit-il pas, il est sûr qu’elles existent, et le voilà en repos. La faute heureuse d’Adam nous a valu le Rédempteur, felix culpa; les châtiments éternels et le petit nombre des élus l’inquiètent d’abord, mais il se rassure en songeant que ces événements entrent, de toute nécessité, dans le plan du meilleur des mondes. Arrivé là, on est tout près de les trouver conformes à la raison et à la justice; aussi il découvre des principes philosophiques qui justifient l’éternité des peines.
Tel est le danger de l’optimisme: après avoir trouvé ce beau principe, l’esprit cesse d’agir, ou, s’il agit encore, il se met à l’aise, et perd ces scrupules qui sauvent la vérité ; après ce brillant éclair, la raison s’endort, pour ne jeter plus qu’une lumière incertaine ou trompeuse. Ajoutez qu’une fois notre parti si bien pris de tout ce qui peut survenir, les misères de ce monde nous trouvent très-calmes; les excès des partis, le renversement de la justice, au lieu de nous frapper douloureusement, de nous irriter, de nous armer, nous laissent le cœur froid, la volonté inerte, et n’ont de contre-coup que dans notre raison inaltérable. L’optimisme de Leibniz risque donc d’engourdir et l’intelligence et la sensibilité. Il ne produit ces effets ni toujours ni partout entièrement; ils en sont une conséquence extrême, mais naturelle, et il est naturel aussi qu’on tente de les prévenir. Enfermé dans l’optimisme qui l’enchante, Leibniz n’entend pas les gémissements de l’humanité : ni cette plainte partie de l’Orient: «L’homme né de la femme vit peu de jours, tout pleins de misères»; ni ce soupir mélancolique de la riante Grèce: «Le mieux pour l’homme est de ne pas naître, et, quand il est né, c’est de mourir» ; ni enfin, tout près de lui, Bossuet qui remercie Dieu d’avoir mêlé une goutte de joie à la vie humaine, pour en tempérer l’amertume infinie. Il oublie les maladies de l’intelligence et de la liberté, tant d’erreurs, tant de doutes, la volonté se débattant entre l’ivresse des passions et l’impuissance. Et pourtant, c’est là l’homme éternellement.
Ce que Leibniz n’entend pas et ne voit pas, Voltaire le voit et l’entend: de là Candide. En un sens, c’est un livre diabolique; il semble voir l’Esprit du mal lui-même qui enveloppe les hommes dans un réseau inextricable de folies et de misères, et se rit de leur peine. La fin adoucit cette impression; après tant d’infortunes, les héros, ou si l’on veut, les victimes, trouvent un bonheur estimable dans la solitude et la médiocrité, cultivant en paix leur jardin. M. Cousin a dit: «Espérons que ce triste livre n’exprime qu’une opinion passagère, un de ces moments d’humeur qu’aura traversés Voltaire lorsqu’il errait, comme il le dit, dans le labyrinthe du problème de la liberté.» Il nous encourage à l’espérer, il ne l’affirme pas; on reconnaît là le tact du critique. En effet, c’est bien l’opinion constante de Voltaire sur la vie humaine (sa correspondance entière en fait foi), et l’impression qu’il a emportée de son long voyage dans le monde: «Après avoir bien réfléchi à soixante ans de sottises que j’ai vues et que j’ai faites, j’ai cru m’apercevoir que le monde n’est que le théâtre d’une petite guerre continuelle, ou cruelle, ou ridicule, et un ramas de vanité à faire mal au cœur... Les hommes sont tous Jean qui pleure et qui rit; mais combien y en a-t-il malheureusement qui sont Jean qui mord, Jean qui vole, Jean qui calomnie, Jean qui tue!... Il y a des aspects sous lesquels la nature humaine est la nature infernale. On sécherait d’horreur si on la regardait toujours par ces côtés.» Il peint d’abord le genre humain de profil dans la première édition de l’Histoire générale; dans une autre, de trois quarts; Candide le peint de face et en raccourci. C’est l’Enfer de Dante remonté sur la terre, Tartarus hic nobis est. Son expérience personnelle est là ; insulté par un grand seigneur, puis battu par ses valets, et contraint de dévorer cet affront, emprisonné à la Bastille pour des couplets qu’il n’avait pas faits, forcé d’abandonner la France, privé par la mort d’une ancienne et douce affection, éprouvant trois années près du roi de Prusse, et toute sa vie avec le duc de Richelieu et ses pareils, l’amitié difficile des grands, dupé par des fourbes, trahi par de lâches amis, calomnié et poursuivi sans cesse, il ne trouve le repos que sur la fin de ses jours à la campagne, parmi ses bœufs, qui lui font des mines. Disciple de Pythagore, dans la tempête, il adore l’écho. «Vive la campagne, ma chère nièce; vivent les terres et surtout les terres libres où l’on est chez soi maître absolu, et où l’on n’a point de vingtièmes à payer! C’est beaucoup d’être indépendant; mais d’avoir trouvé le secret de l’être en France, cela vaut mieux que d’avoir fait la Henriade.» «Le monde. est un grand naufrage; la devise des hommes est: sauve qui peut.» C’est bien là son dernier mot sur le monde, et le résumé de la sagesse humaine. Mais, une fois sauvé, que faire? Se réjouir, sans nul souci des malheureux que battent les vents contraires, et laisser aller les choses comme elles vont, content d’échapper à la fortune? Voltaire le dira: «J’en reviens toujours à Candide: il faut finir par cultiver son jardin; tout le reste, excepté l’amitié, est bien peu de chose; et encore, cultiver son jardin n’est pas grand’chose.» Ailleurs, c’est mieux encore: «Mon Dieu, que si j’ai de bon foin celte année, je serai heureux!» Ne croyez pas ses paroles, et croyez sa vie. Quoi qu’il en dise, la destinée de l’homme n’est pas de cultiver son jardin; il ne l’a jamais cru. La liberté l’a visité déjà vieux, mais non désarmé : Libertas quœ sera tamen respexit, sed non inermem. Pourquoi donc ces armes? Ce n’est déjà plus là Candide. Est-ce Candide encore qui envoie du pied des Alpes à Paris des fusées volantes qui crèvent sur la tète des sots? A quelle époque de sa vie Voltaire a-t-il été plus actif, plus audacieux, a-t-il remué plus fortement le monde qu’il avait déserté ? Mais, pour le remuer, il ne faut pas proclamer qu’on le remue, et le doux Candide ne sera jamais soupçonné.
L’étrange roman dont il est le héros est bien un portrait réduit de l’humanité, comme la voyait Voltaire; mais, qu’on ne l’oublie pas, c’est aussi un livre de polémique, armé en guerre contre l’optimisme de Leibniz, de Pope, de Shaftesbury et de Bolingbroke, principalement contre Leibniz, le premier et le plus grand, avec qui Voltaire avait bien d’autres querelles. Dans plus d’un écrit il combat l’optimisme par la raison, dans son poëme sur le désastre de Lisbonne par le sentiment, ici par le ridicule. Il pensait que le ridicule vient à bout de tout; que le ton de la plaisanterie est, de toutes les clefs de la musique française, celle qui se chante le plus aisément; qu’on doit être sûr du succès quand on se moque gaiement de son prochain. Sa prière à Dieu est originale: «0 Dieu des bons esprits! Dieu des esprits justes, Dieu des esprits aimables, répands ta miséricorde sur tous nos frères, continue à confondre les sots, les hypocrites et les fanatiques! Plus nos frères feront de bons ouvrages, en quelque genre que ce puisse être, plus la gloire de ton saint nom sera étendue. Fais toujours réussir les sages, fais siffler les impertinents.» «Je ne me souviens plus, dit-il quelque part, quel était l’honnête homme qui priait Dieu tous les matins que ses ennemis fissent des sottises.» Il le connaissait pourtant bien.
Il savait la puissance de cette arme du ridicule, il l’avait assez essayée; il la mit au service de ce qui lui semblait être le vrai. Il porta des coups terribles sans doute; mais quand on se bat, il ne faut pas se battre mollement. La modération louable qui dans un duel entre hommes s’arrête au premier sang, n’est pas de mise dans un duel entre doctrines ennemies; des engagements qui se reprennent toujours, qui ne décident jamais rien, sont funestes à la vérité. Platon n’a pas craint de blesser la sophistique, ni Pascal le jésuitisme. Dans de telles luttes, l’ironie tempérée n’est qu’impuissance.
Comme on reconnaît bien, dans Candide, la main qui a fait la Diatribe du docteur Akakia, cette raillerie cruelle qui exila Le Franc de Pompignan dans sa province, empoisonna le reste des jours de Maupertuis, fit huer Fréron par le public de tout un théâtre, et, quoique injuste, peut-être, l’accable encore aujourd’hui. C’est le secret, formidable en France, d’attacher à un système, à un personnage, un mot qui désormais fait corps avec lui. Parle-t-on devant quelqu’un des cantiques sacrés de Le Franc de Pompignan, ah! oui, répond-il aussitôt:
Sacrés ils sont, car personne n’y touche.
Se présente-t-il à la cour, le dauphin lui-même répète le vers:
Et l’ami Pompignan pense être quelque chose.
Les laquais fredonnent le refrain:
Vive le Roi et Simon le Franc,
Son favori.
Si on n’a lu l’Akakia, on ne se fait pas une idée de ce que peut la malice humaine. C’est toujours, il est vrai, le même ridicule qui revient, toujours la malheureuse entreprise de disséquer des cervelles de Patagons pour connaître la nature de l’âme; de creuser un trou jusqu’au centre de la terre pour connaître ce qui s’y passe; la pensée étrange que la mort n’est que la maturité des animaux, et que pour empêcher un homme de mûrir, il faut l’enduire de résine; mais cette même plaisanterie est toujours nouvelle par le lieu où elle est placée, par la fable qui l’introduit. Comme ces motifs de musique, qui reviennent les mêmes par des chutes diverses, elle s’empare de l’oreille et s’imprime dans l’esprit. Dans Candide aussi, ce n’est qu’un mot, qui reparaît à chaque page, à chaque infortune nouvelle: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.» Du roman il a passé dans le monde, dans la conversation, on l’a répété sans en connaître l’origine, il est devenu populaire, et l’optimisme, qui avait tenu contre des arguments énormes, a été tué par ce petit mot.
Est-ce à dire que Voltaire soit pessimiste? Non; il répétait après Leibniz que Dieu a choisi le meilleur monde, c’est-à-dire le plus sage; mais il ne pensait pas pour cela que nous vivons dans l’ordre et le bonheur, «La fin de la vie est triste, le commencement doit être compté pour rien, et le milieu est presque toujours un orage.» La condition de l’homme ici-bas lui paraissait tout simplement passable. En hutte à mille maux, la frivolité, la gaieté, le travail l’empêchent de se pendre. Le secret contre le suicide est d’avoir toujours quelque chose à faire. Creech, commentateur de Lucrèce, mit sur son manuscrit: «N. B. Qu’il faudra que je me pende quand j’aurai fini mon commentaire.» Il se tint parole. S’il avait entrepris un commentaire sur Ovide, il aurait vécu plus longtemps. Grâce à ces remèdes peu héroïques, il est vrai, mais efficaces, Voltaire s’accommode de son sort. Malade toute sa vie, il ne se regarde pas comme la plus heureuse de toutes les créatures, mais il n’y a point de malade plus heureux que lui. Il passe son temps à faire des gambades sur le bord de son tombeau, et c’est, en vérité, ce que font tous les hommes. Il faut jouer avec la vie jusqu’au dernier moment,... c’est un enfant qu’il faut bercer jusqu’à ce qu’il s’endorme.
Pauvre idée, usage médiocre de la vie, assurément; mais il y a dans Voltaire une conception plus haute et plus équitable de notre destinée. Il l’a dit:
Un jour tout sera bien, voilà notre espérance;
Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion.
Et plus loin:
Un calife autrefois, à son heure dernière,
Au Dieu qu’il adorait dit pour toute prière:
Je t’apporte, ô seul roi! seul être illimité !
Tout ce que tu n’as pas dans ton immensité,
Les défauts, les regrets, les maux et l’ignorance,
Mais il pouvait encore ajouter l’espérance.
Par-dessus toutes les fables que nous ont laissées les Grecs, il aimait la fable de Pandore. A cette doctrine consolante répondait une maxime de pratique hardie et salutaire: que tout soit bien ou mal, tâchons que tout soit mieux.
Telle est l’opinion de Voltaire sur le monde. Il croit que cet univers est le meilleur qui pût être; mais, pour être le meilleur de tous, il ne le trouve pas irréprochable, et en exagère les défauts; il ne conçoit pas pourquoi le mal existe, et pense volontiers que Dieu n’a pu mieux faire; il espère que tout sera bien un jour, et voit le progrès s’accomplir sous ses yeux, sans se pénétrer de la beauté de cet ordre qui tire le bien du mal; la vérité est dans sa main, il n’ose la saisir. Le sentiment des problèmes, à ce degré-là, n’est plus une qualité, c’est une maladie: «La sagesse doute où il faut douter, et affirme où il faut affirmer.»
Il n’y a que deux grandes doctrines sur la perfection de ce monde, et il n’est pas si difficile de choisir. Suivant l’une, Dieu conçoit le plan magnifique de l’univers et l’exécute lui-même, il n’appelle l’homme que comme spectateur: vois et admire, garde-toi de critiquer. Ces ombres qui te déplaisent avivent le jour; ce personnage difforme qui te choque fait ressortir la beauté qui t’enchante; chaque couleur, chaque trait est pour l’ensemble: pris à part, il peut être blâmé ; rapporté au tout, il est irréproprochable. Pénétré de cette vérité, contemple ce chef-d’ œuvre en silence, et prends garde d’y rien mettre du tien. Suivant l’autre doctrine, Dieu encore conçoit le plan du monde avec sa sagesse infinie; il achève lui-même l’univers physique, impose à la matière les lois d’où dériveront fatalement tous ses mouvements et leur harmonie; quant au monde des esprits, il lui fixe sa destinée, il veut qu’un jour la vérité et la justice y résident, mais il ne les y place pas lui-même et il donne à l’homme cette mission. Que parle-t-on de Prométhée, qui, dérobant le feu du ciel, encourt la colère de Jupiter et un châtiment terrible! Dieu, quand il nous a formés, a gravé dans notre raison l’idéal d’un monde parfait où règnent sans ennemis la vérité et la justice; il nous a communiqué le plan conçu par sa souveraine sagesse; il a fait plus, il a mis dans notre cœur l’amour de cet idéal, l’enthousiasme de cette perfection, une portion de ce feu divin qui crée, qui anime les formes mortes de l’intelligence. Cette ardeur secrète, sans cesse renaissante, qui nous dévore, est notre gloire, elle n’est point notre châtiment. Poursuivi par le rêve de l’idéal, l’homme s’agite et ne peut goûter le repos; les yeux fixés sur cet exemplaire immortel, il tente de le traduire; mécontent de ses ébauches, il efface, il corrige, souvent, dans son impatience, remplaçant une erreur par une erreur, une injustice par une injustice, qui sera emportée à son tour, quelquefois par une vérité solide, par une pratique équitable qui ne périront point. Ainsi, à travers ces tentatives avortées et reprises, l’œuvre avance, la science s’accroît, les institutions s’améliorent, la cité de Dieu se dessine dans la nuit. Quel spectacle! et qu’il est vraiment divin! Dieu pouvait d’un coup achever le monde, il ne l’a pas voulu; il s’est adjoint l’homme, et c’est une créature ignorante et vicieuse qui enfante la vérité et la justice. Nous ne sommes donc pas à Dieu des rivaux mais des associés, car il est exempt d’envie. Le père qui a fo mé l’âme de son fils, lorsque ce fils fait une belle action, n’en est point jaloux. Qui pourrait à ce moment lire dans son cœur, y verrait le contentement sévère de la sagesse qui a porté ses fruits et la douceur de la tendresse paternelle avec ses ineffables complaisances. Or qu’est-ce que Dieu, sinon un père, sans nos aveuglements et nos lâchetés.
Cette doctrine est-elle donc si abstraite, si compliquée, qu’elle doive effaroucher une raison amie de la clarté et de la simplicité ? Non sans doute; mais encore faut-il oser croire ce que l’œil ne voit pas, ce que la main ne touche pas. Voltaire croit à Dieu, à la liberté, à la vertu; c’est fort bien, ce n’est pas assez. Où tend ce travail si dur de l’homme sur lui-même? Dans quel but tant de fatigues, de privations, de sacrifices? Si tout finit avec le corps, qu’importe que je tombe un peu plus ou un peu moins parfait dans le néant? Quoi! Dieu nous donne une part de sa raison et de sa liberté, il fait briller devant nous l’idéal éclatant de la vertu, il descend lui-même dans la conscience avec ses douceurs et ses terreurs; et nous n’avons que quelques pas à faire entre deux abîmes! quelle contradiction! et quel danger encore pour la société, si les méchants ont l’impunité assurée! Voltaire le sentait bien, il comprenait que la destinée humaine est incomplète ici-bas, et qu’elle se dénoue dans l’invisible; mais pour la suivre jusque-là il fallait consentir à perdre terre, et son esprit n’avait pas ce courage. Il accable la Sorbonne qui damne Trajan et Marc-Aurèle; mais lui, que fait-il de ces âmes généreuses? il veut des peines pour les méchants et sauverait l’enfer pour y loger Fréron, mais il n’ouvre pas le ciel aux héros; il ressent une profonde aversion pour le dogme de la vie future, telle que le catholicisme l’entend: sa raison rejette ces récits intrépides d’un monde d’où personne n’est revenu, et sa compassion s’émeut pour des misères innombrables et infinies; devant un tel monde il goûte le néant, mais le néant à son tour le repousse, et il reste suspendu dans le vide, trop craintif pour se faire une doctrine suivant ses instincts, et garder la vie future en la consolant. Et pourtant, si l’on veut juger de l’excellence ou des défauts de la création, c’est de là, c’est de cette région invisible qu’il faut l’observer. Attaché au globe, on est emporté par son mouvement, on ne voit que le commencement et le milieu des choses, sans la fin qui les achève, et l’on s’agite tristement, comme Voltaire, dans un monde mutilé.